Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Le GRAND PAPE, le GRAND MONARQUE et HENRI V de la CROIX, le NOUVEAU ROI de FRANCE :: DICTATURE DU RELATIVISME
Page 1 sur 1
 Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
Nihil obstat. A. VILLIEN, censor dep. Die 15 nov. 1935.
IMPRIMATUR : Parisiis, die 18° nov, 1935. V. DUPIN, v. g.
A Monsieur le Chanoine Sauvêtre
Cher Monsieur le Chanoine,
Vous finissez votre livre par le récit des funérailles de Mgr Jouin et son ensevelissement dans le caveau de famille du cimetière Montparnasse, auprès de sa mère et de ses deux frères qu'il avait tant aimés. Vous ajoutez ces lignes :
«C'est là qu'il dort son dernier sommeil.
«Mais la pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin, n’étouffe pas sa voix et ne paralyse pas son activité. Il parle encore et se survit dans les œuvres qu'il a créées. Les vingt prêtres qu'il a don-nés à l'Église, les œuvres de jeunesse qu'il a fondées, les soixante-dix servantes des pauvres qu'il a introduites à Pa-ris et, surtout, la Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer l'action bienfaisante du grand serviteur de l’Église que fut Mgr Ernest Jouin».
Tous ses amis ont espéré en effet qu'après la mort sa grande voix nous parlerait encore. Ils attendaient qu'une plume autorisée se chargeât de nous raconter cette vie si variée et si bien remplie.
Mgr Jouin est assez mal connu. Comme de tous ceux qui ont été mêlés à des polémiques retentissantes, on n'a rete-nu de sa vie quelques événements plus bruyants. Le reste est enseveli dans l'oubli. Notre manie de simplification se con-tente pour chaque homme, comme pour chaque objet d'une seule étiquette. Il importe donc que des témoins bien infor-més prennent la parole devant les contemporains distraits ou prévenus, et leur disent la vérité, toute la vérité.
Vous êtes ce témoin bienveillant, mais éclairé, impartial et, comme on dit aujourd'hui, bien documenté, que tous les amis de Mgr Jouin avaient désigné, au lendemain de sa mort, comme le plus capable d'écrire sa vie.
Vous n'avez pas besoin d'être recommandé aux lecteurs. Votre livre se recommandera de lui-même. Le nom de Mgr Jouin est resté cher à la mémoire de beaucoup de prêtres et de laïques à Paris, à Angers, et dans bien des villes où il a passé. Ses adversaires eux-mêmes voudront savoir ce qu'était au fond ce polémiste redoutable qu'ils se peignaient sous des traits durs et déplaisants. Combien eux, et bien d'autres avec eux, s'étonneront de voir que vous le présentez comme un mystique, et croiront à une illusion d'ami. Mais ceux, ils étaient peu nombreux, qui ont pu pénétrer dans son intimité, souscriront à votre jugement. Oui, c'était un mystique qui, avant tout et en tout, cherchait Dieu. Le mot de Jeanne d'Arc qui l'avait tellement frappé «Dieu premier servi» était aussi sa devise. A travers toutes les péripéties d'une vie longue et très accidentée, il a vécu en ascète, prêt à tout sacrifier à son Dieu et à sa foi. Il serait mort martyr avec la foi d'un saint Ignace d'Antioche, et l'on peut dire que, si cette glorieuse épreuve lui a été épargnée, Dieu lui a réservé de lui rendre té-moignage, dans une maladie très longue et infiniment douloureuse, par son courage, sa résignation, sa patience.
Pour vous qui avez été un disciple, longtemps avant d'être pour lui un ami et un confident, vous avez eu l'avantage, l'ayant si bien connu, d'avoir eu à votre disposition des lettres et des papiers de famille. Vous avez travaillé avec achar-nement, malgré les épreuves d'une santé chancelante, et vous nous avez donné un récit à la fois très documenté, très impartial, très attachant et instructif.
Je vous en remercie au nom de tous ses amis, je puis dire au nom de tous vos lecteurs, et reste votre bien fidèlement dévoué in Xo.
† fr. Fernand Cabrol, abbé de Farnborough.
AVANT-PROPOS
Si, pour raconter une vie qu'on a partagée, il suffisait d'évoquer ses souvenirs et de laisser parler son cœur, ce livre serait sans défaut. N'est-il pas d'abord un hommage de piété filiale à une mémoire vénérée ?
Mais si, en l'écrivant, nous obéissions au sentiment d'une âme pleine de reconnaissance, nous cédions aussi à d'ho-norables et pressantes sollicitations : «Vous êtes qualifié entre tous, pour écrire la vie de Mgr Jouin, voulait bien écrire à l'auteur le distingué prélat qui avait présidé à l'installation du Curé de Saint-Augustin, et vous l'écrirez con amore».
De son côté, l'Abbé de Farnborough, Dom Cabrol, qui honorait Mgr Jouin d'une amitié de longue date, nous témoi-gnait naguère sa satisfaction de nous voir reprendre, après deux ans, notre travail : «Je déplorais, nous écrivait-il, qu'un homme aussi éminent tombât dans l'oubli, alors que tant de personnages de seconde zone sont célébrés par les mille voix de la renommée».
En ce siècle d'agitation fébrile, l'oubli ensevelit bien vite les mémoires les plus dignes de survivre. «Parmi les expé-riences que j'ai faites de la légèreté humaine, constatait, après beaucoup d'autres, Guizot, l'une des plus pénibles a été de voir avec quelle rapidité les souvenirs s'effacent et le peu de traces qui restent au bout de peu de temps des meil-leures vies et des plus douces».
Celle que nous racontons, toute de bienfaisante activité, doit échapper à cette loi de la fragilité humaine. Il convient aussi qu'elle soit vengée des calomnies et des basses injures dont elle fut l'objet.
Mgr Jouin était à peine descendu dans la tombe qu'une haine, accumulée depuis vingt ans, se déchaînait sur son œuvre et sur sa personne. De son vivant, elle n'avait osé paraître ; lui mort, elle crut pouvoir l'attaquer sans danger et le jeter à bas du piédestal où l'avaient élevé ses talents, ses mérites, l'abnégation et l'héroïsme d'une existence consumée au service de l'Église et des âmes. La tentative a échoué.
Surpris d'abord, les continuateurs de son œuvre ne tardèrent pas à faire paraître une «Réponse à l'odieuse cam-pagne», en signalant les insuffisances, les réticences, les contradictions de l'agresseur et, à la fin, sa fuite honteuse et en démontrant comment, pour les besoins de sa mauvaise cause, il avait affirmé sans preuve, et faussé les documents en regroupant ou disjoignant les textes - en séparant les textes - en forgeant de toutes pièces d'autres textes, enfin, en faus-sant les dates.
On ne tardait pas à apprendre que l'auteur de ces mensonges qui avait prudemment dissimulé son vrai nom, n'était autre que M. Flavien Brenier, le même qui, vingt ans auparavant, avait fait échouer le projet de fédération des Ligues An-ti-Maçonniques du Curé de Saint-Augustin, le même dont celui-ci avait alors stigmatisé les louches manœuvres. La Franc-Maçonnerie, que M. Brenier avait si bien servie à cette époque, se servait de nouveau de lui pour sa vilaine be-sogne. Ainsi pensait-elle faire payer au Fondateur de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes ses longues et vi-goureuses attaques contre la Judéo-Maçonnerie ; détruire son œuvre, sa Ligue, et sa Revue, en salissant la mémoire de son fondateur ; intimider enfin ses successeurs et tous ceux qui seraient tentés de s'attaquer aux sectes maçonniques.
Trois ans ont passé, et le temps, en s'écoulant, n'a fait que mettre davantage en lumière et dans un relief plus saisis-sant la figure de Mgr. Jouin. Les événements qui se déroulent sous nos yeux depuis sa disparition, loin d'apporter un démenti à ses affirmations, leur fournissent une éclatante confirmation. Depuis les scandales judéo-maçonniques qui ont marqué le début de l’année 1933, chaque jour allonge la liste des méfaits de la Secte et signale son emprise sur la France et sur le monde ; et la presse, muette jusqu'ici ne peut plus les dissimuler.
Ceux qui affectaient de nier l'existence ou la malfaisance de la Maçonnerie, peut-être pour se dispenser de la com-battre, et ceux qui, désespérant du succès, déposaient les armes devant elle, constatent, non sans surprise, le réveil de nations jusqu'ici soumises à son empire. Après l'Italie et l'Allemagne, voici la Turquie qui dissout toutes les associations maçonniques, confisque leurs biens et ferme toutes les Loges ; voici le Portugal qui supprime, lui aussi, la Maçonnerie sur tout son territoire et - fait digne de remarque et capable d'enflammer le zèle des successeurs de Mgr Jouin - c'est en s'appuyant, pour une bonne part, sur la documentation de sa Revue que le rapport des Corporations portugaises a obte-nu le vote de la loi.
Autre symptôme consolant : en trois ans, le nombre des abonnés à la Revue et des adhérents à la Ligue Franc-Catholique a doublé.
D'ailleurs, si la lutte contre la Judéo-Maçonnerie rencontrait en France des incrédules ou même des adversaires, il n'en était pas de même à l'étranger. N'est-il pas remarquable que le premier souscripteur à la Vie de Mgr Jouin fut un pasteur protestant suisse ?
Les contradictions ne paraissaient guère émouvoir Mgr Jouin. II avait, pour l'encourager, la certitude de ses convic-tions, fruit de ses recherches, et l'approbation de Rome. Les éminents cardinaux Gasparri, Gasquet, Granito di Belmonte lui écrivaient pour reconnaître la justesse de ses vues et l’utilité de son œuvre, et deux papes - Benoît XV et Pie XI - en le faisant prélat puis Protonotaire, lui adressèrent des brefs particulièrement élogieux.
Nous ne pouvions donc pas, dans cette Vie, ne pas signaler le beau spectacle de ce prêtre se faisant - à l'âge où la plupart déposent les armes et n'aspirent qu'au repos - le chef et comme le «Pierre l'Ermite» d'une suprême croisade contre les sectes pour le salut de son pays et de l'Église.
Mais s'il fallait mettre en relief le tempérament de ce lutteur, calme et fort, il ne convenait pas non plus de laisser dans l'ombre les soixante années d'un ministère aussi varié que fécond. On aimera, dans ce livre, trouver l'homme qu'était Mgr Jouin et dont on aurait pu dire, comme de saint Paul, «qu'il avait l'œil et le geste du chef, le don de voir la chose à faire, de convaincre les autres qu'elle devait, qu'elle pouvait être faite», et qui la faisait le premier - l'homme d'œuvres qui fonde des patronages et introduit à Paris les Servantes des Pauvres - le catéchiste incomparable, l'orateur de marque, le poète gracieux, l'auteur applaudi de La Nativité et de tant d'autres drames sacrés et patriotiques - le recruteur du clergé - l'apôtre en un mot demeuré moine par le détachement absolu et dont Mgr Le Roy, son voisin à Saint-Médard, écrivait
«J'ai toujours été édifié de sa foi profonde, de son amour pour l'intégrité de la doctrine, de son zèle pastoral, de ses initiatives et de son activité».
«C'est ce zèle pour la vérité et pour le bien qui, plus tard, l'engagea dans sa campagne anti-maçonnique, en dépit des contradictions qui ne devaient pas lui manquer».
Au moment où la tempête faisait rage et menaçait d'engloutir son bateau, le pilote pressait de questions le prophète qu'il portait : «Qui es-tu ? - Quelle est ta profession ? - D'où viens-tu ? - Où vas-tu ?» A toutes ces questions, Jonas ne fit qu'une réponse : «Je suis le Serviteur de Dieu». Mgr Jouin n'ambitionnait pas d'autre titre.
C'est pour servir Dieu qu'à dix-sept ans il entre au couvent et revêt la robe dominicaine ; c'est pour le servir que, dans sa jeunesse sacerdotale il rêve de beaux ouvrages. Quand, vicaire, il fonde des œuvres de jeunesse ou compose ses drames sacrés, c'est Dieu qu'il veut servir ; et quand, à cinquante ans il entreprend d'étudier les règles de l'harmonie, et, à soixante, celles de la langue hébraïque, c'était toujours pour le service et la gloire de Dieu. En entreprenant, presque septuagénaire, et en poursuivant pendant vingt ans, sa lutte contre les Sectes, il n'avait d'autre pensée que le service de Dieu, et la défense de l'Église.
Que Mgr Jouin se soit parfois trompé, sur les hommes et sur les choses, qui pourrait s'en étonner ? Il était homme, donc faillible.
Polémiste ardent et sincère, apparenté par son tempérament aux Louis Veuillot et aux Freppel, il a pu, croyant frapper sur l'ennemi, atteindre des hommes qui, par des méthodes différentes, sous d'autres étiquettes, poursuivaient au fond le même but. Surtout, des collaborateurs, dépassant sa pensée, ont pu voir des ennemis là où il n'y en avait pas. Quand on le lui démontra, il n'hésita pas à s'en séparer.
Ennemi des concessions, plus soldat que diplomate, il attaquait les idées qu'il croyait fausses ou dangereuses, mais sans haine ni mauvaise foi, jamais les personnes ; fidèle à la vieille devise : in certis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
Que tous ceux qui, par leurs conseils ou par les documents qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition, ont aidé l'auteur dans son travail, reçoivent ici l'expression de sa très vive reconnaissance. Il remercie très particulièrement M. le Chanoine Villien, Doyen de la Faculté Canonique, M. le chanoine Duplessy, M. le chanoine Viteau, professeur à l'Institut catholique, M. l'abbé Rouault, M. l'abbé Chabot, membre de l'Institut.
Chanoine J. Sauvêtre.
CHAPITRE PREMIER. DU BAPTÊME A L'ORDINATION. (1844-1868)
M. ET MME MARIN JOUIN. - NAISSANCE ET BAPTEME D'ERNEST. - SES DEUX FRERES, AMEDEE ET HENRY. - LE REVE DE MME JOUIN. - LE VIEIL AN-GERS. - MORT DE M. JOUIN. - SOUVENIRS D'ENFANCE. - EVEIL MUSICAL. - PREMIER APPEL DE DIEU. - LE COLLEGE MONGAZON. - L'EXTERNAT SAINT-JULIEN. - LE COLLEGE DE COMBREE. - «JE SERAI DANS BOUILLET !». - PREMIERS ESSAIS LITTERAIRES. - L'OUBLI DE DIEU. - DANS LA CHAMBRE DU PERE PIOU. - LA CONVERSION. - «ENTRE JESUS ET MOI». - ERNEST FAIT VŒU DE CHASTETE ET D'OBEISSANCE. - SA CONSECRATION AU SACRE-CŒUR. - SON ENTREE AU COUVENT DES DOMINICAINS A FLAVIGNY. - LE FRERE MANNES. - IL Y RETROUVE SON FRERE AMEDEE. - LE NOVICIAT SIMPLE. - LE NOVICIAT PROFES A SAINT-MAXIMIN. - MME JOUIN ACCOMPAGNE SES FILS JUSQU'A LA SALETTE. - LA SANTE DU FRERE MANNES L'OBLIGE A RENONCER A LA VIE RELIGIEUSE. - SON ORDINATION A ANGERS.
Ernest Jouin naquit à Angers, 12 rue Saint-Georges, le 21 décembre 1844.
Son père, Amédée Marin Jouin, exerçait depuis douze ans dans la cité angevine sa profession d'ébéniste quand sa femme, Françoise Cousin, originaire comme lui des environs de Château-Gontier, lui donna ce cinquième enfant - le der-nier. L'aîné n'avait vécu que quelques jours. Mais deux fils, et une fille, étaient encore vivants. Celle-ci, âgée de cinq ans, n'allait pas tarder, elle aussi, à s'envoler au ciel. Ernest ne connut donc guère que ses deux frères : Amédée, qui venait d'entrer dans sa onzième année, et Henry, âgé de trois ans, et qu'une infirmité privait de l'usage de ses jambes.
Située au centre d'Angers, tout près de la rue Saint-Laud, la plus commerçante de la ville, dans le voisinage de l'insti-tution Saint-Julien, la rue Saint-Georges offrait à M. et à Mme Jouin toutes les facilités pour l'éducation religieuse de leurs enfants, en même temps qu'elle assurait au jeune artisan une clientèle de choix.
Des souvenirs historiques s'attachaient à ce quartier de la capitale angevine : les vieilles constructions en bois de la place Sainte-Croix - la Maison d'Abraham et la Maison d'Adam - et les enseignes pittoresques des Trois-Connins, de la Barbe, de Bois et des Quatre Fils Aymon, piquaient la curiosité de l'ouvrier qui avait conquis son brevet de maîtrise au cours de son tour de France et ne manquait ni de goût, ni de culture artistique.
Tout différents étaient les sentiments qu'éveillait dans l'âme ardente, de Madame Jouin le voisinage de la Place du Ralliement. Là, aux jours de la Terreur, avait coulé le sang des martyrs ; là, un prêtre angevin, Noël Pinot, curé du Lo-roux-Béconnais, avait gravi l'échafaud, vêtu de l'aube et de la chasuble, comme pour un suprême sacrifice... Et ce sou-venir faisait tressaillir douloureusement le cœur de la vaillante chrétienne.
Le surlendemain de sa naissance - quatrième dimanche de l'Avent - Ernest fut porté à l'église cathédrale Saint- Mau-rice pour y être baptisé. On lui avait donné pour parrain son frère aîné et pour marraine une jeune cousine de la Mayenne, Zoé Vannier. De sa chambre, Madame Jouin suivait par la pensée le petit groupe de parents et d'amis condui-sant son fijs à l'église et, de toute son âme, priait pour son avenir religieux. Et maintenant que les cloches, appelant les fidèles à l'office des Vêpres, lui annonçaient que le mystère de régénération était accompli, que le fils de sa chair était devenu l'enfant de Dieu, elle faisait pour lui et pour ses frères des rêves de bonheur.
Le rêve d'une mère sur le berceau de son enfant est immense comme son amour. La femme qui osait solliciter de Jé-sus les premières places dans Son royaume pour les deux fils qu'elle lui avait donnés, ne se croyait pas ambitieuse ; mais quand Jésus lui eut découvert le mystère de la Passion et le calice auquel il fallait boire avant de régner avec Lui, elle s'inclina généreuse et soumise devant la volonté divine.
Madame Jouin demandait-elle à Dieu pour ses fils une place de choix ? On peut le supposer, puisqu'elle était mère. Mais en même temps - et de ceci nous ne pouvons douter - elle ambitionnait pour eux la gloire du sacerdoce. Et si, au milieu de sa prière et de son rêve, l'image de Noël Pinot, le curé martyr, surgit soudain devant ses yeux, elle ne les dé-tourna point avec effroi. Sa foi le lui révélait : quand le Christ appelle une âme d'élite à Le suivre dans la voie de l'aposto-lat et lui révèle les sacrifices qui l'attendent, ce n'est qu'après avoir trempé, le premier, ses lèvres au calice d'amertume et versé dans le cœur de la mère, à laquelle il demande l'immolation de son fils, la force et la grâce qui soutenaient Marie au pied de la croix... Aussi, lorsqu'au retour de l'église, on présenta à Madame Jouin son fils à baiser, quelle eût été sa joie, si son regard, perçant l'avenir, eût entrevu son petit Ernest, revêtu du sacerdoce, vicaire dans l'église de son bap-tême, puis curé d'une importante paroisse de Paris, où il mourrait presque nonagénaire, après avoir donné l'exemple des plus hautes vertus et le spectacle d'une activité d'autant plus étonnante qu'elle n'aurait pour soutien qu'un organisme des plus fragiles et longtemps menacé I
Le rêve de Madame Jouin devait se réaliser dans sa plénitude : de ses trois fils, l'aîné, après un détour dans le siècle, devint dans le cloître un saint et ardent religieux, prédicateur de grand talent, plusieurs fois prieur de son Ordre - le plus jeune fut un prêtre admirable de zèle et de charité - et le cadet, que son infirmité retint dans le monde, y mena la vie d'un chrétien exemplaire, laissant à ses enfants les leçons d'une vie sans reproche et à la postérité la réputation d'un écrivain de haute valeur.
- «Tous nos enfants feront leurs études», avait déclaré M. Jouin. Peut-être regrettait-il d'avoir jadis négligé les conseils d'un oncle notaire et préféré le travail manuel à l'étude du droit... Quand Amédée eut atteint sa douzième année, il l'en-voya donc à l'Institution libre de Combrée. II se disposait à faire de même pour Henry et Ernest, quand un mal mystérieux le terrassa lui-même en pleine force et, en quelques jours, l'enleva à l'affection des siens.
«Ce fut pour ma mère, écrira l'abbé Jouin, un coup terrible qui brisait une union de dix-sept ans. Elle demeura plusieurs jours dans une morne prostration, ramassée sur elle-même, presque sans mouvement. Mais elle se ressai-sit bien vite et, sans oublier le passé, elle prit conscience de la tâche imposée par l'éducation de trois fils dont l'aîné avait quatorze ans et le plus jeune quatre seulement. Depuis lors, on ne l'a jamais vue faiblir».
Les économies du foyer ne devaient pas tarder à s'épuiser ; la gêne allait venir et avec elle les privations. Résolue à les supporter vaillamment, elle voulut du moins les épargner à ses enfants. Longtemps après, évoquant le souvenir de cette épreuve et parlant des difficultés matérielles, dont il avait été, avec ses frères, la cause involontaire, le Curé de Saint-Augustin dira : «Je me rappelle qu'un jour, j'avais une dizaine d'années, ma mère me servit un plat fortifiant, tandis qu'elle ne prenait qu'un peu de pain sec et de fromage plus sec encore ; je lui en fis la remarque : «La vie est dure, me répondit-elle, il faut que j'épargne». Que de fois ce souvenir m'a pris au cœur comme un remords !»
Respectueuse des volontés de son mari, Madame Jouin mit donc, quand il en eut l'âge, Henry au collège Mongazon, aux portes d'Angers.
Quant à Ernest, peu de temps après sa naissance, on l'avait confié aux soins de sa grand'mère à Bierné, dans la Mayenne, et, plus tard, à ceux de sa tante et de sa marraine, à Ménil. C'est là que, loin de la ville, s'écoula sa première enfance ; là, sans doute, qu'il puisa son amour des champs, son goût pour le travail, sa prédilection pour les presbytères de campagne, et sa familiarité bienveillante pour les humbles, les ouvriers, les paysans.
Nous permettra-t-on de rapporter ici quelques épisodes de ces premières années ? Nous les empruntons à une Vie d'Henry Jouin que la guerre et des travaux plus impérieux empêchèrent le Curé de Saint-Augustin de mener à terme.
«A Ménil, le théâtre de mes exploits journaliers était un grand jardin en terrasse dominant la Mayenne. Lorsque je l'avais longuement arpenté en tous sens à la poursuite de quelque papillon plus capricieux et plus volage encore que mes rêves d'enfant, je m'empressais d'orner de fleurs et de guirlandes un petit autel dressé dans le creux du mur et dédié à la Madone. Le vicaire rendait visite chaque semaine aux deux dames du logis, pour apprendre aux chan-teuses le cantique du dimanche suivant. Je faisais partie de cette modeste chorale et l’on vantait ma voix, dans le but sans doute de plaire à ma marraine qui me gâtait beaucoup. Tous ces airs éveillèrent en moi un sentiment musical insoupçonné, et je me prenais, lorsque j'étais seul, à improviser des chants qui devaient être en mineur, car ils me faisaient infailliblement pleurer».
Vers sept ans, de retour rue Saint-Georges, il y retrouva Henry et pendant quatre années, partagea son existence au foyer maternel. Un dimanche, ils avaient descendu la rue Val-de-Maine, traversé la rivière et ne s'étaient arrêtés que très loin, dans un chemin creux, sur les marches d'une porte condamnée de la chapelle du Bon-Pasteur. Ils se reposaient, tandis que dans la chapelle on entendait psalmodier l'office : «Écoute !» dit tout à coup Henry. Des voix d'enfants ve-naient d'entonner, avec les Alléluia de Pâques, le répons des Complies : In manus tuas, Domine... Entre Vos mains, Sei-gneur, je remets mon âme... «Il me semble, racontait-il, plus tard, que ce fut pour nous deux la première révélation de l'harmonie. L'émotion que je ressentis m'est encore sensible aujourd'hui...» - «J'étais fait pour la musique», dira-t-il en-core. Elle sera en effet pour l'artiste qu'il devait être la source de très nobles jouissances, en même temps qu'un moyen dont le prêtre saura se servir pour gagner à Dieu des âmes d'artistes.
Mais sa véritable vocation était de nature plus élevée. - «Qui sait, dit-il, en racontant l'événement de la chapelle du Bon-Pasteur, si ce n'était pas le premier appel de Dieu à mon âme» ? Tout petit, il avait déclaré vouloir être prêtre et, pour le devenir, s'imposait déjà d'héroïques sacrifices. Un jour qu'il avait refusé de manger des poireaux pour lesquels il avait de la répugnance : «S'il en est ainsi, lui dit sa mère, tu ne pourras jamais être curé, car tous les curés en mangent». - «Alors, je veux bien». Depuis ce jour, l'enfant ne refusa plus l'aliment qui lui inspirait du dégoût.
Ces premiers germes de vocation trouvaient pour se développer un milieu favorable au Collège Mongazon où il était venu rejoindre Henry. C'était l'époque de sa première communion qu'il fit à la fin de sa septième, sous la direction de M. l'abbé Chupin.
Sa santé «ne pouvant s'accommoder du lever matinal et du régime un peu Spartiate» du collège, il le quitta, à la fin de sa cinquième, pour suivre, comme externe, les cours du pensionnat Saint-Julien, à Angers. Mais, à partir de la troisième, les élèves étaient conduits au Lycée : sa mère, soucieuse avant tout de sa formation chrétienne, l'envoya terminer ses études à Combrée, où le souvenir de son frère aîné était encore vivant. C'est là que Dieu l'attendait.
* * *
Lorsqu'à la fin de septembre 1858, Ernest fit son entrée, comme élève de troisième, au collège fondé par M. l'abbé Drouet aux environs de Segré, le souvenir des fêtes qui avaient marqué la consécration de la nouvelle chapelle, n'était pas encore éteint. On revoyait encore autour de Mgr Angebault, évêque d'Angers, les quatre évêques et les cinq-cents prêtres ou religieux qui l'accompagnaient. Deux mois auparavant, conduits par le comte de Falloux, Montalembert et le R.P. Lacordaire avaient rendu visite au nouveau collège : maîtres et élèves redisaient, non sans fierté, les paroles élo-quentes tombées des lèvres de ces deux paladins de la liberté de l'Enseignement.
Que furent les études du nouveau Combréen ? Cinquante ans plus tard, au centenaire du Collège, parlant aux élèves, le Curé de Saint-Augustin s'accusait de n'avoir pas suivi les exemples de son frère Amédée et d'avoir, comme son frère Henry, «fait plus d'une fois l'école buissonnière dans des auteurs ne figurant pas au programme scolaire et d'avoir trop négligé l'étude des langues grecque et latine». Charitablement, il excusait son frère.
«Mon frère Henry avait au reste une excuse : son infirmité. Aussi préférait-il orner et détendre son esprit dans la lecture d'œuvres modernes, et dans des essais personnels de productions littéraires. Dès la seconde, il préludait à ses publications en s'imprégnant du Dictionnaire de Bouillet dont il me parlait avec admiration, si bien que ma mère m'ayant reproché mon peu d'ardeur à l'étude, je lui répondis consciencieusement : «A quoi bon ? Henry m'a dit que plus tard il serait dans Bouillet et qu'il m'y ferait mettre». La certitude de figurer dans Bouillet m'apparaissait comme la réalisation des rêves d'un intellectuel et, ce qui ne laissait pas de flatter ma paresse, comme la dispense plénière de tout travail de l'esprit».
Disons, à sa décharge, qu'en cinquième, déjà ! il avait fait un essai de composition littéraire : «Une pièce, dit-il, qu'on devait jouer et qui ne fut pas représentée, parce que, pour la composer, je m'étais servi sans scrupule d'Octave Feuillet». En troisième, à Combrée, les élèves faisaient paraître un journal. Ernest y écrivit le premier chapitre d'un roman.
«Mais le haro des Animaux malades de la peste ne fut rien, raconte-t-il, en comparaison des avanies que j'eus à subir. On ne me reprochait pas mon unique chapitre, presque personne ne l'avait lu ; on ne discutait pas le plan de l'ouvrage, je n'en avais pas. On criait contre le titre : Fuirel !... Que voulez-vous, je m'étais épris des rimes en el ; et ce nom est bien à moi, je ne l'ai pas volé et nul ne me l'a pris».
Disons encore qu'il fut choisi pour adresser le compliment à M. Adolphe Levoyer, son professeur d'Histoire, le jour de sa fête : «Je lui parlai, dit-il modestement, de la philosophie de l'Histoire avec autant d'aise que d'incompétence».
A dire vrai, celui qui, à cinquante ans de distance, s'accusait de paresse au collège avait été un laborieux. Il travaillait, mais à sa façon, d'une façon indépendante, comme était sa nature. Et puis n'avait-il pas lui aussi une excuse dans la ma-ladie qui l'obligeait à de longs et fréquents séjours à l'infirmerie ? De retour en classe, il ne pouvait plus regagner l'avance prise par ses camarades. D'ailleurs, si son nom ne figure pas sur les palmarès de son temps, comme celui de son brillant condisciple, Mauvif de Montergon, il ne tardera pas à combler les lacunes de ses études grammaticales et linguistiques et à se placer au premier rang des travailleurs de l'esprit.
On serait curieux de connaître dans quels auteurs il aimait à s'évader. Est-ce Octave Feuillet, à l'égard duquel il vient de s'accuser de plagiat ? ou Victor Hugo pour qui il eut longtemps de la sympathie et qui venait de publier les Châtiments et les Contemplations ?... Le moindre danger de ces lectures, faites sans contrôle, est la dissipation de l'esprit. Il en est un autre. Au cours de ses vacances qu'il passait avec son frère chez une tante à Bierné, il fit des lectures moins inno-centes : «Un livre peut décider de la vie d'un enfant», dit Paul Gerfaut. Il y avait là, nous dit-il, «un octogénaire voltairien de mœurs plus encore que de conviction, qui nous initia à la littérature légère du dix-huitième siècle, et je lui en ai long-temps voulu». Tardifs regrets. Que n'avait-il suivi les conseils de son poète favori à la jeune ouvrière dans sa mansarde ! Prends garde, lui dit-il ; Voltaire est là,
Ce singe de génie,
Chez l'homme en mission par le diable envoyé.
Hélas ! si ta main chaste ouvrait ce livre infâme,
Tu sentirais soudain Dieu mourir dans ton âme !
Ce soir, tu pencherais ton front triste et boudeur,
Et demain, tu rirais de la sainte pudeur !
Jusqu'à quelle profondeur le mal pénétra-t-il dans le cœur d'Ernest ? «S'il ne sentit pas Dieu mourir dans son âme», du moins sa piété première disparut. L'appel d'en-haut cessa de retentir à son oreille, ses aspirations vers le sacerdoce fi-rent place à des projets plus terrestres, et les impressions ressenties au chant de l’In manus tuas, à la porte de la petite chapelle, ne tardèrent pas à s'évanouir. Il en fait l'aveu : «Aucun de nous, ses deux frères et lui, ne songeait plus, à mettre Dieu dans sa vie et nos trois âmes s'orientaient vers un monde de rêves dorés par l'éveil des passions».
Henry approchait de sa vingtième année ; il était à Paris, à la recherche d'une situation. Quant à Amédée, sa mère, inquiète de ses tendances mondaines, soucieuse de soustraire les deux plus jeunes à des exemples qu'elle estimait dangereux, venait de lui refuser l'entrée de la maison paternelle. Depuis six mois, il errait en Allemagne. Quant à Ernest, nous trouvons encore cette confidence dans le discours du centenaire de Combrée : «Après ma famille, après ma mère, c'est à Combrée que je dois tout : au Père Piou, le saint, ma vocation ; à M. Suppiot, mon professeur de troisième, de se-conde et de rhétorique, le premier éveil de l'esprit, avec de telles envolées qu'elles m'ont gardé jusqu'à ce jour l'enthou-siasme de mes quinze ans ; au vénéré M. Claude, mon professeur de philosophie, un grain de bon sens, suffisant pour ne pas être présomptueux, assez tempéré pour ne pas être prudent jusqu'à la peur».
A Combrée, l'aumônier était celui que l'on n'appelait pas autrement que le Père Piou. Par ce nom familier, les élèves voulaient exprimer tout ce qu'ils ressentaient de tendresse, de respect et de confiance pour le vénérable prêtre qui se dé-vouait à leurs âmes. «Il était impossible de le voir passer dans nos rangs, les yeux à demi-fermés, avec sa belle cou-ronne de cheveux blancs, son bon sourire, son air d'exquise bonté et de sainteté répandu en tous ses traits, sans avoir le désir de devenir meilleur. Il était le confident de nos peines, de nos joies, de nos fautes d'écoliers : Sa chambre était la nôtre». Tel est le témoignage que lui rendait naguère un de ses disciples, M. le chanoine Brossard.
Cette chambre du Père Piou, Ernest la connaissait bien.
«Un soir, raconte-t-il, nous regardions, M. Piou et moi, Un album des divinités de l'Inde. Peu à peu, je le sentais s'animer. Il parlait d'apostolat et, de son regard perdu dans l'espace, il semblait embrasser ces populations im-menses. Il se taisait, puis tout à coup me fixant :
- Il faudrait des ouvriers, des apôtres.
- Mais n'y a-t-il pas aussi du bien à faire en France ?
- C'est vrai. Mais, ici, Notre-Seigneur est connu ; là-bas, il est ignoré. Ici, tout est joie ; là-bas, tout est sacrifice... Impatient enfin de formuler d'un mot ce qui fut la passion de sa vie :
- Ici, c'est une mort vulgaire ; là-bas, c'est le martyre !»
La semence tombait dans une terre généreuse. Pour lever et fructifier, il ne lui fallait qu'un chaud rayon d'en haut, une de ces grâces de choix, comme celle qu'obtinrent du Ciel les larmes de Monique. Cette grâce, Dieu la répandit abon-damment dans l'âme d'Ernest, au cours de la retraite, à la fin de sa rhétorique.
Ouvrons avec précaution les feuillets sur lesquels le retraitant de 1861, d'une écriture ferme, consigna ses pensées et ses résolutions. Complétés par les notes de l'année suivante, ils nous livrent le secret de la transformation qui s'accomplit en lui. Ces notes portent un titre : Entre Jésus et moi. Elles ont une allure de contrat solennel, daté et signé :
«Aujourd'hui, 28 juillet 1861, moi, Jouin Ernest, âgé de seize ans, je me suis consacré au Cœur de Jésus. C'est-à-dire que j'ai pris l'engagement de me conformer, autant qu'il est possible, à ce cœur doux et humble...
De plus, aujourd'hui, j'ai fait à Jésus vœu de chasteté.
J'ai agi ainsi pour plaire à Dieu en répondant aux grâces, qu'Il m'a faites depuis ma naissance, et principalement en cette année, et afin que Dieu augmente en moi la sainte vocation qu'Il m'a donnée.
En troisième lieu, j'ai promis au Cœur de Jésus de dire tous les jours : 1) mon acte de consécration, 2) les litanies de ce Sacré-Cœur.
Tout ceci a été fait et traité entre Jésus et moi le 28 juillet 1861».
Jouin Ernest.
Quatre mois plus tard, il ajoute :
«Afin de me préparer à la vie sainte et pure à laquelle Dieu m'a destiné, aujourd'hui, 21 novembre, jour de la Pré-sentation de la Sainte Vierge, je me suis consacré entièrement à Dieu sous la protection de Marie.
J'ai agi ainsi parce qu'ayant beaucoup reçu, il est juste que je donne tout à Dieu, parce qu'en donnant tout, je suis sur de recevoir cent fois plus et d'obtenir enfin cette force qui me fera vaincre l'orgueil, le démon de la chair, l'atta-chement aux choses d'ici-bas, cette force qui doit me rendre saint.
Je me consacre donc entièrement à Dieu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai Lui appartient, que je ne dois rechercher que Lui et faire toujours Sa sainte volonté : et afin d'y arriver, je ferai bien, avant toute action, de l'offrir à Dieu en Lui demandant ce qu'Il attend de moi, et de dire tous les matins : Mon Dieu, souvenez-Vous que je Vous appartiens en-tièrement.
Tout pour Dieu, tout par Dieu, tout avec Dieu».
8 décembre 1861
«Partant de ce principe qu'il me faut être saint, je raisonne ainsi : Être saint, c'est toujours faire la volonté de Dieu...
Vu mon extrême faiblesse, il faut, pour ainsi dire, me forcer à obéir à Dieu. Je m'y forcerai en faisant le vœu d'obéissance qui consiste à observer la règle qui m'est prescrite par mes Supérieurs, parce que cette règle est l'ex-pression de la volonté de Dieu...
Ce vœu m'astreint aux engagements les plus difficiles, je le sais, mais il faut de la générosité envers Dieu, si l'on veut qu'Il nous soutienne. Au reste, je n'agis, il me semble, que d'après Sa propre inspiration».
Le retraitant précise alors les moyens qu'il emploiera pour tenir ses engagements : la vigilance et la prière ; vigilance qui le maintiendra dans le recueillement et en la présence de Dieu - la prière, c'est-à-dire l'usage fréquent de l'oraison et des Sacrements.
Dans ces notes et dans le Règlement qui les suit, apparaît déjà la nature mystique et généreuse d'Ernest Jouin. C'est au Cœur de Jésus qu'il va puiser la tendre piété qui éclate dans ces lignes. «Cœur de Jésus, ne souffrez pas que je sois jamais séparé de Vous !» C'est l'invocation qui leur sert d'introduction.
C'est à ce Cœur qu'il se consacre. Ce Cœur, il lui semble l'entendre : «Voilà, dit-il, ô mon Jésus, ce que Vous m'avez dicté. Vous seul étiez capable de me l'inspirer ; Vous seul êtes capable de me faire tenir mes engagements. Je n'ai pas de force, voilà pourquoi je me donne à Vous ; j'étais esclave du respect humain, je veux reconquérir ma liberté en ac-complissant Votre sainte volonté ; enfin, je ne Vous aimais pas, et je veux mériter Votre amour : Ah ! assez de fois, mon Dieu, Vous m'avez crié : J'ai soif de ton amour, sitio. C'est à moi maintenant d'avoir soif de Vous, c'est à moi de Vous ai-mer, car Vous m'avez assez aimé. Déjà j'ai fait vœu de chasteté, je fais vœu d'obéissance, ce vœu me lie pour ainsi dire à embrasser la vie religieuse à laquelle, je le vois clairement, Vous me destinez. Il ne me reste plus que le vœu de pau-vreté : puissé-je le mettre en pratique jusqu'à ce que je le fasse»
Mais ce Cœur aimant, il L'a méconnu par ses ingratitudes ; il L'a offensé par des fautes sans nombre : «Fils d'une mère chrétienne, arraché, malgré moi, à l'enfer, et, après des chutes sans nombre, forcé de me relever. Que de bontés et que d'ingratitudes ! J'ai été un enfant choisi. Jésus eût pu me dire mille fois : Tu quoque, fili !»
Jésus aurait pu l'abandonner à l'enfer. «Sainte Thérèse pour de petits riens faillit y aller. C'était juste : sa tiédeur - à elle comblée de grâces - faisait plus de mal à Dieu que les sacrilèges des impies. Moi aussi, je suis comblé de grâces : mon compte sera d'autant plus terrible».
Dans l'enfer, ce qu'Ernest voit surtout, c'est la privation de Dieu : «Le Ciel, dit-il, c'est Jésus, et l'enfer, Sa privation. Comment passer une éternité privé de mon ami, de mon seul ami ! Eh ! quoi ? Je rechercherais quelques plaisirs de ce monde, quelques satisfactions d'orgueil, pour perdre Jésus ?»
Ce Cœur de Jésus méconnu et blessé réclame des réparations : il est prêt à les lui offrir : «Il y a des méchants qui of-fensent Dieu par des sacrilèges, qui ne correspondent pas à Ses grâces, des ingrats qui reposent sur le Cœur de Jésus, Le caressent d'une main et de l'autre Le percent de coups d'épingle. A nous de réparer ces outrages».
Ce Cœur enfin sollicite des consolations : «Il y a des saints qui souffrent tout pour Jésus, qui réjouissent Son Cœur : soyons des victimes expiatoires pour les autres».
Victime, il veut l'être. Il immole sa chair par le vœu de chasteté, sa volonté par le vœu d'obéissance, tout ce qu'il a par le vœu de pauvreté. A ces sacrifices il en joindra d'autres : privation de soupe le matin et de goûter le jour de sa confes-sion, chemin de croix deux fois la semaine. La plupart du temps, il se tiendra dans une attitude incommode ; il s'applique-ra à être aimable envers tous...
Ainsi purifié par la pénitence, il s'attachera à acquérir la foi, la confiance, la charité, la douceur, l'humilité, la force, la tempérance, la chasteté : «J'ai pris, dit-il, la résolution de me conformer à ce Cœur doux et humble. Je dois être doux, af-fable envers tous, humble et soumis à Dieu et aux hommes». Cette pratique des vertus chrétiennes est le second degré de la vie mystique.
Il s'élance alors vers les sommets, et rêve de parcourir la voie des parfaits, où l'âme sans cesser de pleurer ses infidé-lités ni de poursuivre l'acquisition des vertus, tend à les ramener toutes à une seule : l'union intime et amoureuse avec son Dieu.
Dans son Règlement de retraite nous lisons encore : «La vigilance que je dois exercer pour arriver à tenir mes pro-messes, réclame l’oraison jaculatoire et la communion spirituelle qui doivent toujours me tenir comme en présence de Dieu. C'est dans ce but que je promets à Dieu de Lui offrir toutes mes actions et que je Lui promets de faire chaque jour environ quinze fois la communion spirituelle : c'est bien peu quand je vois une sainte la faire trois cents fois par jour...»
Il entre ensuite dans le détail le plus minutieux : les vertus qu'il pratiquera à chaque exercice de la journée, les dévo-tions de chacun des jours de la semaine, tout cela est prévu. Le dimanche est consacré au Saint-Esprit, le mardi à son saint Patron... La journée se terminera par un examen écrit.
Qu'une âme généreuse, dans la ferveur d'une retraite, se trace un beau programme de perfection, il n'y a rien là de surprenant. Mais que dans tout le cours de la vie et jusqu'à une extrême vieillesse, ce programme se trouve réalisé, voilà la merveille. Les témoins des dernières années de M. Jouin sont unanimes à admirer sa fidélité à la confession hebdo-madaire, à l'oraison, à la mortification.
L'année suivante, à la fin de la retraite, Ernest Jouin renouvelle ses vœux d'obéissance et de chasteté et termine par ces mots : «Encore deux mois de vacances, deux mois dans le monde et tout est fini, je suis à Vous...»
Quelques jours plus tard, après avoir embrassé le Père Piou, salué la Vierge dorée, il disait adieu à Combrée. Du col-lège, il emportait mieux que tous les succès scolaires : sa piété reconquise et l'assurance de sa vocation religieuse.
* * *
Au mois de septembre, Ernest se dirigeait vers le noviciat des Dominicains, à Flavigny. Son frère aîné, qu'un coup de la grâce et l'action de sa mère avaient arraché au monde et jeté dans le cloître, venait lui-même d'y entrer et transporté de joie en apprenant la décision d'Ernest, il écrivait à madame Jouin : «Si Ernest doit venir ici, que ne vient-il immédiate-ment ? Il commencerait sa retraite en même temps que moi... Le plaisir pour moi serait inappréciable». Mais Ernest n'ar-rivant, pas, et la prise d'habit ayant été fixée au 28 août, il écrivit :
«Je n'attendrai donc pas Ernest. J'aurais été heureux de prendre l'habit en même temps que lui. Toutefois, en le précédant, je lui serai peut-être plus utile... Qu'il vienne donc, aussitôt que cela sera possible. Je tâcherai de lui mon-trer la route, jusqu'à ce que lui-même me prêche d'exemple, à son tour, et me soutienne dans cette voie de sacrifice qui lui est déjà familière».
Qu'attendait donc Ernest ? Voulait-il donner à sa vocation l’épreuve de deux mois passés dans le monde ? Éprouvait-il quelques difficultés pour obtenir de l'Évêché les lettres testimoniales nécessaires à son entrée en religion ?...
Quoi qu'il en soit, Amédée, devenu le Frère Augustin, avait pris l'habit depuis dix jours, lorsque le nouveau postulant se présenta aux portes de Flavigny.
Dès les premiers jours de la retraite, sa vocation parut indéniable et le 23 septembre 1862 - il n'avait pas encore dix-huit ans - il revêtit la robe de saint Dominique, en prenant pour patron le Bienheureux Mannès, frère du saint Fondateur.
Cette cérémonie ne fut pas sans éclat. Le Frère Mannès reçut l'habit des mains du Général de l'Ordre, le Révérendis-sime Père Jandel, de passage à Flavigny, et le soir même, il adressait à sa mère ce simple récit :
«Je fus d'abord soumis à quelques minutes d'attente à la porte de la salle du Chapitre, puis j'entrai et je me pros-ternai à terre. Au bout de peu d'instants, je me relevai. Le Révérendissime Père Général, s'adressant à moi, exposa les devoirs des religieux dans une courte allocution. Je quittai alors mon vêtement laïque et l'on me revêtit de la robe blanche et de la chape de laine noire. La vêture achevée, nous nous rendîmes à la chapelle. Je pris place au milieu du chœur et me prosternai, selon la coutume des religieux lorsqu'ils font la venia, au moment de la sainte commu-nion. Lorsque je me fus relevé, on entonna le Te Deum. Le Général me donna le baiser de paix et je le donnai moi-même à tous mes Frères».
Le corollaire de cette scène touchante nous est fourni par le Frère Augustin. Lui aussi prend la plume au lendemain de la cérémonie.
«Le frère Mannès, écrit-il, est des nôtres depuis avant-hier. Comme tu pressentais, ça été pour notre couvent une véritable fête de moines, une fête de famille dont le cœur fait tous les frais. Frère Mannès te parlera sûrement du Ré-vérendissime Père Général ; je veux t'en dire aussi quelques mots.
J'ai été particulièrement frappé de l'abandon plein de charme, de la bonté toute patriarcale avec lesquels ce saint moine se laissait aborder par de pauvres petits novices tels que nous. Si tu avais pu voir comme il s'entretenait sim-plement avec nous, comme il vivait de notre vie, et avec quelle affabilité il nous embrassa tous en partant. C'est que la piété transforme l'homme. Ah ! si l'on pouvait révéler au monde ces horizons nouveaux que donne à l'âme la vie chrétienne vraiment sérieuse, en Jésus, en Sa loi, en Son amour, et si le monde pouvait le comprendre une bonne fois, il y aurait plus de saints qu'il n'y en a, et tous voudraient le devenir».
Un saint ! c'est pour le devenir que le Frère Mannès embrassait la vie religieuse et qu'il allait s'exercer à la pratique des vertus monastiques. Cette formation, dit l'Imitation, «n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un simple jeu d'enfant. Ce n'est pas rien que d'habiter dans un monastère, d'y vivre sans reproche, et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort». C'est un moine qui parle ainsi à des religieux : «Il faut apprendre ici à vous briser en beaucoup de choses».
Il faut en effet briser la nature orgueilleuse, car «c'est pour servir et non pas pour commander que vous êtes venu... Ici personne ne peut persévérer s'il n'a pas la plus cordiale volonté d'accepter pour Dieu l'humiliation».
Il faut briser la nature toujours avide de jouissance, «rarement sortir, de la retraite faire sa vie, être pauvrement nourri, grossièrement vêtu, beaucoup travailler, peu parler, veiller tard et se lever tôt, prier longtemps, fréquemment lire et garder en tout une discipline exacte».
Il faut briser la nature avide de posséder. Le religieux n'a rien en propre, pas même le vêtement qu'il porte. Il aban-donne jusqu'au désir d'avoir.
Cette violence continuelle faite aux penchants naturels est le fond de la vie religieuse et la sainteté est à ce prix. Pour cette formation, l'année du noviciat simple ne suffit pas. Il y faudra les années du noviciat profès et la vie entière.
Voici du reste l'emploi d'une journée à Flavigny.
Le premier lever sonne à 2 heures. Les religieux quittent la planche qui leur sert de lit et sur laquelle ils dorment avec leur vêtement, enveloppés dans une couverture. Ils descendent au chœur pour le chant des Matines et Laudes. De retour dans leurs cellules, ils reposent jusqu'à six heures. C'est le moment du second lever. Un quart d'heure plus tard, ils sont au chœur, chantent Prime et assistent à la messe conventuelle. A l'issue de la messe, chacun rentre dans sa cellule, ré-pare le désordre de la nuit, prend les soins qu'exige la propreté. Cela fait, les novices se retrouvent au réfectoire, où les attend un déjeuner frugal, durant les quelques mois soustraits au grand jeûne.
A huit heures, étude de l'Écriture Sainte, à huit heures et demie, leçon sur les constitutions de l'Ordre, remplacé à cer-tains jours par une classe de Psaumes, un Commentaire des Rubriques, ou l'étude des Cérémonies. A neuf heures, le Petit Office de la Sainte Vierge et le chapelet. A neuf heures et demie, lecture spirituelle, à la salle commune, et deux fois par semaine, le chapitre des coulpes, c'est à dire l'aveu spontané ou la dénonciation publique en présence de la Com-munauté réunie de tous les manquements à la règle constatés depuis la dernière coulpe.
A dix heures, oraison en cellule. Une demi-heure après, lecture d'une vie de Saint. A onze heure, temps libre, à onze heure vingt, examen particulier et, deux fois chaque semaine, la discipline. A onze heures et demie, les Petites heures du grand office. Viennent ensuite le diner toujours maigre, la récréation et les vêpres. De deux heures à trois heures, temps libre. Les vêpres et les complies de la T.S. Vierge, une prière à saint Thomas d'Aquin sont récitées à trois heures. A l'is-sue de cet exercice a lieu le travail manuel (confection de cilices, de chapelets et de disciplines, nettoyage du cloître, de la salle commune, du chœur). Les charges les plus humbles, les tâches les plus pénibles incombent aux novices. Une classe de chant venait ensuite, suivie à cinq heures d'une étude ; à six heures et demie oraison, lecture spirituelle au Chapitre.
Au noviciat profès, à Saint-Maximin, la règle était la même, mais certains exercices du matin et du soir étaient rempla-cés par des classes d'histoire ecclésiastique, d'Écriture Sainte ou de Droit Canon ; ou des cours de théologie dogmatique et morale. A dix heures un sermon, une dissertation ou une thèse. Le sermon avait pour objet d'habituer l'esprit au déve-loppement oratoire, la dissertation visait le style ; la thèse était une argumentation en forme.
Voilà la règle austère à laquelle, pendant des mois, des années, le novice, simple ou profès, doit plier son corps, son esprit, sa volonté, son être tout entier.
De rares exceptions modifiaient cet enchaînement ininterrompu d'exercices laborieux. Une part était faite, à de cer-tains jours de la semaine, aux travaux littéraires. Mais ce n'étaient là que de courtes haltes, et, somme toute, la vie d'étu-diant au noviciat, ne laissait pas d'être pénible.
Le Frère Mannès sortit victorieusement de toutes ces épreuves, puisqu'un an après son entrée, on l'admit à faire sa profession le même jour que son frère, le 23 septembre 1863.
Dès les premiers jours du mois, les deux frères avaient annoncé à leur mère la date de l'heureux événement.
«Nous entrerons en retraite le 13. Viens donc au plus tôt. Nous t'attendons avec impatience. Songe, chère et bien ai-mée mère, que pendant les dix jours de notre retraite, il ne nous sera pas permis de te voir, et dès le lendemain de notre profession, nous devons prendre le chemin de Saint-Maximin, pour le noviciat profès… il faudra nous séparer...»
Madame Jouin répondit à ce pressant appel. Elle fut témoin de la profession de ses deux fils. Puis, autorisée à les conduire à la Salette, où elle voulait se rendre en pèlerinage d'action de grâces, tous les trois prirent le chemin de Gre-noble. Quelques jours plus tard, ils se séparaient à Lyon. Madame Jouin rentrait à Angers, tandis que le Frère Augustin et le Frère Mannès gagnaient Marseille et Saint-Maximin.
A peine était-elle arrivée qu'elle recevait de ses fils une longue lettre datée du couvent. Ils avaient communié à N.-D. de la Garde, visité les cachots de Mirabeau, du Masque de Fer et de Monte-Christo. Le lendemain, à midi, ils étaient à la Sainte-Baume et avaient gravi le Saint-Pilon. «De retour à l'Hôtellerie, ils avaient dû eux-mêmes préparer leur souper avec un peu de lait et des haricots de rencontre. Repas frugal, assaisonné de gaieté»...
Au mois de juillet 1914, à la fin d'un séjour à Saint-Christophe-en-Oisans, où il avait conduit, avec deux de ses vi-caires, un curé de Paris souffrant, le Curé de Saint-Augustin voulut revoir les lieux témoins de sa jeunesse dominicaine. Avec ses compagnons, guides en tête, il franchissait les pentes neigeuses du col de la Muselle, passait la nuit dans un refuge alpestre, pour gagner, après deux jours de marche, le sommet de la Salette. Puis par Gap, Notre-Dame du Laus et Aix, il arrivait à Saint-Maximin. Le vieux couvent était silencieux ; les moines en avaient été chassés, mais les lieux parlaient à son âme.
L'après-midi, refusant la voiture qui lui était offerte, il fit seul, sous un soleil ardent, la longue route qui sépare Saint-Maximin de la Sainte-Baume, plus libre ainsi de laisser sa pensée s'en aller au fil de ses souvenirs. Il gravit une dernière fois le Saint-Pilon, célébra pour la première fois, la messe dans la Grotte de Marie-Madeleine, et, par Notre-Dame de la Garde, terminait ce pèlerinage d'action de grâces.
Pendant trois ans, soit à Saint-Maximin, soit à Flavigny, où le noviciat profès fut transféré deux ans plus tard, le Frère Mannès poursuivit ses cours de théologie et d'Écriture Sainte. Mais le climat de la Provence, la continuité des études, l'abstinence perpétuelle, le jeûne épuisaient rapidement les forces des novices profès. Les Frères originaires des régions tempérées de la France souffraient plus particulièrement des chaleurs du Midi. Le Frère Mannès, entré trop tôt dans l'Ordre, fut l'un des plus gravement atteints et, à plusieurs reprises, il retourna près de sa mère pendant les mois d'été.
On pouvait espérer que le climat plus tempéré de Flavigny, serait plus favorable à sa santé. Mais au bout d'une qua-trième année, il fallut se rendre à l'évidence. Un tempérament si délicat ne pourrait jamais s'accommoder aux rigueurs de l'observance, et, au mois d'août 1866, le Frère Mannès rentra à Angers, quittant non sans regret la robe dominicaine pour revêtir la soutane du séminariste.
Il ne s'en consola jamais. Cinquante ans plus tard, le jour de ses noces d'or, remerciant le R.P. Hébert d'avoir évoqué le souvenir de sa vie dominicaine avec son frère «de si douce et si éloquente mémoire», il lui disait avec l'accent d'une vive émotion :
«C'était ma première jeunesse ; et, des couvents de Flavigny et de Saint-Maximin, des apparitions insoupçonnées de saint Dominique et de son frère le bienheureux Mannès, de saint Thomas d'Aquin, de saint Pierre martyr, de sainte Catherine de Sienne, de sainte Rose de Lima, de ces phalanges d'élus passant devant mes yeux éblouis, s'était dégagé un idéal de splendeur, de science, de sainteté, d'héroïsme qui m'a ensoleillé jusqu'à ce jour, me lais-sant, comme une blessure au cœur, le regret persistant de ne pas vivre et de ne pouvoir mourir dans la robe blanche de mes dix-sept ans. J'ai parlé de la mort parce que ce sont les souvenirs les plus vivants qui me restent. C'était le frère Proyart, c'était le Père Gaidan. Nous nous réunissions autour de la planche d'agonie ; les frères agenouillés laissaient tomber le rosaire sur les dalles de la cellule, et cela vibrait à mon oreille en des sons argentins d'une clo-chette d'appel ; nous chantions à mi-voix le Salve Regina, comme pour bercer et endormir du dernier sommeil celui qui nous quittait, et la Vierge, invisible mais présente, descendait doucement pour emporter sous son grand manteau bleu, selon la vision du Patriarche de l'Ordre, cette âme dominicaine dans son royaume de paradis... Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai rêvé, mais, hélas ! ce n'était qu'un rêve !»
Plus tard, se croyant rétabli, il songea à revenir parmi ses Frères. Son directeur, M. Bieil, l'en dissuada. Toutefois on le vit longtemps, porter autour du cou un foulard blanc et, sous ses vêtements, jusqu'à sa mort, un scapulaire de même cou-leur : souvenir de sa vocation dominicaine.
Simple minoré quand il entra au grand séminaire d'Angers, il reçut, en dix-huit mois, les autres ordres : le sous-diaconat (décembre 1866) le diaconat six mois après, et le 23 février 1868, la prêtrise des mains de Mgr Angebault, son évêque.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
Nihil obstat. A. VILLIEN, censor dep. Die 15 nov. 1935.
IMPRIMATUR : Parisiis, die 18° nov, 1935. V. DUPIN, v. g.
A Monsieur le Chanoine Sauvêtre
Cher Monsieur le Chanoine,
Vous finissez votre livre par le récit des funérailles de Mgr Jouin et son ensevelissement dans le caveau de famille du cimetière Montparnasse, auprès de sa mère et de ses deux frères qu'il avait tant aimés. Vous ajoutez ces lignes :
«C'est là qu'il dort son dernier sommeil.
«Mais la pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin, n’étouffe pas sa voix et ne paralyse pas son activité. Il parle encore et se survit dans les œuvres qu'il a créées. Les vingt prêtres qu'il a don-nés à l'Église, les œuvres de jeunesse qu'il a fondées, les soixante-dix servantes des pauvres qu'il a introduites à Pa-ris et, surtout, la Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer l'action bienfaisante du grand serviteur de l’Église que fut Mgr Ernest Jouin».
Tous ses amis ont espéré en effet qu'après la mort sa grande voix nous parlerait encore. Ils attendaient qu'une plume autorisée se chargeât de nous raconter cette vie si variée et si bien remplie.
Mgr Jouin est assez mal connu. Comme de tous ceux qui ont été mêlés à des polémiques retentissantes, on n'a rete-nu de sa vie quelques événements plus bruyants. Le reste est enseveli dans l'oubli. Notre manie de simplification se con-tente pour chaque homme, comme pour chaque objet d'une seule étiquette. Il importe donc que des témoins bien infor-més prennent la parole devant les contemporains distraits ou prévenus, et leur disent la vérité, toute la vérité.
Vous êtes ce témoin bienveillant, mais éclairé, impartial et, comme on dit aujourd'hui, bien documenté, que tous les amis de Mgr Jouin avaient désigné, au lendemain de sa mort, comme le plus capable d'écrire sa vie.
Vous n'avez pas besoin d'être recommandé aux lecteurs. Votre livre se recommandera de lui-même. Le nom de Mgr Jouin est resté cher à la mémoire de beaucoup de prêtres et de laïques à Paris, à Angers, et dans bien des villes où il a passé. Ses adversaires eux-mêmes voudront savoir ce qu'était au fond ce polémiste redoutable qu'ils se peignaient sous des traits durs et déplaisants. Combien eux, et bien d'autres avec eux, s'étonneront de voir que vous le présentez comme un mystique, et croiront à une illusion d'ami. Mais ceux, ils étaient peu nombreux, qui ont pu pénétrer dans son intimité, souscriront à votre jugement. Oui, c'était un mystique qui, avant tout et en tout, cherchait Dieu. Le mot de Jeanne d'Arc qui l'avait tellement frappé «Dieu premier servi» était aussi sa devise. A travers toutes les péripéties d'une vie longue et très accidentée, il a vécu en ascète, prêt à tout sacrifier à son Dieu et à sa foi. Il serait mort martyr avec la foi d'un saint Ignace d'Antioche, et l'on peut dire que, si cette glorieuse épreuve lui a été épargnée, Dieu lui a réservé de lui rendre té-moignage, dans une maladie très longue et infiniment douloureuse, par son courage, sa résignation, sa patience.
Pour vous qui avez été un disciple, longtemps avant d'être pour lui un ami et un confident, vous avez eu l'avantage, l'ayant si bien connu, d'avoir eu à votre disposition des lettres et des papiers de famille. Vous avez travaillé avec achar-nement, malgré les épreuves d'une santé chancelante, et vous nous avez donné un récit à la fois très documenté, très impartial, très attachant et instructif.
Je vous en remercie au nom de tous ses amis, je puis dire au nom de tous vos lecteurs, et reste votre bien fidèlement dévoué in Xo.
† fr. Fernand Cabrol, abbé de Farnborough.
AVANT-PROPOS
Si, pour raconter une vie qu'on a partagée, il suffisait d'évoquer ses souvenirs et de laisser parler son cœur, ce livre serait sans défaut. N'est-il pas d'abord un hommage de piété filiale à une mémoire vénérée ?
Mais si, en l'écrivant, nous obéissions au sentiment d'une âme pleine de reconnaissance, nous cédions aussi à d'ho-norables et pressantes sollicitations : «Vous êtes qualifié entre tous, pour écrire la vie de Mgr Jouin, voulait bien écrire à l'auteur le distingué prélat qui avait présidé à l'installation du Curé de Saint-Augustin, et vous l'écrirez con amore».
De son côté, l'Abbé de Farnborough, Dom Cabrol, qui honorait Mgr Jouin d'une amitié de longue date, nous témoi-gnait naguère sa satisfaction de nous voir reprendre, après deux ans, notre travail : «Je déplorais, nous écrivait-il, qu'un homme aussi éminent tombât dans l'oubli, alors que tant de personnages de seconde zone sont célébrés par les mille voix de la renommée».
En ce siècle d'agitation fébrile, l'oubli ensevelit bien vite les mémoires les plus dignes de survivre. «Parmi les expé-riences que j'ai faites de la légèreté humaine, constatait, après beaucoup d'autres, Guizot, l'une des plus pénibles a été de voir avec quelle rapidité les souvenirs s'effacent et le peu de traces qui restent au bout de peu de temps des meil-leures vies et des plus douces».
Celle que nous racontons, toute de bienfaisante activité, doit échapper à cette loi de la fragilité humaine. Il convient aussi qu'elle soit vengée des calomnies et des basses injures dont elle fut l'objet.
Mgr Jouin était à peine descendu dans la tombe qu'une haine, accumulée depuis vingt ans, se déchaînait sur son œuvre et sur sa personne. De son vivant, elle n'avait osé paraître ; lui mort, elle crut pouvoir l'attaquer sans danger et le jeter à bas du piédestal où l'avaient élevé ses talents, ses mérites, l'abnégation et l'héroïsme d'une existence consumée au service de l'Église et des âmes. La tentative a échoué.
Surpris d'abord, les continuateurs de son œuvre ne tardèrent pas à faire paraître une «Réponse à l'odieuse cam-pagne», en signalant les insuffisances, les réticences, les contradictions de l'agresseur et, à la fin, sa fuite honteuse et en démontrant comment, pour les besoins de sa mauvaise cause, il avait affirmé sans preuve, et faussé les documents en regroupant ou disjoignant les textes - en séparant les textes - en forgeant de toutes pièces d'autres textes, enfin, en faus-sant les dates.
On ne tardait pas à apprendre que l'auteur de ces mensonges qui avait prudemment dissimulé son vrai nom, n'était autre que M. Flavien Brenier, le même qui, vingt ans auparavant, avait fait échouer le projet de fédération des Ligues An-ti-Maçonniques du Curé de Saint-Augustin, le même dont celui-ci avait alors stigmatisé les louches manœuvres. La Franc-Maçonnerie, que M. Brenier avait si bien servie à cette époque, se servait de nouveau de lui pour sa vilaine be-sogne. Ainsi pensait-elle faire payer au Fondateur de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes ses longues et vi-goureuses attaques contre la Judéo-Maçonnerie ; détruire son œuvre, sa Ligue, et sa Revue, en salissant la mémoire de son fondateur ; intimider enfin ses successeurs et tous ceux qui seraient tentés de s'attaquer aux sectes maçonniques.
Trois ans ont passé, et le temps, en s'écoulant, n'a fait que mettre davantage en lumière et dans un relief plus saisis-sant la figure de Mgr. Jouin. Les événements qui se déroulent sous nos yeux depuis sa disparition, loin d'apporter un démenti à ses affirmations, leur fournissent une éclatante confirmation. Depuis les scandales judéo-maçonniques qui ont marqué le début de l’année 1933, chaque jour allonge la liste des méfaits de la Secte et signale son emprise sur la France et sur le monde ; et la presse, muette jusqu'ici ne peut plus les dissimuler.
Ceux qui affectaient de nier l'existence ou la malfaisance de la Maçonnerie, peut-être pour se dispenser de la com-battre, et ceux qui, désespérant du succès, déposaient les armes devant elle, constatent, non sans surprise, le réveil de nations jusqu'ici soumises à son empire. Après l'Italie et l'Allemagne, voici la Turquie qui dissout toutes les associations maçonniques, confisque leurs biens et ferme toutes les Loges ; voici le Portugal qui supprime, lui aussi, la Maçonnerie sur tout son territoire et - fait digne de remarque et capable d'enflammer le zèle des successeurs de Mgr Jouin - c'est en s'appuyant, pour une bonne part, sur la documentation de sa Revue que le rapport des Corporations portugaises a obte-nu le vote de la loi.
Autre symptôme consolant : en trois ans, le nombre des abonnés à la Revue et des adhérents à la Ligue Franc-Catholique a doublé.
D'ailleurs, si la lutte contre la Judéo-Maçonnerie rencontrait en France des incrédules ou même des adversaires, il n'en était pas de même à l'étranger. N'est-il pas remarquable que le premier souscripteur à la Vie de Mgr Jouin fut un pasteur protestant suisse ?
Les contradictions ne paraissaient guère émouvoir Mgr Jouin. II avait, pour l'encourager, la certitude de ses convic-tions, fruit de ses recherches, et l'approbation de Rome. Les éminents cardinaux Gasparri, Gasquet, Granito di Belmonte lui écrivaient pour reconnaître la justesse de ses vues et l’utilité de son œuvre, et deux papes - Benoît XV et Pie XI - en le faisant prélat puis Protonotaire, lui adressèrent des brefs particulièrement élogieux.
Nous ne pouvions donc pas, dans cette Vie, ne pas signaler le beau spectacle de ce prêtre se faisant - à l'âge où la plupart déposent les armes et n'aspirent qu'au repos - le chef et comme le «Pierre l'Ermite» d'une suprême croisade contre les sectes pour le salut de son pays et de l'Église.
Mais s'il fallait mettre en relief le tempérament de ce lutteur, calme et fort, il ne convenait pas non plus de laisser dans l'ombre les soixante années d'un ministère aussi varié que fécond. On aimera, dans ce livre, trouver l'homme qu'était Mgr Jouin et dont on aurait pu dire, comme de saint Paul, «qu'il avait l'œil et le geste du chef, le don de voir la chose à faire, de convaincre les autres qu'elle devait, qu'elle pouvait être faite», et qui la faisait le premier - l'homme d'œuvres qui fonde des patronages et introduit à Paris les Servantes des Pauvres - le catéchiste incomparable, l'orateur de marque, le poète gracieux, l'auteur applaudi de La Nativité et de tant d'autres drames sacrés et patriotiques - le recruteur du clergé - l'apôtre en un mot demeuré moine par le détachement absolu et dont Mgr Le Roy, son voisin à Saint-Médard, écrivait
«J'ai toujours été édifié de sa foi profonde, de son amour pour l'intégrité de la doctrine, de son zèle pastoral, de ses initiatives et de son activité».
«C'est ce zèle pour la vérité et pour le bien qui, plus tard, l'engagea dans sa campagne anti-maçonnique, en dépit des contradictions qui ne devaient pas lui manquer».
Au moment où la tempête faisait rage et menaçait d'engloutir son bateau, le pilote pressait de questions le prophète qu'il portait : «Qui es-tu ? - Quelle est ta profession ? - D'où viens-tu ? - Où vas-tu ?» A toutes ces questions, Jonas ne fit qu'une réponse : «Je suis le Serviteur de Dieu». Mgr Jouin n'ambitionnait pas d'autre titre.
C'est pour servir Dieu qu'à dix-sept ans il entre au couvent et revêt la robe dominicaine ; c'est pour le servir que, dans sa jeunesse sacerdotale il rêve de beaux ouvrages. Quand, vicaire, il fonde des œuvres de jeunesse ou compose ses drames sacrés, c'est Dieu qu'il veut servir ; et quand, à cinquante ans il entreprend d'étudier les règles de l'harmonie, et, à soixante, celles de la langue hébraïque, c'était toujours pour le service et la gloire de Dieu. En entreprenant, presque septuagénaire, et en poursuivant pendant vingt ans, sa lutte contre les Sectes, il n'avait d'autre pensée que le service de Dieu, et la défense de l'Église.
Que Mgr Jouin se soit parfois trompé, sur les hommes et sur les choses, qui pourrait s'en étonner ? Il était homme, donc faillible.
Polémiste ardent et sincère, apparenté par son tempérament aux Louis Veuillot et aux Freppel, il a pu, croyant frapper sur l'ennemi, atteindre des hommes qui, par des méthodes différentes, sous d'autres étiquettes, poursuivaient au fond le même but. Surtout, des collaborateurs, dépassant sa pensée, ont pu voir des ennemis là où il n'y en avait pas. Quand on le lui démontra, il n'hésita pas à s'en séparer.
Ennemi des concessions, plus soldat que diplomate, il attaquait les idées qu'il croyait fausses ou dangereuses, mais sans haine ni mauvaise foi, jamais les personnes ; fidèle à la vieille devise : in certis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
Que tous ceux qui, par leurs conseils ou par les documents qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition, ont aidé l'auteur dans son travail, reçoivent ici l'expression de sa très vive reconnaissance. Il remercie très particulièrement M. le Chanoine Villien, Doyen de la Faculté Canonique, M. le chanoine Duplessy, M. le chanoine Viteau, professeur à l'Institut catholique, M. l'abbé Rouault, M. l'abbé Chabot, membre de l'Institut.
Chanoine J. Sauvêtre.
CHAPITRE PREMIER. DU BAPTÊME A L'ORDINATION. (1844-1868)
M. ET MME MARIN JOUIN. - NAISSANCE ET BAPTEME D'ERNEST. - SES DEUX FRERES, AMEDEE ET HENRY. - LE REVE DE MME JOUIN. - LE VIEIL AN-GERS. - MORT DE M. JOUIN. - SOUVENIRS D'ENFANCE. - EVEIL MUSICAL. - PREMIER APPEL DE DIEU. - LE COLLEGE MONGAZON. - L'EXTERNAT SAINT-JULIEN. - LE COLLEGE DE COMBREE. - «JE SERAI DANS BOUILLET !». - PREMIERS ESSAIS LITTERAIRES. - L'OUBLI DE DIEU. - DANS LA CHAMBRE DU PERE PIOU. - LA CONVERSION. - «ENTRE JESUS ET MOI». - ERNEST FAIT VŒU DE CHASTETE ET D'OBEISSANCE. - SA CONSECRATION AU SACRE-CŒUR. - SON ENTREE AU COUVENT DES DOMINICAINS A FLAVIGNY. - LE FRERE MANNES. - IL Y RETROUVE SON FRERE AMEDEE. - LE NOVICIAT SIMPLE. - LE NOVICIAT PROFES A SAINT-MAXIMIN. - MME JOUIN ACCOMPAGNE SES FILS JUSQU'A LA SALETTE. - LA SANTE DU FRERE MANNES L'OBLIGE A RENONCER A LA VIE RELIGIEUSE. - SON ORDINATION A ANGERS.
Ernest Jouin naquit à Angers, 12 rue Saint-Georges, le 21 décembre 1844.
Son père, Amédée Marin Jouin, exerçait depuis douze ans dans la cité angevine sa profession d'ébéniste quand sa femme, Françoise Cousin, originaire comme lui des environs de Château-Gontier, lui donna ce cinquième enfant - le der-nier. L'aîné n'avait vécu que quelques jours. Mais deux fils, et une fille, étaient encore vivants. Celle-ci, âgée de cinq ans, n'allait pas tarder, elle aussi, à s'envoler au ciel. Ernest ne connut donc guère que ses deux frères : Amédée, qui venait d'entrer dans sa onzième année, et Henry, âgé de trois ans, et qu'une infirmité privait de l'usage de ses jambes.
Située au centre d'Angers, tout près de la rue Saint-Laud, la plus commerçante de la ville, dans le voisinage de l'insti-tution Saint-Julien, la rue Saint-Georges offrait à M. et à Mme Jouin toutes les facilités pour l'éducation religieuse de leurs enfants, en même temps qu'elle assurait au jeune artisan une clientèle de choix.
Des souvenirs historiques s'attachaient à ce quartier de la capitale angevine : les vieilles constructions en bois de la place Sainte-Croix - la Maison d'Abraham et la Maison d'Adam - et les enseignes pittoresques des Trois-Connins, de la Barbe, de Bois et des Quatre Fils Aymon, piquaient la curiosité de l'ouvrier qui avait conquis son brevet de maîtrise au cours de son tour de France et ne manquait ni de goût, ni de culture artistique.
Tout différents étaient les sentiments qu'éveillait dans l'âme ardente, de Madame Jouin le voisinage de la Place du Ralliement. Là, aux jours de la Terreur, avait coulé le sang des martyrs ; là, un prêtre angevin, Noël Pinot, curé du Lo-roux-Béconnais, avait gravi l'échafaud, vêtu de l'aube et de la chasuble, comme pour un suprême sacrifice... Et ce sou-venir faisait tressaillir douloureusement le cœur de la vaillante chrétienne.
Le surlendemain de sa naissance - quatrième dimanche de l'Avent - Ernest fut porté à l'église cathédrale Saint- Mau-rice pour y être baptisé. On lui avait donné pour parrain son frère aîné et pour marraine une jeune cousine de la Mayenne, Zoé Vannier. De sa chambre, Madame Jouin suivait par la pensée le petit groupe de parents et d'amis condui-sant son fijs à l'église et, de toute son âme, priait pour son avenir religieux. Et maintenant que les cloches, appelant les fidèles à l'office des Vêpres, lui annonçaient que le mystère de régénération était accompli, que le fils de sa chair était devenu l'enfant de Dieu, elle faisait pour lui et pour ses frères des rêves de bonheur.
Le rêve d'une mère sur le berceau de son enfant est immense comme son amour. La femme qui osait solliciter de Jé-sus les premières places dans Son royaume pour les deux fils qu'elle lui avait donnés, ne se croyait pas ambitieuse ; mais quand Jésus lui eut découvert le mystère de la Passion et le calice auquel il fallait boire avant de régner avec Lui, elle s'inclina généreuse et soumise devant la volonté divine.
Madame Jouin demandait-elle à Dieu pour ses fils une place de choix ? On peut le supposer, puisqu'elle était mère. Mais en même temps - et de ceci nous ne pouvons douter - elle ambitionnait pour eux la gloire du sacerdoce. Et si, au milieu de sa prière et de son rêve, l'image de Noël Pinot, le curé martyr, surgit soudain devant ses yeux, elle ne les dé-tourna point avec effroi. Sa foi le lui révélait : quand le Christ appelle une âme d'élite à Le suivre dans la voie de l'aposto-lat et lui révèle les sacrifices qui l'attendent, ce n'est qu'après avoir trempé, le premier, ses lèvres au calice d'amertume et versé dans le cœur de la mère, à laquelle il demande l'immolation de son fils, la force et la grâce qui soutenaient Marie au pied de la croix... Aussi, lorsqu'au retour de l'église, on présenta à Madame Jouin son fils à baiser, quelle eût été sa joie, si son regard, perçant l'avenir, eût entrevu son petit Ernest, revêtu du sacerdoce, vicaire dans l'église de son bap-tême, puis curé d'une importante paroisse de Paris, où il mourrait presque nonagénaire, après avoir donné l'exemple des plus hautes vertus et le spectacle d'une activité d'autant plus étonnante qu'elle n'aurait pour soutien qu'un organisme des plus fragiles et longtemps menacé I
Le rêve de Madame Jouin devait se réaliser dans sa plénitude : de ses trois fils, l'aîné, après un détour dans le siècle, devint dans le cloître un saint et ardent religieux, prédicateur de grand talent, plusieurs fois prieur de son Ordre - le plus jeune fut un prêtre admirable de zèle et de charité - et le cadet, que son infirmité retint dans le monde, y mena la vie d'un chrétien exemplaire, laissant à ses enfants les leçons d'une vie sans reproche et à la postérité la réputation d'un écrivain de haute valeur.
- «Tous nos enfants feront leurs études», avait déclaré M. Jouin. Peut-être regrettait-il d'avoir jadis négligé les conseils d'un oncle notaire et préféré le travail manuel à l'étude du droit... Quand Amédée eut atteint sa douzième année, il l'en-voya donc à l'Institution libre de Combrée. II se disposait à faire de même pour Henry et Ernest, quand un mal mystérieux le terrassa lui-même en pleine force et, en quelques jours, l'enleva à l'affection des siens.
«Ce fut pour ma mère, écrira l'abbé Jouin, un coup terrible qui brisait une union de dix-sept ans. Elle demeura plusieurs jours dans une morne prostration, ramassée sur elle-même, presque sans mouvement. Mais elle se ressai-sit bien vite et, sans oublier le passé, elle prit conscience de la tâche imposée par l'éducation de trois fils dont l'aîné avait quatorze ans et le plus jeune quatre seulement. Depuis lors, on ne l'a jamais vue faiblir».
Les économies du foyer ne devaient pas tarder à s'épuiser ; la gêne allait venir et avec elle les privations. Résolue à les supporter vaillamment, elle voulut du moins les épargner à ses enfants. Longtemps après, évoquant le souvenir de cette épreuve et parlant des difficultés matérielles, dont il avait été, avec ses frères, la cause involontaire, le Curé de Saint-Augustin dira : «Je me rappelle qu'un jour, j'avais une dizaine d'années, ma mère me servit un plat fortifiant, tandis qu'elle ne prenait qu'un peu de pain sec et de fromage plus sec encore ; je lui en fis la remarque : «La vie est dure, me répondit-elle, il faut que j'épargne». Que de fois ce souvenir m'a pris au cœur comme un remords !»
Respectueuse des volontés de son mari, Madame Jouin mit donc, quand il en eut l'âge, Henry au collège Mongazon, aux portes d'Angers.
Quant à Ernest, peu de temps après sa naissance, on l'avait confié aux soins de sa grand'mère à Bierné, dans la Mayenne, et, plus tard, à ceux de sa tante et de sa marraine, à Ménil. C'est là que, loin de la ville, s'écoula sa première enfance ; là, sans doute, qu'il puisa son amour des champs, son goût pour le travail, sa prédilection pour les presbytères de campagne, et sa familiarité bienveillante pour les humbles, les ouvriers, les paysans.
Nous permettra-t-on de rapporter ici quelques épisodes de ces premières années ? Nous les empruntons à une Vie d'Henry Jouin que la guerre et des travaux plus impérieux empêchèrent le Curé de Saint-Augustin de mener à terme.
«A Ménil, le théâtre de mes exploits journaliers était un grand jardin en terrasse dominant la Mayenne. Lorsque je l'avais longuement arpenté en tous sens à la poursuite de quelque papillon plus capricieux et plus volage encore que mes rêves d'enfant, je m'empressais d'orner de fleurs et de guirlandes un petit autel dressé dans le creux du mur et dédié à la Madone. Le vicaire rendait visite chaque semaine aux deux dames du logis, pour apprendre aux chan-teuses le cantique du dimanche suivant. Je faisais partie de cette modeste chorale et l’on vantait ma voix, dans le but sans doute de plaire à ma marraine qui me gâtait beaucoup. Tous ces airs éveillèrent en moi un sentiment musical insoupçonné, et je me prenais, lorsque j'étais seul, à improviser des chants qui devaient être en mineur, car ils me faisaient infailliblement pleurer».
Vers sept ans, de retour rue Saint-Georges, il y retrouva Henry et pendant quatre années, partagea son existence au foyer maternel. Un dimanche, ils avaient descendu la rue Val-de-Maine, traversé la rivière et ne s'étaient arrêtés que très loin, dans un chemin creux, sur les marches d'une porte condamnée de la chapelle du Bon-Pasteur. Ils se reposaient, tandis que dans la chapelle on entendait psalmodier l'office : «Écoute !» dit tout à coup Henry. Des voix d'enfants ve-naient d'entonner, avec les Alléluia de Pâques, le répons des Complies : In manus tuas, Domine... Entre Vos mains, Sei-gneur, je remets mon âme... «Il me semble, racontait-il, plus tard, que ce fut pour nous deux la première révélation de l'harmonie. L'émotion que je ressentis m'est encore sensible aujourd'hui...» - «J'étais fait pour la musique», dira-t-il en-core. Elle sera en effet pour l'artiste qu'il devait être la source de très nobles jouissances, en même temps qu'un moyen dont le prêtre saura se servir pour gagner à Dieu des âmes d'artistes.
Mais sa véritable vocation était de nature plus élevée. - «Qui sait, dit-il, en racontant l'événement de la chapelle du Bon-Pasteur, si ce n'était pas le premier appel de Dieu à mon âme» ? Tout petit, il avait déclaré vouloir être prêtre et, pour le devenir, s'imposait déjà d'héroïques sacrifices. Un jour qu'il avait refusé de manger des poireaux pour lesquels il avait de la répugnance : «S'il en est ainsi, lui dit sa mère, tu ne pourras jamais être curé, car tous les curés en mangent». - «Alors, je veux bien». Depuis ce jour, l'enfant ne refusa plus l'aliment qui lui inspirait du dégoût.
Ces premiers germes de vocation trouvaient pour se développer un milieu favorable au Collège Mongazon où il était venu rejoindre Henry. C'était l'époque de sa première communion qu'il fit à la fin de sa septième, sous la direction de M. l'abbé Chupin.
Sa santé «ne pouvant s'accommoder du lever matinal et du régime un peu Spartiate» du collège, il le quitta, à la fin de sa cinquième, pour suivre, comme externe, les cours du pensionnat Saint-Julien, à Angers. Mais, à partir de la troisième, les élèves étaient conduits au Lycée : sa mère, soucieuse avant tout de sa formation chrétienne, l'envoya terminer ses études à Combrée, où le souvenir de son frère aîné était encore vivant. C'est là que Dieu l'attendait.
* * *
Lorsqu'à la fin de septembre 1858, Ernest fit son entrée, comme élève de troisième, au collège fondé par M. l'abbé Drouet aux environs de Segré, le souvenir des fêtes qui avaient marqué la consécration de la nouvelle chapelle, n'était pas encore éteint. On revoyait encore autour de Mgr Angebault, évêque d'Angers, les quatre évêques et les cinq-cents prêtres ou religieux qui l'accompagnaient. Deux mois auparavant, conduits par le comte de Falloux, Montalembert et le R.P. Lacordaire avaient rendu visite au nouveau collège : maîtres et élèves redisaient, non sans fierté, les paroles élo-quentes tombées des lèvres de ces deux paladins de la liberté de l'Enseignement.
Que furent les études du nouveau Combréen ? Cinquante ans plus tard, au centenaire du Collège, parlant aux élèves, le Curé de Saint-Augustin s'accusait de n'avoir pas suivi les exemples de son frère Amédée et d'avoir, comme son frère Henry, «fait plus d'une fois l'école buissonnière dans des auteurs ne figurant pas au programme scolaire et d'avoir trop négligé l'étude des langues grecque et latine». Charitablement, il excusait son frère.
«Mon frère Henry avait au reste une excuse : son infirmité. Aussi préférait-il orner et détendre son esprit dans la lecture d'œuvres modernes, et dans des essais personnels de productions littéraires. Dès la seconde, il préludait à ses publications en s'imprégnant du Dictionnaire de Bouillet dont il me parlait avec admiration, si bien que ma mère m'ayant reproché mon peu d'ardeur à l'étude, je lui répondis consciencieusement : «A quoi bon ? Henry m'a dit que plus tard il serait dans Bouillet et qu'il m'y ferait mettre». La certitude de figurer dans Bouillet m'apparaissait comme la réalisation des rêves d'un intellectuel et, ce qui ne laissait pas de flatter ma paresse, comme la dispense plénière de tout travail de l'esprit».
Disons, à sa décharge, qu'en cinquième, déjà ! il avait fait un essai de composition littéraire : «Une pièce, dit-il, qu'on devait jouer et qui ne fut pas représentée, parce que, pour la composer, je m'étais servi sans scrupule d'Octave Feuillet». En troisième, à Combrée, les élèves faisaient paraître un journal. Ernest y écrivit le premier chapitre d'un roman.
«Mais le haro des Animaux malades de la peste ne fut rien, raconte-t-il, en comparaison des avanies que j'eus à subir. On ne me reprochait pas mon unique chapitre, presque personne ne l'avait lu ; on ne discutait pas le plan de l'ouvrage, je n'en avais pas. On criait contre le titre : Fuirel !... Que voulez-vous, je m'étais épris des rimes en el ; et ce nom est bien à moi, je ne l'ai pas volé et nul ne me l'a pris».
Disons encore qu'il fut choisi pour adresser le compliment à M. Adolphe Levoyer, son professeur d'Histoire, le jour de sa fête : «Je lui parlai, dit-il modestement, de la philosophie de l'Histoire avec autant d'aise que d'incompétence».
A dire vrai, celui qui, à cinquante ans de distance, s'accusait de paresse au collège avait été un laborieux. Il travaillait, mais à sa façon, d'une façon indépendante, comme était sa nature. Et puis n'avait-il pas lui aussi une excuse dans la ma-ladie qui l'obligeait à de longs et fréquents séjours à l'infirmerie ? De retour en classe, il ne pouvait plus regagner l'avance prise par ses camarades. D'ailleurs, si son nom ne figure pas sur les palmarès de son temps, comme celui de son brillant condisciple, Mauvif de Montergon, il ne tardera pas à combler les lacunes de ses études grammaticales et linguistiques et à se placer au premier rang des travailleurs de l'esprit.
On serait curieux de connaître dans quels auteurs il aimait à s'évader. Est-ce Octave Feuillet, à l'égard duquel il vient de s'accuser de plagiat ? ou Victor Hugo pour qui il eut longtemps de la sympathie et qui venait de publier les Châtiments et les Contemplations ?... Le moindre danger de ces lectures, faites sans contrôle, est la dissipation de l'esprit. Il en est un autre. Au cours de ses vacances qu'il passait avec son frère chez une tante à Bierné, il fit des lectures moins inno-centes : «Un livre peut décider de la vie d'un enfant», dit Paul Gerfaut. Il y avait là, nous dit-il, «un octogénaire voltairien de mœurs plus encore que de conviction, qui nous initia à la littérature légère du dix-huitième siècle, et je lui en ai long-temps voulu». Tardifs regrets. Que n'avait-il suivi les conseils de son poète favori à la jeune ouvrière dans sa mansarde ! Prends garde, lui dit-il ; Voltaire est là,
Ce singe de génie,
Chez l'homme en mission par le diable envoyé.
Hélas ! si ta main chaste ouvrait ce livre infâme,
Tu sentirais soudain Dieu mourir dans ton âme !
Ce soir, tu pencherais ton front triste et boudeur,
Et demain, tu rirais de la sainte pudeur !
Jusqu'à quelle profondeur le mal pénétra-t-il dans le cœur d'Ernest ? «S'il ne sentit pas Dieu mourir dans son âme», du moins sa piété première disparut. L'appel d'en-haut cessa de retentir à son oreille, ses aspirations vers le sacerdoce fi-rent place à des projets plus terrestres, et les impressions ressenties au chant de l’In manus tuas, à la porte de la petite chapelle, ne tardèrent pas à s'évanouir. Il en fait l'aveu : «Aucun de nous, ses deux frères et lui, ne songeait plus, à mettre Dieu dans sa vie et nos trois âmes s'orientaient vers un monde de rêves dorés par l'éveil des passions».
Henry approchait de sa vingtième année ; il était à Paris, à la recherche d'une situation. Quant à Amédée, sa mère, inquiète de ses tendances mondaines, soucieuse de soustraire les deux plus jeunes à des exemples qu'elle estimait dangereux, venait de lui refuser l'entrée de la maison paternelle. Depuis six mois, il errait en Allemagne. Quant à Ernest, nous trouvons encore cette confidence dans le discours du centenaire de Combrée : «Après ma famille, après ma mère, c'est à Combrée que je dois tout : au Père Piou, le saint, ma vocation ; à M. Suppiot, mon professeur de troisième, de se-conde et de rhétorique, le premier éveil de l'esprit, avec de telles envolées qu'elles m'ont gardé jusqu'à ce jour l'enthou-siasme de mes quinze ans ; au vénéré M. Claude, mon professeur de philosophie, un grain de bon sens, suffisant pour ne pas être présomptueux, assez tempéré pour ne pas être prudent jusqu'à la peur».
A Combrée, l'aumônier était celui que l'on n'appelait pas autrement que le Père Piou. Par ce nom familier, les élèves voulaient exprimer tout ce qu'ils ressentaient de tendresse, de respect et de confiance pour le vénérable prêtre qui se dé-vouait à leurs âmes. «Il était impossible de le voir passer dans nos rangs, les yeux à demi-fermés, avec sa belle cou-ronne de cheveux blancs, son bon sourire, son air d'exquise bonté et de sainteté répandu en tous ses traits, sans avoir le désir de devenir meilleur. Il était le confident de nos peines, de nos joies, de nos fautes d'écoliers : Sa chambre était la nôtre». Tel est le témoignage que lui rendait naguère un de ses disciples, M. le chanoine Brossard.
Cette chambre du Père Piou, Ernest la connaissait bien.
«Un soir, raconte-t-il, nous regardions, M. Piou et moi, Un album des divinités de l'Inde. Peu à peu, je le sentais s'animer. Il parlait d'apostolat et, de son regard perdu dans l'espace, il semblait embrasser ces populations im-menses. Il se taisait, puis tout à coup me fixant :
- Il faudrait des ouvriers, des apôtres.
- Mais n'y a-t-il pas aussi du bien à faire en France ?
- C'est vrai. Mais, ici, Notre-Seigneur est connu ; là-bas, il est ignoré. Ici, tout est joie ; là-bas, tout est sacrifice... Impatient enfin de formuler d'un mot ce qui fut la passion de sa vie :
- Ici, c'est une mort vulgaire ; là-bas, c'est le martyre !»
La semence tombait dans une terre généreuse. Pour lever et fructifier, il ne lui fallait qu'un chaud rayon d'en haut, une de ces grâces de choix, comme celle qu'obtinrent du Ciel les larmes de Monique. Cette grâce, Dieu la répandit abon-damment dans l'âme d'Ernest, au cours de la retraite, à la fin de sa rhétorique.
Ouvrons avec précaution les feuillets sur lesquels le retraitant de 1861, d'une écriture ferme, consigna ses pensées et ses résolutions. Complétés par les notes de l'année suivante, ils nous livrent le secret de la transformation qui s'accomplit en lui. Ces notes portent un titre : Entre Jésus et moi. Elles ont une allure de contrat solennel, daté et signé :
«Aujourd'hui, 28 juillet 1861, moi, Jouin Ernest, âgé de seize ans, je me suis consacré au Cœur de Jésus. C'est-à-dire que j'ai pris l'engagement de me conformer, autant qu'il est possible, à ce cœur doux et humble...
De plus, aujourd'hui, j'ai fait à Jésus vœu de chasteté.
J'ai agi ainsi pour plaire à Dieu en répondant aux grâces, qu'Il m'a faites depuis ma naissance, et principalement en cette année, et afin que Dieu augmente en moi la sainte vocation qu'Il m'a donnée.
En troisième lieu, j'ai promis au Cœur de Jésus de dire tous les jours : 1) mon acte de consécration, 2) les litanies de ce Sacré-Cœur.
Tout ceci a été fait et traité entre Jésus et moi le 28 juillet 1861».
Jouin Ernest.
Quatre mois plus tard, il ajoute :
«Afin de me préparer à la vie sainte et pure à laquelle Dieu m'a destiné, aujourd'hui, 21 novembre, jour de la Pré-sentation de la Sainte Vierge, je me suis consacré entièrement à Dieu sous la protection de Marie.
J'ai agi ainsi parce qu'ayant beaucoup reçu, il est juste que je donne tout à Dieu, parce qu'en donnant tout, je suis sur de recevoir cent fois plus et d'obtenir enfin cette force qui me fera vaincre l'orgueil, le démon de la chair, l'atta-chement aux choses d'ici-bas, cette force qui doit me rendre saint.
Je me consacre donc entièrement à Dieu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai Lui appartient, que je ne dois rechercher que Lui et faire toujours Sa sainte volonté : et afin d'y arriver, je ferai bien, avant toute action, de l'offrir à Dieu en Lui demandant ce qu'Il attend de moi, et de dire tous les matins : Mon Dieu, souvenez-Vous que je Vous appartiens en-tièrement.
Tout pour Dieu, tout par Dieu, tout avec Dieu».
8 décembre 1861
«Partant de ce principe qu'il me faut être saint, je raisonne ainsi : Être saint, c'est toujours faire la volonté de Dieu...
Vu mon extrême faiblesse, il faut, pour ainsi dire, me forcer à obéir à Dieu. Je m'y forcerai en faisant le vœu d'obéissance qui consiste à observer la règle qui m'est prescrite par mes Supérieurs, parce que cette règle est l'ex-pression de la volonté de Dieu...
Ce vœu m'astreint aux engagements les plus difficiles, je le sais, mais il faut de la générosité envers Dieu, si l'on veut qu'Il nous soutienne. Au reste, je n'agis, il me semble, que d'après Sa propre inspiration».
Le retraitant précise alors les moyens qu'il emploiera pour tenir ses engagements : la vigilance et la prière ; vigilance qui le maintiendra dans le recueillement et en la présence de Dieu - la prière, c'est-à-dire l'usage fréquent de l'oraison et des Sacrements.
Dans ces notes et dans le Règlement qui les suit, apparaît déjà la nature mystique et généreuse d'Ernest Jouin. C'est au Cœur de Jésus qu'il va puiser la tendre piété qui éclate dans ces lignes. «Cœur de Jésus, ne souffrez pas que je sois jamais séparé de Vous !» C'est l'invocation qui leur sert d'introduction.
C'est à ce Cœur qu'il se consacre. Ce Cœur, il lui semble l'entendre : «Voilà, dit-il, ô mon Jésus, ce que Vous m'avez dicté. Vous seul étiez capable de me l'inspirer ; Vous seul êtes capable de me faire tenir mes engagements. Je n'ai pas de force, voilà pourquoi je me donne à Vous ; j'étais esclave du respect humain, je veux reconquérir ma liberté en ac-complissant Votre sainte volonté ; enfin, je ne Vous aimais pas, et je veux mériter Votre amour : Ah ! assez de fois, mon Dieu, Vous m'avez crié : J'ai soif de ton amour, sitio. C'est à moi maintenant d'avoir soif de Vous, c'est à moi de Vous ai-mer, car Vous m'avez assez aimé. Déjà j'ai fait vœu de chasteté, je fais vœu d'obéissance, ce vœu me lie pour ainsi dire à embrasser la vie religieuse à laquelle, je le vois clairement, Vous me destinez. Il ne me reste plus que le vœu de pau-vreté : puissé-je le mettre en pratique jusqu'à ce que je le fasse»
Mais ce Cœur aimant, il L'a méconnu par ses ingratitudes ; il L'a offensé par des fautes sans nombre : «Fils d'une mère chrétienne, arraché, malgré moi, à l'enfer, et, après des chutes sans nombre, forcé de me relever. Que de bontés et que d'ingratitudes ! J'ai été un enfant choisi. Jésus eût pu me dire mille fois : Tu quoque, fili !»
Jésus aurait pu l'abandonner à l'enfer. «Sainte Thérèse pour de petits riens faillit y aller. C'était juste : sa tiédeur - à elle comblée de grâces - faisait plus de mal à Dieu que les sacrilèges des impies. Moi aussi, je suis comblé de grâces : mon compte sera d'autant plus terrible».
Dans l'enfer, ce qu'Ernest voit surtout, c'est la privation de Dieu : «Le Ciel, dit-il, c'est Jésus, et l'enfer, Sa privation. Comment passer une éternité privé de mon ami, de mon seul ami ! Eh ! quoi ? Je rechercherais quelques plaisirs de ce monde, quelques satisfactions d'orgueil, pour perdre Jésus ?»
Ce Cœur de Jésus méconnu et blessé réclame des réparations : il est prêt à les lui offrir : «Il y a des méchants qui of-fensent Dieu par des sacrilèges, qui ne correspondent pas à Ses grâces, des ingrats qui reposent sur le Cœur de Jésus, Le caressent d'une main et de l'autre Le percent de coups d'épingle. A nous de réparer ces outrages».
Ce Cœur enfin sollicite des consolations : «Il y a des saints qui souffrent tout pour Jésus, qui réjouissent Son Cœur : soyons des victimes expiatoires pour les autres».
Victime, il veut l'être. Il immole sa chair par le vœu de chasteté, sa volonté par le vœu d'obéissance, tout ce qu'il a par le vœu de pauvreté. A ces sacrifices il en joindra d'autres : privation de soupe le matin et de goûter le jour de sa confes-sion, chemin de croix deux fois la semaine. La plupart du temps, il se tiendra dans une attitude incommode ; il s'applique-ra à être aimable envers tous...
Ainsi purifié par la pénitence, il s'attachera à acquérir la foi, la confiance, la charité, la douceur, l'humilité, la force, la tempérance, la chasteté : «J'ai pris, dit-il, la résolution de me conformer à ce Cœur doux et humble. Je dois être doux, af-fable envers tous, humble et soumis à Dieu et aux hommes». Cette pratique des vertus chrétiennes est le second degré de la vie mystique.
Il s'élance alors vers les sommets, et rêve de parcourir la voie des parfaits, où l'âme sans cesser de pleurer ses infidé-lités ni de poursuivre l'acquisition des vertus, tend à les ramener toutes à une seule : l'union intime et amoureuse avec son Dieu.
Dans son Règlement de retraite nous lisons encore : «La vigilance que je dois exercer pour arriver à tenir mes pro-messes, réclame l’oraison jaculatoire et la communion spirituelle qui doivent toujours me tenir comme en présence de Dieu. C'est dans ce but que je promets à Dieu de Lui offrir toutes mes actions et que je Lui promets de faire chaque jour environ quinze fois la communion spirituelle : c'est bien peu quand je vois une sainte la faire trois cents fois par jour...»
Il entre ensuite dans le détail le plus minutieux : les vertus qu'il pratiquera à chaque exercice de la journée, les dévo-tions de chacun des jours de la semaine, tout cela est prévu. Le dimanche est consacré au Saint-Esprit, le mardi à son saint Patron... La journée se terminera par un examen écrit.
Qu'une âme généreuse, dans la ferveur d'une retraite, se trace un beau programme de perfection, il n'y a rien là de surprenant. Mais que dans tout le cours de la vie et jusqu'à une extrême vieillesse, ce programme se trouve réalisé, voilà la merveille. Les témoins des dernières années de M. Jouin sont unanimes à admirer sa fidélité à la confession hebdo-madaire, à l'oraison, à la mortification.
L'année suivante, à la fin de la retraite, Ernest Jouin renouvelle ses vœux d'obéissance et de chasteté et termine par ces mots : «Encore deux mois de vacances, deux mois dans le monde et tout est fini, je suis à Vous...»
Quelques jours plus tard, après avoir embrassé le Père Piou, salué la Vierge dorée, il disait adieu à Combrée. Du col-lège, il emportait mieux que tous les succès scolaires : sa piété reconquise et l'assurance de sa vocation religieuse.
* * *
Au mois de septembre, Ernest se dirigeait vers le noviciat des Dominicains, à Flavigny. Son frère aîné, qu'un coup de la grâce et l'action de sa mère avaient arraché au monde et jeté dans le cloître, venait lui-même d'y entrer et transporté de joie en apprenant la décision d'Ernest, il écrivait à madame Jouin : «Si Ernest doit venir ici, que ne vient-il immédiate-ment ? Il commencerait sa retraite en même temps que moi... Le plaisir pour moi serait inappréciable». Mais Ernest n'ar-rivant, pas, et la prise d'habit ayant été fixée au 28 août, il écrivit :
«Je n'attendrai donc pas Ernest. J'aurais été heureux de prendre l'habit en même temps que lui. Toutefois, en le précédant, je lui serai peut-être plus utile... Qu'il vienne donc, aussitôt que cela sera possible. Je tâcherai de lui mon-trer la route, jusqu'à ce que lui-même me prêche d'exemple, à son tour, et me soutienne dans cette voie de sacrifice qui lui est déjà familière».
Qu'attendait donc Ernest ? Voulait-il donner à sa vocation l’épreuve de deux mois passés dans le monde ? Éprouvait-il quelques difficultés pour obtenir de l'Évêché les lettres testimoniales nécessaires à son entrée en religion ?...
Quoi qu'il en soit, Amédée, devenu le Frère Augustin, avait pris l'habit depuis dix jours, lorsque le nouveau postulant se présenta aux portes de Flavigny.
Dès les premiers jours de la retraite, sa vocation parut indéniable et le 23 septembre 1862 - il n'avait pas encore dix-huit ans - il revêtit la robe de saint Dominique, en prenant pour patron le Bienheureux Mannès, frère du saint Fondateur.
Cette cérémonie ne fut pas sans éclat. Le Frère Mannès reçut l'habit des mains du Général de l'Ordre, le Révérendis-sime Père Jandel, de passage à Flavigny, et le soir même, il adressait à sa mère ce simple récit :
«Je fus d'abord soumis à quelques minutes d'attente à la porte de la salle du Chapitre, puis j'entrai et je me pros-ternai à terre. Au bout de peu d'instants, je me relevai. Le Révérendissime Père Général, s'adressant à moi, exposa les devoirs des religieux dans une courte allocution. Je quittai alors mon vêtement laïque et l'on me revêtit de la robe blanche et de la chape de laine noire. La vêture achevée, nous nous rendîmes à la chapelle. Je pris place au milieu du chœur et me prosternai, selon la coutume des religieux lorsqu'ils font la venia, au moment de la sainte commu-nion. Lorsque je me fus relevé, on entonna le Te Deum. Le Général me donna le baiser de paix et je le donnai moi-même à tous mes Frères».
Le corollaire de cette scène touchante nous est fourni par le Frère Augustin. Lui aussi prend la plume au lendemain de la cérémonie.
«Le frère Mannès, écrit-il, est des nôtres depuis avant-hier. Comme tu pressentais, ça été pour notre couvent une véritable fête de moines, une fête de famille dont le cœur fait tous les frais. Frère Mannès te parlera sûrement du Ré-vérendissime Père Général ; je veux t'en dire aussi quelques mots.
J'ai été particulièrement frappé de l'abandon plein de charme, de la bonté toute patriarcale avec lesquels ce saint moine se laissait aborder par de pauvres petits novices tels que nous. Si tu avais pu voir comme il s'entretenait sim-plement avec nous, comme il vivait de notre vie, et avec quelle affabilité il nous embrassa tous en partant. C'est que la piété transforme l'homme. Ah ! si l'on pouvait révéler au monde ces horizons nouveaux que donne à l'âme la vie chrétienne vraiment sérieuse, en Jésus, en Sa loi, en Son amour, et si le monde pouvait le comprendre une bonne fois, il y aurait plus de saints qu'il n'y en a, et tous voudraient le devenir».
Un saint ! c'est pour le devenir que le Frère Mannès embrassait la vie religieuse et qu'il allait s'exercer à la pratique des vertus monastiques. Cette formation, dit l'Imitation, «n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un simple jeu d'enfant. Ce n'est pas rien que d'habiter dans un monastère, d'y vivre sans reproche, et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort». C'est un moine qui parle ainsi à des religieux : «Il faut apprendre ici à vous briser en beaucoup de choses».
Il faut en effet briser la nature orgueilleuse, car «c'est pour servir et non pas pour commander que vous êtes venu... Ici personne ne peut persévérer s'il n'a pas la plus cordiale volonté d'accepter pour Dieu l'humiliation».
Il faut briser la nature toujours avide de jouissance, «rarement sortir, de la retraite faire sa vie, être pauvrement nourri, grossièrement vêtu, beaucoup travailler, peu parler, veiller tard et se lever tôt, prier longtemps, fréquemment lire et garder en tout une discipline exacte».
Il faut briser la nature avide de posséder. Le religieux n'a rien en propre, pas même le vêtement qu'il porte. Il aban-donne jusqu'au désir d'avoir.
Cette violence continuelle faite aux penchants naturels est le fond de la vie religieuse et la sainteté est à ce prix. Pour cette formation, l'année du noviciat simple ne suffit pas. Il y faudra les années du noviciat profès et la vie entière.
Voici du reste l'emploi d'une journée à Flavigny.
Le premier lever sonne à 2 heures. Les religieux quittent la planche qui leur sert de lit et sur laquelle ils dorment avec leur vêtement, enveloppés dans une couverture. Ils descendent au chœur pour le chant des Matines et Laudes. De retour dans leurs cellules, ils reposent jusqu'à six heures. C'est le moment du second lever. Un quart d'heure plus tard, ils sont au chœur, chantent Prime et assistent à la messe conventuelle. A l'issue de la messe, chacun rentre dans sa cellule, ré-pare le désordre de la nuit, prend les soins qu'exige la propreté. Cela fait, les novices se retrouvent au réfectoire, où les attend un déjeuner frugal, durant les quelques mois soustraits au grand jeûne.
A huit heures, étude de l'Écriture Sainte, à huit heures et demie, leçon sur les constitutions de l'Ordre, remplacé à cer-tains jours par une classe de Psaumes, un Commentaire des Rubriques, ou l'étude des Cérémonies. A neuf heures, le Petit Office de la Sainte Vierge et le chapelet. A neuf heures et demie, lecture spirituelle, à la salle commune, et deux fois par semaine, le chapitre des coulpes, c'est à dire l'aveu spontané ou la dénonciation publique en présence de la Com-munauté réunie de tous les manquements à la règle constatés depuis la dernière coulpe.
A dix heures, oraison en cellule. Une demi-heure après, lecture d'une vie de Saint. A onze heure, temps libre, à onze heure vingt, examen particulier et, deux fois chaque semaine, la discipline. A onze heures et demie, les Petites heures du grand office. Viennent ensuite le diner toujours maigre, la récréation et les vêpres. De deux heures à trois heures, temps libre. Les vêpres et les complies de la T.S. Vierge, une prière à saint Thomas d'Aquin sont récitées à trois heures. A l'is-sue de cet exercice a lieu le travail manuel (confection de cilices, de chapelets et de disciplines, nettoyage du cloître, de la salle commune, du chœur). Les charges les plus humbles, les tâches les plus pénibles incombent aux novices. Une classe de chant venait ensuite, suivie à cinq heures d'une étude ; à six heures et demie oraison, lecture spirituelle au Chapitre.
Au noviciat profès, à Saint-Maximin, la règle était la même, mais certains exercices du matin et du soir étaient rempla-cés par des classes d'histoire ecclésiastique, d'Écriture Sainte ou de Droit Canon ; ou des cours de théologie dogmatique et morale. A dix heures un sermon, une dissertation ou une thèse. Le sermon avait pour objet d'habituer l'esprit au déve-loppement oratoire, la dissertation visait le style ; la thèse était une argumentation en forme.
Voilà la règle austère à laquelle, pendant des mois, des années, le novice, simple ou profès, doit plier son corps, son esprit, sa volonté, son être tout entier.
De rares exceptions modifiaient cet enchaînement ininterrompu d'exercices laborieux. Une part était faite, à de cer-tains jours de la semaine, aux travaux littéraires. Mais ce n'étaient là que de courtes haltes, et, somme toute, la vie d'étu-diant au noviciat, ne laissait pas d'être pénible.
Le Frère Mannès sortit victorieusement de toutes ces épreuves, puisqu'un an après son entrée, on l'admit à faire sa profession le même jour que son frère, le 23 septembre 1863.
Dès les premiers jours du mois, les deux frères avaient annoncé à leur mère la date de l'heureux événement.
«Nous entrerons en retraite le 13. Viens donc au plus tôt. Nous t'attendons avec impatience. Songe, chère et bien ai-mée mère, que pendant les dix jours de notre retraite, il ne nous sera pas permis de te voir, et dès le lendemain de notre profession, nous devons prendre le chemin de Saint-Maximin, pour le noviciat profès… il faudra nous séparer...»
Madame Jouin répondit à ce pressant appel. Elle fut témoin de la profession de ses deux fils. Puis, autorisée à les conduire à la Salette, où elle voulait se rendre en pèlerinage d'action de grâces, tous les trois prirent le chemin de Gre-noble. Quelques jours plus tard, ils se séparaient à Lyon. Madame Jouin rentrait à Angers, tandis que le Frère Augustin et le Frère Mannès gagnaient Marseille et Saint-Maximin.
A peine était-elle arrivée qu'elle recevait de ses fils une longue lettre datée du couvent. Ils avaient communié à N.-D. de la Garde, visité les cachots de Mirabeau, du Masque de Fer et de Monte-Christo. Le lendemain, à midi, ils étaient à la Sainte-Baume et avaient gravi le Saint-Pilon. «De retour à l'Hôtellerie, ils avaient dû eux-mêmes préparer leur souper avec un peu de lait et des haricots de rencontre. Repas frugal, assaisonné de gaieté»...
Au mois de juillet 1914, à la fin d'un séjour à Saint-Christophe-en-Oisans, où il avait conduit, avec deux de ses vi-caires, un curé de Paris souffrant, le Curé de Saint-Augustin voulut revoir les lieux témoins de sa jeunesse dominicaine. Avec ses compagnons, guides en tête, il franchissait les pentes neigeuses du col de la Muselle, passait la nuit dans un refuge alpestre, pour gagner, après deux jours de marche, le sommet de la Salette. Puis par Gap, Notre-Dame du Laus et Aix, il arrivait à Saint-Maximin. Le vieux couvent était silencieux ; les moines en avaient été chassés, mais les lieux parlaient à son âme.
L'après-midi, refusant la voiture qui lui était offerte, il fit seul, sous un soleil ardent, la longue route qui sépare Saint-Maximin de la Sainte-Baume, plus libre ainsi de laisser sa pensée s'en aller au fil de ses souvenirs. Il gravit une dernière fois le Saint-Pilon, célébra pour la première fois, la messe dans la Grotte de Marie-Madeleine, et, par Notre-Dame de la Garde, terminait ce pèlerinage d'action de grâces.
Pendant trois ans, soit à Saint-Maximin, soit à Flavigny, où le noviciat profès fut transféré deux ans plus tard, le Frère Mannès poursuivit ses cours de théologie et d'Écriture Sainte. Mais le climat de la Provence, la continuité des études, l'abstinence perpétuelle, le jeûne épuisaient rapidement les forces des novices profès. Les Frères originaires des régions tempérées de la France souffraient plus particulièrement des chaleurs du Midi. Le Frère Mannès, entré trop tôt dans l'Ordre, fut l'un des plus gravement atteints et, à plusieurs reprises, il retourna près de sa mère pendant les mois d'été.
On pouvait espérer que le climat plus tempéré de Flavigny, serait plus favorable à sa santé. Mais au bout d'une qua-trième année, il fallut se rendre à l'évidence. Un tempérament si délicat ne pourrait jamais s'accommoder aux rigueurs de l'observance, et, au mois d'août 1866, le Frère Mannès rentra à Angers, quittant non sans regret la robe dominicaine pour revêtir la soutane du séminariste.
Il ne s'en consola jamais. Cinquante ans plus tard, le jour de ses noces d'or, remerciant le R.P. Hébert d'avoir évoqué le souvenir de sa vie dominicaine avec son frère «de si douce et si éloquente mémoire», il lui disait avec l'accent d'une vive émotion :
«C'était ma première jeunesse ; et, des couvents de Flavigny et de Saint-Maximin, des apparitions insoupçonnées de saint Dominique et de son frère le bienheureux Mannès, de saint Thomas d'Aquin, de saint Pierre martyr, de sainte Catherine de Sienne, de sainte Rose de Lima, de ces phalanges d'élus passant devant mes yeux éblouis, s'était dégagé un idéal de splendeur, de science, de sainteté, d'héroïsme qui m'a ensoleillé jusqu'à ce jour, me lais-sant, comme une blessure au cœur, le regret persistant de ne pas vivre et de ne pouvoir mourir dans la robe blanche de mes dix-sept ans. J'ai parlé de la mort parce que ce sont les souvenirs les plus vivants qui me restent. C'était le frère Proyart, c'était le Père Gaidan. Nous nous réunissions autour de la planche d'agonie ; les frères agenouillés laissaient tomber le rosaire sur les dalles de la cellule, et cela vibrait à mon oreille en des sons argentins d'une clo-chette d'appel ; nous chantions à mi-voix le Salve Regina, comme pour bercer et endormir du dernier sommeil celui qui nous quittait, et la Vierge, invisible mais présente, descendait doucement pour emporter sous son grand manteau bleu, selon la vision du Patriarche de l'Ordre, cette âme dominicaine dans son royaume de paradis... Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai rêvé, mais, hélas ! ce n'était qu'un rêve !»
Plus tard, se croyant rétabli, il songea à revenir parmi ses Frères. Son directeur, M. Bieil, l'en dissuada. Toutefois on le vit longtemps, porter autour du cou un foulard blanc et, sous ses vêtements, jusqu'à sa mort, un scapulaire de même cou-leur : souvenir de sa vocation dominicaine.
Simple minoré quand il entra au grand séminaire d'Angers, il reçut, en dix-huit mois, les autres ordres : le sous-diaconat (décembre 1866) le diaconat six mois après, et le 23 février 1868, la prêtrise des mains de Mgr Angebault, son évêque.
(à suivre...)
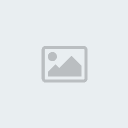
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 1)
CHAPITRE II LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE.
AU CHATEAU DE LATHAN. - SA CORRESPONDANCE AVEC M. LAROCHE, SON DIRECTEUR. - CONSEILS SUR LE JEU DE CROQUET ET AUTRES JEUX. - CONSEILS LITTERAIRES ! ETRE SOI-MEME. - CONSEILS DE PIETE. - CRISE DE SANTE. - DECOURAGEMENT. - IL VOUDRAIT ARRIVER A L'ORAISON D'UNION. - IL REVE D'UN CHAMP D'ACTION PLUS VASTE. - PARIS L'ATTIRE. - SON DIRECTEUR L'EN DETOURNE : OPINION FAUSSE QUE SE FAIT M. LA-ROCHE DU CLERGE DE PARIS. - «DONNEZ-VOUS A L'ANJOU». - LE VICARIAT DE BREZE. - NOUVELLE CRISE DE DECOURAGEMENT : L'ABBE JOUIN VOU-DRAIT MOURIR. - SA VIE INUTILE. - IL EST NOMME VICAIRE A LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH D'ANGERS ET TROIS MOIS APRES A LA CATHEDRALE. - AVEC LES SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE UNE ŒUVRE DE JEUNESSE. SES DEUX PREMIERS ELEVES. - IL OBTIENT DE REJOINDRE A PARIS SA MERE ET SES DEUX FRERES. - UNE PROPHETIE DE MGR FREPPEL QUI NE S'EST PAS REALISEE. - L'ABBE JOUIN EST NOMME VICAIRE A SAINT-ETIENNE DU MONT A PARIS, ET, BIENTOT, CHAPELAIN DE SAINTE-GENEVIEVE. - IL TOMBE GRAVEMENT MALADE. - DANS LES PINS D'ARCACHON.
LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE DE BRÉZÉ.
La santé encore mal rétablie de l'abbé Jouin ne lui permettait pas, au sortir du séminaire, d'affronter les fatigues d'un ministère actif. Il se résigna donc aux fonctions de précepteur ou plutôt de surveillant des études du jeune François, fils du Comte et de la Comtesse de la Bouillerie, et neveu de l'évêque de ce nom . Mais bientôt, son élève étant entré comme interne dans un collège des Jésuites, le jeune prêtre fut nommé vicaire d'une petite paroisse du Saumurois, à Brézé. Là encore, son séjour sera de courte durée, et moins de quatre ans après son ordination, la confiance de son évêque, Mgr Freppel, l'appellera à un poste plus important, à Angers.
De cette période de sa vie (mars 1868-août 1871) nous savons peu de chose. Sauf un voyage à Dijon pour l'ordina-tion de son frère, le Père Augustin Jouin, deux séjours à Paris - où il accompagnait son élève, externe, pendant les mois d'hiver, au collège de Vaugirard - et enfin une apparition de son frère à Brézé pour un sermon, le dimanche de la Quasímodo 1870, aucun événement notable ne vint interrompre la monotonie de son existence. Déjà cependant se fai-saient jour son esprit d'initiative et son zèle pour les âmes.
Précepteur, il composait à l'usage de son jeune disciple les rudiments d'une grammaire française ; vicaire, il trouvait, en un si court espace de temps, le moyen de grouper quelques jeunes gens du village et de leur faire jouer des comédies dont les vieillards d'aujourd'hui gardent encore le souvenir,
A la surface, sa vie coulait calme et tranquille. Mais dans les profondeurs, son âme était violemment agitée. Cette crise, nul ne la connut, en dehors du prêtre qui avait dirigé à Angers la conscience du séminariste. Nous n'avons pas les lettres que, précepteur ou vicaire, l'abbé Jouin lui adressa, nombreuses, au cours de ces trois ans. Mais des réponses du Directeur, heureusement conservées, jaillit assez de lumière pour éclairer le drame intérieur qui agite l'âme du jeune prêtre.
L'abbé Jouin est donc au château de Lathan, près de Baugé, chez le Comte et la Comtesse de la Bouillerie. A ses heures libres, il lit, travaille, s'exerce à la composition littéraire ; son âme est en progrès : il a des consolations sensibles dans son oraison ; il croit même avoir été favorisé d'extases. Mais bientôt une note triste et découragée se fait entendre : il pense à sa mère qu'il voudrait aider, à son passé évanoui, à ses rêves de vie religieuse et d'apostolat écroulés... l'ave-nir est plus sombre encore ! Avec sa santé délabrée que pourra-t-il être ? Précepteur ? Vicaire de campagne ? lui qui se sentait des ailes et fait pour l'action !... A quoi bon vivre ainsi ? Ne vaudrait-il pas mieux mourir ?...
Dans ces alternatives de confiance et de découragement, pour ses travaux littéraires même, il aurait besoin d'un guide, d'un conseiller, d'un appui... Il recourrait à son Directeur, s'il ne craignait de l'importuner.
Et les réponses du prêtre arrivent, tour à tour paternelles ou sévères. Suivant le cas, le prêtre encourage, éclaire, sou-tient, reprend son pénitent.
La première lettre de l'abbé, à son arrivée, ne devait pas être tout à fait enthousiaste, car, dans sa réponse, le Direc-teur se croit obligé de souligner les avantages du château. Cette lettre est du 6 mai 1868.
«Vous voyez, mon cher ami, que j'use largement de la permission que vous m'avez donnée, de ne me point gêner avec vous. La recommandation était bien inutile, et je vous engage à ne point la renouveler : ma paresse trouverait peut-être là un prétexte dont elle n'a pas besoin. Elle est par elle-même assez ingénieuse pour en trouver de toutes sortes... Pressez-moi plutôt et fâchez-vous quand je vous ferai trop attendre : vous me rendrez ainsi un grand ser-vice...
Et que vous dirai-je ? Que je vous aime bien ? Je veux croire que vous l'avez deviné, malgré toutes les raisons d'en douter que je vous ai données si souvent. Je porte une bien dure écorce et je ne puis pas toujours disposer de moi. Le poids d'infirmités que vous portez vous-même vous a fait comprendre et vous a rendu indulgent. Je crains bien de rester toujours le même ; j'espère que vous serez toujours aussi bon.
Je suis très heureux d'apprendre que vous êtes content de votre nouvelle position : vous êtes avec un monde ex-cellent et votre petit bonhomme est tout à fait aimable. Très bien. De plus vous avez envie d'être très bon, très pieux, un prêtre parfait et vous faites de la littérature ! Rien de mieux. Tous vos vœux sont accomplis et aussi les miens. A moins que la santé ne vienne là jeter une vilaine ombre. Vous ne m'en parlez pas, peut-être est-ce le moindre de vos soucis. Croyons plutôt que vous êtes content même de votre santé. Elle serait vraiment bien revêche si elle s'avisait d'être maussade. N'a-t-elle pas tout à souhait ? Le repos, la belle campagne, le doux printemps et tout le reste ! Vous êtes fait pour le bonheur ; il y a longtemps que je vous l'ai dit, sans compter que tout le monde veut vous avoir. Comment ferez-vous pour vous donner à tous ceux qui vous demandent ?... »
Celui qui signait ces lignes, M. Laroche, était professeur de morale au grand séminaire d'Angers, après avoir enseigné la philosophie à Issy, avec un tel succès que le jeune abbé d'Hulst, un de ses élèves, avait demandé à renouveler avec lui sa première année. Un de ses élèves angevins, Mgr Crosnier, en a tracé un saisissant portrait : «Dans une tête large et forte, deux yeux profonds, chargés de pensée, cachés derrière une broussaille d'épais sourcils, lui donnaient un air in-vestigateur ou même inquisiteur. Les timides prenaient peur au premier aspect ; mais sa voix douce, claire, harmonieuse les rassurait... M. Laroche était un excellent directeur, un directeur recherché. Cette paternité lui fit faire des actes hé-roïques. Lui, qui avait horreur de la plume, il a envoyé des milliers et des milliers de lettres à ses «pénitents». Lettres ai-mantes, toute pleines de sages conseils, de confidences amicales, d'abandons gracieux...»
On en jugera mieux par les larges extraits que nous allons faire de sa correspondance avec l'abbé Jouin.
Voici l'été. Le château s'anime. Des visites arrivent. Des jeux s'organisent. On joue au croquet. Quelle part l'abbé doit-il prendre à ces récréations ? Et la réponse arrive fine, doucement moqueuse d'abord, pour s'élever bientôt à des consi-dérations d'une philosophie toute surnaturelle :
23 juillet 1868. - «C'est donc le croquet qui vous tourmente ! Je ne connais pas ce jeu. Je n'aurais pas cru qu'il y eût là de quoi ébranler une tête de philosophe. Je sais bien cependant que c'est au jeu surtout que se dévoile un homme. Il paraît que vous n'échappez point à la loi commune et, vous aussi, vous êtes trahi par le jeu.
Que voulez-vous que je vous dise ? De ne pas jouer ? Cela serait bien dur et, dans les circonstances où vous vous trouvez, ce serait comme impossible. Jouez donc, mais quand les convenances vous obligent de le faire. Ne faites point naître les occasions, ne les fuyez pas non plus d'une manière qui pourrait gêner.
Je crois que le meilleur moyen de vous guérir des préoccupations qui naissent du jeu, c'est d'abord de ne point tant tenir à gagner. Il faut même être, au moins quelquefois, content de perdre. Il y a un plaisir, que vous apprendrez à goûter, à perdre au jeu, c'est le plaisir de voir les autres contents d'avoir gagné...
Je voudrais aussi que vous fissiez quelques considérations sérieuses, philosophiques et chrétiennes sur la vanité de ces graves occupations du jeu de Croquet. En moins de dix minutes, si je ne me trompe, vous en aurez assez pour vous guérir de cette passion. Pauvre nature humaine, à quoi elle se laisse prendre !...»
Des scrupules plus sérieux tourmentent le jeune prêtre. Doit-il s'accuser en confession de ses fautes de vanité dans le détail ? Il a peur de faire rire son confesseur, s'il lui dit «toutes ces drôleries» :
«Il n'est pas nécessaire de descendre dans les derniers détails, répond le Directeur. C'est plutôt affaire de direc-tion. Cependant vous pouvez le faire quelquefois, surtout lorsque vous y aurez plus de répugnance. Il en coûte peu de dire en général que l'on a eu de la vanité, cela est même assez bien porté quelquefois, mais de dire que l'on a fait tel vilain petit péché, c'est un autre affaire. Mais pas de scrupules».
L'époque des vacances laisse quelques loisirs au précepteur. Il les met à profit pour s'essayer à des compositions qu'il soumet à son Directeur. M. Laroche répond :
21 septembre 1868. – «Il ne m'appartient pas de vous donner des conseils sur vos études littéraires : je ne suis qu'un béotien encroûté et je donnerais à rire si je laissais voir des prétentions d'homme de goût et de littérateur... Voyez si vous pouvez avoir confiance en mon jugement et si je puis oser vous diriger dans vos études !
Permettez-moi, cependant, de vous dire que je ne crois pas bien sûre la voie dans laquelle veut vous pousser votre frère. Il ne faut point viser à la phrase ornée et pompeuse : vous devez avant tout chercher le naturel, parce que le naturel, c'est le vrai, et le vrai lui-même est le beau. Avant tout, enrichissez votre esprit et, en lisant les auteurs, appliquez-vous à saisir les différents aspects sous lesquels ils présentent les choses. Voyez comment ils dévelop-pent un sujet et le fécondent... Celui qui aspire à l'art d'écrire doit d'abord s'appliquer à la méditation. Car c'est elle qui est ici l'ouvrier ; c'est la méditation qui creuse la vérité, qui la développe, la tourne sous toutes ses faces et met au jour toutes ses beautés. Vouloir se mêler d'écrire avant de s'être enrichi par ce premier travail de l'étude sérieuse et longtemps poursuivie, c'est vouloir tirer de l'eau d'une source vide...
Encore un mot. Il m'a semblé que vous étiez préoccupé du désir de trouver un écrivain qui fût plus spécialement votre modèle et que vous puissiez chercher à imiter. Vous établissez même à ce point de vue, une comparaison entre Massillon et Bossuet. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il soit bon de se proposer de suivre pas à pas dans sa manière d'écrire tel ou tel écrivain. C'est se faire esclave et tuer la spontanéité. Notre esprit est nôtre. Il n'est ni celui de Bossuet ni celui de Massillon. Soyez ce que vous êtes et n'empruntez pas une personnalité étran-gère. Si vous empruntiez les vêtements d'un homme plus grand ou plus petit que vous, vous seriez mal à l'aise : les esprits sont encore plus divers que les corps...
Votre légende me paraît passable. Je ne veux point vous flatter en vous disant que vous avez fait un chef d'œuvre. C'est un peu long, lourd et traînant. Voyez si je prends des gants» !
La lettre suivante répond aux mêmes préoccupations littéraires.
24 janvier 1869. - «Depuis le 4 janvier que j'ai reçu votre lettre, j'ai voulu cent fois vous écrire... je ne l'ai pas fait. Est-ce un crime irrémissible ? Je compte pourtant bien que je le commettrai encore bien des fois, si je vis. Mais à quoi bon poursuivre ?...
Vous avez l'audace de me dire que vous éprouvez souvent le besoin de m'écrire et que vous ne le faites point parce que et parce que... Je ne suis pas content, et de moi surtout, car vous me donnez la preuve que j'ai manqué envers vous de simplicité et de bonté. Je ne pourrais pas dire tout à fait que ce soit à mon insu, mais c'est, bien sûr, à mon grand regret. Je suis mal fait, mal outillé, et trop souvent je ne dispose point de ma personne comme je vou-drais ; je prends des airs d ours et de tigre et je fais peur, et l'on fuit. Croyez que je ne suis qu'un vieux gros mouton qui est souvent malade et qui, à cause de cela, fait mauvaise mine.
Donc, vous avez envie de travailler, de devenir savant et de composer de beaux ouvrages. Je suis aussi de cet avis. La seule difficulté c'est de trouver les moyens, et les moyens pour vous, c'est la santé et le temps. Or pour vous procurer ces deux choses, je suis un peu embarrassé. Et puis vous avez le malheur d'être bien jeune et de le pa-raître... Il faudrait peut-être avoir la patience d'attendre quelques années... Si cela est nécessaire, il faudra bien pren-dre votre cœur à deux mains et lui dire de se calmer... Et que devenir pendant ce temps ? En attendant la place dési-rée, vous seriez aumônier du château de quelque douairière. Mais ce monde vous fatigue et vous ennuie ! - Vous avez si grand besoin de faire pénitence !
Je ne vous parle point de Sainte-Geneviève (il s'agit d'une place de Chapelain de Sainte-Geneviève, à Paris, pour laquelle on avait dû faire une proposition à l'abbé Jouin). Mon premier mouvement a été de repousser cette proposi-tion ; mais j'aime mieux vous dire que je ne vois pas assez clair et qu'il faudrait mieux connaître ce terrain. Puisque vous allez à Pâques vous fixer pour deux mois à Paris, vous verrez. Ne prenez pour le moment aucune résolution.
Et vos extases ! C'est bien. Occupez-vous de Dieu, de votre bon Maître, et fort peu de vous. Vous me dites que vous êtes en progrès et que vous comptez bien avancer toujours. Dieu soit béni ! Aucune nouvelle ne pouvait m'être plus agréable. Vous savez la leçon qui ne trompe pas : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat cru-cem suam et sequatur me... ama nesciri...
Adieu. Soyez bon, soyez pieux et toujours simple. Et continuez vos études.
La lettre suivante écrite au lendemain de troubles qui avaient agité la Capitale cherche à consoler le précepteur de mécomptes et d'injustices, dont il a été victime et qui ont eu un retentissement jusque dans sa santé.
Du 5 juin 1869. - «J'ai tout l'air de vous abandonner et vous êtes triste, découragé, abattu ! Vous devez m'en vou-loir et je le comprends. A votre place je ne serais pas content du tout. Mais à votre place aussi, je pardonnerais à ce pauvre bonhomme, si malade de la paresse et de plusieurs autres maladies. Cependant, croyez-le, il n'est atteint ni du mal de l'oubli, ni de l'indifférence, ni du sine affectione. Je vous aime bien toujours, vous le savez, il suffit.
Je me mets à votre place et je sens que tout ce que vous me dites, me fatiguerait aussi et m'agacerait les nerfs. Mais pourtant, cher ami, soyons sages et ne nous laissons point accabler. Si les hommes sont injustes à votre égard, tant pis pour eux ! Ils sont plus à plaindre que nous. Rien de plus utile pour élever le cœur jusqu'aux régions où il doit habiter que ces mécomptes et ces coups imprévus. Vous avez bien travaillé, vous avez donné tous vos soins, toute votre affection, tout votre zèle et l'on ne vous paie que d'ingratitude ! Allez maintenant vous épuiser pour les hommes ! Non, mon cher ami, et cependant il ne faut pas les mépriser, les abandonner, il faut être bon toujours, toujours dé-voué, mais pour la récompense, ne l'attendez que de Dieu. Ce qui vous est arrivé là, vous arrivera ailleurs, vous ne faites que commencer votre éducation. Que cette première leçon vous soit du moins utile.
Vous me dites que votre santé elle-même est tout ébranlée, de grâce, ne vous fatiguez point trop, et ménagez-vous le plus que vous pourrez, et, comme je soupçonne les idées noires d'être un peu la cause de votre fatigue, chassez bien loin les idées noires.
...Les émeutiers de Paris ne vous font-ils point peur ? Quels gens I... »
Du 30 juin 1869. - «Je me suis couché hier avec un poids bien lourd sur le cœur : je ne vous avais pas écrit ! et vous attendez avec une impatience qui vous donne la fièvre ! Vous avez des craintes, des remords, vous êtes dam-né ! Je savais tout cela, et j'étais bien triste de ne vous avoir pas écrit. Hier, il m'a été physiquement impossible d'écrire.
Aujourd'hui, quelques mots seulement : il me faut prendre sur la nuit.
Votre long mémoire est admirable ! Mais, bon ami, pourquoi donc toutes ces précautions avec moi ? Vous ne croyez donc point à mon amitié ? Vous êtes un méchant... Vous n'irez point à Nantes. Monseigneur ne le veut pas...
Puis, des soucis d'ordre spirituel jettent une ombre sur son âme : il n'avance pas dans l'oraison. Il est triste, mé-content de lui. Et le Directeur de répondre :
Du 7 décembre 1869. - «Vous étiez tout triste le 3 décembre, tout triste et tout découragé et le découragement avait une forte nuance de dépit. Vous n'étiez pas content de vous. Quel malheur, cher ami ! Comment vous n'êtes pas content de vous ! Vous ne vous trouvez pas assez saint, assez parfait, assez savant ! Cela est vraiment tout à fait extraordinaire de trouver un homme qui n'est pas satisfait de sa vie et de ses œuvres !
Enfant que vous êtes. Vous êtes encore assez naïf pour vous imaginer que vous arriverez un jour à mettre tous les nuages au-dessous de vos pieds ! Vous croyez que vous vous établirez pour toujours dans la région du bleu pur et du calme imperturbable. Je vous dis que vous êtes un enfant et que vous ne savez ce que c'est que la vie hu-maine.
Voyez-vous, cher ami, vous serez toujours un petit bonhomme, pas trop fin, peu dévot, et malgré cela tout plein de vanité et de prétentions. Vous ferez des rêves : «à trente ans, je serai à ce point de la montagne, à quarante, j'au-rai dépassé ces pics, à cinquante, je serai au sommet». Oui, à cinquante, vous vous trouverez encore au pied, vous essaierez de faire quelques pas, et puis vous glisserez, et puis vous serez toujours là.
- Autant se coucher et dormir !
- Non pas. Il faut monter, il faut gravir cet âpre sentier.
- Mais vous me dites que je ne puis avancer.
- Non pas, je vous dis que vous aurez beau marcher, vous vous trouverez toujours loin des cimes. C'est que la montagne s'élève toujours ! Vous n'en voyiez qu'un petit point avec vos mauvais yeux. Quand la lumière se fait plus grande, vous découvrez des horizons plus vastes et une route plus longue à parcourir.
Je crois que vous marchez. Il peut se faire que votre marche ne soit pas une course, mais enfin vous marchez à votre manière, comme l'escargot, si vous voulez.
Voici déjà un progrès notable que nous pouvons constater, vous commencez à vous connaître et à vous douter que vous pourriez bien n'être pas tout à fait un phénomène, un phénix...
Voilà bien des métaphores et vous allez dire que je manque de simplicité. C'est vrai ; et cela est d'autant plus fâ-cheux que je voulais précisément vous prêcher la simplicité... Écoutez donc mon petit sermon et ne regardez point à la personne qui le fait. Eh bien ! cher ami, soyez simple et ne philosophez point tant sur beaucoup de choses ; vous êtes toujours dans les analyses et les dissections. Vous me dites que vous ne sauriez me rendre compte de ce qui est en vous, et là-dessus vous commencez votre travail et puis gare ! Combien de fois vous l'avez fait déjà cet exa-men du jugement dernier ! II n'est pas bon, croyez-moi, d'avoir la tête sans cesse courbée sur soi-même. Il sort de là des miasmes et des odeurs marécageuses qui donnent la fièvre. Sans doute il faut avoir attention à son cœur, mais que ce soit pour l'élever au-dessus de lui-même, pour le sortir de ses ténèbres, pour le présenter à la lumière du so-leil et l'unir au bien qui est en Dieu. Aimez Notre-Seigneur, faites Sa volonté, donnez-vous à Lui sincèrement et ne vous demandez point si vous n'arriverez pas bientôt à l’oraison d'union. Quand vous êtes triste, examinez d'où cela vient. Vous trouverez très souvent que c'est l'orgueil qui est la vraie cause de votre chagrin. Le remède est de con-sentir à n'être rien, pas même savant, si Dieu le veut ainsi. Et pourtant travaillez comme vous pourrez et priez dévo-tement».
Vers le printemps ou l'été de 1869, une autre préoccupation se fait jour dans l'esprit de l'abbé Jouin. Il apprend qu'à la rentrée prochaine son élève va entrer au collège des Pères Jésuites, à Poitiers. Il lui faut donc chercher une autre situa-tion. Au Séminaire aussi on y pense et plusieurs préceptorats dont on lui a parlé sont envisagés, à Nantes, à Toulouse et encore ailleurs. M. Laroche donne son avis. «Toulouse, dit-il, c'est si loin, vilain pays, mauvaise cuisine. Est-ce que vous pourriez vous faire au régime de l'huile ? Nantes, pour une raison particulière, est écarté. Et cependant, vous auriez là un piano et pourriez vous livrer à la musique !»
Entre temps, à Paris, où il se trouve à ce moment, on lui suggère de chercher une place dans l'une des nombreuses maisons d'éducation de la Capitale. Il s'arrête même, et assez volontiers, à la pensée de concourir pour un poste de cha-pelain de Sainte-Geneviève. Les chapelains, libres de ministère paroissial, se donnent à la prédication. Son rêve d'autre-fois pourrait se réaliser. Paris ! champ digne d'une activité qui brûle de s'exercer. Mais, dès les premiers mots, le prudent Directeur l'arrête ;
«Je ne vous cacherai pas que je vois avec une sorte de dépit beaucoup de jeunes gens intelligents quitter leurs diocèses pour aller à Paris. Ils auraient pu rendre chez eux de vrais et grands services, et ils s'en vont là-bas, se noyer dans toutes ces inutilités dont vous me parlez dans votre dernière lettre. Il vaut encore mieux être un bon vi-caire de campagne que certains de ces prêtres qui voient tout, qui lisent tout, qui savent tout, qui parlent de tout, et ne font rien».
Et les lettres se succédaient, pressantes du côté du précepteur, modératrices de la part du directeur. L'abbé parlait de sa mère qu'il pourrait aider, de ses études qu'il pourrait poursuivre, quand, au mois de juillet 1869, à Paris, où il se trou-vait, de l'Évêché d'Angers arriva la nouvelle officielle de sa nomination au vicariat de Brézé.
M. Laroche devine la déception de son «pénitent», il s'empresse de lui écrire et lui parle le langage de la foi.
«...Vous en serez quitte pour votre philosophie sur les précepteurs et les préceptorats. En avez-vous posé des principes ! Quelle fécondité de vues, d'aperçus de toute sorte. Cette question est épuisée ; vous l'avez étudiée à fond, sous toutes ses faces et vous ne serez point précepteur... A mon tour, je ne puis me défendre de certaines ré-flexions philosophiques ; elles se résument toutes dans cette belle et désormais vieille maxime : «L'homme s'agite et Dieu le mène». Consolons-nous de notre agitation et de notre inutile effort par cette bonne pensée que Dieu nous mène là où Il veut que nous allions. C'est à Brézé que vous deviez aboutir, c'est là que la Providence vous adresse... «Un sentiment domine tous les autres dans votre cœur : c'est le besoin d'obéir et de n'être que pour le moins pos-sible dans tous les arrangements qui vous concernent... Vous serez donc dispensé d'aller vous offrir à tous les chefs d'institutions de Paris. J'en suis vraiment heureux, car je vous avoue qu'il ne me paraissait guère acceptable que vous fissiez ces démarches. C'est peut-être fierté de ma part...
Revenez donc tout doucement en chantant le Dominus regit me, et nihil mihi deerit. Je vous avais donné la per-mission de rester à Paris quelque temps, faut-il vous dire que ce n'était pas sans une certaine inquiétude. Je crai-gnais pour vous la séduction de cette vie parisienne, je craignais que vous ne puissiez plus ensuite vous résigner à être un simple provincial, et j'en aurais eu un véritable chagrin... Vous appartenez à l'Anjou, donnez-vous à l'Anjou...»
L'abbé Jouin accepta le poste qu'on lui assignait. N'avait-il pas fait vœu d'obéir ? Toutefois, un souci le tourmente. Que fera-t-il dans ce village indifférent, près d'un curé âgé et qui passe pour se nourrir très mal ?...
Son Directeur l'encourage :
«Le jour où vous m'écriviez, un soir sans doute, par un temps sombre, vous n'étiez pas gai. Vos pensées étaient très graves et si sérieuses qu'elles tournaient tout à fait au noir. Les plus graves problèmes venaient se présenter à votre esprit : l'origine du mal et son rôle dans le monde. Vous essayiez de vous consoler par l'O felix culpa ! Un chant plein de feu : vous aimiez, vous aimiez tout, tout, jusqu'aux gens de Brézé, tout à l'exception du Bon Dieu.
Enfant ! Mais vous êtes bien aimable, surtout quand vous consentez à passer inutile sur la terre. C'est un progrès que je suis heureux de constater, pourvu toutefois que nous ne soyons pas quiétiste et que nous travaillions de tout notre cœur à l'œuvre de Dieu. Nourrissez avec soin la flamme sacrée ; mais s'il plaît à Dieu qu'elle se consume en pure perte, comme l'encens, comme la lampe du sanctuaire, qu'importe ? pourvu que ce soit toujours à la gloire de Dieu et du Sauveur Jésus. Quoi que vous en disiez, je suis sûr que vous L'aimez très véritablement et cela vaut mieux que de L'aimer très sensiblement S'il Lui plaisait pourtant de vous sourire, souriez aussi ; mais je ne regrette pas beaucoup les quasi-extases d'autrefois...
A Dieu ! Allez-vous convertir tout Brézé ? Ces pauvres gens, ils n'ont guère le goût de la vérité. Vous le leur don-nerez».
Quelques mois après, nouvelle crise de tristesse. Le jeune vicaire se sent vieux, il voudrait mourir.
13 juin 1870. - «...Mais comme vous étiez vieux dans ce temps où vous m'écriviez I et quel catarrhe sur votre poi-trine ! M. Pasquieri (ami commun de M. Laroche et de M. Jouin et futur recteur de l'Université Catholique d'Angers) m'écrivait hier qu'il était à la Fontaine de Castalie. Peut-être vous serait-il bon de faire vous aussi le pèlerinage de la poétique fontaine. Mais en vous y rendant, il est nécessaire absolument que vous passiez par la fontaine de Jou-vence. Sans cela en voyant arriver ce vieux petit bonhomme enrhumé et grincheux, les Muses de Castalie l'assom-meraient...
Où suis-je ? Avec vous, je crois. Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez bon à mettre aux petites maisons ? nous y voilà.
Mais non, je réponds comme il faut répondre et mes arguments valent les vôtres et ils sont topiques. Cependant vous avez sur moi un avantage. Vous avez fait une découverte et, depuis longtemps, je n'en fais plus. Vous avez donc pu vous douter depuis quelque temps qu'il pourrait bien se faire qu'il y eût des gens à idées pas très larges, un peu étroites même. Vous êtes sagace, mon ami. Et vous osez vous plaindre de vous et de votre génie ! Quand donc avez-vous fait cette trouvaille ? Notez le jour de peur qu'on ne vous la conteste et prenez vos précautions pour vous en assurer la priorité.
Je voudrais vous faire sourire un peu : vous étiez si chagrin. Mais je n'aurai point réussi, j'ai la main trop lourde et l'esprit trop épais. Contentez-vous de l'intention et de la bonne volonté. Je suis, voyez-vous, comme les gros bonshommes qui veulent faire des gentillesses aux petits enfants. Ils sont maladroits et gauches, mais cela même fait rire les petits enfants. Je veux bien prendre ce rôle, pourvu que cela vous égaie un petit moment et vous donne envie de vivre. Ne me parlez-vous pas de l'envie de mourir, oui, et de vieillir à 24 ans ! Je vous en prie, puisque vous êtes jeune, soyez jeune et vivez.
Vous m'avez dit beaucoup d'autres belles choses de cette force. Sainte-Geneviève se trouve là-dedans, le plébis-cite, les barricades et les préceptorats. Tout cela dans un même plat, tout cela danse et remue dans l'eau bouillante. Attendons que le calme vienne et nous verrons ce qui pèse le plus et est allé au fond.
Vous êtes à Brézé, soyez-y content. Vous avez des livres, la nature... vous avez Dieu, que demandez vous ? Ja-mais, nulle part, vous ne serez mieux pour étudier et avoir la paix, malgré ceux qui pourraient bien n'avoir pas les idées très larges. Bonsoir !»
La lettre suivante est du 29 août. La guerre et la maladie ont cruellement éprouvé la famille de M. Laroche. A plusieurs reprises, le vicaire de Brézé a dit son affectueuse sympathie à son directeur :
«Vous êtes bien bon, mon cher ami, et votre amitié me touche très sensiblement. Vos lettres m'ont été une douce consolation dans ces chagrins si cruels. Je vous aime bien aussi ; vous le savez et je compte que cela est pour vous un appui et une force : l'amitié qui vient de Dieu, et qui est selon Dieu, n'est pas seulement la plus douce de toutes les choses, elle est ce qu'il y a en ce monde de plus fortifiant...
- Mais, répétait l'abbé, ma vie est inutile. Qu'est-ce que je fais ici ?
Le vide sera toujours au fond de tous les cœurs humains, répond le prêtre. Ne vous étonnez donc pas d'éprouver ce tourment. Mais faut-il se résigner à mener une vie inutile ? Pourquoi pas, s'il plaît à Dieu de vous tenir dans cette humiliation. Je parle comme un homme, car il est certain que Dieu n'a rien fait d'inutile ; pas même vous, mon cher ami.
Vous êtes là par Sa volonté, vous restez à ce poste parce qu'Il le veut ; vous y souffrez, vous y priez, vous y don-nez le bon exemple et vous dites que votre vie est inutile ! Et le divin sacrifice que vous offrez saintement tous les jours !... Ne dites plus que votre vie est inutile, dites plutôt que vous, qui êtes un tout petit bonhomme, auriez eu cer-tains projets de grand homme, qu'il ne plaît pas à la divine Providence de vous laisser réaliser, au moins à cette heure. Mais en vérité quel mal y a-t-il à cela ? Les plans de Dieu valent bien les nôtres...
Telle est cette correspondance précieusement conservée et annotée par l'Abbé Jouin. Elle jette un jour très vif sur ses sentiments au lendemain de l'ordination sacerdotale. A travers ces lettres, on assiste au drame émouvant qui se joue dans l’âme du jeune prêtre. Après l'échec de son rêve de vie religieuse, ses forces physiques et morales sont ébranlées. La tristesse, le découragement, le doute, les scrupules envahissent cet organisme déprimé.
Puis, il se ressaisit et se reprend à espérer. Il fait des projets d'études, rêve d'apostolat, imagine de vaste travaux et fait même des essais de composition.
Mais son activité souffre d'être emprisonnée dans l'enceinte étroite d'un château ou dans les limites d'un petit village sans religion. Elle s'impatiente et voudrait briser le cadre, prendre son essor, et s'exercer sur un plus vaste théâtre : Paris le séduit et l'attire.
En même temps, dans ces confidences faites au Directeur, nous surprenons les beaux élans d'une âme religieuse qu'attirent les sommets de la vie parfaite, qui s'impatiente de ne pas arriver encore à l'oraison d'union et jouit parfois de consolations très douces, peut-être même, croit-il, d'extases.
Mais la voix du Directeur le rappelle à l'humilité, à la patience, au sacrifice, à l'acceptation de la volonté divine...
Devant le plan de Dieu, l'abbé Jouin inclina ses projets d'avenir. «Il se donna à l'Anjou et à Brézé». De toutes ses forces il se dépensa au service de ces pauvres gens plus occupés de leurs vignes que de leur âme ; et, quand, au bout de dix-huit mois, la volonté de ses supérieurs l'appela au vicariat de Saint-Joseph, l'aristocratique paroisse d'Angers, il n'avait point, sans doute, «converti tout Brézé», mais on nous assure qu'aujourd'hui encore des vieillards gardent le sou-venir du jeune vicaire de 1870-1871 qui leur consacra les prémices de son ministère angevin.
LES VICARIATS D'ANGERS.
L'abbé Jouin demeura à peine trois mois à Saint-Joseph. Une situation délicate réclamant à la Cathédrale la présence d'un prêtre saint et instruit, Mgr Freppel jeta les yeux sur lui (iI est remarquable que M. Jouin ne resta jamais plus de quatre ans dans chacun de ses postes). Au mois de septembre 1871, il fut donc installé comme vicaire de Saint-Maurice : il devait y rester quatre ans. Il retrouvait là l'église de son baptême, un milieu familier à son enfance, un curé réputé comme orateur, M. l'abbé Bodaire et deux confrères dont l'un, l'abbé Peltier, devint bientôt un ami, auquel il restera fidèle dans la bonne comme dans la mauvaise fortune.
La paroisse de la Cathédrale était la plus populeuse d'Angers. Elle ne se bornait plus, comme jadis, aux limites de la Cité marquées par les trois portes, encore visibles à la Révolution - la porte angevine, la porte de Fer et la porte de la Vieille Charte - elle s'étendait sur le territoire de sept paroisses supprimées au Concordat (les paroisses de Saint- Denis, de Saint-Julien, de Saint-Martin, de Saint-Evroult, de Saint-Aignan, de Saint-Maurille et de Sainte-Croix ).
De chétive apparence, souffrant de l'estomac, après des nuits sans sommeil, peut-être le jeune vicaire avait-il encore, à certains moments, cet «air renfrogné» que lui reprochait M. Laroche. Quelques-uns le croyaient poitrinaire, et des fa-milles pauvres n'utilisaient qu'avec précaution les vêtements dont il se défaisait en faveur de leurs enfants.
Sous ces apparences fragiles se cachaient cependant, des jarrets solides, et cet air chagrin dissimulait mal un cœur généreux. Lui parlait-on d'un malade ? il le visitait aussitôt ; d'un enfant intéressant ? il se l'attachait, ou même l'adoptait.
Une de ses premières conquêtes, peut-être même de ses converties, fut la «mère Jeannette», brave paysanne des environs d'Angers qui, chaque semaine, apportait à la cure, sur sa brouette, les légumes et les fruits de son jardin. Deve-nu curé de Paris, il ne manquait jamais, au temps des vacances, de l'aller voir au milieu de ses champs ou de faire pren-dre de ses nouvelles.
L'abbé Jouin se mit donc à l'œuvre : l'œuvre d'un vicaire. Il prêchait parfois hors d'Angers. Sa mère, femme pratique avant tout, et goûtant peu les hautes spéculations et les raisonnements profonds, lui reprochait d'être au-dessus de son auditoire. Il catéchisait les garçons et dirigeait le petit groupe des enfants de chœur. Surtout il visitait les malades.
Aux pieds du Château du Roi René, sur les bords de la Maine et le long des pentes qui dévalent de la cathédrale à la rivière s'enchevêtraient alors des ruelles étroites, - véritables casse-cous -, le long desquelles se serraient d'affreux tau-dis. Dans ces réduits, refuges de la misère et souvent du vice, la soutane pénètre difficilement, si elle n'est précédée par la robe de la sœur hospitalière.
Justement au portes d'Angers naissait alors la Congrégation des Servantes des Pauvres, vouée au service gratuit des malades indigents (c'est le R. P. Dom Leduc, de l'abbaye de Solesmes, qui fonda définitivement la Congrégation des Servantes des Pauvres). Madame Jouin en avait été l'inspiratrice. Elle-même en avait rédigé les premiers statuts et dé-terminé le costume des futures religieuses. A l'abri désormais des soucis matériels grâce à un petit héritage, elle était ve-nue s'installer Boulevard des Lices, et pendant l'année de la guerre, on l'avait vue au chevet des malades, auxquels elle consacrait jusqu'à trois nuits par semaine : elle fut la première Servante des Pauvres.
Non loin de la cathédrale, s'était établi un petit groupe de ces religieuses. Le jeune vicaire les rencontrait souvent au-près du lit des pauvres gens qu'elles soignaient. Lorsque, plus tard, il prononcera devant l'Évêque d'Angers l'éloge fu-nèbre de la plus admirable de ces vaillantes sœurs, la Mère Agnès, il dira :
«Je me rappelle, près du quai de la Maine, la rue du Port-Ligny qui, comme une vaste clinique, hospitalisait tous les miséreux, les tuberculeux, les varioleux, les cancéreux, et dans quelles mansardes, dans quels taudis ! La Ser-vante des Pauvres arrivait, c'était déjà un rayon de soleil ; ses soins s'étendaient à toute la famille, elle apportait par-fois la santé, toujours le Crucifix, c'est-à-dire Dieu. Voilà ce que j'ai vu pendant mon vicariat d'Angers».
Ce qu'il ne dit pas, ce que d'autres ont vu, c'est le jeune prêtre entrant derrière la Servante des Pauvres, et apportant, lui aussi, avec une bouteille d'un vin fortifiant prélevé dans la cave maternelle, son bon sourire, sa parole affable, et sur-tout le pardon de Dieu et l'espoir du Ciel.
Avec les malades, les enfants - cette autre faiblesse - provoquèrent le zèle de l'abbé Jouin. Pour se les attacher, il a sa méthode, stimuler l'étude du catéchisme par des récompenses utiles - par des promenades aux environs dans les bois d'Avrillé ou même chez quelque curé plus éloigné ; enfin par la création d'une œuvre de jeunesse pour la persévérance après la première communion.
Aucune œuvre de ce genre n'existait encore à Saint-Maurice. A Angers même, elles étaient rares. L'œuvre de M. l'ab-bé Fournier ne fut fondée qu'en 1874. Quant à l'œuvre de Notre-Dame des Champs, elle était bien loin, hors de la ville et n'avait rien de paroissial.
L'abbé Jouin essaya donc de créer un patronage paroissial et, pour lui donner au plus tôt la consécration officielle, il invita l'Évêque à présider une représentation donnée par ses enfants dans un jardin voisin. On y joua La Grammaire de Labiche et une délicieuse opérette de Dalayrac, Les Deux Petits Savoyards. Un jeune acteur de cette soirée se souvient d'avoir vu, à l’entr'acte, l'abbé, gants noirs à la main, saluant d'un geste large Mgr Freppel et lui présentant son Patronage naissant. Le lendemain l'évêque disait à ses commensaux : «L'abbé Jouin m'a présenté son Œuvre. J'ai béni la cage. Mais dans la cage, il y avait peu d'oiseaux».
Les «oiseaux» étaient encore peu nombreux, mais l'un d'eux, Honoré Dupont, mourut martyr peu après son arrivée en Annam, en 1885 ; un autre devait suivre l'abbé Jouin à Paris et fut associé à son ministère à Joinville-le-Pont, à Saint-Augustin et à Saint-Médard. Témoin oculaire de la plus grande partie des faits racontés dans ce livre, il peut, comme saint Jean, affirmer que son témoignage est véridique. L'abbé Jouin l'appelait «son abbé». Nous lui laisserons ce nom dans la suite de ce récit.
Toutefois deux concours nécessaires manquèrent à l'œuvre naissante : les encouragements du Curé, plus occupé de littérature et de prédication que d'œuvres de jeunesse, et la collaboration des Frères de l'École paroissiale : ceux-ci ex-cellents instituteurs, étaient moins soucieux de Patronages et se retranchaient derrière les règles de leur Institut. Le petit groupe se développait donc péniblement : il devait disparaître avec son fondateur.
Un événement décisif pour l'avenir de l'abbé Jouin venait de se produire : son frère Henry était entré dans l’Administration des Beaux-Arts, et sa mère avait rejoint à Paris son fils infirme. D'autre part, le R.P. Jouin, dont la rési-dence était au couvent de Lille, venait fréquemment prêcher dans la Capitale. Bientôt même les Pères du couvent de Saint-Jacques l'élurent comme prieur. Seul, l'abbé Jouin restait à Angers. Les instances de sa famille, son attrait person-nel, tout l'appelait à Paris : ce Paris, dont M. Laroche le détournait naguère et dont il avait peur pour lui ! Mais l'Évêque d'Angers, qui se connaissait en hommes et qui tenait à l'abbé Jouin, opposait une résistance qui ne tomba, au bout de deux ans, que devant cet argument ad hominem :
- Monseigneur, vous avez fait venir d'Alsace en votre palais épiscopal Madame votre Mère. Vous ne pouvez me refuser de rejoindre la mienne et mes deux frères.
Mgr Freppel se piquait de logique. Il reconnut sa défaite et consentit à laisser partir un prêtre de valeur :
- Soit, répondit-il. Allez à Paris. Mais, je vous le déclare, je connais le milieu ; vous n'y réussirez pas».
La suite des événements démontra que, dans la circonstance, l'Évêque d'Angers ne fut pas bon prophète.
SAINT-ÉTIENNE DU MONT. SAINTE-GENEVIÈVE.
Le quartier où, pendant un nouveau cycle de quatre ans, va s'exercer l'activité de l'abbé Jouin, ne lui est pas tout à fait inconnu. C'est la Montagne Sainte-Geneviève.
Plus d'une fois, au cours de ses récents voyages, il en a gravi les pentes, croisant des caravanes de touristes ama-teurs du Vieux-Paris ou les groupes de pèlerins venant prier là-haut la Patronne de la Cité.
A cette époque, deux églises voisines se partagent le culte de Sainte-Geneviève. Majestueuse et massive, semblable à une nécropole, la Basilique bâtie par Soufflot abrite la châsse de la Sainte ; à côté, élégante et gracieuse, l'église pa-roissiale de Saint-Étienne du Mont possède le Tombeau. Entre les deux - vestiges de l'ancienne basilique - se dresse la Tour de Clovis.
Aux jours de la neuvaine séculaire, les fidèles vont d'une église à l'autre, s'arrêtant pour de pieuses emplettes aux boutiques pittoresques élevées en plein vent.
Dans la Basilique, cinq chapelains entretiennent le culte de la Vierge parisienne, et à Saint-Étienne du Mont un nombre égal de vicaires assurent le service paroissial. Le Curé, M. l'abbé Perdreau, est un ami de l'Anjou. Il n'a pas ce-pendant demandé l'abbé Jouin. C'est M. l'abbé d'Hulst qui, pour être agréable à M. Henry, a fait nommer son frère à cette paroisse que, seuls, les Jardins du Luxembourg séparent de la demeure de Madame Jouin.
Cette paroisse ne semblait pas devoir fournir un terrain bien favorable à l'activité impatiente du nouveau vicaire. Pa-roisse universitaire sans doute, avec le Collège de France, la Sorbonne, l'École Polytechnique, la Faculté de Droit, cinq collèges ou lycées - mais paroisse pauvre et l'une des dernières de Paris par le chiffre et par les ressources de sa popu-lation. Isolée par les innombrables monuments, collèges, lycées, bibliothèques, communautés ou séminaires qui couvrent le sommet et les pentes de la montagne, l'église ne voit guère - les jours de la neuvaine exceptés - les foules envahir sa nef et prier devant son joli jubé, ce bijou de la Renaissance. D'autre part, les quatre aumôniers des lycées voisins, et ceux de nombreuses communautés religieuses, se partagent, avec les chapelains de la Basilique et le clergé paroissial, la clientèle religieuse du quartier : clientèle instable composée surtout d'étudiants et de familles qui disparaissent une fois les grades obtenus.
Champ d'action ingrat et modeste, dans lequel le jeune prêtre va travailler pendant près de quatre ans - de 1875 à 1879 - soit comme dernier vicaire de Saint-Étienne du Mont, soit comme chapelain de Sainte-Geneviève. Qu'importe ? L'abbé Jouin s'en console en pénétrant dans les masures insalubres de la rue Mouffetard ou dans les taudis collés le long des murs du Collège de France ou du collège Sainte-Barbe, et jusque sous les fenêtres du presbytère. Il y laisse toujours d'abondantes aumônes, au point de se mettre lui-même dans l’embarras.
- Je n'ai plus un sou, confiait-il un jour «à son abbé» peu de temps après son arrivée à Saint-Étienne du Mont : mon mois est entièrement dépensé.
- Nous ne sommes pourtant qu'au 15 du mois, répondit celui-ci. Comment allez-vous faire ?
Ce qu'il fit ? on le devine, il s'endetta. Puis il se mit à chercher des vocations sacerdotales, sans grand succès d'ail-leurs. L'unique sujet qu'il envoya au collège de Combrée lui revint bientôt, faute d'aptitudes littéraires.
Enfin, libéré en 1877, par sa nomination de chapelain à la Basilique Sainte-Geneviève des embarras du ministère pa-roissial, il se donne à la prédication. Il prêche le Carême à Saint-Paul-Saint-Louis, des retraites de premières commu-nions en plusieurs églises, les exercices de l'Adoration en diverses communautés. Soucieux de mettre dans sa parole, avec la forme qui captive l'auditeur, la science qui l'instruit et l'édifie, il se décide à donner à ses études théologiques une consécration dernière en se présentant à Flavigny devant ses anciens professeurs pour conquérir le grade de Maître en théologie. Le diplôme de Docteur qui lui fut délivré le 30 septembre 1879, constate que l'abbé Jouin fut admis avec toutes boules blanches.
C'est de cette époque que datent ses premières relations avec les chanteurs d'églises. En les recevant à sa table, en acceptant leurs invitations, en faisant dans leur compagnie aux environs de Paris de familières excursions, il cédait sans doute à son attrait pour la musique - son rêve de jadis - mais plus encore songeait-il qu'un jour ils apporteraient à son mi-nistère un concours efficace et qu'en gagnant leur amitié, il atteindrait plus sûrement leur âme. «Son abbé» se souvient de son chagrin lorsque, un jour, l'un d'eux gravement malade refusa de se rendre à ses instances, comme à celles du jeune abbé qu'il envoya tenter un suprême effort pour ramener à Dieu cette âme qu'il aimait.
Vigilante, parfois jusqu'à la défiance, Madame Jouin redoutait pour son abbé ces relations d'un genre nouveau. Trou-vant, près de sa demeure, un appartement libre, elle demanda à son fils d'abandonner le logement ensoleillé qu'il occu-pait alors, rue Claude-Bernard, pour s'installer près d'elle et de son frère, dans un appartement froid et humide : un rez-de-chaussée. Un désir de Madame Jouin était un ordre. Chaque matin du rude hiver 1879, pour aller dire sa messe, le chapelain de Sainte-Geneviève était obligé de traverser les vastes Jardins du Luxembourg. Sa poitrine déjà fatiguée par de nombreuses prédications, ne put résister à cet ensemble de circonstances fâcheuses ; une pleurésie se déclara qui mit ses jours en danger. Convalescent, il dut quitter Paris et s'en alla chercher la guérison dans les pins d'Arcachon, d'où plusieurs pensaient qu'il ne reviendrait pas. Une fois encore, la maladie était venue contrarier ses beaux projets et boule-verser ses plans.
De longs mois il vécut dans les pins et sur les sables du bassin, se reposant à sa façon, faisant de longues marches, s'amusant à promener, jusqu'à les exténuer, les amis venus au cours de l'été s'apitoyer sur son sort, rendant même des services à l'église Saint-Ferdinand, dont il devint, en fait, un vicaire très actif.
Quand, au bout de dix-huit mois, vers la fin de 1881, il revint à Paris, de graves événements avaient bouleversé la France. Les fameux décrets du 29 mars 1880 avaient été exécutés ; son frère, le R.P. Jouin, prieur du couvent de Saint Jacques, avait été expulsé (l'expulsion du R. P. Jouin et des religieux du Couvent de Saint- Jacques, rue Jean de Beau-vais, eut lieu le 5 novembre 1880) par la force publique, et la Basilique Sainte-Geneviève, une fois de plus, allait redeve-nir le Panthéon, le «Tombeau des Grands Hommes» !
Les chapelains, dont il avait clos la liste, furent appelés à d'autres postes : M. Pousset devint plus tard Archiprêtre de Notre-Dame et M. Le Nordez, évêque de Dijon. Quant à lui, il attendit, six mois, un poste compatible avec ses forces.
Enfin le 2 juillet 1882, il fut nommé à la cure de Joinville-le-Pont.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 1)
CHAPITRE II LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE.
AU CHATEAU DE LATHAN. - SA CORRESPONDANCE AVEC M. LAROCHE, SON DIRECTEUR. - CONSEILS SUR LE JEU DE CROQUET ET AUTRES JEUX. - CONSEILS LITTERAIRES ! ETRE SOI-MEME. - CONSEILS DE PIETE. - CRISE DE SANTE. - DECOURAGEMENT. - IL VOUDRAIT ARRIVER A L'ORAISON D'UNION. - IL REVE D'UN CHAMP D'ACTION PLUS VASTE. - PARIS L'ATTIRE. - SON DIRECTEUR L'EN DETOURNE : OPINION FAUSSE QUE SE FAIT M. LA-ROCHE DU CLERGE DE PARIS. - «DONNEZ-VOUS A L'ANJOU». - LE VICARIAT DE BREZE. - NOUVELLE CRISE DE DECOURAGEMENT : L'ABBE JOUIN VOU-DRAIT MOURIR. - SA VIE INUTILE. - IL EST NOMME VICAIRE A LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH D'ANGERS ET TROIS MOIS APRES A LA CATHEDRALE. - AVEC LES SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE UNE ŒUVRE DE JEUNESSE. SES DEUX PREMIERS ELEVES. - IL OBTIENT DE REJOINDRE A PARIS SA MERE ET SES DEUX FRERES. - UNE PROPHETIE DE MGR FREPPEL QUI NE S'EST PAS REALISEE. - L'ABBE JOUIN EST NOMME VICAIRE A SAINT-ETIENNE DU MONT A PARIS, ET, BIENTOT, CHAPELAIN DE SAINTE-GENEVIEVE. - IL TOMBE GRAVEMENT MALADE. - DANS LES PINS D'ARCACHON.
LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE DE BRÉZÉ.
La santé encore mal rétablie de l'abbé Jouin ne lui permettait pas, au sortir du séminaire, d'affronter les fatigues d'un ministère actif. Il se résigna donc aux fonctions de précepteur ou plutôt de surveillant des études du jeune François, fils du Comte et de la Comtesse de la Bouillerie, et neveu de l'évêque de ce nom . Mais bientôt, son élève étant entré comme interne dans un collège des Jésuites, le jeune prêtre fut nommé vicaire d'une petite paroisse du Saumurois, à Brézé. Là encore, son séjour sera de courte durée, et moins de quatre ans après son ordination, la confiance de son évêque, Mgr Freppel, l'appellera à un poste plus important, à Angers.
De cette période de sa vie (mars 1868-août 1871) nous savons peu de chose. Sauf un voyage à Dijon pour l'ordina-tion de son frère, le Père Augustin Jouin, deux séjours à Paris - où il accompagnait son élève, externe, pendant les mois d'hiver, au collège de Vaugirard - et enfin une apparition de son frère à Brézé pour un sermon, le dimanche de la Quasímodo 1870, aucun événement notable ne vint interrompre la monotonie de son existence. Déjà cependant se fai-saient jour son esprit d'initiative et son zèle pour les âmes.
Précepteur, il composait à l'usage de son jeune disciple les rudiments d'une grammaire française ; vicaire, il trouvait, en un si court espace de temps, le moyen de grouper quelques jeunes gens du village et de leur faire jouer des comédies dont les vieillards d'aujourd'hui gardent encore le souvenir,
A la surface, sa vie coulait calme et tranquille. Mais dans les profondeurs, son âme était violemment agitée. Cette crise, nul ne la connut, en dehors du prêtre qui avait dirigé à Angers la conscience du séminariste. Nous n'avons pas les lettres que, précepteur ou vicaire, l'abbé Jouin lui adressa, nombreuses, au cours de ces trois ans. Mais des réponses du Directeur, heureusement conservées, jaillit assez de lumière pour éclairer le drame intérieur qui agite l'âme du jeune prêtre.
L'abbé Jouin est donc au château de Lathan, près de Baugé, chez le Comte et la Comtesse de la Bouillerie. A ses heures libres, il lit, travaille, s'exerce à la composition littéraire ; son âme est en progrès : il a des consolations sensibles dans son oraison ; il croit même avoir été favorisé d'extases. Mais bientôt une note triste et découragée se fait entendre : il pense à sa mère qu'il voudrait aider, à son passé évanoui, à ses rêves de vie religieuse et d'apostolat écroulés... l'ave-nir est plus sombre encore ! Avec sa santé délabrée que pourra-t-il être ? Précepteur ? Vicaire de campagne ? lui qui se sentait des ailes et fait pour l'action !... A quoi bon vivre ainsi ? Ne vaudrait-il pas mieux mourir ?...
Dans ces alternatives de confiance et de découragement, pour ses travaux littéraires même, il aurait besoin d'un guide, d'un conseiller, d'un appui... Il recourrait à son Directeur, s'il ne craignait de l'importuner.
Et les réponses du prêtre arrivent, tour à tour paternelles ou sévères. Suivant le cas, le prêtre encourage, éclaire, sou-tient, reprend son pénitent.
La première lettre de l'abbé, à son arrivée, ne devait pas être tout à fait enthousiaste, car, dans sa réponse, le Direc-teur se croit obligé de souligner les avantages du château. Cette lettre est du 6 mai 1868.
«Vous voyez, mon cher ami, que j'use largement de la permission que vous m'avez donnée, de ne me point gêner avec vous. La recommandation était bien inutile, et je vous engage à ne point la renouveler : ma paresse trouverait peut-être là un prétexte dont elle n'a pas besoin. Elle est par elle-même assez ingénieuse pour en trouver de toutes sortes... Pressez-moi plutôt et fâchez-vous quand je vous ferai trop attendre : vous me rendrez ainsi un grand ser-vice...
Et que vous dirai-je ? Que je vous aime bien ? Je veux croire que vous l'avez deviné, malgré toutes les raisons d'en douter que je vous ai données si souvent. Je porte une bien dure écorce et je ne puis pas toujours disposer de moi. Le poids d'infirmités que vous portez vous-même vous a fait comprendre et vous a rendu indulgent. Je crains bien de rester toujours le même ; j'espère que vous serez toujours aussi bon.
Je suis très heureux d'apprendre que vous êtes content de votre nouvelle position : vous êtes avec un monde ex-cellent et votre petit bonhomme est tout à fait aimable. Très bien. De plus vous avez envie d'être très bon, très pieux, un prêtre parfait et vous faites de la littérature ! Rien de mieux. Tous vos vœux sont accomplis et aussi les miens. A moins que la santé ne vienne là jeter une vilaine ombre. Vous ne m'en parlez pas, peut-être est-ce le moindre de vos soucis. Croyons plutôt que vous êtes content même de votre santé. Elle serait vraiment bien revêche si elle s'avisait d'être maussade. N'a-t-elle pas tout à souhait ? Le repos, la belle campagne, le doux printemps et tout le reste ! Vous êtes fait pour le bonheur ; il y a longtemps que je vous l'ai dit, sans compter que tout le monde veut vous avoir. Comment ferez-vous pour vous donner à tous ceux qui vous demandent ?... »
Celui qui signait ces lignes, M. Laroche, était professeur de morale au grand séminaire d'Angers, après avoir enseigné la philosophie à Issy, avec un tel succès que le jeune abbé d'Hulst, un de ses élèves, avait demandé à renouveler avec lui sa première année. Un de ses élèves angevins, Mgr Crosnier, en a tracé un saisissant portrait : «Dans une tête large et forte, deux yeux profonds, chargés de pensée, cachés derrière une broussaille d'épais sourcils, lui donnaient un air in-vestigateur ou même inquisiteur. Les timides prenaient peur au premier aspect ; mais sa voix douce, claire, harmonieuse les rassurait... M. Laroche était un excellent directeur, un directeur recherché. Cette paternité lui fit faire des actes hé-roïques. Lui, qui avait horreur de la plume, il a envoyé des milliers et des milliers de lettres à ses «pénitents». Lettres ai-mantes, toute pleines de sages conseils, de confidences amicales, d'abandons gracieux...»
On en jugera mieux par les larges extraits que nous allons faire de sa correspondance avec l'abbé Jouin.
Voici l'été. Le château s'anime. Des visites arrivent. Des jeux s'organisent. On joue au croquet. Quelle part l'abbé doit-il prendre à ces récréations ? Et la réponse arrive fine, doucement moqueuse d'abord, pour s'élever bientôt à des consi-dérations d'une philosophie toute surnaturelle :
23 juillet 1868. - «C'est donc le croquet qui vous tourmente ! Je ne connais pas ce jeu. Je n'aurais pas cru qu'il y eût là de quoi ébranler une tête de philosophe. Je sais bien cependant que c'est au jeu surtout que se dévoile un homme. Il paraît que vous n'échappez point à la loi commune et, vous aussi, vous êtes trahi par le jeu.
Que voulez-vous que je vous dise ? De ne pas jouer ? Cela serait bien dur et, dans les circonstances où vous vous trouvez, ce serait comme impossible. Jouez donc, mais quand les convenances vous obligent de le faire. Ne faites point naître les occasions, ne les fuyez pas non plus d'une manière qui pourrait gêner.
Je crois que le meilleur moyen de vous guérir des préoccupations qui naissent du jeu, c'est d'abord de ne point tant tenir à gagner. Il faut même être, au moins quelquefois, content de perdre. Il y a un plaisir, que vous apprendrez à goûter, à perdre au jeu, c'est le plaisir de voir les autres contents d'avoir gagné...
Je voudrais aussi que vous fissiez quelques considérations sérieuses, philosophiques et chrétiennes sur la vanité de ces graves occupations du jeu de Croquet. En moins de dix minutes, si je ne me trompe, vous en aurez assez pour vous guérir de cette passion. Pauvre nature humaine, à quoi elle se laisse prendre !...»
Des scrupules plus sérieux tourmentent le jeune prêtre. Doit-il s'accuser en confession de ses fautes de vanité dans le détail ? Il a peur de faire rire son confesseur, s'il lui dit «toutes ces drôleries» :
«Il n'est pas nécessaire de descendre dans les derniers détails, répond le Directeur. C'est plutôt affaire de direc-tion. Cependant vous pouvez le faire quelquefois, surtout lorsque vous y aurez plus de répugnance. Il en coûte peu de dire en général que l'on a eu de la vanité, cela est même assez bien porté quelquefois, mais de dire que l'on a fait tel vilain petit péché, c'est un autre affaire. Mais pas de scrupules».
L'époque des vacances laisse quelques loisirs au précepteur. Il les met à profit pour s'essayer à des compositions qu'il soumet à son Directeur. M. Laroche répond :
21 septembre 1868. – «Il ne m'appartient pas de vous donner des conseils sur vos études littéraires : je ne suis qu'un béotien encroûté et je donnerais à rire si je laissais voir des prétentions d'homme de goût et de littérateur... Voyez si vous pouvez avoir confiance en mon jugement et si je puis oser vous diriger dans vos études !
Permettez-moi, cependant, de vous dire que je ne crois pas bien sûre la voie dans laquelle veut vous pousser votre frère. Il ne faut point viser à la phrase ornée et pompeuse : vous devez avant tout chercher le naturel, parce que le naturel, c'est le vrai, et le vrai lui-même est le beau. Avant tout, enrichissez votre esprit et, en lisant les auteurs, appliquez-vous à saisir les différents aspects sous lesquels ils présentent les choses. Voyez comment ils dévelop-pent un sujet et le fécondent... Celui qui aspire à l'art d'écrire doit d'abord s'appliquer à la méditation. Car c'est elle qui est ici l'ouvrier ; c'est la méditation qui creuse la vérité, qui la développe, la tourne sous toutes ses faces et met au jour toutes ses beautés. Vouloir se mêler d'écrire avant de s'être enrichi par ce premier travail de l'étude sérieuse et longtemps poursuivie, c'est vouloir tirer de l'eau d'une source vide...
Encore un mot. Il m'a semblé que vous étiez préoccupé du désir de trouver un écrivain qui fût plus spécialement votre modèle et que vous puissiez chercher à imiter. Vous établissez même à ce point de vue, une comparaison entre Massillon et Bossuet. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il soit bon de se proposer de suivre pas à pas dans sa manière d'écrire tel ou tel écrivain. C'est se faire esclave et tuer la spontanéité. Notre esprit est nôtre. Il n'est ni celui de Bossuet ni celui de Massillon. Soyez ce que vous êtes et n'empruntez pas une personnalité étran-gère. Si vous empruntiez les vêtements d'un homme plus grand ou plus petit que vous, vous seriez mal à l'aise : les esprits sont encore plus divers que les corps...
Votre légende me paraît passable. Je ne veux point vous flatter en vous disant que vous avez fait un chef d'œuvre. C'est un peu long, lourd et traînant. Voyez si je prends des gants» !
La lettre suivante répond aux mêmes préoccupations littéraires.
24 janvier 1869. - «Depuis le 4 janvier que j'ai reçu votre lettre, j'ai voulu cent fois vous écrire... je ne l'ai pas fait. Est-ce un crime irrémissible ? Je compte pourtant bien que je le commettrai encore bien des fois, si je vis. Mais à quoi bon poursuivre ?...
Vous avez l'audace de me dire que vous éprouvez souvent le besoin de m'écrire et que vous ne le faites point parce que et parce que... Je ne suis pas content, et de moi surtout, car vous me donnez la preuve que j'ai manqué envers vous de simplicité et de bonté. Je ne pourrais pas dire tout à fait que ce soit à mon insu, mais c'est, bien sûr, à mon grand regret. Je suis mal fait, mal outillé, et trop souvent je ne dispose point de ma personne comme je vou-drais ; je prends des airs d ours et de tigre et je fais peur, et l'on fuit. Croyez que je ne suis qu'un vieux gros mouton qui est souvent malade et qui, à cause de cela, fait mauvaise mine.
Donc, vous avez envie de travailler, de devenir savant et de composer de beaux ouvrages. Je suis aussi de cet avis. La seule difficulté c'est de trouver les moyens, et les moyens pour vous, c'est la santé et le temps. Or pour vous procurer ces deux choses, je suis un peu embarrassé. Et puis vous avez le malheur d'être bien jeune et de le pa-raître... Il faudrait peut-être avoir la patience d'attendre quelques années... Si cela est nécessaire, il faudra bien pren-dre votre cœur à deux mains et lui dire de se calmer... Et que devenir pendant ce temps ? En attendant la place dési-rée, vous seriez aumônier du château de quelque douairière. Mais ce monde vous fatigue et vous ennuie ! - Vous avez si grand besoin de faire pénitence !
Je ne vous parle point de Sainte-Geneviève (il s'agit d'une place de Chapelain de Sainte-Geneviève, à Paris, pour laquelle on avait dû faire une proposition à l'abbé Jouin). Mon premier mouvement a été de repousser cette proposi-tion ; mais j'aime mieux vous dire que je ne vois pas assez clair et qu'il faudrait mieux connaître ce terrain. Puisque vous allez à Pâques vous fixer pour deux mois à Paris, vous verrez. Ne prenez pour le moment aucune résolution.
Et vos extases ! C'est bien. Occupez-vous de Dieu, de votre bon Maître, et fort peu de vous. Vous me dites que vous êtes en progrès et que vous comptez bien avancer toujours. Dieu soit béni ! Aucune nouvelle ne pouvait m'être plus agréable. Vous savez la leçon qui ne trompe pas : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, tollat cru-cem suam et sequatur me... ama nesciri...
Adieu. Soyez bon, soyez pieux et toujours simple. Et continuez vos études.
La lettre suivante écrite au lendemain de troubles qui avaient agité la Capitale cherche à consoler le précepteur de mécomptes et d'injustices, dont il a été victime et qui ont eu un retentissement jusque dans sa santé.
Du 5 juin 1869. - «J'ai tout l'air de vous abandonner et vous êtes triste, découragé, abattu ! Vous devez m'en vou-loir et je le comprends. A votre place je ne serais pas content du tout. Mais à votre place aussi, je pardonnerais à ce pauvre bonhomme, si malade de la paresse et de plusieurs autres maladies. Cependant, croyez-le, il n'est atteint ni du mal de l'oubli, ni de l'indifférence, ni du sine affectione. Je vous aime bien toujours, vous le savez, il suffit.
Je me mets à votre place et je sens que tout ce que vous me dites, me fatiguerait aussi et m'agacerait les nerfs. Mais pourtant, cher ami, soyons sages et ne nous laissons point accabler. Si les hommes sont injustes à votre égard, tant pis pour eux ! Ils sont plus à plaindre que nous. Rien de plus utile pour élever le cœur jusqu'aux régions où il doit habiter que ces mécomptes et ces coups imprévus. Vous avez bien travaillé, vous avez donné tous vos soins, toute votre affection, tout votre zèle et l'on ne vous paie que d'ingratitude ! Allez maintenant vous épuiser pour les hommes ! Non, mon cher ami, et cependant il ne faut pas les mépriser, les abandonner, il faut être bon toujours, toujours dé-voué, mais pour la récompense, ne l'attendez que de Dieu. Ce qui vous est arrivé là, vous arrivera ailleurs, vous ne faites que commencer votre éducation. Que cette première leçon vous soit du moins utile.
Vous me dites que votre santé elle-même est tout ébranlée, de grâce, ne vous fatiguez point trop, et ménagez-vous le plus que vous pourrez, et, comme je soupçonne les idées noires d'être un peu la cause de votre fatigue, chassez bien loin les idées noires.
...Les émeutiers de Paris ne vous font-ils point peur ? Quels gens I... »
Du 30 juin 1869. - «Je me suis couché hier avec un poids bien lourd sur le cœur : je ne vous avais pas écrit ! et vous attendez avec une impatience qui vous donne la fièvre ! Vous avez des craintes, des remords, vous êtes dam-né ! Je savais tout cela, et j'étais bien triste de ne vous avoir pas écrit. Hier, il m'a été physiquement impossible d'écrire.
Aujourd'hui, quelques mots seulement : il me faut prendre sur la nuit.
Votre long mémoire est admirable ! Mais, bon ami, pourquoi donc toutes ces précautions avec moi ? Vous ne croyez donc point à mon amitié ? Vous êtes un méchant... Vous n'irez point à Nantes. Monseigneur ne le veut pas...
Puis, des soucis d'ordre spirituel jettent une ombre sur son âme : il n'avance pas dans l'oraison. Il est triste, mé-content de lui. Et le Directeur de répondre :
Du 7 décembre 1869. - «Vous étiez tout triste le 3 décembre, tout triste et tout découragé et le découragement avait une forte nuance de dépit. Vous n'étiez pas content de vous. Quel malheur, cher ami ! Comment vous n'êtes pas content de vous ! Vous ne vous trouvez pas assez saint, assez parfait, assez savant ! Cela est vraiment tout à fait extraordinaire de trouver un homme qui n'est pas satisfait de sa vie et de ses œuvres !
Enfant que vous êtes. Vous êtes encore assez naïf pour vous imaginer que vous arriverez un jour à mettre tous les nuages au-dessous de vos pieds ! Vous croyez que vous vous établirez pour toujours dans la région du bleu pur et du calme imperturbable. Je vous dis que vous êtes un enfant et que vous ne savez ce que c'est que la vie hu-maine.
Voyez-vous, cher ami, vous serez toujours un petit bonhomme, pas trop fin, peu dévot, et malgré cela tout plein de vanité et de prétentions. Vous ferez des rêves : «à trente ans, je serai à ce point de la montagne, à quarante, j'au-rai dépassé ces pics, à cinquante, je serai au sommet». Oui, à cinquante, vous vous trouverez encore au pied, vous essaierez de faire quelques pas, et puis vous glisserez, et puis vous serez toujours là.
- Autant se coucher et dormir !
- Non pas. Il faut monter, il faut gravir cet âpre sentier.
- Mais vous me dites que je ne puis avancer.
- Non pas, je vous dis que vous aurez beau marcher, vous vous trouverez toujours loin des cimes. C'est que la montagne s'élève toujours ! Vous n'en voyiez qu'un petit point avec vos mauvais yeux. Quand la lumière se fait plus grande, vous découvrez des horizons plus vastes et une route plus longue à parcourir.
Je crois que vous marchez. Il peut se faire que votre marche ne soit pas une course, mais enfin vous marchez à votre manière, comme l'escargot, si vous voulez.
Voici déjà un progrès notable que nous pouvons constater, vous commencez à vous connaître et à vous douter que vous pourriez bien n'être pas tout à fait un phénomène, un phénix...
Voilà bien des métaphores et vous allez dire que je manque de simplicité. C'est vrai ; et cela est d'autant plus fâ-cheux que je voulais précisément vous prêcher la simplicité... Écoutez donc mon petit sermon et ne regardez point à la personne qui le fait. Eh bien ! cher ami, soyez simple et ne philosophez point tant sur beaucoup de choses ; vous êtes toujours dans les analyses et les dissections. Vous me dites que vous ne sauriez me rendre compte de ce qui est en vous, et là-dessus vous commencez votre travail et puis gare ! Combien de fois vous l'avez fait déjà cet exa-men du jugement dernier ! II n'est pas bon, croyez-moi, d'avoir la tête sans cesse courbée sur soi-même. Il sort de là des miasmes et des odeurs marécageuses qui donnent la fièvre. Sans doute il faut avoir attention à son cœur, mais que ce soit pour l'élever au-dessus de lui-même, pour le sortir de ses ténèbres, pour le présenter à la lumière du so-leil et l'unir au bien qui est en Dieu. Aimez Notre-Seigneur, faites Sa volonté, donnez-vous à Lui sincèrement et ne vous demandez point si vous n'arriverez pas bientôt à l’oraison d'union. Quand vous êtes triste, examinez d'où cela vient. Vous trouverez très souvent que c'est l'orgueil qui est la vraie cause de votre chagrin. Le remède est de con-sentir à n'être rien, pas même savant, si Dieu le veut ainsi. Et pourtant travaillez comme vous pourrez et priez dévo-tement».
Vers le printemps ou l'été de 1869, une autre préoccupation se fait jour dans l'esprit de l'abbé Jouin. Il apprend qu'à la rentrée prochaine son élève va entrer au collège des Pères Jésuites, à Poitiers. Il lui faut donc chercher une autre situa-tion. Au Séminaire aussi on y pense et plusieurs préceptorats dont on lui a parlé sont envisagés, à Nantes, à Toulouse et encore ailleurs. M. Laroche donne son avis. «Toulouse, dit-il, c'est si loin, vilain pays, mauvaise cuisine. Est-ce que vous pourriez vous faire au régime de l'huile ? Nantes, pour une raison particulière, est écarté. Et cependant, vous auriez là un piano et pourriez vous livrer à la musique !»
Entre temps, à Paris, où il se trouve à ce moment, on lui suggère de chercher une place dans l'une des nombreuses maisons d'éducation de la Capitale. Il s'arrête même, et assez volontiers, à la pensée de concourir pour un poste de cha-pelain de Sainte-Geneviève. Les chapelains, libres de ministère paroissial, se donnent à la prédication. Son rêve d'autre-fois pourrait se réaliser. Paris ! champ digne d'une activité qui brûle de s'exercer. Mais, dès les premiers mots, le prudent Directeur l'arrête ;
«Je ne vous cacherai pas que je vois avec une sorte de dépit beaucoup de jeunes gens intelligents quitter leurs diocèses pour aller à Paris. Ils auraient pu rendre chez eux de vrais et grands services, et ils s'en vont là-bas, se noyer dans toutes ces inutilités dont vous me parlez dans votre dernière lettre. Il vaut encore mieux être un bon vi-caire de campagne que certains de ces prêtres qui voient tout, qui lisent tout, qui savent tout, qui parlent de tout, et ne font rien».
Et les lettres se succédaient, pressantes du côté du précepteur, modératrices de la part du directeur. L'abbé parlait de sa mère qu'il pourrait aider, de ses études qu'il pourrait poursuivre, quand, au mois de juillet 1869, à Paris, où il se trou-vait, de l'Évêché d'Angers arriva la nouvelle officielle de sa nomination au vicariat de Brézé.
M. Laroche devine la déception de son «pénitent», il s'empresse de lui écrire et lui parle le langage de la foi.
«...Vous en serez quitte pour votre philosophie sur les précepteurs et les préceptorats. En avez-vous posé des principes ! Quelle fécondité de vues, d'aperçus de toute sorte. Cette question est épuisée ; vous l'avez étudiée à fond, sous toutes ses faces et vous ne serez point précepteur... A mon tour, je ne puis me défendre de certaines ré-flexions philosophiques ; elles se résument toutes dans cette belle et désormais vieille maxime : «L'homme s'agite et Dieu le mène». Consolons-nous de notre agitation et de notre inutile effort par cette bonne pensée que Dieu nous mène là où Il veut que nous allions. C'est à Brézé que vous deviez aboutir, c'est là que la Providence vous adresse... «Un sentiment domine tous les autres dans votre cœur : c'est le besoin d'obéir et de n'être que pour le moins pos-sible dans tous les arrangements qui vous concernent... Vous serez donc dispensé d'aller vous offrir à tous les chefs d'institutions de Paris. J'en suis vraiment heureux, car je vous avoue qu'il ne me paraissait guère acceptable que vous fissiez ces démarches. C'est peut-être fierté de ma part...
Revenez donc tout doucement en chantant le Dominus regit me, et nihil mihi deerit. Je vous avais donné la per-mission de rester à Paris quelque temps, faut-il vous dire que ce n'était pas sans une certaine inquiétude. Je crai-gnais pour vous la séduction de cette vie parisienne, je craignais que vous ne puissiez plus ensuite vous résigner à être un simple provincial, et j'en aurais eu un véritable chagrin... Vous appartenez à l'Anjou, donnez-vous à l'Anjou...»
L'abbé Jouin accepta le poste qu'on lui assignait. N'avait-il pas fait vœu d'obéir ? Toutefois, un souci le tourmente. Que fera-t-il dans ce village indifférent, près d'un curé âgé et qui passe pour se nourrir très mal ?...
Son Directeur l'encourage :
«Le jour où vous m'écriviez, un soir sans doute, par un temps sombre, vous n'étiez pas gai. Vos pensées étaient très graves et si sérieuses qu'elles tournaient tout à fait au noir. Les plus graves problèmes venaient se présenter à votre esprit : l'origine du mal et son rôle dans le monde. Vous essayiez de vous consoler par l'O felix culpa ! Un chant plein de feu : vous aimiez, vous aimiez tout, tout, jusqu'aux gens de Brézé, tout à l'exception du Bon Dieu.
Enfant ! Mais vous êtes bien aimable, surtout quand vous consentez à passer inutile sur la terre. C'est un progrès que je suis heureux de constater, pourvu toutefois que nous ne soyons pas quiétiste et que nous travaillions de tout notre cœur à l'œuvre de Dieu. Nourrissez avec soin la flamme sacrée ; mais s'il plaît à Dieu qu'elle se consume en pure perte, comme l'encens, comme la lampe du sanctuaire, qu'importe ? pourvu que ce soit toujours à la gloire de Dieu et du Sauveur Jésus. Quoi que vous en disiez, je suis sûr que vous L'aimez très véritablement et cela vaut mieux que de L'aimer très sensiblement S'il Lui plaisait pourtant de vous sourire, souriez aussi ; mais je ne regrette pas beaucoup les quasi-extases d'autrefois...
A Dieu ! Allez-vous convertir tout Brézé ? Ces pauvres gens, ils n'ont guère le goût de la vérité. Vous le leur don-nerez».
Quelques mois après, nouvelle crise de tristesse. Le jeune vicaire se sent vieux, il voudrait mourir.
13 juin 1870. - «...Mais comme vous étiez vieux dans ce temps où vous m'écriviez I et quel catarrhe sur votre poi-trine ! M. Pasquieri (ami commun de M. Laroche et de M. Jouin et futur recteur de l'Université Catholique d'Angers) m'écrivait hier qu'il était à la Fontaine de Castalie. Peut-être vous serait-il bon de faire vous aussi le pèlerinage de la poétique fontaine. Mais en vous y rendant, il est nécessaire absolument que vous passiez par la fontaine de Jou-vence. Sans cela en voyant arriver ce vieux petit bonhomme enrhumé et grincheux, les Muses de Castalie l'assom-meraient...
Où suis-je ? Avec vous, je crois. Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez bon à mettre aux petites maisons ? nous y voilà.
Mais non, je réponds comme il faut répondre et mes arguments valent les vôtres et ils sont topiques. Cependant vous avez sur moi un avantage. Vous avez fait une découverte et, depuis longtemps, je n'en fais plus. Vous avez donc pu vous douter depuis quelque temps qu'il pourrait bien se faire qu'il y eût des gens à idées pas très larges, un peu étroites même. Vous êtes sagace, mon ami. Et vous osez vous plaindre de vous et de votre génie ! Quand donc avez-vous fait cette trouvaille ? Notez le jour de peur qu'on ne vous la conteste et prenez vos précautions pour vous en assurer la priorité.
Je voudrais vous faire sourire un peu : vous étiez si chagrin. Mais je n'aurai point réussi, j'ai la main trop lourde et l'esprit trop épais. Contentez-vous de l'intention et de la bonne volonté. Je suis, voyez-vous, comme les gros bonshommes qui veulent faire des gentillesses aux petits enfants. Ils sont maladroits et gauches, mais cela même fait rire les petits enfants. Je veux bien prendre ce rôle, pourvu que cela vous égaie un petit moment et vous donne envie de vivre. Ne me parlez-vous pas de l'envie de mourir, oui, et de vieillir à 24 ans ! Je vous en prie, puisque vous êtes jeune, soyez jeune et vivez.
Vous m'avez dit beaucoup d'autres belles choses de cette force. Sainte-Geneviève se trouve là-dedans, le plébis-cite, les barricades et les préceptorats. Tout cela dans un même plat, tout cela danse et remue dans l'eau bouillante. Attendons que le calme vienne et nous verrons ce qui pèse le plus et est allé au fond.
Vous êtes à Brézé, soyez-y content. Vous avez des livres, la nature... vous avez Dieu, que demandez vous ? Ja-mais, nulle part, vous ne serez mieux pour étudier et avoir la paix, malgré ceux qui pourraient bien n'avoir pas les idées très larges. Bonsoir !»
La lettre suivante est du 29 août. La guerre et la maladie ont cruellement éprouvé la famille de M. Laroche. A plusieurs reprises, le vicaire de Brézé a dit son affectueuse sympathie à son directeur :
«Vous êtes bien bon, mon cher ami, et votre amitié me touche très sensiblement. Vos lettres m'ont été une douce consolation dans ces chagrins si cruels. Je vous aime bien aussi ; vous le savez et je compte que cela est pour vous un appui et une force : l'amitié qui vient de Dieu, et qui est selon Dieu, n'est pas seulement la plus douce de toutes les choses, elle est ce qu'il y a en ce monde de plus fortifiant...
- Mais, répétait l'abbé, ma vie est inutile. Qu'est-ce que je fais ici ?
Le vide sera toujours au fond de tous les cœurs humains, répond le prêtre. Ne vous étonnez donc pas d'éprouver ce tourment. Mais faut-il se résigner à mener une vie inutile ? Pourquoi pas, s'il plaît à Dieu de vous tenir dans cette humiliation. Je parle comme un homme, car il est certain que Dieu n'a rien fait d'inutile ; pas même vous, mon cher ami.
Vous êtes là par Sa volonté, vous restez à ce poste parce qu'Il le veut ; vous y souffrez, vous y priez, vous y don-nez le bon exemple et vous dites que votre vie est inutile ! Et le divin sacrifice que vous offrez saintement tous les jours !... Ne dites plus que votre vie est inutile, dites plutôt que vous, qui êtes un tout petit bonhomme, auriez eu cer-tains projets de grand homme, qu'il ne plaît pas à la divine Providence de vous laisser réaliser, au moins à cette heure. Mais en vérité quel mal y a-t-il à cela ? Les plans de Dieu valent bien les nôtres...
Telle est cette correspondance précieusement conservée et annotée par l'Abbé Jouin. Elle jette un jour très vif sur ses sentiments au lendemain de l'ordination sacerdotale. A travers ces lettres, on assiste au drame émouvant qui se joue dans l’âme du jeune prêtre. Après l'échec de son rêve de vie religieuse, ses forces physiques et morales sont ébranlées. La tristesse, le découragement, le doute, les scrupules envahissent cet organisme déprimé.
Puis, il se ressaisit et se reprend à espérer. Il fait des projets d'études, rêve d'apostolat, imagine de vaste travaux et fait même des essais de composition.
Mais son activité souffre d'être emprisonnée dans l'enceinte étroite d'un château ou dans les limites d'un petit village sans religion. Elle s'impatiente et voudrait briser le cadre, prendre son essor, et s'exercer sur un plus vaste théâtre : Paris le séduit et l'attire.
En même temps, dans ces confidences faites au Directeur, nous surprenons les beaux élans d'une âme religieuse qu'attirent les sommets de la vie parfaite, qui s'impatiente de ne pas arriver encore à l'oraison d'union et jouit parfois de consolations très douces, peut-être même, croit-il, d'extases.
Mais la voix du Directeur le rappelle à l'humilité, à la patience, au sacrifice, à l'acceptation de la volonté divine...
Devant le plan de Dieu, l'abbé Jouin inclina ses projets d'avenir. «Il se donna à l'Anjou et à Brézé». De toutes ses forces il se dépensa au service de ces pauvres gens plus occupés de leurs vignes que de leur âme ; et, quand, au bout de dix-huit mois, la volonté de ses supérieurs l'appela au vicariat de Saint-Joseph, l'aristocratique paroisse d'Angers, il n'avait point, sans doute, «converti tout Brézé», mais on nous assure qu'aujourd'hui encore des vieillards gardent le sou-venir du jeune vicaire de 1870-1871 qui leur consacra les prémices de son ministère angevin.
LES VICARIATS D'ANGERS.
L'abbé Jouin demeura à peine trois mois à Saint-Joseph. Une situation délicate réclamant à la Cathédrale la présence d'un prêtre saint et instruit, Mgr Freppel jeta les yeux sur lui (iI est remarquable que M. Jouin ne resta jamais plus de quatre ans dans chacun de ses postes). Au mois de septembre 1871, il fut donc installé comme vicaire de Saint-Maurice : il devait y rester quatre ans. Il retrouvait là l'église de son baptême, un milieu familier à son enfance, un curé réputé comme orateur, M. l'abbé Bodaire et deux confrères dont l'un, l'abbé Peltier, devint bientôt un ami, auquel il restera fidèle dans la bonne comme dans la mauvaise fortune.
La paroisse de la Cathédrale était la plus populeuse d'Angers. Elle ne se bornait plus, comme jadis, aux limites de la Cité marquées par les trois portes, encore visibles à la Révolution - la porte angevine, la porte de Fer et la porte de la Vieille Charte - elle s'étendait sur le territoire de sept paroisses supprimées au Concordat (les paroisses de Saint- Denis, de Saint-Julien, de Saint-Martin, de Saint-Evroult, de Saint-Aignan, de Saint-Maurille et de Sainte-Croix ).
De chétive apparence, souffrant de l'estomac, après des nuits sans sommeil, peut-être le jeune vicaire avait-il encore, à certains moments, cet «air renfrogné» que lui reprochait M. Laroche. Quelques-uns le croyaient poitrinaire, et des fa-milles pauvres n'utilisaient qu'avec précaution les vêtements dont il se défaisait en faveur de leurs enfants.
Sous ces apparences fragiles se cachaient cependant, des jarrets solides, et cet air chagrin dissimulait mal un cœur généreux. Lui parlait-on d'un malade ? il le visitait aussitôt ; d'un enfant intéressant ? il se l'attachait, ou même l'adoptait.
Une de ses premières conquêtes, peut-être même de ses converties, fut la «mère Jeannette», brave paysanne des environs d'Angers qui, chaque semaine, apportait à la cure, sur sa brouette, les légumes et les fruits de son jardin. Deve-nu curé de Paris, il ne manquait jamais, au temps des vacances, de l'aller voir au milieu de ses champs ou de faire pren-dre de ses nouvelles.
L'abbé Jouin se mit donc à l'œuvre : l'œuvre d'un vicaire. Il prêchait parfois hors d'Angers. Sa mère, femme pratique avant tout, et goûtant peu les hautes spéculations et les raisonnements profonds, lui reprochait d'être au-dessus de son auditoire. Il catéchisait les garçons et dirigeait le petit groupe des enfants de chœur. Surtout il visitait les malades.
Aux pieds du Château du Roi René, sur les bords de la Maine et le long des pentes qui dévalent de la cathédrale à la rivière s'enchevêtraient alors des ruelles étroites, - véritables casse-cous -, le long desquelles se serraient d'affreux tau-dis. Dans ces réduits, refuges de la misère et souvent du vice, la soutane pénètre difficilement, si elle n'est précédée par la robe de la sœur hospitalière.
Justement au portes d'Angers naissait alors la Congrégation des Servantes des Pauvres, vouée au service gratuit des malades indigents (c'est le R. P. Dom Leduc, de l'abbaye de Solesmes, qui fonda définitivement la Congrégation des Servantes des Pauvres). Madame Jouin en avait été l'inspiratrice. Elle-même en avait rédigé les premiers statuts et dé-terminé le costume des futures religieuses. A l'abri désormais des soucis matériels grâce à un petit héritage, elle était ve-nue s'installer Boulevard des Lices, et pendant l'année de la guerre, on l'avait vue au chevet des malades, auxquels elle consacrait jusqu'à trois nuits par semaine : elle fut la première Servante des Pauvres.
Non loin de la cathédrale, s'était établi un petit groupe de ces religieuses. Le jeune vicaire les rencontrait souvent au-près du lit des pauvres gens qu'elles soignaient. Lorsque, plus tard, il prononcera devant l'Évêque d'Angers l'éloge fu-nèbre de la plus admirable de ces vaillantes sœurs, la Mère Agnès, il dira :
«Je me rappelle, près du quai de la Maine, la rue du Port-Ligny qui, comme une vaste clinique, hospitalisait tous les miséreux, les tuberculeux, les varioleux, les cancéreux, et dans quelles mansardes, dans quels taudis ! La Ser-vante des Pauvres arrivait, c'était déjà un rayon de soleil ; ses soins s'étendaient à toute la famille, elle apportait par-fois la santé, toujours le Crucifix, c'est-à-dire Dieu. Voilà ce que j'ai vu pendant mon vicariat d'Angers».
Ce qu'il ne dit pas, ce que d'autres ont vu, c'est le jeune prêtre entrant derrière la Servante des Pauvres, et apportant, lui aussi, avec une bouteille d'un vin fortifiant prélevé dans la cave maternelle, son bon sourire, sa parole affable, et sur-tout le pardon de Dieu et l'espoir du Ciel.
Avec les malades, les enfants - cette autre faiblesse - provoquèrent le zèle de l'abbé Jouin. Pour se les attacher, il a sa méthode, stimuler l'étude du catéchisme par des récompenses utiles - par des promenades aux environs dans les bois d'Avrillé ou même chez quelque curé plus éloigné ; enfin par la création d'une œuvre de jeunesse pour la persévérance après la première communion.
Aucune œuvre de ce genre n'existait encore à Saint-Maurice. A Angers même, elles étaient rares. L'œuvre de M. l'ab-bé Fournier ne fut fondée qu'en 1874. Quant à l'œuvre de Notre-Dame des Champs, elle était bien loin, hors de la ville et n'avait rien de paroissial.
L'abbé Jouin essaya donc de créer un patronage paroissial et, pour lui donner au plus tôt la consécration officielle, il invita l'Évêque à présider une représentation donnée par ses enfants dans un jardin voisin. On y joua La Grammaire de Labiche et une délicieuse opérette de Dalayrac, Les Deux Petits Savoyards. Un jeune acteur de cette soirée se souvient d'avoir vu, à l’entr'acte, l'abbé, gants noirs à la main, saluant d'un geste large Mgr Freppel et lui présentant son Patronage naissant. Le lendemain l'évêque disait à ses commensaux : «L'abbé Jouin m'a présenté son Œuvre. J'ai béni la cage. Mais dans la cage, il y avait peu d'oiseaux».
Les «oiseaux» étaient encore peu nombreux, mais l'un d'eux, Honoré Dupont, mourut martyr peu après son arrivée en Annam, en 1885 ; un autre devait suivre l'abbé Jouin à Paris et fut associé à son ministère à Joinville-le-Pont, à Saint-Augustin et à Saint-Médard. Témoin oculaire de la plus grande partie des faits racontés dans ce livre, il peut, comme saint Jean, affirmer que son témoignage est véridique. L'abbé Jouin l'appelait «son abbé». Nous lui laisserons ce nom dans la suite de ce récit.
Toutefois deux concours nécessaires manquèrent à l'œuvre naissante : les encouragements du Curé, plus occupé de littérature et de prédication que d'œuvres de jeunesse, et la collaboration des Frères de l'École paroissiale : ceux-ci ex-cellents instituteurs, étaient moins soucieux de Patronages et se retranchaient derrière les règles de leur Institut. Le petit groupe se développait donc péniblement : il devait disparaître avec son fondateur.
Un événement décisif pour l'avenir de l'abbé Jouin venait de se produire : son frère Henry était entré dans l’Administration des Beaux-Arts, et sa mère avait rejoint à Paris son fils infirme. D'autre part, le R.P. Jouin, dont la rési-dence était au couvent de Lille, venait fréquemment prêcher dans la Capitale. Bientôt même les Pères du couvent de Saint-Jacques l'élurent comme prieur. Seul, l'abbé Jouin restait à Angers. Les instances de sa famille, son attrait person-nel, tout l'appelait à Paris : ce Paris, dont M. Laroche le détournait naguère et dont il avait peur pour lui ! Mais l'Évêque d'Angers, qui se connaissait en hommes et qui tenait à l'abbé Jouin, opposait une résistance qui ne tomba, au bout de deux ans, que devant cet argument ad hominem :
- Monseigneur, vous avez fait venir d'Alsace en votre palais épiscopal Madame votre Mère. Vous ne pouvez me refuser de rejoindre la mienne et mes deux frères.
Mgr Freppel se piquait de logique. Il reconnut sa défaite et consentit à laisser partir un prêtre de valeur :
- Soit, répondit-il. Allez à Paris. Mais, je vous le déclare, je connais le milieu ; vous n'y réussirez pas».
La suite des événements démontra que, dans la circonstance, l'Évêque d'Angers ne fut pas bon prophète.
SAINT-ÉTIENNE DU MONT. SAINTE-GENEVIÈVE.
Le quartier où, pendant un nouveau cycle de quatre ans, va s'exercer l'activité de l'abbé Jouin, ne lui est pas tout à fait inconnu. C'est la Montagne Sainte-Geneviève.
Plus d'une fois, au cours de ses récents voyages, il en a gravi les pentes, croisant des caravanes de touristes ama-teurs du Vieux-Paris ou les groupes de pèlerins venant prier là-haut la Patronne de la Cité.
A cette époque, deux églises voisines se partagent le culte de Sainte-Geneviève. Majestueuse et massive, semblable à une nécropole, la Basilique bâtie par Soufflot abrite la châsse de la Sainte ; à côté, élégante et gracieuse, l'église pa-roissiale de Saint-Étienne du Mont possède le Tombeau. Entre les deux - vestiges de l'ancienne basilique - se dresse la Tour de Clovis.
Aux jours de la neuvaine séculaire, les fidèles vont d'une église à l'autre, s'arrêtant pour de pieuses emplettes aux boutiques pittoresques élevées en plein vent.
Dans la Basilique, cinq chapelains entretiennent le culte de la Vierge parisienne, et à Saint-Étienne du Mont un nombre égal de vicaires assurent le service paroissial. Le Curé, M. l'abbé Perdreau, est un ami de l'Anjou. Il n'a pas ce-pendant demandé l'abbé Jouin. C'est M. l'abbé d'Hulst qui, pour être agréable à M. Henry, a fait nommer son frère à cette paroisse que, seuls, les Jardins du Luxembourg séparent de la demeure de Madame Jouin.
Cette paroisse ne semblait pas devoir fournir un terrain bien favorable à l'activité impatiente du nouveau vicaire. Pa-roisse universitaire sans doute, avec le Collège de France, la Sorbonne, l'École Polytechnique, la Faculté de Droit, cinq collèges ou lycées - mais paroisse pauvre et l'une des dernières de Paris par le chiffre et par les ressources de sa popu-lation. Isolée par les innombrables monuments, collèges, lycées, bibliothèques, communautés ou séminaires qui couvrent le sommet et les pentes de la montagne, l'église ne voit guère - les jours de la neuvaine exceptés - les foules envahir sa nef et prier devant son joli jubé, ce bijou de la Renaissance. D'autre part, les quatre aumôniers des lycées voisins, et ceux de nombreuses communautés religieuses, se partagent, avec les chapelains de la Basilique et le clergé paroissial, la clientèle religieuse du quartier : clientèle instable composée surtout d'étudiants et de familles qui disparaissent une fois les grades obtenus.
Champ d'action ingrat et modeste, dans lequel le jeune prêtre va travailler pendant près de quatre ans - de 1875 à 1879 - soit comme dernier vicaire de Saint-Étienne du Mont, soit comme chapelain de Sainte-Geneviève. Qu'importe ? L'abbé Jouin s'en console en pénétrant dans les masures insalubres de la rue Mouffetard ou dans les taudis collés le long des murs du Collège de France ou du collège Sainte-Barbe, et jusque sous les fenêtres du presbytère. Il y laisse toujours d'abondantes aumônes, au point de se mettre lui-même dans l’embarras.
- Je n'ai plus un sou, confiait-il un jour «à son abbé» peu de temps après son arrivée à Saint-Étienne du Mont : mon mois est entièrement dépensé.
- Nous ne sommes pourtant qu'au 15 du mois, répondit celui-ci. Comment allez-vous faire ?
Ce qu'il fit ? on le devine, il s'endetta. Puis il se mit à chercher des vocations sacerdotales, sans grand succès d'ail-leurs. L'unique sujet qu'il envoya au collège de Combrée lui revint bientôt, faute d'aptitudes littéraires.
Enfin, libéré en 1877, par sa nomination de chapelain à la Basilique Sainte-Geneviève des embarras du ministère pa-roissial, il se donne à la prédication. Il prêche le Carême à Saint-Paul-Saint-Louis, des retraites de premières commu-nions en plusieurs églises, les exercices de l'Adoration en diverses communautés. Soucieux de mettre dans sa parole, avec la forme qui captive l'auditeur, la science qui l'instruit et l'édifie, il se décide à donner à ses études théologiques une consécration dernière en se présentant à Flavigny devant ses anciens professeurs pour conquérir le grade de Maître en théologie. Le diplôme de Docteur qui lui fut délivré le 30 septembre 1879, constate que l'abbé Jouin fut admis avec toutes boules blanches.
C'est de cette époque que datent ses premières relations avec les chanteurs d'églises. En les recevant à sa table, en acceptant leurs invitations, en faisant dans leur compagnie aux environs de Paris de familières excursions, il cédait sans doute à son attrait pour la musique - son rêve de jadis - mais plus encore songeait-il qu'un jour ils apporteraient à son mi-nistère un concours efficace et qu'en gagnant leur amitié, il atteindrait plus sûrement leur âme. «Son abbé» se souvient de son chagrin lorsque, un jour, l'un d'eux gravement malade refusa de se rendre à ses instances, comme à celles du jeune abbé qu'il envoya tenter un suprême effort pour ramener à Dieu cette âme qu'il aimait.
Vigilante, parfois jusqu'à la défiance, Madame Jouin redoutait pour son abbé ces relations d'un genre nouveau. Trou-vant, près de sa demeure, un appartement libre, elle demanda à son fils d'abandonner le logement ensoleillé qu'il occu-pait alors, rue Claude-Bernard, pour s'installer près d'elle et de son frère, dans un appartement froid et humide : un rez-de-chaussée. Un désir de Madame Jouin était un ordre. Chaque matin du rude hiver 1879, pour aller dire sa messe, le chapelain de Sainte-Geneviève était obligé de traverser les vastes Jardins du Luxembourg. Sa poitrine déjà fatiguée par de nombreuses prédications, ne put résister à cet ensemble de circonstances fâcheuses ; une pleurésie se déclara qui mit ses jours en danger. Convalescent, il dut quitter Paris et s'en alla chercher la guérison dans les pins d'Arcachon, d'où plusieurs pensaient qu'il ne reviendrait pas. Une fois encore, la maladie était venue contrarier ses beaux projets et boule-verser ses plans.
De longs mois il vécut dans les pins et sur les sables du bassin, se reposant à sa façon, faisant de longues marches, s'amusant à promener, jusqu'à les exténuer, les amis venus au cours de l'été s'apitoyer sur son sort, rendant même des services à l'église Saint-Ferdinand, dont il devint, en fait, un vicaire très actif.
Quand, au bout de dix-huit mois, vers la fin de 1881, il revint à Paris, de graves événements avaient bouleversé la France. Les fameux décrets du 29 mars 1880 avaient été exécutés ; son frère, le R.P. Jouin, prieur du couvent de Saint Jacques, avait été expulsé (l'expulsion du R. P. Jouin et des religieux du Couvent de Saint- Jacques, rue Jean de Beau-vais, eut lieu le 5 novembre 1880) par la force publique, et la Basilique Sainte-Geneviève, une fois de plus, allait redeve-nir le Panthéon, le «Tombeau des Grands Hommes» !
Les chapelains, dont il avait clos la liste, furent appelés à d'autres postes : M. Pousset devint plus tard Archiprêtre de Notre-Dame et M. Le Nordez, évêque de Dijon. Quant à lui, il attendit, six mois, un poste compatible avec ses forces.
Enfin le 2 juillet 1882, il fut nommé à la cure de Joinville-le-Pont.
(à suivre...)
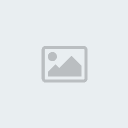
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 2)
CHAPITRE III. LE CURÉ DE JOINVILLE-LE-PONT. (1882-1886)
JOINVILLE-LE-PONT EN 1882 - LE BANQUET DU VENDREDI-SAINT. - UNE INSTALLATION QUI COMMENCE PAR LE MISERERE. - PREMIERE REN-CONTRE AVEC LA FRANC-MAÇONNERIE. - LES CONQUETES MERVEILLEUSES DES SERVANTES DES PAUVRES. - L'ORAGE ECLATE. - COMMENT ON «FAIT RENDRE GORGE A UN CURE AVANT LA LETTRE». - UN MINISTRE DES CULTES QUI SE DEJUGE A DEUX SEMAINES DE DISTANCE. - QUATRE PROCES ET CENT ARTICLES DE JOURNAUX EN DEUX ANS. - UNE SEANCE TRAGI-COMIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE. - ACQUITTE SUR TOUTE LA LIGNE. - LE CURE DE JOINVILLE EST NOMME SECOND VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. - COMMENT IL SE VENGE DE SES ENNEMIS.
Aucun site ne pouvait mieux convenir à la santé encore chancelante de l'Abbé Jouin que celui de la charmante localité de Joinville-le-Pont, sur un plateau riant, à la lisière du Bois de Vincennes, à l'entrée de la boucle que forme la Marne avant d'unir ses eaux à celles de la Seine. Par contre, sous des couleurs moins favorables se présentait la situation mo-rale et religieuse de la paroisse. Chaque dimanche, les trains déversent sur la région des milliers de Parisiens attirés par le bois, la Marne et ses îles ; on y vient danser, canoter... et souvent s'y noyer. La semaine, les courses amènent un monde encore plus douteux. C'est Joinville que la Société dite «Les Becs salés» a choisi pour le champ de ses joyeux exploits, et les bouchers libre-penseurs de Paris pour leur banquet sacrilège du Vendredi-Saint. Le pays vit de cet afflux d'étrangers qui ne se retire pas sans laisser beaucoup de lie après lui.
L'église est bâtie en façade sur la rue principale ; mais le chœur et la sacristie s'enfoncent dans les jardins des pro-priétés voisines : circonstance favorable aux cambrioleurs qui, justement peu de jours avant l'arrivée du nouveau curé, viennent de la dévaliser, profanant les saintes hosties. Aussi, les rites de l'installation seront-ils précédés du chant du Mi-serere. M. l'Archidiacre de Saint-Denys préside la cérémonie ; mais il a délégué le R.P. Jouin pour présenter aux fidèles leur nouveau curé.
Il n'y a pas de presbytère, et la Municipalité, aux termes du Concordat alors en vigueur, verse au desservant une in-demnité annuelle de logement. A la Mairie, règne un esprit sectaire. Le Maire, ancien restaurateur, et l'un de ses adjoints sont francs-maçons. Le Conseiller général du canton appartient aussi à la Loge. La population est indifférente. Peu d'hommes à l'église, les fabriciens eux-mêmes n'y paraissent guère et ne font pas leurs Pâques. Il y a pourtant parmi eux de braves gens, tel le trésorier de la Fabrique, M. Durand, un ancien colonial. Il est dévoué à son curé et au besoin le dé-fendrait. Dans les écoles, les nouvelles lois laïques sont appliquées dans toute leur rigueur.
Au milieu de l'indifférence générale, quelques femmes pieuses - telles les saintes demoiselles Amiel et cette autre qui surveille à la messe les enfants du catéchisme - apportent au pasteur un peu de consolation ; elles lui seraient même une aide précieuse, mais jusqu'ici on n'a guère fait appel à leur bonne volonté : elle se contentent de prier et - comme les filles de Jérusalem - de pleurer sur l'indifférence universelle.
Il faudrait des œuvres, des patronages, des sœurs pour atteindre cette population qui se passe de Dieu. Mais le Curé est seul ; seul pour baptiser, prêcher, confesser, catéchiser, procéder aux enterrements et aux mariages. Le dimanche, avec ses deux messes, son sermon, les baptêmes et les convois, il n'a pas un instant de repos.
Voilà le champ qu'il lui faut défricher, ou plutôt le terrain sur lequel, durant quatre ans, il va livrer un rude combat.
Ce fut, en effet, la destinée de l'abbé Jouin, de subir, un des premiers, l'assaut des sectes anti-religieuses déchaî-nées, depuis Gambetta et Ferry, contre la France catholique. Associées pour paralyser son action sacerdotale, elles n'au-ront de cesse qu'après l'avoir chassé de Joinville.
Le premier acte d'hostilité, il va sans dire, ne vint pas de son côté. Dès le 5 août - c'est-à-dire quelques semaines seu-lement après son arrivée, le Conseil Municipal lui supprimait l'indemnité de logement. Cette attaque imméritée ne dé-tourne pas un instant le Curé de son œuvre. Il a son plan : attirer les indifférents à l'église par l'éclat des cérémonies ; donner aux enfants une forte instruction religieuse ; assister les pauvres, dans toute l'étendue de ses ressources ; visiter les malades et les préparer à une fin chrétienne.
II commence donc par faire venir d'Angers tout un chargement de plantes et de fleurs : décorations fraîches et gra-cieuses qui, à certains jours plus solennels, du tabernacle s'élèvent presque jusqu'à la voûte. A Noël, c'est une crèche originale dont il est lui-même l'architecte ; à la Fête-Dieu, c'est un «reposoir» extérieur auquel une équipe de dames tra-vaille pendant des semaines. Il n'y a pas d'hommes pour porter le dais : il en fait venir de Paris. Tout ceci pour le plaisir des yeux.
Et voici pour la satisfaction de l'oreille : il n'y a qu'un chantre à Joinville, et quelle voix ! Le musicien qui sommeillait en M. Jouin se réveille. Dans les environs, à Joinville même, il trouve un organiste, des instrumentistes, jusqu'à des chan-teurs de l'Opéra, heureux de lui prêter leur concours pour des messes en musique ou des saluts solennels, pendant que des prédicateurs extraordinaires, cherchent à réveiller la foi assoupie dans les âmes. De temps à autre, on entend la voix ardente de son frère et celle d'un autre dominicain, le R.P. Mercier, portant l'un et l'autre sur la robe blanche le ruban rouge gagné au prix de leur sang, sur les champs de bataille.
Ne pouvant encore songer à établir des patronages, il se dédommage en multipliant les catéchismes : garçons et filles, première et seconde année sont séparés. Des récompenses sanctionnent la récitation exacte du texte diocésain : à la fin de l'année, des dizaines d'enfants se présentent pour gagner la médaille d'or promise à quiconque récitera sans faute le catéchisme en entier.
A ce régime, dimanches et jeudis sont lourdement chargés.
En 1885, «son abbé» souffrant vint, après son ordination, prendre quelques mois de repos au presbytère de Joinville ; il rendait en même temps quelques services au Curé ; il le remplaça même entièrement durant une semaine. Le jeudi, après avoir fait le catéchisme aux enfants des écoles communales, et à ceux des pensions libres, il revint sans voix, n'ayant pas parlé moins de huit heures. Il comprit alors la somme de travail que s'imposait le Curé au cours d'une année.
Mais si le Pasteur pouvait se réjouir de l'application des enfants et de l'assistance chaque jour grandissante à l'église, il ressentait une vive douleur de son insuccès auprès des malades. En dix-sept mois, un seul avait consenti à recevoir le secours de son ministère. Riches ou pauvres, tous mouraient sans souci de leur éternité. - «Que faire, demandait-il un jour à sa mère ?» - «Appelle à ton aide les Servantes des Pauvres !» répondit-elle.
Les Servantes des Pauvres ! Il les avait vues à l'œuvre à Angers. Mais Dom Leduc voudrait-il détacher quelques unes de ses filles, encore peu nombreuses, pour une si petite paroisse ? Les négociations commencées aboutirent heureuse-ment et, à la fin du mois de novembre 1883, Madame Jouin allait recevoir à la gare Montparnasse les trois petites sœurs un peu effrayées, et les conduisait à Joinville dans le modeste logement que la Providence leur avait préparé, et le len-demain, fête de la Présentation, la petite communauté était solennellement installée, sous la protection de sainte Gene-viève.
Mgr Freppel, l’évêque d'Angers, retenu par une séance à la Chambre des Députés, ne put présider la cérémonie. Dom Leduc présenta ses religieuses, le Pasteur lui répondit et bénit la chapelle et le soir, en présence d'une assistance choisie, le R.P. Jouin prenant pour texte ces paroles de l'Évangile : «Ne craignez rien, petit troupeau, car vous avez de votre Père la promesse d'un royaume : vous marcherez à la conquête des âmes», adressa aux trois Servantes des Pauvres une éloquente exhortation. Dès le lendemain, Mère Agnès - la prieure - et ses deux compagnes commençaient leur service auprès des malades et préludaient à la conquête des âmes.
Des conquérantes ! elles l'étaient par leur charité. Comment résister à tant d'humilité, de patience, d'abnégation, de désintéressement ? A la première heure, elles accourent au pauvre logis, nettoient la chambre, font la toilette des en-fants, soignent le malade, préparent toutes choses. A son retour à midi, l'homme s'émerveille de trouver sa maison en ordre, sa femme plus résignée, son repas préparé. Un ange est-il donc passé chez lui ? Oui, certes, un ange terrestre, la petite Servante qui a disparu pour aller prendre chez elle son modeste repas, rejoindre ses compagnes et, devant le Ta-bernacle, retremper ses forces pour reprendre tout à l'heure, demain, et tous les jours de sa vie, l'humble service des ma-lades auxquels elle s'est consacrée. Faut-il, en cas de danger, passer la nuit près du malade ? la Servante des Pauvres donnera jusqu'à trois de ses nuits par semaine. Et tout cela sans aucune rétribution. Que dis-je ? lorsque la famille est nécessiteuse, la sœur apporte un pot-au-feu pour le repas, des vêtements pour les enfants.
On ne tarde pas à apprendre que soins et secours sont donnés ainsi sans considération de personnes ou d'opinions au nom de Monsieur le Curé, de ce Curé que, chaque semaine, les journaux du pays tournent en dérision, accusent même de malversations et de vol.
«Jamais, M. le Curé ne me refuse quoi que ce soit pour les pauvres», disait la Mère Prieure. «Donnez autant que ce sera nécessaire, répétait-il. C'est avec des pot-au-feu que nous gagnerons leurs âmes».
Leur première conquête fut celle d'un cordonnier et de sa famille. Les parents n'étaient pas mariés, et les enfants - au nombre de six ou sept - pas baptisés. De plus, la femme était protestante. Les sœurs se présentent à l'occasion d'une maladie. Peu après l'union était régularisée, la femme abjurait et les enfants, instruits, recevaient le Baptême. Puis, c'est une famille juive qui se fait catholique. Mais le plus beau triomphe de la petite sœur Marie-Thérèse fut la conversion d'un franc-maçon. Très malade d'un cancer, il avait consenti à recevoir les soins des religieuses : - «Je veux bien recevoir la Sœur, mais pas le Curé», disait-il en blasphémant ! Au bout de six mois, il était vaincu, se confessait et mourait dans le repentir.
Devant tant de générosité, les préjugés tombaient. On admirait, on aimait ces petites sœurs toujours souriantes, tou-jours empressées aux besognes les plus répugnantes, et l'on était reconnaissant au prêtre qui les envoyait.
Entre temps, par une dérogation aux règles de la Congrégation, les Sœurs recevaient, jeudis et dimanches, les petites filles que le Pasteur ne se résignait pas à abandonner après leur première communion, et leur procuraient d'honnêtes distractions. Quant aux garçons, il en choisissait deux, plus intelligents et plus pieux que les autres, et les envoyait au collège de Combrée. Le premier devait lui succéder un jour comme curé de Joinville ; l'autre est aujourd'hui religieux dans un couvent de Rome.
Mais à la Mairie, l'orage se formait. «Ce n'était donc pas assez de ces robes de moines que, le dimanche, on croisait dans les rues de la ville ! Ce sont maintenant des «bonnes» Sœurs qu'on rencontre à tout instant dans tous les quartiers. On dirait qu'il y a dix Servantes «dites» des Pauvres. Elles osent pénétrer dans les maisons ouvrières et, sur leurs talons, le Curé s'y introduit. Pour comble, celui-ci distribue des secours, paye même des loyers !... Il est donc riche, et n'a nul be-soin d'une indemnité de logement».
Cette indemnité que la Municipalité, de par le Concordat, allouait au desservant de Joinville, le Conseil Municipal l'avait, en principe, supprimée, avant même l'arrivée de l'abbé Jouin.
Voici en quels termes élégants, deux ans plus tard, un journal local narrait la chose à ses lecteurs :
«Il y a quelques trois ans, du temps de l'abbé Moreau, le Conseil Municipal de Joinville trouva singulièrement maigres les recettes des Pompes Funèbres accusées par le Conseil de Fabrique.
On procéda à une enquête. Il en résulta qu'il manquait à l'appel une somme de 1200 francs.
- Qu'est-elle devenue ? demanda-t-on au Curé.
Celui-ci répondit carrément, sans le moindre détour, qu'il l'avait mise dans sa poche, ainsi que cela se fait tou-jours, et, se basant sur cette coutume invétérée, se refusa à en rendre un traître maravédis.
Cette franchise de la part d'un bâton de réglisse, tonsuré, va sans doute surprendre bien des gens. Elle est si en dehors de l'habitude de ces messieurs !...
Donc le Conseil municipal apprit que le curé avait fait du fourbi, comme on dit au régiment, sur les produits des Pompes Funèbres.
Il s'empressa de réclamer les 1200 francs perçus indûment par l'abbé Moreau, lequel, ainsi que je l'ai dit, n'enten-dit point de cette oreille...
L'abbé Moreau fut remplacé par un autre prêtre qui ne ressemblait au premier que par le waterproof noir d'uni-forme et la tonsure.
Jugeant que ce nouveau ministre du Seigneur s'empresserait d'en user avec les sommes versées pour les ser-vices funèbres selon la coutume, le Conseil s'avisa d’un expédient pour lui faire rendre gorge avant la lettre.
Le 5 août 1882, considérant que la Fabrique était assez riche, il supprima les 720 francs accordés au Curé comme indemnité de logement».
En conséquence, quelques jours après l'installation des Servantes des Pauvres, par un vote unanime, renouvelant ce-lui du 5 août 1882, le Conseil Municipal supprimait la dite indemnité pour le dernier trimestre de cette année 1883. Bien plus, on réclamait au desservant les trois premiers trimestres déjà versés. «Car, cet argent, disait le Maire, avait servi à faire bouillir la marmite du Curé». A ce langage imagé, on reconnaissait l'ancien restaurateur.
Sans tarder, le Conseil de Fabrique riposta : «Il est connu que les faibles honoraires de M. le Curé servent largement à «faire bouillir la marmite» des pauvres».
Pour comprendre, non pas les raisons, mais les prétextes dont cherchait à se couvrir l'hostilité municipale, il nous faut revenir à cette affaire de Remise des Pompes Funèbres.
L'Administration civile ainsi désignée avait pour but la fourniture dans la banlieue parisienne de tout le matériel néces-saire aux enterrements : Dans chaque commune, un employé - souvent le secrétaire de la Mairie - réglait ces dépenses avec les familles suivant un tarif officiel. D'après un usage commun à toutes les communes, usage connu et approuvé par l'Archevêché et par la Préfecture, à la fin de chaque mois, l'Administration des Pompes Funèbres abandonnait à l'église une certaine somme appelée «remise». Une moitié était versée à la Fabrique, qui la portait en recette. L'autre moitié, donnée au Curé, ne figurait pas aux comptes fabriciens.
Les administrations diocésaine et préfectorale saisies de la plainte municipale déclarèrent la conduite du Curé légitime pour le passé, mais demandèrent à l'avenir au trésorier de faire figurer aux recettes la totalité de la Remise et aux dé-penses la part afférente au Curé : décision qui fut appliquée dans le projet de budget de 1884.
D'autre part, le Ministre de la Justice et des Cultes estimait qu'«en présence des explications fournies par l'Archevê-ché, il ne convenait pas de prononcer la dissolution du Conseil de Fabrique qui n'avait fait que suivre un usage ancien et commun aux paroisses suburbaines et que, par les mêmes raisons, il ne saurait être question de versement à la caisse fabricienne de sommes indûment perçues par le desservant».
On pouvait donc croire l'affaire terminée quand, le 17 août suivant, parmi d'autres énormités, on pouvait relever dans une délibération du Conseil Municipal ce considérant mensonger :
...«Attendu que le Conseil de Fabrique, auquel ces agissements ont été signalés par le Maire, ne les a pas désa-voués et n'a pris aucune mesure pour y mettre fin...»
En même temps, un journal libre penseur du canton publiait cette lettre du Préfet de la Seine à M. le Maire :
Paris, 31 juillet 1884.
«Monsieur le Maire,
A la suite, et en conformité d'une décision de M. le Ministre de la Justice, en date du 14 juin dernier, j'ai enjoint : 1° à M. le Curé de Joinville de remettre au Trésorier de la Fabrique, la somme qu'il a indûment touchée sur la Recette des Pompes Funèbres ; 2° au Trésorier de la Fabrique, de verser sur cette somme, entre les mains du Percepteur, au profit de la Commune, l'indemnité de logement accordée par le Conseil au Curé en raison de l'insuffisance des ressources de la Fabrique, insuffisance dont le mal-fondé est aujourd'hui établi».
Par quelles manœuvres avait-on arraché au Ministre une décision qui, à quelques semaines de distance, le mettait en contradiction avec lui-même et en opposition avec l'Archevêché ? On le devine...
Tel est le point de départ d'une chicane déloyale où se révèlent la mauvaise foi d'un maire sectaire et la docilité d'un ministre aux ordres de la Franc-Maçonnerie - chicane qui va se prolonger trois ans et conduire le Curé de Joinville du Conseil de Préfecture au Conseil d'État, de la Police correctionnelle à la Cour d'Appel et jusques à la Cour de Cassation.
De la décision du ministre, l'abbé Jouin fit en effet immédiatement appel devant la Cour suprême. L'arrêt - qui n'inter-viendra qu'un an plus tard - lui donnera pleinement raison. Mais, dès ce jour, et jusqu'à la fin, les deux journaux libres penseurs du canton obéissant à un mot d'ordre vont publier chaque semaine contre le Curé des articles injurieux et blas-phématoires reprenant et répétant contre lui les accusations de vol et de détournement, annoncent avec une joie maligne le vote par le Conseil Municipal d'une installation d'urinoirs presque à l'entrée de l'église et l'impression à 2000 exem-plaires et la distribution de la lettre du Ministre - inventent de toutes pièces un prétendu guet-apens tendu au Maire par le Curé et les fabriciens à l'occasion d'une réunion fabricienne, où «tout le Conseil, nous citons, y compris le Curé, avaient invectivé le Maire, et, les yeux injectés, l'écume à la bouche, lui avaient vomi les insultes et les injures les plus grossières, où les mots lâche, canaille étaient les moins malsonnants» - profèrent des blasphèmes à l'occasion d'une allocution du Curé aux jeunes filles pour leur fête patronale - rapportent avec force détails une conférence du député Laguerre, membre de la Loge, au sujet de la Fondation à Joinville d'un groupe de la Libre-Pensée et de l'organisation d'un banquet pour le Vendredi-Saint.
Le Conseil de Fabrique se justifiait et justifiait la conduite du Curé dans une «Lettre à la Population de Joinville». Il s'appuyait sur l'approbation de l'Archevêché et sur la décision primitive du ministre repoussant la dissolution de la Fa-brique :
«En face des cabales montées par M. le Maire à tous les carrefours de la Commune et des imputations de dé-tournement et de vol dont il ne cesse d'accuser publiquement le Curé, nous avons le droit, disaient les Fabriciens, d'affirmer qu'il est impossible de ne pas reconnaître de la part du Conseil Municipal un parti pris haineux et une hosti-lité systématique contre la religion et contre un Curé honorable dont la charité est connue de tous».
- «Qu'en dites-vous ? répliquaient ces journaux. Un Curé honorable qui touche indûment une somme de 1200 francs qui ne lui appartient pas... Cela lui permet facilement d'être charitable».
Entre temps, les instances faites auprès du Ministre par le Conseil Municipal avaient abouti.
Par une décision du 9 février 1885, il prononce la révocation du Conseil de Fabrique de Joinville, décide la formation d'un nouveau Conseil et prononce l’inéligibilité des fabriciens révoqués au nouveau Conseil. «Leurs successeurs devront faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, ainsi que pour établir la responsabilité du trésorier et des fabriciens sortants».
C'est alors que les mêmes journaux publiaient le récit mensonger d'un prétendu attentat commis sur la personne du Maire au cours d'une séance fabricienne, le dimanche de Quasímodo, jour où les Fabriques - avant la loi de Séparation devaient voter le budget.
L'abbé Jouin n'avait pu trouver dans toute sa paroisse les trois catholiques, dont la désignation en vue du nouveau Conseil appartenait à l'autorité diocésaine ; d'autre part, d'après l'avis de Me Sabatier, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'État, que le Comité des Jurisconsultes catholiques avait chargé de soutenir le pourvoi des Fabriciens révo-qués, ce pourvoi pouvait être considéré comme suspensif. - L'Archidiacre, M. Pelgé, et le Coadjuteur, Mgr Richard, avaient unanimement conseillé au Curé de convoquer l'ancien Conseil pour le vote du budget et l'expédition des affaires courantes.
Le dimanche de Quasímodo, le Maire se présente accompagné de l'un des deux citoyens nommés par le Ministre. En vain, le Curé lui explique-t-il que c'est l'Ancien Conseil' qui se réunit et qu'on n'y saurait admettre M. Beaulard, le nouveau Conseil n'étant pas encore constitué. Le Maire proteste violemment. Une discussion s'engage au cours de laquelle des épithètes malsonnantes retentissent :
- Vous manquez de dignité en siégeant après votre révocation.
- Ceux qui manquent de dignité sont ceux qui ne cessent de répandre contre la Fabrique, le trésorier et le Curé d'odieuses accusations ; ce sont les francs-maçons qui prétendent - contre la loi - gérer les intérêts catholiques.
- Oui, je le répète, c'est avec l'argent de la Fabrique que le Curé «fait bouillir sa marmite», et le trésorier qui se prêté à ces malversations est un voleur... Quant à notre «foi franc-maçonne», nous en sommes fiers ! - Et cette pro-fession de foi du Maire était accompagnée d'un blasphème. En même temps, de sa canne, il désignait le trésorier, M. Durand, et s'avançait vers lui.
L'ancien soldat bondit sous l'injure. Se croyant menacé, il cherche une arme pour se défendre. Sur une table, il saisit un crucifix ; aveuglé par la colère, il allait en frapper le Maire quand il s'aperçoit de sa méprise. Il dépose son arme ; mais revenant vers son adversaire, il le repousse de l'épaule. Ce qui permit au Maire de raconter ensuite qu'on l'avait bousculé et saisi à la gorge...
Conclusion : deux nouveaux procès :
Le Maire assignait le Trésorier devant le Tribunal pour voies de fait sur un Magistrat dans l'exercice de ses fonctions, (art. 228 du Code pénal).
Et d'autre part, le Conseil de Préfecture, agissant au nom du Maire, obtenait du Conseil d'État l'autorisation de pour-suivre le Curé et ses Fabriciens devant le Tribunal correctionnel pour exercice illégal de l'autorité publique après leur ré-vocation.
Voilà donc l'abbé Jouin avec quatre procès. Car il prend tout à sa charge : honoraires des avocats - (Maître Sabatier, Maître Albert Danet, le bâtonnier d'alors, et Maître de Saint-Auban, futur bâtonnier - préparation des dossiers relatifs aux affaires en litige, (car il a étudié le Décret de 1809, la question du casuel et celle des Pompes Funèbres, dépouillé le Code Dalloz et la collection du Bulletin des Lois pour y trouver la Jurisprudence établie), tout lui incombe. Si l'on ajoute à cela les citations à comparaître, soit comme témoin, soit comme accusé ; les audiences devant le Juge d'instruction, le Tribunal et la Cour (puisque l'on ira en Appel et même en Cour de Cassation), on aura une idée de l'énergie dépensée par ce prêtre - qui mène de front avec ce travail écrasant l'administration de sa paroisse et le soin de ses catéchismes. Son bureau est devenu une salle de rédaction, mieux encore, un arsenal où se forgent les armes de la défense. Sous sa dictée, trois ou quatre secrétaires improvisés écrivent les arrêts des tribunaux qui ont fixé la jurisprudence, notant en marge d'un côté les références, de l'autre les commentaires des jurisconsultes. De temps à autre, parfois deux fois le jour, «son abbé», se détache pour porter à Paris les dossiers sur lesquels les avocats n'auront plus qu'à plaider.
Haletants, les secrétaires s'agitent et s'énervent. Lui seul, impassible, comme un capitaine sur la passerelle de son navire battu par la tempête, compulse toujours et dicte à deux ou trois de ses aides en même temps.
Désormais les jugements vont se succéder rapidement, sans l'atteindre d'ailleurs, mais frappant iniquement son tréso-rier et ses fabriciens. Les voici, dans l'ordre de date :
20 avril 1885. - Me Sabatier dépose devant le Conseil d'État le pourvoi des fabriciens contre le décret de révocation.
15 juillet. - Audience de la 11e chambre. M. Durand est condamné à six jours de prison et à 1 franc de dommages-intérêts. Appel de ce jugement est interjeté devant la Cour.
3 novembre. - La Cour modifie la sentence des juges de première instance, supprime la prison et réduit la peine à 16 francs d'amende.
12 novembre. - La Cour de Cassation, appelée à se prononcer sur la décision ministérielle enjoignant au Curé de re-mettre «la somme qu'il avait indûment touchée sur la recette des Pompes Funèbres, condamne le Ministre, et déclare que l'indemnité de logement attribuée par la loi au Curé d'une paroisse constitue une allocation spéciale pour un service public. Le paiement de cette indemnité est dû par la Fabrique, et la charge en incombe à la Commune, si les ressources de la Fabrique sont insuffisantes. Le Curé ne saurait être tenu de restituer les sommes qu'il a légitimement reçues de la Commune».
Ainsi, après trois ans, le Curé de Joinville était justifié et la Municipalité condamnée.
30 janvier 1886. - Le Conseil d'État décide qu'il y a lieu de poursuivre le Conseil de Fabrique pour la réunion de Quasímodo, (art. 197 du Code pénal) et assigne le Curé et les Fabriciens devant la 11e chambre. Dans l'audience de ce jour, et dans celle du 6 février, Me Danet et Me de Saint-Auban établissent, contrairement aux conclusions de M. le Subs-titut Lombard, que
1) le Curé n'est pas fonctionnaire public.
2) que, membre de droit du Conseil, il peut continuer à siéger même après révocation du Conseil.
3) que les fabriciens ne sont pas davantage fonctionnaires publics et ils réclament leur acquittement.
13 février. — Le tribunal acquitte le Curé de Joinville, mais condamne les membres du Conseil de Fabrique à 25 francs d'amende et solidairement aux dépens.
Acquitté, l'abbé Jouin n'abandonne pas ses fabriciens. Il fait appel du jugement qui les condamnait.
19 mars. - Le Conseil d'État rend son arrêt sur la demande d'annulation, présentée par les fabriciens, de la décision ministérielle qui les avait révoqués. Me Sabatier, leur avocat, avait présenté des conclusions établissant que le Ministre avait excédé ses pouvoirs : 1) en prenant sa décision contre l'avis de l'Evêque ; 2) en décidant que les membres révo-qués ne pourraient faire partie du nouveau Conseil.
Le Conseil d'État les déboute de leur revendication.
22 mars. - L'affaire des fabriciens revient devant la Cour d'Appel. L'avocat général Bernard compare le Curé de Join-ville et ses fabriciens à Louise Michel et aux anarchistes .
27 mars. - La Cour confirme le jugement du Tribunal : Ainsi donc, 16 francs d'amende au Trésorier pour voies de fait sur le Maire ; 25 francs aux fabriciens coupables de rébellion contre la loi ; voilà le résultat de trois ans de lutte. La mon-tagne maçonnique accouchait d'une souris !
«Un seul des prévenus, remarquait, non sans dépit, Le Progrès, a été acquitté, est-il besoin de le nommer ? C'est celui qui, semblable au lion de la fable, a dévoré force moutons, et a mangé quelquefois le berger. Les autres n'ont pas même tondu le pré de la largeur de leur langue. L'acquitté, au contraire, a empoché l'argent, cause première du conflit : c'est lui qui, après la révocation de l'ancien Conseil, l'a convoqué sous sa responsabilité et l'a engagé à con-tinuer d'administrer la Fabrique ; c'est lui, en un mot, qui a été l'âme de cette petite rébellion contre la loi ; et c'est lui seul que la loi n'atteint pas !»
Le Curé sortait indemne. Mais les fabriciens étaient déclarés fonctionnaires publics, exposés comme tels à des pénali-tés plus sévères. Qui donc désormais consentirait à en assumer les fonctions ? M. Jouin s'en apercevait bien, qui ne pouvait trouver trois hommes de bonne volonté pour le nouveau Conseil.
C'est alors que, pour mettre fin à une lutte qui menaçait de s'éterniser, dans une pensée d'apaisement et aussi pour récompenser l'abbé Jouin, l'Administration diocésaine songea pour lui à un déplacement honorable. Mais on lui deman-dait sa démission. C'était le Jeudi-Saint 1886.
Devait-il obéir jusque-là et laisser croire, en demandant lui-même son changement, qu'il se reconnaissait coupable, alors qu'il n'avait fait que suivre les instructions de ses supérieurs ? Il ne le pensait pas. Toutefois il consulta. Le lende-main, Vendredi-Saint, «son abbé» se présentait à la porte du R.P. Jouin, au moment où celui-ci allait monter en chaire pour prêcher les Sept Paroles de Jésus en Croix. Il n'eut que le temps de jeter un regard sur les lignes que son frère lui adressait et de répondre : «On donne sa démission, quand on est coupable ou vaincu, sinon on reste à son poste. Voilà mon avis. Dites le à mon frère».
L'abbé Jouin n'était pas coupable. Cette guerre qu'on lui faisait depuis quatre ans, il ne l'avait pas provoquée. Il n'avait rien fait sans l'avis de ses supérieurs. Par ailleurs c'était contre l'avis formel de l'Archevêque que le Ministre avait dissous le Conseil de Fabrique et arbitrairement prononcé l'inéligibilité des anciens membres. Cette lutte était uniquement reli-gieuse et déchaînée par la Franc-Maçonnerie. Déclarée dès son arrivée, elle avait atteint toute son acuité au lendemain de l'installation des Religieuses.
Vaincu, le Curé ne l'était pas davantage. Il se sentait de force à continuer le combat.
Il ne donna donc pas sa démission : il se contenta de s'en remettre à la décision de ses supérieurs qui l'envoyèrent à Saint-Augustin à Paris, avec le titre de second vicaire.
Dès que le bruit se répandit dans Joinville du départ de l'abbé Jouin, une femme du peuple se mit à la tête d'une péti-tion demandant le maintien du Curé et des Sœurs. En moins de quinze jours, elle se couvrait de 900 signatures, et fut portée par des notables du pays à l'Archevêché. Témoignage éloquent des dispositions d'une population jusque-là indif-férente.
Il était trop tard, et l'abbé Jouin, quatre ans après son arrivée à Joinville, où il avait tant lutté, rentrait à Paris.
Voici en quels termes La Voix des Communes du 21 août annonçait la nouvelle à ses lecteurs.
«Le Curé, principal auteur du conflit entre la Municipalité et la Fabrique, après avoir épuisé toutes les juridictions, n'ayant pu faire prévaloir les ridicules prétentions des fabriciens, ses acolytes, a reçu ordre de son changement. II a dû quitter Joinville la semaine dernière, malgré la tentative faite en sa faveur par les bonnes sœurs et les bigotes du pays qui faisaient signer par les femmes, les enfants et les fournisseurs peureux ou complaisants, une pétition de-mandant son maintien. Elles en sont pour leurs frais, car elles n'ont pu lever la pénitence, si pénitence il y a... La pé-nitence est douce en effet : être nommé vicaire d'une des grandes paroisses de Paris, où les bénéfices, à part ceux résultant des incendies , sont beaucoup plus considérables, ne nous semble pas un châtiment bien sévère».
Les libres penseurs n'étaient qu'à moitié satisfaits : à leurs yeux, la mort seule, ou la prison, leur eût paru un châtiment suffisant pour ce prêtre qui avait commis le crime impardonnable de reconstituer le mobilier de sa sacristie incendiée, et celui, plus grave encore, de doter la commune d'une maison de Servantes des Pauvres !
Le Curé s'en alla où on l'appelait. Mais il laissa les Sœurs qui restèrent à sa charge jusqu'à sa mort.
Ce fut sa vengeance. Il fit même davantage.
Quelques mois après le départ de l'abbé Jouin, Dom Leduc, s'inquiétait du sort de la maison Sainte-Geneviève ; le nouveau Curé, M. l'abbé Roustan, lui répondit :
«Les intentions de M. l'abbé Jouin ? j'affirme qu'elles n'ont jamais changé. M. Jouin a toujours été le soutien et la providence de cette Maison. Il continuera à faire le bien comme par le passé, avec autant de dévouement et de zèle. Avec lui vous n’avez pas à vous mettre en peine du loyer ni de l'entretien de vos filles... M. Jouin fait plus encore (et c'est un acte héroïque dont je lui suis très reconnaissant) : ce digne prêtre donne chaque mois une somme à vos reli-gieuses pour les mettre à même de faire l'aumône matérielle, quand elles sont appelées auprès de nos malades, ce qui les dispose à recevoir plus facilement l'aumône spirituelle. Je n'exagère pas en disant que mon vénéré et chari-table prédécesseur est le père et la providence de ma paroisse».
Providence de Joinville, il le restera jusqu'à la fin.
Séparé de cette paroisse, qu'il avait dû quitter, mais qu'il n'abandonnait pas, M. Jouin y revenait à certains jours. On l'y voyait fidèle à célébrer l'anniversaire de la fondation de ses chères Servantes des Pauvres. Près d'elles, il aimait à re-trouver quelques-unes de ces âmes de choix qui l'avaient soutenu de leurs prières et de leurs libéralités et, parmi elles, la bonne demoiselle Amiel.
Ces deux cœurs unis dans le même amour du Christ et des pauvres, poursuivirent jusqu'à un âge avancé leur mission de charité. Mademoiselle Amiel précéda de quelques semaines M. Jouin dans la tombe. L'ancien curé de Joinville se fit un devoir de rendre à sa dépouille un dernier hommage et lui consacra, dans le Bulletin paroissial de Joinville-le-Pont, ces lignes émues, les dernières peut-être qui sortirent de son cœur :
«...Comme les sept titulaires qui m'ont succédé, tous ont appelé Mlle Céleste Amiel la grande bienfaitrice de l'église paroissiale de Joinville, titre qu'elle partageait avec sa sœur, Mlle Caroline, qui fut enlevée à la fin de la guerre. Je suis heureux d'ajouter à l'appréciation unanime des douze curés de Joinville, celle d'un vicaire général de l'Arche-vêché, qui m'écrivait le 25 mai dernier : «Mlle Amiel est une grande bienfaitrice du diocèse» (Mlle Amiel a légué à l'Ar-chevêché de Paris sa maison et son jardin, contigus à l'église, pour devenir le presbytère des curés de Joinville). L'éloge est complet.
En quoi consiste-t-il ? En ceci qu'il résume la vie même du Christ. Les foules, émues des miracles de Jésus s'écriaient : «Il a bien fait toutes choses» ? Et puisqu'il s'agissait dans ce passage de l'Évangile d'avoir fait entendre les sourds et voir les aveugles, ne peut-on pas dire que ceux qui l'imitent et le suivent, font de l'exemple qu'ils don-nent une prédication et une lumière ? C'est bien la marque distinctive des quatre-vingt-six ans de Mlle Amiel.
«Aussi, au terme de cette longue existence, on lui applique encore cette autre parole dite du Sauveur : «Il a passé en faisant le bien». Elle fut la bienfaitrice de Dieu et du prochain.
De Dieu par sa fidélité exemplaire à la communion quotidienne, à l'assistance aux offices, au zèle de la maison de Dieu. Elle s'occupait des linges sacrés, elle soignait ses fleurs pour les porter à l'autel. Durant mes quatre ans de cure à Joinville, que de décorations à l'église, que de jolies crèches nous avons faites ensemble ! C'était le rayonne-ment de son cœur et de sa piété»...
A un mois de distance, leurs deux âmes se rejoignirent devant ce Dieu qu'elles contemplent et adorent, après l'avoir si fidèlement servi sur la terre.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 2)
CHAPITRE III. LE CURÉ DE JOINVILLE-LE-PONT. (1882-1886)
JOINVILLE-LE-PONT EN 1882 - LE BANQUET DU VENDREDI-SAINT. - UNE INSTALLATION QUI COMMENCE PAR LE MISERERE. - PREMIERE REN-CONTRE AVEC LA FRANC-MAÇONNERIE. - LES CONQUETES MERVEILLEUSES DES SERVANTES DES PAUVRES. - L'ORAGE ECLATE. - COMMENT ON «FAIT RENDRE GORGE A UN CURE AVANT LA LETTRE». - UN MINISTRE DES CULTES QUI SE DEJUGE A DEUX SEMAINES DE DISTANCE. - QUATRE PROCES ET CENT ARTICLES DE JOURNAUX EN DEUX ANS. - UNE SEANCE TRAGI-COMIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE. - ACQUITTE SUR TOUTE LA LIGNE. - LE CURE DE JOINVILLE EST NOMME SECOND VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. - COMMENT IL SE VENGE DE SES ENNEMIS.
Aucun site ne pouvait mieux convenir à la santé encore chancelante de l'Abbé Jouin que celui de la charmante localité de Joinville-le-Pont, sur un plateau riant, à la lisière du Bois de Vincennes, à l'entrée de la boucle que forme la Marne avant d'unir ses eaux à celles de la Seine. Par contre, sous des couleurs moins favorables se présentait la situation mo-rale et religieuse de la paroisse. Chaque dimanche, les trains déversent sur la région des milliers de Parisiens attirés par le bois, la Marne et ses îles ; on y vient danser, canoter... et souvent s'y noyer. La semaine, les courses amènent un monde encore plus douteux. C'est Joinville que la Société dite «Les Becs salés» a choisi pour le champ de ses joyeux exploits, et les bouchers libre-penseurs de Paris pour leur banquet sacrilège du Vendredi-Saint. Le pays vit de cet afflux d'étrangers qui ne se retire pas sans laisser beaucoup de lie après lui.
L'église est bâtie en façade sur la rue principale ; mais le chœur et la sacristie s'enfoncent dans les jardins des pro-priétés voisines : circonstance favorable aux cambrioleurs qui, justement peu de jours avant l'arrivée du nouveau curé, viennent de la dévaliser, profanant les saintes hosties. Aussi, les rites de l'installation seront-ils précédés du chant du Mi-serere. M. l'Archidiacre de Saint-Denys préside la cérémonie ; mais il a délégué le R.P. Jouin pour présenter aux fidèles leur nouveau curé.
Il n'y a pas de presbytère, et la Municipalité, aux termes du Concordat alors en vigueur, verse au desservant une in-demnité annuelle de logement. A la Mairie, règne un esprit sectaire. Le Maire, ancien restaurateur, et l'un de ses adjoints sont francs-maçons. Le Conseiller général du canton appartient aussi à la Loge. La population est indifférente. Peu d'hommes à l'église, les fabriciens eux-mêmes n'y paraissent guère et ne font pas leurs Pâques. Il y a pourtant parmi eux de braves gens, tel le trésorier de la Fabrique, M. Durand, un ancien colonial. Il est dévoué à son curé et au besoin le dé-fendrait. Dans les écoles, les nouvelles lois laïques sont appliquées dans toute leur rigueur.
Au milieu de l'indifférence générale, quelques femmes pieuses - telles les saintes demoiselles Amiel et cette autre qui surveille à la messe les enfants du catéchisme - apportent au pasteur un peu de consolation ; elles lui seraient même une aide précieuse, mais jusqu'ici on n'a guère fait appel à leur bonne volonté : elle se contentent de prier et - comme les filles de Jérusalem - de pleurer sur l'indifférence universelle.
Il faudrait des œuvres, des patronages, des sœurs pour atteindre cette population qui se passe de Dieu. Mais le Curé est seul ; seul pour baptiser, prêcher, confesser, catéchiser, procéder aux enterrements et aux mariages. Le dimanche, avec ses deux messes, son sermon, les baptêmes et les convois, il n'a pas un instant de repos.
Voilà le champ qu'il lui faut défricher, ou plutôt le terrain sur lequel, durant quatre ans, il va livrer un rude combat.
Ce fut, en effet, la destinée de l'abbé Jouin, de subir, un des premiers, l'assaut des sectes anti-religieuses déchaî-nées, depuis Gambetta et Ferry, contre la France catholique. Associées pour paralyser son action sacerdotale, elles n'au-ront de cesse qu'après l'avoir chassé de Joinville.
Le premier acte d'hostilité, il va sans dire, ne vint pas de son côté. Dès le 5 août - c'est-à-dire quelques semaines seu-lement après son arrivée, le Conseil Municipal lui supprimait l'indemnité de logement. Cette attaque imméritée ne dé-tourne pas un instant le Curé de son œuvre. Il a son plan : attirer les indifférents à l'église par l'éclat des cérémonies ; donner aux enfants une forte instruction religieuse ; assister les pauvres, dans toute l'étendue de ses ressources ; visiter les malades et les préparer à une fin chrétienne.
II commence donc par faire venir d'Angers tout un chargement de plantes et de fleurs : décorations fraîches et gra-cieuses qui, à certains jours plus solennels, du tabernacle s'élèvent presque jusqu'à la voûte. A Noël, c'est une crèche originale dont il est lui-même l'architecte ; à la Fête-Dieu, c'est un «reposoir» extérieur auquel une équipe de dames tra-vaille pendant des semaines. Il n'y a pas d'hommes pour porter le dais : il en fait venir de Paris. Tout ceci pour le plaisir des yeux.
Et voici pour la satisfaction de l'oreille : il n'y a qu'un chantre à Joinville, et quelle voix ! Le musicien qui sommeillait en M. Jouin se réveille. Dans les environs, à Joinville même, il trouve un organiste, des instrumentistes, jusqu'à des chan-teurs de l'Opéra, heureux de lui prêter leur concours pour des messes en musique ou des saluts solennels, pendant que des prédicateurs extraordinaires, cherchent à réveiller la foi assoupie dans les âmes. De temps à autre, on entend la voix ardente de son frère et celle d'un autre dominicain, le R.P. Mercier, portant l'un et l'autre sur la robe blanche le ruban rouge gagné au prix de leur sang, sur les champs de bataille.
Ne pouvant encore songer à établir des patronages, il se dédommage en multipliant les catéchismes : garçons et filles, première et seconde année sont séparés. Des récompenses sanctionnent la récitation exacte du texte diocésain : à la fin de l'année, des dizaines d'enfants se présentent pour gagner la médaille d'or promise à quiconque récitera sans faute le catéchisme en entier.
A ce régime, dimanches et jeudis sont lourdement chargés.
En 1885, «son abbé» souffrant vint, après son ordination, prendre quelques mois de repos au presbytère de Joinville ; il rendait en même temps quelques services au Curé ; il le remplaça même entièrement durant une semaine. Le jeudi, après avoir fait le catéchisme aux enfants des écoles communales, et à ceux des pensions libres, il revint sans voix, n'ayant pas parlé moins de huit heures. Il comprit alors la somme de travail que s'imposait le Curé au cours d'une année.
Mais si le Pasteur pouvait se réjouir de l'application des enfants et de l'assistance chaque jour grandissante à l'église, il ressentait une vive douleur de son insuccès auprès des malades. En dix-sept mois, un seul avait consenti à recevoir le secours de son ministère. Riches ou pauvres, tous mouraient sans souci de leur éternité. - «Que faire, demandait-il un jour à sa mère ?» - «Appelle à ton aide les Servantes des Pauvres !» répondit-elle.
Les Servantes des Pauvres ! Il les avait vues à l'œuvre à Angers. Mais Dom Leduc voudrait-il détacher quelques unes de ses filles, encore peu nombreuses, pour une si petite paroisse ? Les négociations commencées aboutirent heureuse-ment et, à la fin du mois de novembre 1883, Madame Jouin allait recevoir à la gare Montparnasse les trois petites sœurs un peu effrayées, et les conduisait à Joinville dans le modeste logement que la Providence leur avait préparé, et le len-demain, fête de la Présentation, la petite communauté était solennellement installée, sous la protection de sainte Gene-viève.
Mgr Freppel, l’évêque d'Angers, retenu par une séance à la Chambre des Députés, ne put présider la cérémonie. Dom Leduc présenta ses religieuses, le Pasteur lui répondit et bénit la chapelle et le soir, en présence d'une assistance choisie, le R.P. Jouin prenant pour texte ces paroles de l'Évangile : «Ne craignez rien, petit troupeau, car vous avez de votre Père la promesse d'un royaume : vous marcherez à la conquête des âmes», adressa aux trois Servantes des Pauvres une éloquente exhortation. Dès le lendemain, Mère Agnès - la prieure - et ses deux compagnes commençaient leur service auprès des malades et préludaient à la conquête des âmes.
Des conquérantes ! elles l'étaient par leur charité. Comment résister à tant d'humilité, de patience, d'abnégation, de désintéressement ? A la première heure, elles accourent au pauvre logis, nettoient la chambre, font la toilette des en-fants, soignent le malade, préparent toutes choses. A son retour à midi, l'homme s'émerveille de trouver sa maison en ordre, sa femme plus résignée, son repas préparé. Un ange est-il donc passé chez lui ? Oui, certes, un ange terrestre, la petite Servante qui a disparu pour aller prendre chez elle son modeste repas, rejoindre ses compagnes et, devant le Ta-bernacle, retremper ses forces pour reprendre tout à l'heure, demain, et tous les jours de sa vie, l'humble service des ma-lades auxquels elle s'est consacrée. Faut-il, en cas de danger, passer la nuit près du malade ? la Servante des Pauvres donnera jusqu'à trois de ses nuits par semaine. Et tout cela sans aucune rétribution. Que dis-je ? lorsque la famille est nécessiteuse, la sœur apporte un pot-au-feu pour le repas, des vêtements pour les enfants.
On ne tarde pas à apprendre que soins et secours sont donnés ainsi sans considération de personnes ou d'opinions au nom de Monsieur le Curé, de ce Curé que, chaque semaine, les journaux du pays tournent en dérision, accusent même de malversations et de vol.
«Jamais, M. le Curé ne me refuse quoi que ce soit pour les pauvres», disait la Mère Prieure. «Donnez autant que ce sera nécessaire, répétait-il. C'est avec des pot-au-feu que nous gagnerons leurs âmes».
Leur première conquête fut celle d'un cordonnier et de sa famille. Les parents n'étaient pas mariés, et les enfants - au nombre de six ou sept - pas baptisés. De plus, la femme était protestante. Les sœurs se présentent à l'occasion d'une maladie. Peu après l'union était régularisée, la femme abjurait et les enfants, instruits, recevaient le Baptême. Puis, c'est une famille juive qui se fait catholique. Mais le plus beau triomphe de la petite sœur Marie-Thérèse fut la conversion d'un franc-maçon. Très malade d'un cancer, il avait consenti à recevoir les soins des religieuses : - «Je veux bien recevoir la Sœur, mais pas le Curé», disait-il en blasphémant ! Au bout de six mois, il était vaincu, se confessait et mourait dans le repentir.
Devant tant de générosité, les préjugés tombaient. On admirait, on aimait ces petites sœurs toujours souriantes, tou-jours empressées aux besognes les plus répugnantes, et l'on était reconnaissant au prêtre qui les envoyait.
Entre temps, par une dérogation aux règles de la Congrégation, les Sœurs recevaient, jeudis et dimanches, les petites filles que le Pasteur ne se résignait pas à abandonner après leur première communion, et leur procuraient d'honnêtes distractions. Quant aux garçons, il en choisissait deux, plus intelligents et plus pieux que les autres, et les envoyait au collège de Combrée. Le premier devait lui succéder un jour comme curé de Joinville ; l'autre est aujourd'hui religieux dans un couvent de Rome.
Mais à la Mairie, l'orage se formait. «Ce n'était donc pas assez de ces robes de moines que, le dimanche, on croisait dans les rues de la ville ! Ce sont maintenant des «bonnes» Sœurs qu'on rencontre à tout instant dans tous les quartiers. On dirait qu'il y a dix Servantes «dites» des Pauvres. Elles osent pénétrer dans les maisons ouvrières et, sur leurs talons, le Curé s'y introduit. Pour comble, celui-ci distribue des secours, paye même des loyers !... Il est donc riche, et n'a nul be-soin d'une indemnité de logement».
Cette indemnité que la Municipalité, de par le Concordat, allouait au desservant de Joinville, le Conseil Municipal l'avait, en principe, supprimée, avant même l'arrivée de l'abbé Jouin.
Voici en quels termes élégants, deux ans plus tard, un journal local narrait la chose à ses lecteurs :
«Il y a quelques trois ans, du temps de l'abbé Moreau, le Conseil Municipal de Joinville trouva singulièrement maigres les recettes des Pompes Funèbres accusées par le Conseil de Fabrique.
On procéda à une enquête. Il en résulta qu'il manquait à l'appel une somme de 1200 francs.
- Qu'est-elle devenue ? demanda-t-on au Curé.
Celui-ci répondit carrément, sans le moindre détour, qu'il l'avait mise dans sa poche, ainsi que cela se fait tou-jours, et, se basant sur cette coutume invétérée, se refusa à en rendre un traître maravédis.
Cette franchise de la part d'un bâton de réglisse, tonsuré, va sans doute surprendre bien des gens. Elle est si en dehors de l'habitude de ces messieurs !...
Donc le Conseil municipal apprit que le curé avait fait du fourbi, comme on dit au régiment, sur les produits des Pompes Funèbres.
Il s'empressa de réclamer les 1200 francs perçus indûment par l'abbé Moreau, lequel, ainsi que je l'ai dit, n'enten-dit point de cette oreille...
L'abbé Moreau fut remplacé par un autre prêtre qui ne ressemblait au premier que par le waterproof noir d'uni-forme et la tonsure.
Jugeant que ce nouveau ministre du Seigneur s'empresserait d'en user avec les sommes versées pour les ser-vices funèbres selon la coutume, le Conseil s'avisa d’un expédient pour lui faire rendre gorge avant la lettre.
Le 5 août 1882, considérant que la Fabrique était assez riche, il supprima les 720 francs accordés au Curé comme indemnité de logement».
En conséquence, quelques jours après l'installation des Servantes des Pauvres, par un vote unanime, renouvelant ce-lui du 5 août 1882, le Conseil Municipal supprimait la dite indemnité pour le dernier trimestre de cette année 1883. Bien plus, on réclamait au desservant les trois premiers trimestres déjà versés. «Car, cet argent, disait le Maire, avait servi à faire bouillir la marmite du Curé». A ce langage imagé, on reconnaissait l'ancien restaurateur.
Sans tarder, le Conseil de Fabrique riposta : «Il est connu que les faibles honoraires de M. le Curé servent largement à «faire bouillir la marmite» des pauvres».
Pour comprendre, non pas les raisons, mais les prétextes dont cherchait à se couvrir l'hostilité municipale, il nous faut revenir à cette affaire de Remise des Pompes Funèbres.
L'Administration civile ainsi désignée avait pour but la fourniture dans la banlieue parisienne de tout le matériel néces-saire aux enterrements : Dans chaque commune, un employé - souvent le secrétaire de la Mairie - réglait ces dépenses avec les familles suivant un tarif officiel. D'après un usage commun à toutes les communes, usage connu et approuvé par l'Archevêché et par la Préfecture, à la fin de chaque mois, l'Administration des Pompes Funèbres abandonnait à l'église une certaine somme appelée «remise». Une moitié était versée à la Fabrique, qui la portait en recette. L'autre moitié, donnée au Curé, ne figurait pas aux comptes fabriciens.
Les administrations diocésaine et préfectorale saisies de la plainte municipale déclarèrent la conduite du Curé légitime pour le passé, mais demandèrent à l'avenir au trésorier de faire figurer aux recettes la totalité de la Remise et aux dé-penses la part afférente au Curé : décision qui fut appliquée dans le projet de budget de 1884.
D'autre part, le Ministre de la Justice et des Cultes estimait qu'«en présence des explications fournies par l'Archevê-ché, il ne convenait pas de prononcer la dissolution du Conseil de Fabrique qui n'avait fait que suivre un usage ancien et commun aux paroisses suburbaines et que, par les mêmes raisons, il ne saurait être question de versement à la caisse fabricienne de sommes indûment perçues par le desservant».
On pouvait donc croire l'affaire terminée quand, le 17 août suivant, parmi d'autres énormités, on pouvait relever dans une délibération du Conseil Municipal ce considérant mensonger :
...«Attendu que le Conseil de Fabrique, auquel ces agissements ont été signalés par le Maire, ne les a pas désa-voués et n'a pris aucune mesure pour y mettre fin...»
En même temps, un journal libre penseur du canton publiait cette lettre du Préfet de la Seine à M. le Maire :
Paris, 31 juillet 1884.
«Monsieur le Maire,
A la suite, et en conformité d'une décision de M. le Ministre de la Justice, en date du 14 juin dernier, j'ai enjoint : 1° à M. le Curé de Joinville de remettre au Trésorier de la Fabrique, la somme qu'il a indûment touchée sur la Recette des Pompes Funèbres ; 2° au Trésorier de la Fabrique, de verser sur cette somme, entre les mains du Percepteur, au profit de la Commune, l'indemnité de logement accordée par le Conseil au Curé en raison de l'insuffisance des ressources de la Fabrique, insuffisance dont le mal-fondé est aujourd'hui établi».
Par quelles manœuvres avait-on arraché au Ministre une décision qui, à quelques semaines de distance, le mettait en contradiction avec lui-même et en opposition avec l'Archevêché ? On le devine...
Tel est le point de départ d'une chicane déloyale où se révèlent la mauvaise foi d'un maire sectaire et la docilité d'un ministre aux ordres de la Franc-Maçonnerie - chicane qui va se prolonger trois ans et conduire le Curé de Joinville du Conseil de Préfecture au Conseil d'État, de la Police correctionnelle à la Cour d'Appel et jusques à la Cour de Cassation.
De la décision du ministre, l'abbé Jouin fit en effet immédiatement appel devant la Cour suprême. L'arrêt - qui n'inter-viendra qu'un an plus tard - lui donnera pleinement raison. Mais, dès ce jour, et jusqu'à la fin, les deux journaux libres penseurs du canton obéissant à un mot d'ordre vont publier chaque semaine contre le Curé des articles injurieux et blas-phématoires reprenant et répétant contre lui les accusations de vol et de détournement, annoncent avec une joie maligne le vote par le Conseil Municipal d'une installation d'urinoirs presque à l'entrée de l'église et l'impression à 2000 exem-plaires et la distribution de la lettre du Ministre - inventent de toutes pièces un prétendu guet-apens tendu au Maire par le Curé et les fabriciens à l'occasion d'une réunion fabricienne, où «tout le Conseil, nous citons, y compris le Curé, avaient invectivé le Maire, et, les yeux injectés, l'écume à la bouche, lui avaient vomi les insultes et les injures les plus grossières, où les mots lâche, canaille étaient les moins malsonnants» - profèrent des blasphèmes à l'occasion d'une allocution du Curé aux jeunes filles pour leur fête patronale - rapportent avec force détails une conférence du député Laguerre, membre de la Loge, au sujet de la Fondation à Joinville d'un groupe de la Libre-Pensée et de l'organisation d'un banquet pour le Vendredi-Saint.
Le Conseil de Fabrique se justifiait et justifiait la conduite du Curé dans une «Lettre à la Population de Joinville». Il s'appuyait sur l'approbation de l'Archevêché et sur la décision primitive du ministre repoussant la dissolution de la Fa-brique :
«En face des cabales montées par M. le Maire à tous les carrefours de la Commune et des imputations de dé-tournement et de vol dont il ne cesse d'accuser publiquement le Curé, nous avons le droit, disaient les Fabriciens, d'affirmer qu'il est impossible de ne pas reconnaître de la part du Conseil Municipal un parti pris haineux et une hosti-lité systématique contre la religion et contre un Curé honorable dont la charité est connue de tous».
- «Qu'en dites-vous ? répliquaient ces journaux. Un Curé honorable qui touche indûment une somme de 1200 francs qui ne lui appartient pas... Cela lui permet facilement d'être charitable».
Entre temps, les instances faites auprès du Ministre par le Conseil Municipal avaient abouti.
Par une décision du 9 février 1885, il prononce la révocation du Conseil de Fabrique de Joinville, décide la formation d'un nouveau Conseil et prononce l’inéligibilité des fabriciens révoqués au nouveau Conseil. «Leurs successeurs devront faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, ainsi que pour établir la responsabilité du trésorier et des fabriciens sortants».
C'est alors que les mêmes journaux publiaient le récit mensonger d'un prétendu attentat commis sur la personne du Maire au cours d'une séance fabricienne, le dimanche de Quasímodo, jour où les Fabriques - avant la loi de Séparation devaient voter le budget.
L'abbé Jouin n'avait pu trouver dans toute sa paroisse les trois catholiques, dont la désignation en vue du nouveau Conseil appartenait à l'autorité diocésaine ; d'autre part, d'après l'avis de Me Sabatier, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'État, que le Comité des Jurisconsultes catholiques avait chargé de soutenir le pourvoi des Fabriciens révo-qués, ce pourvoi pouvait être considéré comme suspensif. - L'Archidiacre, M. Pelgé, et le Coadjuteur, Mgr Richard, avaient unanimement conseillé au Curé de convoquer l'ancien Conseil pour le vote du budget et l'expédition des affaires courantes.
Le dimanche de Quasímodo, le Maire se présente accompagné de l'un des deux citoyens nommés par le Ministre. En vain, le Curé lui explique-t-il que c'est l'Ancien Conseil' qui se réunit et qu'on n'y saurait admettre M. Beaulard, le nouveau Conseil n'étant pas encore constitué. Le Maire proteste violemment. Une discussion s'engage au cours de laquelle des épithètes malsonnantes retentissent :
- Vous manquez de dignité en siégeant après votre révocation.
- Ceux qui manquent de dignité sont ceux qui ne cessent de répandre contre la Fabrique, le trésorier et le Curé d'odieuses accusations ; ce sont les francs-maçons qui prétendent - contre la loi - gérer les intérêts catholiques.
- Oui, je le répète, c'est avec l'argent de la Fabrique que le Curé «fait bouillir sa marmite», et le trésorier qui se prêté à ces malversations est un voleur... Quant à notre «foi franc-maçonne», nous en sommes fiers ! - Et cette pro-fession de foi du Maire était accompagnée d'un blasphème. En même temps, de sa canne, il désignait le trésorier, M. Durand, et s'avançait vers lui.
L'ancien soldat bondit sous l'injure. Se croyant menacé, il cherche une arme pour se défendre. Sur une table, il saisit un crucifix ; aveuglé par la colère, il allait en frapper le Maire quand il s'aperçoit de sa méprise. Il dépose son arme ; mais revenant vers son adversaire, il le repousse de l'épaule. Ce qui permit au Maire de raconter ensuite qu'on l'avait bousculé et saisi à la gorge...
Conclusion : deux nouveaux procès :
Le Maire assignait le Trésorier devant le Tribunal pour voies de fait sur un Magistrat dans l'exercice de ses fonctions, (art. 228 du Code pénal).
Et d'autre part, le Conseil de Préfecture, agissant au nom du Maire, obtenait du Conseil d'État l'autorisation de pour-suivre le Curé et ses Fabriciens devant le Tribunal correctionnel pour exercice illégal de l'autorité publique après leur ré-vocation.
Voilà donc l'abbé Jouin avec quatre procès. Car il prend tout à sa charge : honoraires des avocats - (Maître Sabatier, Maître Albert Danet, le bâtonnier d'alors, et Maître de Saint-Auban, futur bâtonnier - préparation des dossiers relatifs aux affaires en litige, (car il a étudié le Décret de 1809, la question du casuel et celle des Pompes Funèbres, dépouillé le Code Dalloz et la collection du Bulletin des Lois pour y trouver la Jurisprudence établie), tout lui incombe. Si l'on ajoute à cela les citations à comparaître, soit comme témoin, soit comme accusé ; les audiences devant le Juge d'instruction, le Tribunal et la Cour (puisque l'on ira en Appel et même en Cour de Cassation), on aura une idée de l'énergie dépensée par ce prêtre - qui mène de front avec ce travail écrasant l'administration de sa paroisse et le soin de ses catéchismes. Son bureau est devenu une salle de rédaction, mieux encore, un arsenal où se forgent les armes de la défense. Sous sa dictée, trois ou quatre secrétaires improvisés écrivent les arrêts des tribunaux qui ont fixé la jurisprudence, notant en marge d'un côté les références, de l'autre les commentaires des jurisconsultes. De temps à autre, parfois deux fois le jour, «son abbé», se détache pour porter à Paris les dossiers sur lesquels les avocats n'auront plus qu'à plaider.
Haletants, les secrétaires s'agitent et s'énervent. Lui seul, impassible, comme un capitaine sur la passerelle de son navire battu par la tempête, compulse toujours et dicte à deux ou trois de ses aides en même temps.
Désormais les jugements vont se succéder rapidement, sans l'atteindre d'ailleurs, mais frappant iniquement son tréso-rier et ses fabriciens. Les voici, dans l'ordre de date :
20 avril 1885. - Me Sabatier dépose devant le Conseil d'État le pourvoi des fabriciens contre le décret de révocation.
15 juillet. - Audience de la 11e chambre. M. Durand est condamné à six jours de prison et à 1 franc de dommages-intérêts. Appel de ce jugement est interjeté devant la Cour.
3 novembre. - La Cour modifie la sentence des juges de première instance, supprime la prison et réduit la peine à 16 francs d'amende.
12 novembre. - La Cour de Cassation, appelée à se prononcer sur la décision ministérielle enjoignant au Curé de re-mettre «la somme qu'il avait indûment touchée sur la recette des Pompes Funèbres, condamne le Ministre, et déclare que l'indemnité de logement attribuée par la loi au Curé d'une paroisse constitue une allocation spéciale pour un service public. Le paiement de cette indemnité est dû par la Fabrique, et la charge en incombe à la Commune, si les ressources de la Fabrique sont insuffisantes. Le Curé ne saurait être tenu de restituer les sommes qu'il a légitimement reçues de la Commune».
Ainsi, après trois ans, le Curé de Joinville était justifié et la Municipalité condamnée.
30 janvier 1886. - Le Conseil d'État décide qu'il y a lieu de poursuivre le Conseil de Fabrique pour la réunion de Quasímodo, (art. 197 du Code pénal) et assigne le Curé et les Fabriciens devant la 11e chambre. Dans l'audience de ce jour, et dans celle du 6 février, Me Danet et Me de Saint-Auban établissent, contrairement aux conclusions de M. le Subs-titut Lombard, que
1) le Curé n'est pas fonctionnaire public.
2) que, membre de droit du Conseil, il peut continuer à siéger même après révocation du Conseil.
3) que les fabriciens ne sont pas davantage fonctionnaires publics et ils réclament leur acquittement.
13 février. — Le tribunal acquitte le Curé de Joinville, mais condamne les membres du Conseil de Fabrique à 25 francs d'amende et solidairement aux dépens.
Acquitté, l'abbé Jouin n'abandonne pas ses fabriciens. Il fait appel du jugement qui les condamnait.
19 mars. - Le Conseil d'État rend son arrêt sur la demande d'annulation, présentée par les fabriciens, de la décision ministérielle qui les avait révoqués. Me Sabatier, leur avocat, avait présenté des conclusions établissant que le Ministre avait excédé ses pouvoirs : 1) en prenant sa décision contre l'avis de l'Evêque ; 2) en décidant que les membres révo-qués ne pourraient faire partie du nouveau Conseil.
Le Conseil d'État les déboute de leur revendication.
22 mars. - L'affaire des fabriciens revient devant la Cour d'Appel. L'avocat général Bernard compare le Curé de Join-ville et ses fabriciens à Louise Michel et aux anarchistes .
27 mars. - La Cour confirme le jugement du Tribunal : Ainsi donc, 16 francs d'amende au Trésorier pour voies de fait sur le Maire ; 25 francs aux fabriciens coupables de rébellion contre la loi ; voilà le résultat de trois ans de lutte. La mon-tagne maçonnique accouchait d'une souris !
«Un seul des prévenus, remarquait, non sans dépit, Le Progrès, a été acquitté, est-il besoin de le nommer ? C'est celui qui, semblable au lion de la fable, a dévoré force moutons, et a mangé quelquefois le berger. Les autres n'ont pas même tondu le pré de la largeur de leur langue. L'acquitté, au contraire, a empoché l'argent, cause première du conflit : c'est lui qui, après la révocation de l'ancien Conseil, l'a convoqué sous sa responsabilité et l'a engagé à con-tinuer d'administrer la Fabrique ; c'est lui, en un mot, qui a été l'âme de cette petite rébellion contre la loi ; et c'est lui seul que la loi n'atteint pas !»
Le Curé sortait indemne. Mais les fabriciens étaient déclarés fonctionnaires publics, exposés comme tels à des pénali-tés plus sévères. Qui donc désormais consentirait à en assumer les fonctions ? M. Jouin s'en apercevait bien, qui ne pouvait trouver trois hommes de bonne volonté pour le nouveau Conseil.
C'est alors que, pour mettre fin à une lutte qui menaçait de s'éterniser, dans une pensée d'apaisement et aussi pour récompenser l'abbé Jouin, l'Administration diocésaine songea pour lui à un déplacement honorable. Mais on lui deman-dait sa démission. C'était le Jeudi-Saint 1886.
Devait-il obéir jusque-là et laisser croire, en demandant lui-même son changement, qu'il se reconnaissait coupable, alors qu'il n'avait fait que suivre les instructions de ses supérieurs ? Il ne le pensait pas. Toutefois il consulta. Le lende-main, Vendredi-Saint, «son abbé» se présentait à la porte du R.P. Jouin, au moment où celui-ci allait monter en chaire pour prêcher les Sept Paroles de Jésus en Croix. Il n'eut que le temps de jeter un regard sur les lignes que son frère lui adressait et de répondre : «On donne sa démission, quand on est coupable ou vaincu, sinon on reste à son poste. Voilà mon avis. Dites le à mon frère».
L'abbé Jouin n'était pas coupable. Cette guerre qu'on lui faisait depuis quatre ans, il ne l'avait pas provoquée. Il n'avait rien fait sans l'avis de ses supérieurs. Par ailleurs c'était contre l'avis formel de l'Archevêque que le Ministre avait dissous le Conseil de Fabrique et arbitrairement prononcé l'inéligibilité des anciens membres. Cette lutte était uniquement reli-gieuse et déchaînée par la Franc-Maçonnerie. Déclarée dès son arrivée, elle avait atteint toute son acuité au lendemain de l'installation des Religieuses.
Vaincu, le Curé ne l'était pas davantage. Il se sentait de force à continuer le combat.
Il ne donna donc pas sa démission : il se contenta de s'en remettre à la décision de ses supérieurs qui l'envoyèrent à Saint-Augustin à Paris, avec le titre de second vicaire.
Dès que le bruit se répandit dans Joinville du départ de l'abbé Jouin, une femme du peuple se mit à la tête d'une péti-tion demandant le maintien du Curé et des Sœurs. En moins de quinze jours, elle se couvrait de 900 signatures, et fut portée par des notables du pays à l'Archevêché. Témoignage éloquent des dispositions d'une population jusque-là indif-férente.
Il était trop tard, et l'abbé Jouin, quatre ans après son arrivée à Joinville, où il avait tant lutté, rentrait à Paris.
Voici en quels termes La Voix des Communes du 21 août annonçait la nouvelle à ses lecteurs.
«Le Curé, principal auteur du conflit entre la Municipalité et la Fabrique, après avoir épuisé toutes les juridictions, n'ayant pu faire prévaloir les ridicules prétentions des fabriciens, ses acolytes, a reçu ordre de son changement. II a dû quitter Joinville la semaine dernière, malgré la tentative faite en sa faveur par les bonnes sœurs et les bigotes du pays qui faisaient signer par les femmes, les enfants et les fournisseurs peureux ou complaisants, une pétition de-mandant son maintien. Elles en sont pour leurs frais, car elles n'ont pu lever la pénitence, si pénitence il y a... La pé-nitence est douce en effet : être nommé vicaire d'une des grandes paroisses de Paris, où les bénéfices, à part ceux résultant des incendies , sont beaucoup plus considérables, ne nous semble pas un châtiment bien sévère».
Les libres penseurs n'étaient qu'à moitié satisfaits : à leurs yeux, la mort seule, ou la prison, leur eût paru un châtiment suffisant pour ce prêtre qui avait commis le crime impardonnable de reconstituer le mobilier de sa sacristie incendiée, et celui, plus grave encore, de doter la commune d'une maison de Servantes des Pauvres !
Le Curé s'en alla où on l'appelait. Mais il laissa les Sœurs qui restèrent à sa charge jusqu'à sa mort.
Ce fut sa vengeance. Il fit même davantage.
Quelques mois après le départ de l'abbé Jouin, Dom Leduc, s'inquiétait du sort de la maison Sainte-Geneviève ; le nouveau Curé, M. l'abbé Roustan, lui répondit :
«Les intentions de M. l'abbé Jouin ? j'affirme qu'elles n'ont jamais changé. M. Jouin a toujours été le soutien et la providence de cette Maison. Il continuera à faire le bien comme par le passé, avec autant de dévouement et de zèle. Avec lui vous n’avez pas à vous mettre en peine du loyer ni de l'entretien de vos filles... M. Jouin fait plus encore (et c'est un acte héroïque dont je lui suis très reconnaissant) : ce digne prêtre donne chaque mois une somme à vos reli-gieuses pour les mettre à même de faire l'aumône matérielle, quand elles sont appelées auprès de nos malades, ce qui les dispose à recevoir plus facilement l'aumône spirituelle. Je n'exagère pas en disant que mon vénéré et chari-table prédécesseur est le père et la providence de ma paroisse».
Providence de Joinville, il le restera jusqu'à la fin.
Séparé de cette paroisse, qu'il avait dû quitter, mais qu'il n'abandonnait pas, M. Jouin y revenait à certains jours. On l'y voyait fidèle à célébrer l'anniversaire de la fondation de ses chères Servantes des Pauvres. Près d'elles, il aimait à re-trouver quelques-unes de ces âmes de choix qui l'avaient soutenu de leurs prières et de leurs libéralités et, parmi elles, la bonne demoiselle Amiel.
Ces deux cœurs unis dans le même amour du Christ et des pauvres, poursuivirent jusqu'à un âge avancé leur mission de charité. Mademoiselle Amiel précéda de quelques semaines M. Jouin dans la tombe. L'ancien curé de Joinville se fit un devoir de rendre à sa dépouille un dernier hommage et lui consacra, dans le Bulletin paroissial de Joinville-le-Pont, ces lignes émues, les dernières peut-être qui sortirent de son cœur :
«...Comme les sept titulaires qui m'ont succédé, tous ont appelé Mlle Céleste Amiel la grande bienfaitrice de l'église paroissiale de Joinville, titre qu'elle partageait avec sa sœur, Mlle Caroline, qui fut enlevée à la fin de la guerre. Je suis heureux d'ajouter à l'appréciation unanime des douze curés de Joinville, celle d'un vicaire général de l'Arche-vêché, qui m'écrivait le 25 mai dernier : «Mlle Amiel est une grande bienfaitrice du diocèse» (Mlle Amiel a légué à l'Ar-chevêché de Paris sa maison et son jardin, contigus à l'église, pour devenir le presbytère des curés de Joinville). L'éloge est complet.
En quoi consiste-t-il ? En ceci qu'il résume la vie même du Christ. Les foules, émues des miracles de Jésus s'écriaient : «Il a bien fait toutes choses» ? Et puisqu'il s'agissait dans ce passage de l'Évangile d'avoir fait entendre les sourds et voir les aveugles, ne peut-on pas dire que ceux qui l'imitent et le suivent, font de l'exemple qu'ils don-nent une prédication et une lumière ? C'est bien la marque distinctive des quatre-vingt-six ans de Mlle Amiel.
«Aussi, au terme de cette longue existence, on lui applique encore cette autre parole dite du Sauveur : «Il a passé en faisant le bien». Elle fut la bienfaitrice de Dieu et du prochain.
De Dieu par sa fidélité exemplaire à la communion quotidienne, à l'assistance aux offices, au zèle de la maison de Dieu. Elle s'occupait des linges sacrés, elle soignait ses fleurs pour les porter à l'autel. Durant mes quatre ans de cure à Joinville, que de décorations à l'église, que de jolies crèches nous avons faites ensemble ! C'était le rayonne-ment de son cœur et de sa piété»...
A un mois de distance, leurs deux âmes se rejoignirent devant ce Dieu qu'elles contemplent et adorent, après l'avoir si fidèlement servi sur la terre.
(à suivre...)
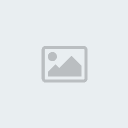
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 3)
CHAPITRE IV SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
Le soir du 15 août 1886, quand il eut chanté la grand'messe et présidé les vêpres, l'abbé Jouin eut la curiosité de par-courir la paroisse dans laquelle il était appelé à travailler. «Son abbé» qui, de Joinville, l'avait suivi à Saint-Augustin, l'ac-compagnait.
Les deux grandes voies percées par l'Empire à travers ce qu'on appelait alors «la Petite Pologne» ou quartier des chiffonniers, étaient silencieuses et les somptueux hôtels du Parc Monceau hermétiquement clos.
- Que pourrai-je bien faire ici, dans ce milieu de riches, moi, numéro deux dans une équipe de dix vicaires ?
Et il regardait son compagnon.
Si celui-ci avait alors connu les lettres de M. Laroche au jeune vicaire de Brézé, il aurait pu répondre :
«Dieu a Son plan que vous ne connaissez pas, mais qui se réalisera. Attendez».
Il se contenta de dire :
«Ce que vous ferez, je l'ignore ; mais ce que je sais bien, c'est que vous ferez quelque chose. Vous seriez plus à l'aise chez les pauvres, c'est vrai... Et puis, un second vicaire n'est-il pas un chef dans son domaine ?...»
Le Curé, un saint prêtre, M. Taillandier, lui avait fait un accueil convenable, encore qu'il eût un autre candidat. N'avait-il pas déjà, parmi ses vicaires, un ancien curé, M. l'abbé Escalle ?
On devinait dans le Curé de Saint-Augustin un homme usé et sur la fin de sa carrière : mais sa charité pour les pauvres ne connut jamais de défaillance.
Le premier vicaire, M. Geslain, résigné au rôle effacé de régleur des cérémonies matrimoniales, était, sans le savoir, encore plus près de sa fin. L'un et l'autre devaient disparaître dans l'année.
Quant aux autres vicaires, ils avaient accueilli le nouveau Second avec une bienveillance mêlée de quelque curiosité. L'abbé Huvelin - l'ancien normalien, le convertisseur de Littré et, plus tard le directeur de Charles de Foucauld - la tête penchée, observait et cherchait à lire dans l'âme du nouveau venu ; l'abbé Chesnelong, souriant, lui avait ouvert tout grand les bras. Puis, c'étaient les abbés de Tourville, le sociologue - Chantrel - de Saint-André, directeur des caté-chismes de filles, et Tardif, chargé de tous les garçons, à l'exception des enfants des écoles laïques, dont l'abbé Delmas n'arrivait pas à dompter l'indiscipline.
Quatre prêtres auxiliaires et une dizaine de précepteurs portaient à près de vingt-cinq le nombre des prêtres qui célé-braient la messe à Saint-Augustin. En semaine, il y avait messes à 11 heures et à midi.
Les fidèles assistaient nombreux aux offices. Ils goûtaient les beaux sermons de prédicateurs de talent : le R.P. Jouin y avait prêché le mois de Marie. Toutes les stations y étaient données en double : l'après-midi, pour les personnes moins occupées, et le soir, pour les familles ouvrières.
«Saint-Augustin, disait le Cardinal Richard, c'est le Saint- Sulpice de la Rive droite».
Les paroissiens avaient plus d'un motif de s'attacher à leur église. De tous les points de la nef et du chœur, on aper-çoit l'autel, élevé de quinze degrés, sous le baldaquin que couronne la coupole aérienne. Les cérémonies se déroulaient majestueuses, devant l'autel, d'où le soir, à la sortie des vêpres et du salut, le regard s'étendait au loin : par les portes grandes ouvertes, le Boulevard Malesherbes, avec ses lampadaires, semblait prolonger la nef jusqu'à la Madeleine. De plus, une légion d'enfants de chœur merveilleusement formés, des voix angéliques et une maîtrise réputée dans tout Pa-ris. A sa tête, un musicien de grande valeur, auteur de plusieurs messes et de noëls délicieux, impressionnable comme un artiste. Quand l'exécution ne répondait pas à son idée, au milieu d'un Kyrie ou d'un Gloria, on voyait le Maître de cha-pelle déposer sa baguette et s'en aller, silencieux et désolé, s'asseoir, la tête dans les mains, dans un coin de l'église.
L'abbé Jouin ne tarda pas à se faire un ami de M. Jacques Hochstetter. Par lui, il fit l'acquisition d'un harmonium et, de temps à autre, l'artiste venait lui faire un peu de musique.
Au Grand Orgue, s'affirmait un talent dont le renom, déjà, se répandait au loin. M. Eugène Gigout, du même âge que l'abbé Jouin, fut toute sa vie organiste de Saint-Augustin. Il n'avait que 24 ans quand, le 28 mai 1868, pour l'inauguration de l'église, il joua un «Prélude» en si mineur de sa composition .
Ce milieu musical, réconcilia l'abbé Jouin avec Paris. Il occupait dans le presbytère, bâti par Mgr Langénieux, un ap-partement ensoleillé, séparé seulement de l'église par une avenue large, plantée de grands arbres. Sa chambre était spacieuse et aérée. Il avait, pour «son abbé», toujours fatigué, une chambre convenable.
Si sa santé et ses goûts artistiques trouvaient toute satisfaction dans ce nouveau poste, il n'en était pas de même de son besoin d'activité. Pas une œuvre à diriger, pas même un catéchisme à faire. Tout avait été distribué : il ne restait rien pour lui.
Au mois de novembre cependant, on lui fit prêcher le triduum des Morts. Le dernier jour, après un mouvement oratoire particulièrement émouvant, l'abbé Chesnelong, se penchant à l'oreille de son voisin de banc d'œuvre, lui murmura : «C'est le triduum de l'après-midi et non celui du soir qu'on aurait dû confier à l'abbé Jouin».
Ses prônes, aussi, retenaient l'attention des paroissiens cultivés ; et la directrice d'un Ouvroir de Dames lui demanda huit conférences sur les Evangiles.
Restait le ministère du Confessionnal. Il s'y donna généreusement, demeurant de longues heures, le samedi soir, à la disposition des petites gens. Même, le dimanche, après les longs offices de la journée, alors qu'il eût volontiers goûté le plaisir d'une promenade au grand air, on le voyait se rendre à sa chapelle pour y accueillir les brebis égarées que l'admi-rable Sœur Pauline - une apôtre - ne pouvait lui amener qu'à ce moment. Des promeneurs, de pieux visiteurs passaient qui, voyant un prêtre au confessionnal, en profitaient souvent pour mettre ordre à leur conscience.
C'est aussi à cette époque qu'il entreprit la rédaction de ses Explications logiques du Catéchisme, travail qu'il conti-nuera pendant plusieurs années. Un jour - c'était pendant l'épidémie meurtrière de 1889 - sa mère accourt chez lui. Elle avait appris qu'il était atteint de la fameuse influenza. Elle le trouve couché avec une forte fièvre, s'empressait à lui don-ner ses soins : «Avant tout, petite Mère, lui dit-il, mettez-vous à cette table et écrivez». Docile et obéissante, pour une fois, Madame Jouin dut écrire toute l'explication de la leçon de la Contrition qu'il venait de rédiger dans sa tête.
Ces exemples d'énergie abondent dans la vie de l'abbé Jouin.
Sa parole originale et puissante, tout imprégnée de doctrine, d'Évangile et de textes patrologiques, son zèle et son assiduité au confessionnal, son empressement à rendre service lui gagnèrent bientôt l'estime et la sympathie de bon nombre de paroissiens et de familles honorables. Le premier abord, chez lui, était assez froid et n'encourageait pas à la conversation, surtout s'il la prévoyait banale et sans utilité. Mais y voyait-il un profit pour son interlocuteur ou pour lui-même, surtout, lui demandait-on un service ? aussitôt il se faisait accueillant. Si l'entretien roulait sur un sujet religieux, patriotique ou musical, vite il s'élevait sans effort à des aperçus souvent personnels.
Dans les visites qu'il recevait - plus encore que dans celles très rares, qu'il faisait lui-même - c'est encore-le bien des autres plus que sa satisfaction personnelle qu'il cherchait. Voyait-il des médecins, comme le Docteur Moizard ? il son-geait aux malades pauvres qu'il pourrait lui recommander - un ingénieur et Directeur de Société, comme le comte de Sa-vignac, ou un ingénieur comme le célèbre M. Boutillier, professeur jusqu'à 80 ans à l'École Centrale ? il pensait à quelque jeune homme à protéger - enfin des paroissiennes, intelligentes et dévouées ? il les attachait à son œuvre de catéchisme - allait-il chez des musiciennes ? il savait après dîner, se faire déchiffrer la musique dont il avait besoin pour sa «Pasto-rale» ou sa «Passion». Car l'abbé Jouin avait le don d'utiliser les talents de chacun et de les faire servir à ses projets. Il n'y a pas jusqu'à tel jeune comptable du personnel du «Printemps», capable d'additionner deux colonnes à la fois, dont il ne mettra le talent à profit pour ses comptes de fin de mois. C'est au «Printemps» également qu'il trouvera le «Saint Jo-seph» de la Nativité et d'autres jeunes gens chrétiens qui, dès les débuts du Patronage, donneront à son œuvre nais-sante un caractère de maturité. Sous sa direction, on y verra se dévouer des séminaristes (comme l'abbé Stalter), des étudiants en médecine (comme le futur Docteur Mondain), des employés et des commerçants (comme MM. Ragot et Le-sourd, ses compatriotes).
A tous il impose sa direction et communique sa flamme. A l'un de ses auxiliaires qui lui objectait la difficulté de faire chanter par des enfants un morceau de César Franck, il répond plaisamment : «Je ferais chanter des chaises, si je le voulais ! A qui veut rien d'impossible !» Avec une telle assurance, il entraînait ses troupes à la bataille, mieux encore, au succès.
Du reste les petites gens, les domestiques, les concierges, les employés de l'église sont ses amis, ses auxiliaires ou ses obligés tout autant que les riches.
«Un soir, à l'issue de la réunion, me racontait naguère une de ses anciennes catéchistes, il me présenta une enve-loppe, en me disant : «Portez vite, je vous prie, ceci à Mme X... : qu'elle puisse au moins dormir cette nuit sans préoccupa-tion». C'était la veille du terme et l'enveloppe contenait l'argent du loyer qu'on allait réclamer le lendemain matin à une pauvre femme sans travail.
Dans cette religieuse et opulente paroisse, l'abbé Jouin recevait de familles plus intimes des invitations à dîner, voire à prendre quelques jours de repos dans leurs résidences d'été. Toujours discret, il évitait de parler de ses œuvres et de leurs besoins. Tenu à moins de discrétion, «son abbé» qui parfois l'accompagnait, ne craignait pas de révéler à leurs hôtes les charges souvent excessives qu'il s'était mises sur les bras.,
L'abbé Jouin recevait lui-même à sa table confrères et amis. Il offrit un grand dîner suivi d'un régal artistique à deux évêques, ses amis - Mgr Renou, évêque d'Amiens, et Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle.
L'un des premiers personnages qui lui fit l'honneur de s'asseoir à sa table, dès son arrivée à Saint-Augustin, fut Mgr Freppel. L'abbé Jouin, pour lui donner un interlocuteur digne de lui, avait invité le sénateur Chesnelong avec son fils, le vicaire de Saint-Augustin, et le Curé de la paroisse. C'était chose hardie de mettre en face l'un de l'autre le Député du Fi-nistère et le Sénateur des Basses-Pyrénées, l'homme de confiance du Comte de Chambord et l'ancien aumônier des Tui-leries.
Le repas achevé, la conversation prit un tour politique. Un moment, l'Évêque, qui avait dans ses armes l'abeille impé-riale avec la devise : sponte favos, ægre spicula, mit en cause les représentants du Comte de Chambord à propos des récentes négociations dont l'échec avait abouti au Gouvernement de Gambetta et à la persécution religieuse. Le Séna-teur personnellement mis en cause releva le gant, et dans un magnifique mouvement justifia la conduite des délégués royalistes. Dans cette joute oratoire entre ces deux défenseurs de la cause catholique, l'avantage, au jugement des té-moins, ne fut pas pour l'Evêque.
Dès son arrivée à Saint-Augustin, l'abbé Jouin reprit avec sa famille les relations un peu distendues par les luttes de Joinville. Chaque dimanche ramenait autour de Madame Jouin ses deux plus jeunes fils et parfois, quand il était à Paris, son aîné, son religieux, nous pourrions dire «son Père», puisqu'elle lui avait confié la direction de sa conscience.
Le Dominicain racontait son élection comme Prieur du couvent de Corbara, en Corse. On allait, y transporter le Novi-ciat, provisoirement établi au Tyrol après les expulsions, et il était chargé de restaurer les vieux bâtiments, de trouver les ressources pour les meubler. Henry, conteur charmant et intarissable, faisait le récit des dernières injustices de son chef de bureau ou des mesquines jalousies de ses collègues ; sa Graziella allait être jouée à la Comédie-Française ; il parlait du Salon dont il venait de faire la critique, ou de son dernier ouvrage paru. Madame Jouin, tout en veillant à la table, écoutait avec fierté ses fils. Puis s'adressant à son Ernest, généralement silencieux : «Tu n'as donc rien à nous raconter, toi ? lui disait-elle. - Il médite sans doute un «Rapport», observait malicieusement le Père, faisant allusion à quelqu'évé-nement d'autrefois.
Rien de beau comme la réunion de ces trois hommes de valeur autour de cette femme supérieure, qu'on écoutait avec déférence, de cette mère qu'on vénérait, qu'on craignait même un peu, car il ne fallait pas tout lui dire. Comment au-rait-elle pris par exemple telle dépense de son abbé ?
Vers la fin de son séjour en Corse, le R.P. Jouin, son œuvre achevée, invita le Vicaire de Saint-Augustin et «son ab-bé» à visiter son couvent restauré. Un curé de Paris et un sculpteur de Caen étaient aussi du voyage. Après un séjour au milieu des Pères et des Novices, les cinq voyageurs partirent pour une excursion dans l'île merveilleuse. Par Corte, Sar-tène et Ajaccio, ils poussèrent jusqu'à la pointe extrême de la Corse, voyage ravissant, au cours duquel l'abbé Jouin put se livrer à son sport favori, en gravissant à pied les côtes brûlées de soleil. Le plus souvent, on s'arrêtait pour le repas chez l'un de ces curés que la parole du P. Jouin avait conquis à la dernière retraite ecclésiastique. La conversation était généralement aiguillée par les Parisiens sur le maquis et sur les «bandits». Les aventures du fameux Bellacoscia - dont les Corses faisaient presque un héros - assaisonnaient les repas toujours abondants. Assassins au regard de notre civili-sation, mais héros de guerre pour leurs compatriotes qui ne voient dans la vendetta qu'un glorieux fait d'armes et protè-gent contre le gendarme l'homme qui a pris le maquis. Si bien qu'un vicaire de Sartène, croyant voir dans notre curiosité un secret désir, s'offrit sérieusement à nous ménager une entrevue avec l'un de ces bandits et commença des dé-marches dans ce sens. Mais elles demandaient deux jours. Le R.P. Jouin et son frère, toujours pressés, ne se résignè-rent pas à cette perte de temps : «D'ailleurs, observait l'abbé Jouin, qu'est-ce qu'un moine, trois curés et un artiste pour-raient bien dire à un bandit, fût il deux fois Corse ? Après tout, c'est un meurtrier». Il fallut donc renoncer à la gloire d'ajouter à nos souvenirs de voyage, celui d'un déjeuner pris dans le maquis avec un bandit.
Par contre, notre cocher était moins désireux de faire connaissance avec l'un d'eux. Une nuit, dans une région particu-lièrement dangereuse, nous paraissions intrigués de le voir voiler d'une main la lanterne de notre voiture. - «Pourquoi ce-la ? lui dis-je. - Je ne tiens pas, expliqua-t-il, à servir de cible à une balle». Réponse qui fit passer un léger frisson dans la peau de celui d'entre nous qui siégeait à côté de lui : le froid de la nuit peut-être aussi.
Une fois l'île parcourue jusqu'à Bonifacio, le retour se fit par l'Italie : Pise, Florence, Venise, Milan furent visitées au pas de course. Après cinq jours et cinq nuits passées en bateau ou en wagon les voyageurs arrivèrent à Paris.
Pour l'abbé Jouin il en passa trois autres au chevet de son curé qu'il trouva mourant. Quand ce saint prêtre mourut, lui seul, avec la sœur garde-malade, était là pour recevoir son dernier soupir.
Quelques mois après, on donna pour successeur à M Taillandier, le curé de la Villette, M. l'abbé Brisset. L'abbé Jouin se présenta chez lui :
- «Après avis de mon Directeur, je viens vous demander une place dans l'un des catéchismes paroissiaux. Je me sens trop jeune encore pour me résigner à la fonction purement administrative de régleur de convois».
Quelques jours après, l'abbé Jouin se voyait affiché à la sacristie comme directeur du catéchisme des garçons des Écoles communales.
Il ne pouvait chanter le «Funes ceciderunt mihi in præclaris» ; au regard de l'homme, son lot n'était pas très reluisant. A son acceptation il ne mit qu'une condition : l'examen pour la première communion se ferait individuellement pour chaque enfant en présence du Curé, de tout son clergé et des Dames catéchistes. Le jour venu le résultat fut tel que les examinateurs s'en allèrent en disant : «Il faut l'avouer ; les enfants des Frères, ceux de l'École Fénelon, nos enfants libres eux-mêmes, n'en savent pas autant !»
Le secret du catéchiste ? Deux mots le révèlent : multiplication du nombre des séances, qui furent doublées pour la première année et triplées pour la seconde - et la méthode : la méthode socratique. Le catéchiste n'expose pas la doc-trine à la manière d'un professeur qui fait un cours. Il interroge l'enfant, lui fait trouver la réponse que le prêtre complète ou rectifie. Ainsi l'esprit de l'enfant reste toujours en éveil. Alors, commence le rôle de la Dame catéchiste. La leçon réci-tée, elle reprend dans les mêmes termes que le prêtre les explications déjà données, grâce au texte imprimé qu'elle a entre les mains. Ainsi la vérité pénètre dans l'intelligence de l'enfant et se fixe dans sa mémoire.
Des récompenses trimestrielles stimulent et récompensent son effort : tel enfant arrive à gagner dans son année 6 ou 7 volumes - une petite bibliothèque.
Après la première communion, ce seront des objets utiles qui feront la joie du jeune persévérant parfois même de la mère de famille.
La préparation de l'enfant à sa première communion n'était, pour l'abbé Jouin, que la première étape : le patronage devait en être la seconde.
Donc le dimanche qui suivit la première communion de 1888, les quarante catéchumènes de l'abbé Jouir furent con-viés à une promenade au Bois de Boulogne. Comme l'abbé Fouque, son émule de Marseille, l'abbé Jouin pensait qu'il faut «aérer la jeunesse». Même quand M. Brisset eut abrité l'œuvre dans le terrain acheté pour l'école des Frères, ces habitudes nomades persévérèrent. Seulement on s'était enhardi et peut-être enrichi depuis les premiers jours, et l'on pre-nait le chemin de fer pour Saint-Cloud, Ville d'Avray, Versailles ou Saint-Germain.
Vers le milieu du jour, on s'arrêtait dans quelque village pour une joyeuse collation en plein air que suivait une courte visite à l'église. Sur le soir, enfin, le bateau ou le chemin de fer ramenaient à Paris la troupe fatiguée, cependant que les plus déterminés revenaient à pied - parfois de Versailles - avec l'abbé Jouin. Faut-il ajouter que voyage et gouter res-taient entièrement à sa charge. «J'ai jeté toute fausse honte, disait encore l'abbé Fouque, et je m'attache à aller droit».
«On le rencontrait, dit son historien, avec sa troupe, sur les routes ; parfois la soutane est déchirée : un bruit de grelots révèle aux passants qu'on joue aux chevaux et aux cavaliers. Tous ces enfants ont un visage gai, rieur et clair».
Dans cette citation d'Henry Bordeaux, si l'on remplace le nom de l'abbé Fouque par celui de l'abbé Jouin, le jeu de chevaux par celui de barres ou de la Mère Garruche, on aura l'image exacte du patronage Notre-Dame-de-Bienfaisance, fondé et dirigé pendant six ans par le Vicaire de Saint-Augustin.
Des réunions théâtrales vinrent bientôt compléter l'Œuvre en y attirant les parents et en groupant autour d'elle des bienfaiteurs indispensables. Deux fois par an, les familles, les notabilités de la paroisse étaient invitées à venir applaudir les jeunes artistes. Ce n'était pas encore le théâtre chrétien. L'abbé Jouin n'y songeait peut-être pas encore, mais il y pré-ludait par le théâtre éducateur.
«Aérer la jeunesse» en lui procurant l'air des grands bois, voire, une fois même, l'air des bords de la Loire, ou celui des cimes de la Savoie, c'est bien ; mais il était encore plus nécessaire de l'aérer moralement, de l'élever socialement, et, - en substituant aux pièces de théâtre souvent vulgaires, aux chansonnettes et aux monologues parfois risqués l'interpré-tation de pièces saines et fines et l'audition d'une musique de haute valeur - de lui donner une culture artistique, tel fut dès le premier jour, le caractère que l'abbé Jouin voulut imprimer aux représentations de la rue de la Bienfaisance - ca-ractère et cachet que gardera son Œuvre tant que l'abbé Jouin ou «son abbé» en auront la direction, et qui subsista même après leur départ.
C'est au milieu de ces travaux que vint le surprendre l'événement qui devait attrister sa vie et briser le cœur de sa mère.
Le R.P. Jouin, en dépit de son activité prodigieuse, avait moins de résistance que son frère. Il n'avait que 55 ans, mais 17 ans de prédications presque ininterrompues - en 1887, il n'avait pas donné moins de trois sermons par jour - avaient épuisé ses forces et brisé sa voix. Il fut atteint à la gorge d'un mal dont les médecins ne comprirent pas la nature et qu'ils soignèrent à contre-sens. Il dut garder un silence absolu. Il ne pouvait s'alimenter qu'avec une extrême difficulté. Le 15 avril 1889, après une agonie de trois mois, il s'éteignait à Cannes, dans les bras de sa mère et près de son frère Ernest.
Les funérailles eurent lieu à Saint-Augustin. Quand on emporta son corps pour le conduire à la chapelle du cimetière Montparnasse, un piquet d'honneur battit aux champs devant le cercueil du moine sur lequel était épinglée la croix de la Légion d'honneur.
Au cours de l'été suivant, l'abbé Jouin accompagnait sa mère à Hermanville, dans ce chalet que le Père avait fait construire pour elle et pour son frère infirme, au bord de l'Océan. Silencieuse, à la fenêtre ouverte, sur la mer, elle restait de longs moments, le regard perdu dans l'espace. Son fils n'osait toucher à cette blessure encore trop vive. Tout à coup elle sortit de sa rêverie : «Là-bas, tout là-bas, demanda-t-elle, est-ce là le ciel ?» Et de son doigt, elle montrait l'immensité de l'Océan.
«Cette parole sur des lèvres si chrétiennes, écrit l'abbé Jouin, me surprit d'abord. Je ne savais quelle réponse lui faire. Elle reprit : «Tu ne dis rien ! Est-ce là le Ciel, et ton frère est-il là-bas». - Mère, lui dis-je, vous savez bien qu'il n'est pas là-bas, mais là-haut. - Là-haut, fit-elle en soupirant, c'est bien loin !»
«A ce moment me revint en mémoire un passage sublime des Confessions de saint Augustin que je n'avais ja-mais lu sans en être profondément frappé, dans la traduction qu'en a faite Hettinger et qui m'était devenu familier. Alors je lui contai doucement à elle, autre Monique, (car le Père Jouin était bien le fils de ses larmes), qu'autrefois le grand Docteur contemplait, à la même heure, la mer sur d'autres rivages - curieux, lui aussi, de savoir si par delà le couchant en feu, c'était le ciel - et que la mer lui répondit : «Cherche plus haut !» Je lui dis qu'Augustin interrogea l'astre des nuits et les myriades d'étoiles qui brillaient au firmament, et qu'au fond de son cœur il entendit encore la même réponse : «Cherche au-dessus de nous, cherche là-haut !» Jusqu'à ce qu'il eût compris que le Ciel n'est qu'en Dieu, et qu'en lui seulement, tout là-haut, les élus ont trouvé la possession du repos sans ennui, du jour sans déclin, de la béatitude sans satiété, de l'amour enfin dans une plénitude si débordante, que du ciel il redescend sur terre vers nos âmes inconsolées pour remonter à Dieu en éternelles actions de grâces».
«Cette méditation fut pour ma mère un apaisement et un réconfort. Quelques larmes coulèrent... Ah ! celui qui n'a pas vu pleurer une mère sur son enfant disparu ne connaît pas la profondeur des douleurs humaines».
A quelque temps de là, une autre mère pleurait sur le berceau d'un enfant envolé au Ciel. C'était une pénitente du P. Jouin. Elle fit part de sa peine à l'abbé Jouin, et lui, qui connaissait toute «la profondeur des douleurs humaines», lui adressa ces lignes émouvantes :
Paris, 29 août 1891.
Chère Madame,
Je vous envoie une petite croix pour vous dire combien je prends part à celle que vous portez si grande, si lourde, si écrasante.
La mienne est faite de fleurs et de parfums, symbole de l’âme qui s'est envolée là-haut, près de Dieu, pour vous aimer complètement avant l'âge, pour vous protéger alors que vous la protégiez, pour vous mériter d'inépuisables bénédictions.
Hier, en priant dans notre petite chapelle de Montparnasse, je me rappelais vous y avoir rencontrée et ce souvenir m'était doux ; je ne savais pas encore que vous étiez dans les larmes et que votre petit ange avait rejoint celui qui vous aime toujours comme son enfant et que vous aimez comme un père.
Ayez donc courage, et levez les yeux vers le Ciel, toutes ces âmes, celles qui vous ont appris à combattre et celles à qui Dieu épargne les luttes de la vie, toutes ces âmes sont invisibles, mais non absentes, elles vivent avec nous tout en vivant avec Dieu, et encore un peu nous connaîtrons cette présence retrouvée dans un bonheur sans trouble, sans déclin, sans séparation.
Je demande pour vous au Christ Jésus les consolations que Lui seul sait verser dans le cœur des mères pour que votre cœur puisse sans de trop cruels déchirements se donner tout entier à l'ange qui vous reste sur la terre et à l'ange que vous avez au ciel.
Croyez que je suis à vous de cœur et de prières,
E. JOUIN 1er Vic.
L'abbé Jouin devait traduire ce sentiment des douleurs maternelles dans cette prière qu'il met sur les lèvres des mères à la Grotte de Lourdes :
Qui donc connaît le cœur des mères !
Qui sait que leur bonheur est toujours inquiet ?
Qui sait que leurs larmes amères
De muettes douleurs sont l'inconnu secret ?
Toi seule, Mère du Sauveur,
Dont l'ineffable extase, en la divine étable,
Dut se terminer dans l'horreur
D'une fuite de nuit, d'un exil misérable ;
Toi seule, Mère des douleurs,
Mêlant de ton Jésus, le sang, source féconde,
A l'amertume de tes pleurs,
Pour vaincre, par l'amour tous les crimes du monde ;
Toi seule, en son immensité,
Tu connais, avec Dieu, l'insondable mystère
Fait d'inépuisable bonté,
De pardon,, de grâce et de vie, -un cœur de mère I
De la coupe que nous buvons
Réserve-nous le fiel, et donne l'ambroisie
Au père, au fils que nous aimons ;
A tous garde le ciel, douce et sainte Marie.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 3)
CHAPITRE IV SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
Le soir du 15 août 1886, quand il eut chanté la grand'messe et présidé les vêpres, l'abbé Jouin eut la curiosité de par-courir la paroisse dans laquelle il était appelé à travailler. «Son abbé» qui, de Joinville, l'avait suivi à Saint-Augustin, l'ac-compagnait.
Les deux grandes voies percées par l'Empire à travers ce qu'on appelait alors «la Petite Pologne» ou quartier des chiffonniers, étaient silencieuses et les somptueux hôtels du Parc Monceau hermétiquement clos.
- Que pourrai-je bien faire ici, dans ce milieu de riches, moi, numéro deux dans une équipe de dix vicaires ?
Et il regardait son compagnon.
Si celui-ci avait alors connu les lettres de M. Laroche au jeune vicaire de Brézé, il aurait pu répondre :
«Dieu a Son plan que vous ne connaissez pas, mais qui se réalisera. Attendez».
Il se contenta de dire :
«Ce que vous ferez, je l'ignore ; mais ce que je sais bien, c'est que vous ferez quelque chose. Vous seriez plus à l'aise chez les pauvres, c'est vrai... Et puis, un second vicaire n'est-il pas un chef dans son domaine ?...»
Le Curé, un saint prêtre, M. Taillandier, lui avait fait un accueil convenable, encore qu'il eût un autre candidat. N'avait-il pas déjà, parmi ses vicaires, un ancien curé, M. l'abbé Escalle ?
On devinait dans le Curé de Saint-Augustin un homme usé et sur la fin de sa carrière : mais sa charité pour les pauvres ne connut jamais de défaillance.
Le premier vicaire, M. Geslain, résigné au rôle effacé de régleur des cérémonies matrimoniales, était, sans le savoir, encore plus près de sa fin. L'un et l'autre devaient disparaître dans l'année.
Quant aux autres vicaires, ils avaient accueilli le nouveau Second avec une bienveillance mêlée de quelque curiosité. L'abbé Huvelin - l'ancien normalien, le convertisseur de Littré et, plus tard le directeur de Charles de Foucauld - la tête penchée, observait et cherchait à lire dans l'âme du nouveau venu ; l'abbé Chesnelong, souriant, lui avait ouvert tout grand les bras. Puis, c'étaient les abbés de Tourville, le sociologue - Chantrel - de Saint-André, directeur des caté-chismes de filles, et Tardif, chargé de tous les garçons, à l'exception des enfants des écoles laïques, dont l'abbé Delmas n'arrivait pas à dompter l'indiscipline.
Quatre prêtres auxiliaires et une dizaine de précepteurs portaient à près de vingt-cinq le nombre des prêtres qui célé-braient la messe à Saint-Augustin. En semaine, il y avait messes à 11 heures et à midi.
Les fidèles assistaient nombreux aux offices. Ils goûtaient les beaux sermons de prédicateurs de talent : le R.P. Jouin y avait prêché le mois de Marie. Toutes les stations y étaient données en double : l'après-midi, pour les personnes moins occupées, et le soir, pour les familles ouvrières.
«Saint-Augustin, disait le Cardinal Richard, c'est le Saint- Sulpice de la Rive droite».
Les paroissiens avaient plus d'un motif de s'attacher à leur église. De tous les points de la nef et du chœur, on aper-çoit l'autel, élevé de quinze degrés, sous le baldaquin que couronne la coupole aérienne. Les cérémonies se déroulaient majestueuses, devant l'autel, d'où le soir, à la sortie des vêpres et du salut, le regard s'étendait au loin : par les portes grandes ouvertes, le Boulevard Malesherbes, avec ses lampadaires, semblait prolonger la nef jusqu'à la Madeleine. De plus, une légion d'enfants de chœur merveilleusement formés, des voix angéliques et une maîtrise réputée dans tout Pa-ris. A sa tête, un musicien de grande valeur, auteur de plusieurs messes et de noëls délicieux, impressionnable comme un artiste. Quand l'exécution ne répondait pas à son idée, au milieu d'un Kyrie ou d'un Gloria, on voyait le Maître de cha-pelle déposer sa baguette et s'en aller, silencieux et désolé, s'asseoir, la tête dans les mains, dans un coin de l'église.
L'abbé Jouin ne tarda pas à se faire un ami de M. Jacques Hochstetter. Par lui, il fit l'acquisition d'un harmonium et, de temps à autre, l'artiste venait lui faire un peu de musique.
Au Grand Orgue, s'affirmait un talent dont le renom, déjà, se répandait au loin. M. Eugène Gigout, du même âge que l'abbé Jouin, fut toute sa vie organiste de Saint-Augustin. Il n'avait que 24 ans quand, le 28 mai 1868, pour l'inauguration de l'église, il joua un «Prélude» en si mineur de sa composition .
Ce milieu musical, réconcilia l'abbé Jouin avec Paris. Il occupait dans le presbytère, bâti par Mgr Langénieux, un ap-partement ensoleillé, séparé seulement de l'église par une avenue large, plantée de grands arbres. Sa chambre était spacieuse et aérée. Il avait, pour «son abbé», toujours fatigué, une chambre convenable.
Si sa santé et ses goûts artistiques trouvaient toute satisfaction dans ce nouveau poste, il n'en était pas de même de son besoin d'activité. Pas une œuvre à diriger, pas même un catéchisme à faire. Tout avait été distribué : il ne restait rien pour lui.
Au mois de novembre cependant, on lui fit prêcher le triduum des Morts. Le dernier jour, après un mouvement oratoire particulièrement émouvant, l'abbé Chesnelong, se penchant à l'oreille de son voisin de banc d'œuvre, lui murmura : «C'est le triduum de l'après-midi et non celui du soir qu'on aurait dû confier à l'abbé Jouin».
Ses prônes, aussi, retenaient l'attention des paroissiens cultivés ; et la directrice d'un Ouvroir de Dames lui demanda huit conférences sur les Evangiles.
Restait le ministère du Confessionnal. Il s'y donna généreusement, demeurant de longues heures, le samedi soir, à la disposition des petites gens. Même, le dimanche, après les longs offices de la journée, alors qu'il eût volontiers goûté le plaisir d'une promenade au grand air, on le voyait se rendre à sa chapelle pour y accueillir les brebis égarées que l'admi-rable Sœur Pauline - une apôtre - ne pouvait lui amener qu'à ce moment. Des promeneurs, de pieux visiteurs passaient qui, voyant un prêtre au confessionnal, en profitaient souvent pour mettre ordre à leur conscience.
C'est aussi à cette époque qu'il entreprit la rédaction de ses Explications logiques du Catéchisme, travail qu'il conti-nuera pendant plusieurs années. Un jour - c'était pendant l'épidémie meurtrière de 1889 - sa mère accourt chez lui. Elle avait appris qu'il était atteint de la fameuse influenza. Elle le trouve couché avec une forte fièvre, s'empressait à lui don-ner ses soins : «Avant tout, petite Mère, lui dit-il, mettez-vous à cette table et écrivez». Docile et obéissante, pour une fois, Madame Jouin dut écrire toute l'explication de la leçon de la Contrition qu'il venait de rédiger dans sa tête.
Ces exemples d'énergie abondent dans la vie de l'abbé Jouin.
Sa parole originale et puissante, tout imprégnée de doctrine, d'Évangile et de textes patrologiques, son zèle et son assiduité au confessionnal, son empressement à rendre service lui gagnèrent bientôt l'estime et la sympathie de bon nombre de paroissiens et de familles honorables. Le premier abord, chez lui, était assez froid et n'encourageait pas à la conversation, surtout s'il la prévoyait banale et sans utilité. Mais y voyait-il un profit pour son interlocuteur ou pour lui-même, surtout, lui demandait-on un service ? aussitôt il se faisait accueillant. Si l'entretien roulait sur un sujet religieux, patriotique ou musical, vite il s'élevait sans effort à des aperçus souvent personnels.
Dans les visites qu'il recevait - plus encore que dans celles très rares, qu'il faisait lui-même - c'est encore-le bien des autres plus que sa satisfaction personnelle qu'il cherchait. Voyait-il des médecins, comme le Docteur Moizard ? il son-geait aux malades pauvres qu'il pourrait lui recommander - un ingénieur et Directeur de Société, comme le comte de Sa-vignac, ou un ingénieur comme le célèbre M. Boutillier, professeur jusqu'à 80 ans à l'École Centrale ? il pensait à quelque jeune homme à protéger - enfin des paroissiennes, intelligentes et dévouées ? il les attachait à son œuvre de catéchisme - allait-il chez des musiciennes ? il savait après dîner, se faire déchiffrer la musique dont il avait besoin pour sa «Pasto-rale» ou sa «Passion». Car l'abbé Jouin avait le don d'utiliser les talents de chacun et de les faire servir à ses projets. Il n'y a pas jusqu'à tel jeune comptable du personnel du «Printemps», capable d'additionner deux colonnes à la fois, dont il ne mettra le talent à profit pour ses comptes de fin de mois. C'est au «Printemps» également qu'il trouvera le «Saint Jo-seph» de la Nativité et d'autres jeunes gens chrétiens qui, dès les débuts du Patronage, donneront à son œuvre nais-sante un caractère de maturité. Sous sa direction, on y verra se dévouer des séminaristes (comme l'abbé Stalter), des étudiants en médecine (comme le futur Docteur Mondain), des employés et des commerçants (comme MM. Ragot et Le-sourd, ses compatriotes).
A tous il impose sa direction et communique sa flamme. A l'un de ses auxiliaires qui lui objectait la difficulté de faire chanter par des enfants un morceau de César Franck, il répond plaisamment : «Je ferais chanter des chaises, si je le voulais ! A qui veut rien d'impossible !» Avec une telle assurance, il entraînait ses troupes à la bataille, mieux encore, au succès.
Du reste les petites gens, les domestiques, les concierges, les employés de l'église sont ses amis, ses auxiliaires ou ses obligés tout autant que les riches.
«Un soir, à l'issue de la réunion, me racontait naguère une de ses anciennes catéchistes, il me présenta une enve-loppe, en me disant : «Portez vite, je vous prie, ceci à Mme X... : qu'elle puisse au moins dormir cette nuit sans préoccupa-tion». C'était la veille du terme et l'enveloppe contenait l'argent du loyer qu'on allait réclamer le lendemain matin à une pauvre femme sans travail.
Dans cette religieuse et opulente paroisse, l'abbé Jouin recevait de familles plus intimes des invitations à dîner, voire à prendre quelques jours de repos dans leurs résidences d'été. Toujours discret, il évitait de parler de ses œuvres et de leurs besoins. Tenu à moins de discrétion, «son abbé» qui parfois l'accompagnait, ne craignait pas de révéler à leurs hôtes les charges souvent excessives qu'il s'était mises sur les bras.,
L'abbé Jouin recevait lui-même à sa table confrères et amis. Il offrit un grand dîner suivi d'un régal artistique à deux évêques, ses amis - Mgr Renou, évêque d'Amiens, et Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle.
L'un des premiers personnages qui lui fit l'honneur de s'asseoir à sa table, dès son arrivée à Saint-Augustin, fut Mgr Freppel. L'abbé Jouin, pour lui donner un interlocuteur digne de lui, avait invité le sénateur Chesnelong avec son fils, le vicaire de Saint-Augustin, et le Curé de la paroisse. C'était chose hardie de mettre en face l'un de l'autre le Député du Fi-nistère et le Sénateur des Basses-Pyrénées, l'homme de confiance du Comte de Chambord et l'ancien aumônier des Tui-leries.
Le repas achevé, la conversation prit un tour politique. Un moment, l'Évêque, qui avait dans ses armes l'abeille impé-riale avec la devise : sponte favos, ægre spicula, mit en cause les représentants du Comte de Chambord à propos des récentes négociations dont l'échec avait abouti au Gouvernement de Gambetta et à la persécution religieuse. Le Séna-teur personnellement mis en cause releva le gant, et dans un magnifique mouvement justifia la conduite des délégués royalistes. Dans cette joute oratoire entre ces deux défenseurs de la cause catholique, l'avantage, au jugement des té-moins, ne fut pas pour l'Evêque.
Dès son arrivée à Saint-Augustin, l'abbé Jouin reprit avec sa famille les relations un peu distendues par les luttes de Joinville. Chaque dimanche ramenait autour de Madame Jouin ses deux plus jeunes fils et parfois, quand il était à Paris, son aîné, son religieux, nous pourrions dire «son Père», puisqu'elle lui avait confié la direction de sa conscience.
Le Dominicain racontait son élection comme Prieur du couvent de Corbara, en Corse. On allait, y transporter le Novi-ciat, provisoirement établi au Tyrol après les expulsions, et il était chargé de restaurer les vieux bâtiments, de trouver les ressources pour les meubler. Henry, conteur charmant et intarissable, faisait le récit des dernières injustices de son chef de bureau ou des mesquines jalousies de ses collègues ; sa Graziella allait être jouée à la Comédie-Française ; il parlait du Salon dont il venait de faire la critique, ou de son dernier ouvrage paru. Madame Jouin, tout en veillant à la table, écoutait avec fierté ses fils. Puis s'adressant à son Ernest, généralement silencieux : «Tu n'as donc rien à nous raconter, toi ? lui disait-elle. - Il médite sans doute un «Rapport», observait malicieusement le Père, faisant allusion à quelqu'évé-nement d'autrefois.
Rien de beau comme la réunion de ces trois hommes de valeur autour de cette femme supérieure, qu'on écoutait avec déférence, de cette mère qu'on vénérait, qu'on craignait même un peu, car il ne fallait pas tout lui dire. Comment au-rait-elle pris par exemple telle dépense de son abbé ?
Vers la fin de son séjour en Corse, le R.P. Jouin, son œuvre achevée, invita le Vicaire de Saint-Augustin et «son ab-bé» à visiter son couvent restauré. Un curé de Paris et un sculpteur de Caen étaient aussi du voyage. Après un séjour au milieu des Pères et des Novices, les cinq voyageurs partirent pour une excursion dans l'île merveilleuse. Par Corte, Sar-tène et Ajaccio, ils poussèrent jusqu'à la pointe extrême de la Corse, voyage ravissant, au cours duquel l'abbé Jouin put se livrer à son sport favori, en gravissant à pied les côtes brûlées de soleil. Le plus souvent, on s'arrêtait pour le repas chez l'un de ces curés que la parole du P. Jouin avait conquis à la dernière retraite ecclésiastique. La conversation était généralement aiguillée par les Parisiens sur le maquis et sur les «bandits». Les aventures du fameux Bellacoscia - dont les Corses faisaient presque un héros - assaisonnaient les repas toujours abondants. Assassins au regard de notre civili-sation, mais héros de guerre pour leurs compatriotes qui ne voient dans la vendetta qu'un glorieux fait d'armes et protè-gent contre le gendarme l'homme qui a pris le maquis. Si bien qu'un vicaire de Sartène, croyant voir dans notre curiosité un secret désir, s'offrit sérieusement à nous ménager une entrevue avec l'un de ces bandits et commença des dé-marches dans ce sens. Mais elles demandaient deux jours. Le R.P. Jouin et son frère, toujours pressés, ne se résignè-rent pas à cette perte de temps : «D'ailleurs, observait l'abbé Jouin, qu'est-ce qu'un moine, trois curés et un artiste pour-raient bien dire à un bandit, fût il deux fois Corse ? Après tout, c'est un meurtrier». Il fallut donc renoncer à la gloire d'ajouter à nos souvenirs de voyage, celui d'un déjeuner pris dans le maquis avec un bandit.
Par contre, notre cocher était moins désireux de faire connaissance avec l'un d'eux. Une nuit, dans une région particu-lièrement dangereuse, nous paraissions intrigués de le voir voiler d'une main la lanterne de notre voiture. - «Pourquoi ce-la ? lui dis-je. - Je ne tiens pas, expliqua-t-il, à servir de cible à une balle». Réponse qui fit passer un léger frisson dans la peau de celui d'entre nous qui siégeait à côté de lui : le froid de la nuit peut-être aussi.
Une fois l'île parcourue jusqu'à Bonifacio, le retour se fit par l'Italie : Pise, Florence, Venise, Milan furent visitées au pas de course. Après cinq jours et cinq nuits passées en bateau ou en wagon les voyageurs arrivèrent à Paris.
Pour l'abbé Jouin il en passa trois autres au chevet de son curé qu'il trouva mourant. Quand ce saint prêtre mourut, lui seul, avec la sœur garde-malade, était là pour recevoir son dernier soupir.
Quelques mois après, on donna pour successeur à M Taillandier, le curé de la Villette, M. l'abbé Brisset. L'abbé Jouin se présenta chez lui :
- «Après avis de mon Directeur, je viens vous demander une place dans l'un des catéchismes paroissiaux. Je me sens trop jeune encore pour me résigner à la fonction purement administrative de régleur de convois».
Quelques jours après, l'abbé Jouin se voyait affiché à la sacristie comme directeur du catéchisme des garçons des Écoles communales.
Il ne pouvait chanter le «Funes ceciderunt mihi in præclaris» ; au regard de l'homme, son lot n'était pas très reluisant. A son acceptation il ne mit qu'une condition : l'examen pour la première communion se ferait individuellement pour chaque enfant en présence du Curé, de tout son clergé et des Dames catéchistes. Le jour venu le résultat fut tel que les examinateurs s'en allèrent en disant : «Il faut l'avouer ; les enfants des Frères, ceux de l'École Fénelon, nos enfants libres eux-mêmes, n'en savent pas autant !»
Le secret du catéchiste ? Deux mots le révèlent : multiplication du nombre des séances, qui furent doublées pour la première année et triplées pour la seconde - et la méthode : la méthode socratique. Le catéchiste n'expose pas la doc-trine à la manière d'un professeur qui fait un cours. Il interroge l'enfant, lui fait trouver la réponse que le prêtre complète ou rectifie. Ainsi l'esprit de l'enfant reste toujours en éveil. Alors, commence le rôle de la Dame catéchiste. La leçon réci-tée, elle reprend dans les mêmes termes que le prêtre les explications déjà données, grâce au texte imprimé qu'elle a entre les mains. Ainsi la vérité pénètre dans l'intelligence de l'enfant et se fixe dans sa mémoire.
Des récompenses trimestrielles stimulent et récompensent son effort : tel enfant arrive à gagner dans son année 6 ou 7 volumes - une petite bibliothèque.
Après la première communion, ce seront des objets utiles qui feront la joie du jeune persévérant parfois même de la mère de famille.
La préparation de l'enfant à sa première communion n'était, pour l'abbé Jouin, que la première étape : le patronage devait en être la seconde.
Donc le dimanche qui suivit la première communion de 1888, les quarante catéchumènes de l'abbé Jouir furent con-viés à une promenade au Bois de Boulogne. Comme l'abbé Fouque, son émule de Marseille, l'abbé Jouin pensait qu'il faut «aérer la jeunesse». Même quand M. Brisset eut abrité l'œuvre dans le terrain acheté pour l'école des Frères, ces habitudes nomades persévérèrent. Seulement on s'était enhardi et peut-être enrichi depuis les premiers jours, et l'on pre-nait le chemin de fer pour Saint-Cloud, Ville d'Avray, Versailles ou Saint-Germain.
Vers le milieu du jour, on s'arrêtait dans quelque village pour une joyeuse collation en plein air que suivait une courte visite à l'église. Sur le soir, enfin, le bateau ou le chemin de fer ramenaient à Paris la troupe fatiguée, cependant que les plus déterminés revenaient à pied - parfois de Versailles - avec l'abbé Jouin. Faut-il ajouter que voyage et gouter res-taient entièrement à sa charge. «J'ai jeté toute fausse honte, disait encore l'abbé Fouque, et je m'attache à aller droit».
«On le rencontrait, dit son historien, avec sa troupe, sur les routes ; parfois la soutane est déchirée : un bruit de grelots révèle aux passants qu'on joue aux chevaux et aux cavaliers. Tous ces enfants ont un visage gai, rieur et clair».
Dans cette citation d'Henry Bordeaux, si l'on remplace le nom de l'abbé Fouque par celui de l'abbé Jouin, le jeu de chevaux par celui de barres ou de la Mère Garruche, on aura l'image exacte du patronage Notre-Dame-de-Bienfaisance, fondé et dirigé pendant six ans par le Vicaire de Saint-Augustin.
Des réunions théâtrales vinrent bientôt compléter l'Œuvre en y attirant les parents et en groupant autour d'elle des bienfaiteurs indispensables. Deux fois par an, les familles, les notabilités de la paroisse étaient invitées à venir applaudir les jeunes artistes. Ce n'était pas encore le théâtre chrétien. L'abbé Jouin n'y songeait peut-être pas encore, mais il y pré-ludait par le théâtre éducateur.
«Aérer la jeunesse» en lui procurant l'air des grands bois, voire, une fois même, l'air des bords de la Loire, ou celui des cimes de la Savoie, c'est bien ; mais il était encore plus nécessaire de l'aérer moralement, de l'élever socialement, et, - en substituant aux pièces de théâtre souvent vulgaires, aux chansonnettes et aux monologues parfois risqués l'interpré-tation de pièces saines et fines et l'audition d'une musique de haute valeur - de lui donner une culture artistique, tel fut dès le premier jour, le caractère que l'abbé Jouin voulut imprimer aux représentations de la rue de la Bienfaisance - ca-ractère et cachet que gardera son Œuvre tant que l'abbé Jouin ou «son abbé» en auront la direction, et qui subsista même après leur départ.
C'est au milieu de ces travaux que vint le surprendre l'événement qui devait attrister sa vie et briser le cœur de sa mère.
Le R.P. Jouin, en dépit de son activité prodigieuse, avait moins de résistance que son frère. Il n'avait que 55 ans, mais 17 ans de prédications presque ininterrompues - en 1887, il n'avait pas donné moins de trois sermons par jour - avaient épuisé ses forces et brisé sa voix. Il fut atteint à la gorge d'un mal dont les médecins ne comprirent pas la nature et qu'ils soignèrent à contre-sens. Il dut garder un silence absolu. Il ne pouvait s'alimenter qu'avec une extrême difficulté. Le 15 avril 1889, après une agonie de trois mois, il s'éteignait à Cannes, dans les bras de sa mère et près de son frère Ernest.
Les funérailles eurent lieu à Saint-Augustin. Quand on emporta son corps pour le conduire à la chapelle du cimetière Montparnasse, un piquet d'honneur battit aux champs devant le cercueil du moine sur lequel était épinglée la croix de la Légion d'honneur.
Au cours de l'été suivant, l'abbé Jouin accompagnait sa mère à Hermanville, dans ce chalet que le Père avait fait construire pour elle et pour son frère infirme, au bord de l'Océan. Silencieuse, à la fenêtre ouverte, sur la mer, elle restait de longs moments, le regard perdu dans l'espace. Son fils n'osait toucher à cette blessure encore trop vive. Tout à coup elle sortit de sa rêverie : «Là-bas, tout là-bas, demanda-t-elle, est-ce là le ciel ?» Et de son doigt, elle montrait l'immensité de l'Océan.
«Cette parole sur des lèvres si chrétiennes, écrit l'abbé Jouin, me surprit d'abord. Je ne savais quelle réponse lui faire. Elle reprit : «Tu ne dis rien ! Est-ce là le Ciel, et ton frère est-il là-bas». - Mère, lui dis-je, vous savez bien qu'il n'est pas là-bas, mais là-haut. - Là-haut, fit-elle en soupirant, c'est bien loin !»
«A ce moment me revint en mémoire un passage sublime des Confessions de saint Augustin que je n'avais ja-mais lu sans en être profondément frappé, dans la traduction qu'en a faite Hettinger et qui m'était devenu familier. Alors je lui contai doucement à elle, autre Monique, (car le Père Jouin était bien le fils de ses larmes), qu'autrefois le grand Docteur contemplait, à la même heure, la mer sur d'autres rivages - curieux, lui aussi, de savoir si par delà le couchant en feu, c'était le ciel - et que la mer lui répondit : «Cherche plus haut !» Je lui dis qu'Augustin interrogea l'astre des nuits et les myriades d'étoiles qui brillaient au firmament, et qu'au fond de son cœur il entendit encore la même réponse : «Cherche au-dessus de nous, cherche là-haut !» Jusqu'à ce qu'il eût compris que le Ciel n'est qu'en Dieu, et qu'en lui seulement, tout là-haut, les élus ont trouvé la possession du repos sans ennui, du jour sans déclin, de la béatitude sans satiété, de l'amour enfin dans une plénitude si débordante, que du ciel il redescend sur terre vers nos âmes inconsolées pour remonter à Dieu en éternelles actions de grâces».
«Cette méditation fut pour ma mère un apaisement et un réconfort. Quelques larmes coulèrent... Ah ! celui qui n'a pas vu pleurer une mère sur son enfant disparu ne connaît pas la profondeur des douleurs humaines».
A quelque temps de là, une autre mère pleurait sur le berceau d'un enfant envolé au Ciel. C'était une pénitente du P. Jouin. Elle fit part de sa peine à l'abbé Jouin, et lui, qui connaissait toute «la profondeur des douleurs humaines», lui adressa ces lignes émouvantes :
Paris, 29 août 1891.
Chère Madame,
Je vous envoie une petite croix pour vous dire combien je prends part à celle que vous portez si grande, si lourde, si écrasante.
La mienne est faite de fleurs et de parfums, symbole de l’âme qui s'est envolée là-haut, près de Dieu, pour vous aimer complètement avant l'âge, pour vous protéger alors que vous la protégiez, pour vous mériter d'inépuisables bénédictions.
Hier, en priant dans notre petite chapelle de Montparnasse, je me rappelais vous y avoir rencontrée et ce souvenir m'était doux ; je ne savais pas encore que vous étiez dans les larmes et que votre petit ange avait rejoint celui qui vous aime toujours comme son enfant et que vous aimez comme un père.
Ayez donc courage, et levez les yeux vers le Ciel, toutes ces âmes, celles qui vous ont appris à combattre et celles à qui Dieu épargne les luttes de la vie, toutes ces âmes sont invisibles, mais non absentes, elles vivent avec nous tout en vivant avec Dieu, et encore un peu nous connaîtrons cette présence retrouvée dans un bonheur sans trouble, sans déclin, sans séparation.
Je demande pour vous au Christ Jésus les consolations que Lui seul sait verser dans le cœur des mères pour que votre cœur puisse sans de trop cruels déchirements se donner tout entier à l'ange qui vous reste sur la terre et à l'ange que vous avez au ciel.
Croyez que je suis à vous de cœur et de prières,
E. JOUIN 1er Vic.
L'abbé Jouin devait traduire ce sentiment des douleurs maternelles dans cette prière qu'il met sur les lèvres des mères à la Grotte de Lourdes :
Qui donc connaît le cœur des mères !
Qui sait que leur bonheur est toujours inquiet ?
Qui sait que leurs larmes amères
De muettes douleurs sont l'inconnu secret ?
Toi seule, Mère du Sauveur,
Dont l'ineffable extase, en la divine étable,
Dut se terminer dans l'horreur
D'une fuite de nuit, d'un exil misérable ;
Toi seule, Mère des douleurs,
Mêlant de ton Jésus, le sang, source féconde,
A l'amertume de tes pleurs,
Pour vaincre, par l'amour tous les crimes du monde ;
Toi seule, en son immensité,
Tu connais, avec Dieu, l'insondable mystère
Fait d'inépuisable bonté,
De pardon,, de grâce et de vie, -un cœur de mère I
De la coupe que nous buvons
Réserve-nous le fiel, et donne l'ambroisie
Au père, au fils que nous aimons ;
A tous garde le ciel, douce et sainte Marie.
(à suivre...)
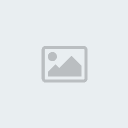
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 4)
CHAPITRE IV SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
L'année suivante devait apporter à Madame Jouin une joie, sinon une consolation. L'abbé Jouin fut élevé au premier Vicariat et «son abbé» que sa santé avait tenu jusqu'alors en dehors de la hiérarchie, entrait à son tour comme vicaire dans les rangs du clergé de Saint-Augustin, presque en même temps que l'Abbé Macchiavelli.
Tout en composant pour les mariages, dont il avait désormais la charge, des discours qui faisaient l'admiration des familles et de ses confrères par leur puissante originalité, le nouveau premier vicaire n'abandonnait pas le Patronage et le catéchisme des Écoles Communales. Il arrangeait, composait même pour ses acteurs de charmantes pièces de théâtre, auxquelles les artistes de la Maîtrise - choristes ou solistes de l'Opéra - prêtaient leur concours.
Encouragé par le succès, il rêva d'une collaboration plus étroite des artistes avec les acteurs. Il conçut l'idée d'un drame dans lequel ces deux éléments s'uniraient pour glorifier Dieu. Car, ce drame sera une prédication. L'abbé Jouin n'est poète, dramaturge et musicien que pour être plus apôtre.
En cette année 1890, dans un petit village de Bavière, Oberammergau, se donnaient les célèbres représentations du Jeu de la Passion. Il y assista et y conduisit son abbé et deux amis. Ne disposant que de peu de temps, il les avait en-voyés devant lui et les rejoignit à Munich. La représentation finie, pendant que ses trois compagnons faisaient, à ses frais toujours, un voyage à travers l'Allemagne, la Bavière et la Suisse, il reprenait aussitôt la route de Paris, mûrissant son projet. Il prendra pour sujet le Mystère de la Nativité, thème plein de fraîcheur et tout indiqué pour son œuvre naissante.
A Oberammergau, le village tout entier concourt au drame de la Passion. Dans sa Nativité, il mettra tout son patro-nage : 60 acteurs évolueront sur la modeste scène du Patronage des Frères. Elle n'a que 4 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur ; il l'agrandira par le moyen de l'avant-scène, et les changements de décors - il n'y en aura pas moins de neuf - se feront rapidement grâce à un ingénieux système de plans assemblés par trois. Le texte est presque achevé ; la musique choisie. Il ne lui manque plus que quelques airs. A le voir appliqué à son ministère, assidu à son confession-nal, soucieux de donner aux jeunes gens du catéchisme de la persévérance dont on vient de le charger, une instruction solide, on ne se douterait pas de l'œuvre que son âme est en train d'enfanter.
Mais pour la réaliser, il lui faut de nombreux et dévoués concours : M. Vivet, chargé de l'orchestration et des répéti-tions des chants et M. Warmbrodt, ce ténor à la voix de charme, auquel il réserve un rôle de premier plan dans la partie musicale, auront à fournir un effort considérable. Pour se les attacher, il songe à leur procurer un voyage en Grèce. Mais retenu jusqu'au 20 juin par le mariage de son frère Henry , il ne dispose plus pour ses vacances que d'une vingtaine de jours : temps insuffisant pour un voyage en cette contrée.
«Qu'à cela ne tienne, dit-il. L'Orient nous est fermé : nous irons au Nord ; nous visiterons les Fiords de Norvège» Et aussitôt, il fait part de son projet à une paroissienne de Saint-Augustin qui vient de partir à Christiania. «Il n'a pu, lui mande-t-il, lui rendre visite cet hiver, mais il se propose d'aller la saluer dans sa résidence d'été. Il sera accompa-gné de «son abbé», d'un autre ami et de deux artistes».
«Venez vite, lui répond Me Fabre. Vos artistes nous chanteront une belle messe...»
Un dimanche soir, les cinq voyageurs s'embarquaient à la Gare du Nord. Où vont-ils ? On verra, paraît-il, le Dane-marck, la Suède, la Norvège, Berlin et qui sait ? - peut être la Finlande. Le chef a son plan, mais il ne le révèle qu'à moi-tié. Ce qu'ils devinent, c'est qu'il faudra aller vite, «quickly», c'est le seul mot anglais que retiendra l'abbé Jouin, au cours de cette randonnée ; quickly, que, pour aller plus vite encore, il a réduit à une syllabe : quick, et qu'il traduit par «filons» ! plus sonore et plus impératif.
L'un des deux survivants de cette aventure, de ce voyage aussi extraordinaire que celui du Tour du monde en quatre-vingts jours, dans lequel l'abbé Jouin donna tant de preuves d'endurance et d'audace nous a communiqué des notes prises au retour. Nous lui laissons la parole :
«En trois bonds de 36, de 26 et de 32 heures, et en cinq jours, nous avions traversé comme un bolide la Belgique, la Hollande, le Danemarck, franchi le Skager-Rath, couché une première nuit à l'ombre de la Tour d'Elseneur, une seconde en chemin de fer, la troisième enfin à Stockholm, où le curé de la paroisse catholique et l'ambassadeur français, M. Millet, fournirent à notre chef les renseignements pour la traversée des fiords. Cinq jours après notre départ, nous étions à Trondhjem au 65e degré de latitude, à quatre jours du Cap Nord et du soleil de minuit.
Le septième jour à minuit, nous prenons le bateau pour redescendre vers Christiansund et Molde. La clarté est encore suffisante pour nous permettre de lire notre bréviaire. Vers midi, nous abordons à Christiansund où une escale de quatre heures nous permet de monter jusqu'au sommet de l'île. L'abbé Jouin refuse de quitter sa cabine : «Il a, dit-il, du courrier en retard, des lettres de nouvel an ( !) qui pressent. - Puis, ajoute-t-il je connais tout cela - c'était une de ses formules en voyage - allez, vous me direz ce que vous aurez vu». A notre retour, il avait écrit quarante cartes de visite qu'il nous montre avec fierté, et peut-être avait-il aussi travaillé à sa pastorale !
A quatre heures, nous doublons le cap de Christiansund, trop connu des touristes ! L'abbé Jouin est particulièrement éprouvé. A 10 heures du soir, nous débarquons à Molde.
De la ville, des groupes sortent et se dirigent vers la campagne. Ils vont fleurir la tombe de leurs morts : le cimetière, couvert de roses éclatantes, est un véritable parterre. De retour vers minuit, nous nous couchons ; c'est la troisième fois depuis une semaine.
Alors commence la terrible randonnée. Il s'agit de franchir en six jours la région montagneuse qui sépare Molde de Christiania ; car l'abbé Jouin a expédié tous nos bagages et notre chapelle portative par chemin de fer à Christiania où il nous faut arriver avant dimanche, si nous voulons y célébrer la Messe. La Messe ! A aucun prix, l'abbé Jouin n'aurait vou-lu y manquer, encore moins la faire manquer à ses compagnons. Et c'est la raison de cette course haletante, de jour et de nuit, qui va commencer aujourd'hui. Mais il vaut mieux laisser la parole à notre compagnon de route.
Dimanche 25 - Dans l'après-midi l'abbé Jouin se fait indiquer un guide. A coups de dictionnaire et par signes, nous lui expliquons notre intention de gagner un village dont nous lui faisons lire le nom sur la carte. Le guide, déjà âgé, bonne fi-gure, grand de taille, fait un signe négatif :
- Snow, fait-il.
- Que dit-il ? demande l'abbé.
- Il y a de la neige, lui explique-t-on.
- Eh bien ! qu'est-ce que cela peut faire ?
Et, de force, il entraîne le guide, qui se décide à le suivre, non sans avoir embrassé sa femme et pris quelques provi-sions. J'ai le pressentiment de quelque coup de l'abbé Jouin. Je me souviens de certains voyages où nous sommes res-tés une journée sans prendre de nourriture avant le soir. En cachette, je me précipite vers une petite boutique et j'enfouis quelques vivres dans mes poches. L'abbé m'a vu et me reproche en termes vifs de retarder le départ.
Nous partons : marche pénible, d'abord, à travers un terrain coupé de ruisseaux et de marécages, puis montée assez rude. Vers huit heures, le guide s'arrête, capte un filet d'eau qui coule sur le talus et entame ses provisions. Mes trois compagnons interrogent du regard l'abbé Jouin qui se tait. Je tire alors de mes poches ce que j'y avais enfoui et j'obtiens un succès auquel ma vanité n'est pas insensible. L'abbé Jouin lui-même prend sa part de cette modique collation. Une bouchée pour chacun. Personne n'ose faire de réflexions sur la frugalité de ces modestes agapes.
Une heure après, la neige apparaît, neige fondante, (nous sommes le 25 juin) dans laquelle nous enfonçons jusqu'à la cheville, jusqu'à mi-jambe, jusqu'au genou, parfois jusqu'à mi-corps.
Pour nous tirer de ces trous glacés, il faut souvent l'aide d'un compagnon. M Guillonneau, haletant, le regard inquiet, toujours le dernier, enfonce plus profondément que nous, car il met ses pieds dans l'empreinte des nôtres. II s'affole, re-proche à l'abbé Jouin, qui ne l'entend pas, de l'avoir entraîné, lui, un père de famille... trois enfants !... dans cette péril-leuse aventure. Il se relève pour retomber encore. A bout de forces, il déclare qu'il n'ira pas plus loin : qu'on l'abandonne I
Nous le remontons physiquement et moralement.
Warmbrodt est un montagnard, il supporte la marche sans se plaindre. Alternativement avec moi, il porte même le pe-tit bagage de l'escouade. Mais il a perdu toute sa saison dernière, retenu au lit par de violents rhumatismes et il me montre ses vêtements ruisselants de neige. Sans conviction, j'essaye de le rassurer : il fait comme nous un traitement homéopathique !
M. Vivet, le plus jeune d'entre nous, reste silencieux et paraît déprimé. Pour moi, en essayant de me tirer d'un trou, je me sens tout à coup paralysé par une crampe douloureuse. Assis sur une pierre, je vois le guide s'arrêter hésitant : Faut-il chercher plus haut une neige plus solide ?... Faut-il revenir en arrière ?
L'abbé Jouin que la traversée de la veille a fortement ébranlé, semble exténué. Pâle comme la neige où nous avan-çons, il accepte le bras du guide.
Le danger est réel. Nous entendons le bruit sourd que font à droite, à gauche, sous nos pas, les ruisseaux qui se dé-versent un peu plus bas dans d'immenses cuvettes.
Enfin la neige devient plus ferme. Nous avons atteint le col, et le versant sur lequel nous descendons maintenant pa-rait moins périlleux. Le guide s'arrête encore. De la main il nous montre une troupe de rennes la tête dressée et immo-biles, surpris de la présence de ces êtres étranges qui osent violer leur domaine. Ils nous ont vus : les voilà partis à toutes jambes. Ah I si nous pouvions avoir leur agilité !
Enfin, la région des neiges est dépassée et le sentier apparaît. Mais une pluie fine achève de tremper nos vêtements. Une chaumière est en vue. Nous entrons ; le guide explique notre cas. On prépare un breuvage chaud et l'on refait les lits pour nous les offrir. L'un de nous commence à quitter la chaussure qui le fait souffrir. Mais l'abbé Jouin survient. Il ins-pecte la pauvre masure et déclare qu'il y a un hôtel plus bas et il nous force à partir, sans rien prendre, à la surprise de ces braves gens qui n'y comprennent rien. Pendant plus d'une heure nous marchons, ou plutôt nous nous traînons, l'un de nous sa bottine à la main. Exaspérés cette fois, presque révoltés, nous allons dire son fait au chef impitoyable. Mais lui, sentant l'orage venir a retrouvé ses jambes et échappe à notre atteinte.
Enfin, après quatorze heures de marche, nous nous trouvons en face d'une seconde chaumière toute semblable à la première. Rien à manger ni à boire. D'ailleurs nous ne demandons qu'à dormir.
Ici ma mémoire fait défaut. Que devinrent mes compagnons ? Je sais seulement que l'on m'offrit, en guise de lit, une sorte de caisse remplie de paille, j'y tombai courbé en deux. Lorsque j'ouvris les yeux, j'avais devant moi le terrible abbé Jouin et j'entendais le mot fatidique : «Filons» ! Je regardai ma montre : nous avions reposé deux heures I Mes vête-ments étaient aussi trempés qu'auparavant.
Une carriole était là. Sans avoir rien pris, nous nous y installons, domptés par cette volonté de fer. A deux heures nous arrivions dans une gracieuse bourgade, au bord d'un lac aux eaux transparentes. Après un jeûne de plus de vingt-quatre heures, le repas fut le bienvenu.
Mais bientôt, infatigable, l'abbé Jouin, m'envoyait au port. Il fallait une barque et des rameurs pour traverser le fiord. A cinq heures, nous voguions vers une région inconnue. De hautes falaises dominaient les eaux, des cascades se jetaient dans la mer de hauteurs impressionnantes, et le vent parfois violent agitait notre frêle embarcation jusqu'à nous donner de l'inquiétude. Sans appui pour notre pauvre tête fatiguée et lourde de sommeil, nous nous laissions aller au murmure des rames.
Enfin, après neuf heures, nous accostons. Courbés comme des vieillards, nous descendons. Un hôtel était là - un vé-ritable hôtel - où, après de longs appels, on nous accueillit. Le jour allait paraître...
Sept heures de repos ! - sept heures, uniquement parce que, vaincu par la fatigue, l'abbé Jouin ne s'était pas réveillé. Un bon déjeuner et le soleil nous rendirent notre entrain.
Ces sept heures données au sommeil, l'abbé Jouin saura bien nous les faire payer. Toute cette journée du mardi, les trois jours et trois nuits suivants - si l'on peut parler de nuit à cette latitude le 26 juin - ne seront qu'une course haletante, en carrioles (à deux places), en stoljere (à une place), en bateaux, à pied, à travers cols et rochers, avec de courts arrêts pour de rapides repas, tout cela pour arriver à prendre de justesse un bateau qui ne passe qu'une fois la semaine et peut, seul, nous conduire à travers l'immense Sognefiord jusqu'à la station de chemin de fer d'où part le train pour Christiania.
Phénomène singulier ! nous avons cessé de protester. L'audace du chef serait-elle contagieuse et nous aurait-il com-muniqué sa flamme ?... Le mercredi, un peu avant minuit, descendant d'un bateau, nous faisons téléphoner par le chef du relais aux deux stations suivantes : à la première nous demandons de tenir prêtes, pour cinq heures, des voitures pour cinq voyageurs pressés, à la seconde de chauffer spécialement pour nous un steamer, car il y a une traversée de trois heures. Au relais où nous nous trouvons, pas de cheval disponible, mais on en attend un d'un instant à l'autre. Nous laissons M. Vivet, plus jeune et plus fatigué, et nous voilà sur la route qui monte en interminables lacets. C'est alors que, dans l'espoir de gagner du temps, Warmbrodt et moi, nous proposons au chef de monter à pic vers le sommet, au milieu des rochers et des fourrés, ayant pour fil conducteur, dans cette marche à travers une région inconnue, le fil téléphonique qui doit, nous le supposons, aboutir au relais où nous sommes annoncés. Entreprise audacieuse !
A 4 heures, n'en pouvant plus, ayant épuisé tous les sujets de conversation (les fameux procès de Joinville, notam-ment), tombant de sommeil, nous arrivons à une avenue au fond de laquelle, sur le perron d'un hôtel, un garçon en livrée semble attendre un voyageur. Quel bon déjeuner ! que vient bientôt partager M. Vivet, pâle et défait. Mais la joie du repos nous fait oublier nos autres compagnons. Au bout d'une heure, ils arrivent épuisés et nous trouvent attablés, sans souci de leur fatigue. Justement mécontents de ce que nous ne leur avions pas envoyé la voiture devenue disponible, ils nous adressent de vifs reproches.
Sentant venir l'orage, je saute dans une des stoljere qui nous attendent dans la cour et m'empare des rênes, tout sur-pris de me trouver, pour mes débuts, assez bon conducteur. Je me demandais si j'avais pris, la bonne route, lorsque mes compagnons me rejoignent à toute vitesse.
La route, semblable à une montagne russe, traverse une contrée ravissante.
C'est dans une halte, au cours de cette journée, que l'abbé Jouin découvre deux charmantes mélodies de Grieg dont il s'empare aussitôt pour sa Pastorale. L'avant-dernier jour, nous déjeunions, à la hâte, comme toujours, au bord d'un lac (ou d'un fiord) enchanteur : un repas appétissant, comme nous n'en avions pas fait depuis longtemps, nous est servi. Nous commencions à lui faire honneur, quand, maladroitement, je fais remarquer que c'est vendredi. «Trouble-fête !» me crie-t-on. Mais nous n'avions plus le temps de faire préparer des aliments maigres, et, la conscience tranquille, nous achevons notre «chateaubriand».
La fin de cette semaine nous réservait d'autres émotions et nous faillîmes échouer au port. Dans la nuit du samedi, nous arrivions au bord du dernier, mais aussi du plus vaste fiord que nous eussions eu à traverser jusqu'alors : le Sogne-fiord. J'avertis le garçon de notre intention de prendre le bateau de six heures pour Lillehammer.
- «No boat !» répond celui-ci.
- «Boat !» réplique l'abbé Jouin, devenu subitement fort en anglais.
- «No boat !» répète le garçon, plus affirmatif.
Pour abréger une discussion qui me paraît devoir se prolonger sans résultat, je me permets d'intervenir.
- «Ne ferions-nous pas mieux d'aller nous coucher ? Il est trois heures du matin, et voici quatre jours que nous n'avons reposé dans un lit».
La majorité se range à mon avis. Et chacun se retire sur ses positions, je veux dire dans sa chambre. J'entends bien, à un moment, l'abbé Jouin - dont je partage la chambre - procéder à sa toilette.
Tout à coup, un cri secoue ma torpeur :
- «Boat ten minutes !» C'est le garçon qui s'est rappelé que, le samedi 1er juillet, commence, en effet, un nouveau ser-vice de bateaux, et le nôtre partait dans dix minutes I
Nous arrivâmes, mais en quelle tenue ! Seul, l'abbé Jouin, correct dans son costume de Clergyman, avait pris le temps de se faire la barbe.
Affalés sur les banquettes du bateau, encore mal éveillés, nous étions là depuis cinq heures. A une station, où l'arrêt se prolongeait outre mesure, nous sortons, surpris de ne voir aucun voyageur sur le pont. Les mariniers embarquaient du charbon. Stupides, nous les regardions aller et venir quand, à cinquante mètres de nous, le sifflet d'une locomotive et le bruit d'un train qui s'arrête nous révélèrent la situation.
Nous étions depuis quinze minutes à la station terminus, et notre bateau allait repartir vers son point de départ. Aussi-tôt, comme de concert, sans prononcer un mot, nous filons à toute vitesse et arrivons tout juste pour prendre le train qui, en deux heures, nous amenait enfin à Christiania... Mais quelle idée ont dû se faire de nous ces mariniers qui nous virent partir, comme nous étions arrivés, au pas de course ? Peut-être s'imaginaient-ils que nous avions pris un billet d'aller et retour !
Dimanche 2 - Me Fabre nous fait visiter la ville et ses environs. Ils doivent être ravissants. Mais le sommeil appesantit nos paupières. Depuis le matin, l'abbé Jouin paraissait sous le coup d'une profonde humiliation. MM. Vivet et Warmbrodt, tombant de fatigue, n'avaient pu se faire entendre pendant la messe et, honteux, s'étaient dérobés aux regards de la foule accourue pour entendre «les grands artistes de Paris». Son erreur - ou sa faute - avait été de croire ses compa-gnons, à la hauteur de son énergie et de ses forces.
Le soir même, la course reprend de plus belle. Nous voyons Copenhague, son musée et son Parc Royal en une jour-née - Berlin, l'allée des Tilleuls et ses palais en quatre heures, après une nuit terrible, où nous avions dû changer trois fois de bateau, deux fois de train et subi trois douanes - Cologne, où nous passons deux heures - Aix-la-Chapelle où nous faisons une halte d'une heure - puis Amiens, où l'abbé Jouin voulait rendre visite à son ami Mgr Renou - Rouen, où il avait des amis à saluer - Sénarpont, résidence d'été d'Auguez, - enfin Paris, où nous arrivons le vendredi, vingt-quatre heures avant le terme fixé.
Plus heureux que Philéas Fog, c'est à notre seule vaillance, et non à une erreur de calcul, que nous devions cette avance considérable dans un voyage de 18 jours, durant lequel nous avions traversé la Belgique, la Hollande, le Dane-mark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, les Bords du Rhin et la Normandie, voyage incroyable où nous avions reposé neuf fois dans un lit, mangé de temps à autre, et qui nous laissa à tous pendant quinze jours, une sensation de vertige - voyage légendaire qui défraya pendant longtemps les conversations des amis de l'abbé Jouin.
Cinq ans plus tard, parlant de cette aventure aux fabriciens de Saint-Médard, il racontait la fameuse traversée dans la neige molle et des dangers qu'il y avait courus. «Ce qui nous frappa dans ce récit, disait l'un de ses auditeurs, le distin-gué Sous-Directeur de la Cie du P. L. M., c'est le souvenir qu'en avait gardé M. Jouin, et l'accent de conviction avec lequel il déclarait que l'obligation de sanctifier le dimanche par la messe est encore plus impérieuse pour le prêtre que pour les fidèles et qu'on y doit satisfaire au prix des plus grands efforts».
«Mais enfin, lui demandait-on parfois, qu'étiez-vous allé faire dans ces régions Scandinaves, et quel profit avez-vous retiré de cette course folle ?»
- «Un très grand, répondait-il. J'ai rapporté de Norvège deux airs délicieux pour ma Nativité : l'air du Départ des Ber-gers et celui de la Danse du couvre-feu».
L'esprit reposé, il se remit à l'œuvre avec des forces décuplées. Sous sa direction, on travaillait fébrilement. M. Vivet achevait l'orchestration de la musique et commençait les répétitions des chants. M. Enfert («le Saint Vincent de Paul de la Maison-Blanche») commandait les costumes d'après Racinet. Un peintre de l'Opéra, M. Karl, brossait les dix décors, que des machinistes du «Chatelet» installaient. Le Régisseur de la scène de l'Opéra, M. Pluque, et l'un de ses profes-seurs dressaient la danse du «Couvre feu» et celle des prêtres Saliens, sur un chœur de Bizet - les artistes répétaient les morceaux particulièrement difficiles : le trio de Saint-Saëns, le quatuor de la Messe en Ré et le chœur de la IXe sympho-nie.
Quant à lui, il s'était réservé le rôle difficile de mettre d'accord comme chef d'orchestre, les artistes chantant à l'avant-scène et les acteurs évoluant sur le théâtre.
La première représentation de la Nativité, bientôt suivie de sept autres, eut lieu en décembre 1893. L'«Univers», sous la signature du Marquis de Ségur en donna un compte-rendu, qui est une analyse parfaite de la pièce.
«Cette pastorale, ou ce mystère, comme on voudra l'appeler, est pour les yeux, l'esprit et le cœur, un des spec-tacles les plus touchants et les plus curieux, une des prédications les plus pénétrantes qu'on puisse imaginer...
«C'est une œuvre à la fois historique, théologique, poétique, musicale, théâtrale même par la recherche des cos-tumes, le nombre des exécutants, la beauté des décors .Elle unit à l'attrait d'une féerie l'intérêt supérieur d'un orato-rio, le charme chrétien d'un mystère et la nouveauté hardie d'une exécution partagée entre des artistes célèbres et des jeunes gens du peuple de Paris.
«Toute la partie scénique est livrée à l'inexpérience pleine de verve et de naïveté d'enfants, d'adolescents, de jeunes employés sortis des écoles laïques et appartenant au Patronage paroissial de Saint-Augustin. Quant à la par-tie artistique, elle est confiée à des chanteurs hors ligne comme MM. Auguez, Vergnet et Warmbrodt, à des canta-trices dignes d'eux, Mmes Auguez de Montalant, Boidin-Puisais, Mlle Moulor, à des musiciens choisis dans les pre-miers orchestres de Paris. L'orgue est tenu par M. Gigout ; le piano, par M. Vivet.
«Or, de toutes ces sciences et de ces inexpériences, de ces grandeurs et de ces humilités, de ce concours de maîtres de l'art et de novices, de cette fusion téméraire, qui semblerait devoir aboutir à une désastreuse confusion, sort une unité merveilleuse d'expression et d'impression, un ensemble harmonieux, oh le ciel et la terre se marient et s'épanouissent en une floraison originale et charmante, exhalant un parfum de fleurs et d'encens.
«La musique présente les mêmes caractères de contrastes et d'étrangetés. Les chanteurs placés à la gauche de la scène, les musiciens à droite, figurent un double promontoire qui s'avance de chaque côté sur la mer vivante et mobile de l'auditoire.
«Autre anomalie tout aussi nouvelle, tout aussi heureuse ; cette musique sans nom d'auteur, a été puisée à des sources diverses et est exécutée par des artistes plus divers encore. M. l'abbé Jouin l'a empruntée à de grands com-positeurs sans distinction de temps, ni de pays, depuis Bach et Beethoven, jusqu'à Berlioz, Franck, Saint-Saëns et Gounod. Et, par un contraste qui devrait choquer et qui charme, ces airs et ces chœurs magnifiques, chantés par les voix des plus grands artistes et joués par les instruments les plus harmonieux, sont entremêlés de cantiques popu-laires, Venez, divin Messie ; Gloria in excelsis Deo, chantés, comme au catéchisme, par les plus jeunes figurants ali-gnés ou répandus en groupes sur la scène.
«Le libretto reproduit la pensée maîtresse de l'ouvrage, cette pensée profondément philosophique et religieuse de la diversité dans l'unité. Des scènes en vers composés par l'auteur et le plus souvent accompagnés de musique, succèdent à des dialogues en prose sobrement écrits et fortement pensés...
«La première partie, intitulée «Bethléem», pleine de mouvement et de vérité, est enlevée vigoureusement, sans un moment de défaillance, y compris une danse de prêtres saliens, sorte de ronde guerrière, accompagnée de grands coups de glaives sur des boucliers que nos jeunes Parisiens exécutent avec une précision étonnante et une furie vertigineuse.
«La scène se passe sur la grande place de la ville. Le père de Judas, le futur traître, hôtelier du Veau d'or, discute avec les bergers des campagnes voisines, en présence de Cyrinus, l'envoyé de César, et de ses officiers récemment arrivés pour le recensement. La venue prochaine du Messie, objet de l'attente universelle, occupe tous les esprits et excite la verve impie du vieux juif. Il insulte d'avance à la royauté de ce Sauveur sans palais et sans garde, se raille de sa pauvreté volontaire et expose avec un cynisme insolent son programme, suivi par les fils d'Israël depuis la ruine de Jérusalem et leur dispersion dans le monde : Ne rien donner, tout vendre, tout prendre, avoir pour dieu le veau d'or, pour ennemi tout ce qui ne s'agenouille pas devant lui.
«A ce moment, apparaît un étranger, grave, simple et touchant dans sa dignité et sa modestie : c'est Joseph, le menuisier de Nazareth, qui n'a ni or, ni argent, et qui demande la charité d'un humble logement pour Marie, sa jeune femme, sur le point de mettre au monde l'Enfant-Dieu.
«Touchés de son aspect et de sa prière, les bergers l'entourent, le consolent, lui offrent leurs services... Mais Si-mon-Judas les écarte, se moque de ce mendiant qui vient troubler leurs fêtes, et soulève, contre lui la populace de Bethléem. Joseph se retire humblement, comme il est venu ; et pendant qu'il s'éloigne les officiers romains indignés, s'écrient : «Peuple vil, peuple flétri ! Si Dieu te sauve, ce ne sera que pour ces bergers et par eux !»
«Le mystère de la Nativité renferme une seconde scène aussi vraie et plus frappante encore que celle-là ; c'est une séance du Sanhédrin, le conseil suprême du peuple juif. Au point de vue doctrinal, littéraire et historique, c'est la page la plus importante de cette belle œuvre.
«Le vieillard Siméon, qui a vu les Mages, qui a tenu dans ses bras l'Enfant-Jésus, annonce à tous ces Pharisiens, ces Saducéens, ces Hérodiens assemblés, l'avènement du Messie. Ils le pressent de questions, d'arguties, de me-naces, et se réunissent presque tous dans une négation hautaine et sacrilège. Toutes les divisions de ces sectes en-nemies, qui devaient s'unir un jour pour condamner le Sauveur, sont admirablement indiquées et rendues.
«Un Messie qui serait pour le monde entier ? - Un Messie qui se serait révélé à des bergers, et pas à nous ? - Qui serait né dans une étable ? - Qui nous enlèverait le peuple ? - Un Messie qui trahirait notre cause ? - «C'est vous qui le trahirez, répond Siméon. - Nous le trahirons, s'il le faut ! s'écrie Caïphe, déjà membre du Sanhédrin. - Et si cet homme était le Fils de Dieu ? - Qu'importe I II faut qu'il soit Juif avant tout ! - Eh quoi ! vous mettriez à mort le Fils de Dieu lui-même ? - Ton Messie, fût-il Dieu, reprend Caïphe, si c'est le Messie de la pauvreté, si c'est un roi sans ar-mées, si c'est le sauveur du genre humain, nous choisirons une montagne, et nous l’élèverons sur une croix, pour qu'il voie au loin le royaume universel qu'il aura rêvé. - Et si son sang criait vengeance et retombait sur vos têtes ? - Nous avons les promesses éternelles !»
«A ce dernier mot, Siméon se redresse et leur jette à tous cette foudroyante apostrophe : «Oui, vous vivrez, mais vous ne serez plus comme aujourd'hui, un peuple de désir, d'espérance, de rayonnement et d'avenir, parce que vos aspirations sont terrestres, vénales et égoïstes. Vous attendrez vainement un Messie qui est déjà venu, et j'entrevois, dans un temps prochain, deux peuples qui rempliront l'univers jusqu'à la consommation des siècles, le peuple du Messie de Bethléem, peuple catholique, peuple conquérant devenu le peuple de Dieu, et le peuple juif, peuple errant, sans unité, sans patrie, avide d'or et de jouissance comme vous, Saducéens ; ambitieux du pouvoir comme vous, Pharisiens, et portant dans la suite des âges la marque indélébile d'une écrasante malédiction. O Dieu ! qui m'avez donné de porter dans mes mains le Sauveur du monde, épargnez à ma vieillesse d'être le témoin attristé de l'aveu-glement et des crimes de Votre peuple. Ma tâche est finie, nul ici ne m'écoute ; prenez l'âme de Votre serviteur et qu'elle repose dans Votre paix éternelle !»
«Pour ne pas multiplier, en me répétant et en fatiguant le lecteur, les formules de mon émotion et de mon enthou-siasme, je laisse de côté les scènes charmantes où les bergers devisent entre eux du Messie attendu, leurs gracieux cantiques, la prière que la voix délicieuse de Warmbrodt exhale comme un pur encens, puis l'apparition des Anges, le chant céleste du Gloria in excelsis Deo, et la joie de ces âmes simples en apprenant la bonne nouvelle de la nais-sance du Sauveur.
«J'ai hâte d'arriver au point culminant du Mystère, à la scène ineffable de l'adoration des bergers, dont l'adoration des Mages n'est guère que la reproduction magnifique, à cette apparition de la Sainte Famille dans l'étable de Be-thléem, qui offre enfin à nos regards et à notre foi ce qu'il y a de plus grand dans ce monde, la Trinité humaine de Jé-sus, Marie et Joseph.
«Aux premiers accords du sublime Benedictus de Beethoven, chanté en quatuor par le chœur et l'orchestre, un ri-deau qui voilait l'arrière-scène se lève et présente aux yeux ravis des spectateurs un tableau digne du pur regard des anges.
«Sous un appentis adossé à la grotte et dont la large ouverture laisse voir le ciel étoile, la nuit lumineuse de Noël, l'Enfant-Jésus repose dans sa crèche, entre la Vierge Marie, qui l'adore à genoux, et saint Joseph debout qui le con-temple dans une muette extase.
«Ce petit enfant, beau comme un ange, semble dormir d'un profond sommeil, aussi immobile dans son misérable berceau que Marie et Joseph dans leur adoration. Cette immobilité de la Sainte Famille se prolonge jusqu'à la fin de la scène, et donne l'illusion de l'extase éternelle des Bienheureux. C'est vraiment une vision du Paradis.
«Le rôle redoutable de la Vierge Marie est rempli par un adolescent de treize ou quatorze ans, choisi parmi les plus purs de visage et de cœur, et qui, par ses traits, la candeur de sa physionomie, la noble simplicité de son atti-tude, personnifie merveilleusement la plus divine des créatures. Chastement enveloppée d'une robe et d'un voile éclatants de blancheur, penchée sur son fils nouveau-né, Marie respire l'humilité, la douceur, l'intensité du saint amour et de l'adoration. Raphaël n'a pas fait une Sainte-Famille plus idéalement belle. Ce tableau seul suffirait à l'admiration d'une soirée tout entière.
«L'adoration des bergers se déroule dans un ordre pieux, dans une harmonie parfaite. Accompagnés des chants délicieux du chœur, ils semblent des premiers communiants venant tour à tour s'agenouiller devant la sainte Table.
«L'Enfant-Jésus demeure jusqu'à la fin dans son sommeil mystique. Mais, au moment où le dernier venu, un petit pâtre de sept ou huit ans, se prosterne devant lui, le Dieu nouveau-né ouvre les yeux, se soulève et, passant ses bras autour du cou de son petit frère, l'embrasse longuement. Rien ne peut donner une idée de l'émotion que soulève cette adorable simplicité. C'est un trait de génie que ce réveil et ce baiser de Jésus.
«L'émotion redouble quand le Fils de Dieu, se redressant, approche Son visage du visage de Marie et pose Ses lèvres, les lèvres du Verbe Éternel, sur la joue virginale de Sa Mère. Dans cette attitude pleine de grâce, Il forme avec elle un tableau divin qui rappelle celui de la Madone du Grand Duc par Raphaël, et qui même le surpasse.
«La toile se baisse comme à regret sur cette scène ineffable, plus éloquente dans son silence que les créations les plus admirées des plus grands génies.
«Que dire après cela de l'adoration des Mages ? Moins touchante que celle des bergers, elle est plus imposante par l'attitude de l’Enfant-Jésus, qui reçoit leurs hommages et leurs présents, debout sur les genoux de la Vierge Ma-rie et les bras étendus comme pour bénir. On ne sait où ce petit enfant a pris cette majesté, et le fils n'est pas moins étonnant que la mère. On dirait que, dans ces scènes plus célestes que terrestres, ces enfants de Paris sont dans leur élément et qu'ils se meuvent dans cette atmosphère surnaturelle, comme dans l'air vicié que leurs lèvres et leur âmes sont condamnées à respirer chaque jour. Il y a pourtant loin de l'école laïque à Bethléem. Mais l'intervention de l'Église a comblé cet abîme, et les enfants de l'athéisme officiel sont redevenus les enfants de Dieu.
«Dans cette troisième partie du mystère, une mélopée admirable, tirée de l'oratorio de notre cher et grand Gou-nod, Rédemption, a soulevé l'enthousiasme de toute l'assistance.
«Enfin, dans un épilogue où le tableau de Merson représentant la Fuite en Egypte est reproduit avec une saisis-sante beauté, le sommeil de l'Enfant-Jésus sur les genoux de Sa mère endormie, à l'ombre d'un sphinx gigantesque mutilé, est accompagné d'un chant merveilleux tiré de l’Enfance du Christ de Berlioz.
«C'est sur cette scène de paix et de grandeur, suivie d'une éclatante apothéose, que finit la représentation et que la foule se retire émue, charmée et toute pénétrée d'impressions religieuses et mystiques.
«M. l'abbé Jouin a fait une grande et sainte œuvre, et nous nous permettons de lui en adresser, en finissant, nos respectueuses et reconnaissantes félicitations. Mais nous osons dire que son Patronage de jeunes gens est une œuvre plus belle et plus sainte encore que sa Nativité».
L'abbé Jouin reçut des félicitations de source plus humble mais aussi non moins touchantes. Un curé de la Mayenne lui écrivait l'année suivante :
«Oh ! c'est une belle œuvre que vous avez faite au point de vue de l'art, il n'y a qu'une voix pour le dire ; mais ce qui me frappe surtout, c'est que cet art captive même les illettrés. Notre assistance à Evron était certes des plus mé-langées. Eh bien ! elle a suivi avec un intérêt marqué la scène elle-même du Sanhédrin et l'interrogatoire d'Hérode. Par ailleurs, nos ressources, sous le rapport du chant et des acteurs, étaient bien misérables en comparaison des vôtres ; et malgré cela, notre monde est complètement enthousiasmé».
Il y avait alors à Paris un musicien viennois de talent et qui allait bientôt se faire, comme compositeur symphonique, une renommée mondiale. Juif d'origine et de religion, il fut amené par l'une des solistes à la troisième représentation de la Nativité. Il entendit sans broncher la tirade contre le peuple juif. Mais dès la première phrase chantée par les onze petits choristes vêtus du peplum grec, sur un récitatif de l'abbé Jouin : Nous vous annonçons le Mystère de la Nativité, il s'était senti remué et, tout en redisant : «Peuple sans unité, sans patrie»..., dans la nuit qui suivit, il composait un Noël de gra-cieuse inspiration, se terminant par un acte de foi.
Il l'apporta comme un hommage à l'abbé Jouin et fut bientôt admis dans le cercle des artistes qui fréquentaient l'ave-nue Portalis, et sur lesquels il exerçait déjà une si bienfaisante influence.
Il est hors de doute que les huit représentations du Mystère de la Nativité furent le point de départ d'un mouvement re-ligieux très profond dans ce monde de chanteurs et d'artistes - les plus réputés de Paris en cette fin de siècle. On ne sau-rait douter que c'est à la bénédiction de cet Enfant-Jésus, si bien représenté par un enfant de trois ans, qu'il faut attribuer tant de conversions qui viendront bientôt réjouir l'âme de l'abbé Jouin.
Disons dès maintenant, que le jeune adolescent, dont le Marquis de Ségur avait remarqué la pureté de visage et de cœur et qui, «par ses traits, la candeur de sa physionomie personnifiait merveilleusement la plus divine des créatures», s'envolait de cette terre à l'aube de sa vingtième année dans des sentiments d'une piété si achevée qu'on peut croire que c'est la Vierge elle-même qui descendit cueillir son âme avant que le mal n'en eût terni la fraîcheur.
«La Nativité» fut bientôt représentée avec un égal succès sur un grand nombre de scènes d'œuvres, à Paris, en pro-vince et jusqu'en Amérique.
La Semaine Religieuse de Paris lui avait consacré un article élogieux, et le Directeur du Grand-Séminaire demanda à l'auteur d'en donner une représentation à Saint-Sulpice. L'impossibilité de supprimer les voix de femmes pour la partie musicale arrêta ce projet.
L'abbé Jouin avait fait, en fondant son patronage, «une œuvre encore plus belle que celle de sa Nativité». Ce juge-ment du Marquis de Ségur, le cardinal Richard semble avoir voulu le ratifier lorsque, au milieu de l'été 1894, il proposa au 1er Vicaire de Saint-Augustin la cure de Saint-Médard, devenue vacante par l'élévation de M. l'abbé Latty à l'évêché de Châlons ; et le Gouvernement s'honora en signant, sans mauvaise grâce, cette nomination de l'ancien curé de Joinville à cette cure de seconde classe.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 4)
CHAPITRE IV SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
L'année suivante devait apporter à Madame Jouin une joie, sinon une consolation. L'abbé Jouin fut élevé au premier Vicariat et «son abbé» que sa santé avait tenu jusqu'alors en dehors de la hiérarchie, entrait à son tour comme vicaire dans les rangs du clergé de Saint-Augustin, presque en même temps que l'Abbé Macchiavelli.
Tout en composant pour les mariages, dont il avait désormais la charge, des discours qui faisaient l'admiration des familles et de ses confrères par leur puissante originalité, le nouveau premier vicaire n'abandonnait pas le Patronage et le catéchisme des Écoles Communales. Il arrangeait, composait même pour ses acteurs de charmantes pièces de théâtre, auxquelles les artistes de la Maîtrise - choristes ou solistes de l'Opéra - prêtaient leur concours.
Encouragé par le succès, il rêva d'une collaboration plus étroite des artistes avec les acteurs. Il conçut l'idée d'un drame dans lequel ces deux éléments s'uniraient pour glorifier Dieu. Car, ce drame sera une prédication. L'abbé Jouin n'est poète, dramaturge et musicien que pour être plus apôtre.
En cette année 1890, dans un petit village de Bavière, Oberammergau, se donnaient les célèbres représentations du Jeu de la Passion. Il y assista et y conduisit son abbé et deux amis. Ne disposant que de peu de temps, il les avait en-voyés devant lui et les rejoignit à Munich. La représentation finie, pendant que ses trois compagnons faisaient, à ses frais toujours, un voyage à travers l'Allemagne, la Bavière et la Suisse, il reprenait aussitôt la route de Paris, mûrissant son projet. Il prendra pour sujet le Mystère de la Nativité, thème plein de fraîcheur et tout indiqué pour son œuvre naissante.
A Oberammergau, le village tout entier concourt au drame de la Passion. Dans sa Nativité, il mettra tout son patro-nage : 60 acteurs évolueront sur la modeste scène du Patronage des Frères. Elle n'a que 4 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur ; il l'agrandira par le moyen de l'avant-scène, et les changements de décors - il n'y en aura pas moins de neuf - se feront rapidement grâce à un ingénieux système de plans assemblés par trois. Le texte est presque achevé ; la musique choisie. Il ne lui manque plus que quelques airs. A le voir appliqué à son ministère, assidu à son confession-nal, soucieux de donner aux jeunes gens du catéchisme de la persévérance dont on vient de le charger, une instruction solide, on ne se douterait pas de l'œuvre que son âme est en train d'enfanter.
Mais pour la réaliser, il lui faut de nombreux et dévoués concours : M. Vivet, chargé de l'orchestration et des répéti-tions des chants et M. Warmbrodt, ce ténor à la voix de charme, auquel il réserve un rôle de premier plan dans la partie musicale, auront à fournir un effort considérable. Pour se les attacher, il songe à leur procurer un voyage en Grèce. Mais retenu jusqu'au 20 juin par le mariage de son frère Henry , il ne dispose plus pour ses vacances que d'une vingtaine de jours : temps insuffisant pour un voyage en cette contrée.
«Qu'à cela ne tienne, dit-il. L'Orient nous est fermé : nous irons au Nord ; nous visiterons les Fiords de Norvège» Et aussitôt, il fait part de son projet à une paroissienne de Saint-Augustin qui vient de partir à Christiania. «Il n'a pu, lui mande-t-il, lui rendre visite cet hiver, mais il se propose d'aller la saluer dans sa résidence d'été. Il sera accompa-gné de «son abbé», d'un autre ami et de deux artistes».
«Venez vite, lui répond Me Fabre. Vos artistes nous chanteront une belle messe...»
Un dimanche soir, les cinq voyageurs s'embarquaient à la Gare du Nord. Où vont-ils ? On verra, paraît-il, le Dane-marck, la Suède, la Norvège, Berlin et qui sait ? - peut être la Finlande. Le chef a son plan, mais il ne le révèle qu'à moi-tié. Ce qu'ils devinent, c'est qu'il faudra aller vite, «quickly», c'est le seul mot anglais que retiendra l'abbé Jouin, au cours de cette randonnée ; quickly, que, pour aller plus vite encore, il a réduit à une syllabe : quick, et qu'il traduit par «filons» ! plus sonore et plus impératif.
L'un des deux survivants de cette aventure, de ce voyage aussi extraordinaire que celui du Tour du monde en quatre-vingts jours, dans lequel l'abbé Jouin donna tant de preuves d'endurance et d'audace nous a communiqué des notes prises au retour. Nous lui laissons la parole :
«En trois bonds de 36, de 26 et de 32 heures, et en cinq jours, nous avions traversé comme un bolide la Belgique, la Hollande, le Danemarck, franchi le Skager-Rath, couché une première nuit à l'ombre de la Tour d'Elseneur, une seconde en chemin de fer, la troisième enfin à Stockholm, où le curé de la paroisse catholique et l'ambassadeur français, M. Millet, fournirent à notre chef les renseignements pour la traversée des fiords. Cinq jours après notre départ, nous étions à Trondhjem au 65e degré de latitude, à quatre jours du Cap Nord et du soleil de minuit.
Le septième jour à minuit, nous prenons le bateau pour redescendre vers Christiansund et Molde. La clarté est encore suffisante pour nous permettre de lire notre bréviaire. Vers midi, nous abordons à Christiansund où une escale de quatre heures nous permet de monter jusqu'au sommet de l'île. L'abbé Jouin refuse de quitter sa cabine : «Il a, dit-il, du courrier en retard, des lettres de nouvel an ( !) qui pressent. - Puis, ajoute-t-il je connais tout cela - c'était une de ses formules en voyage - allez, vous me direz ce que vous aurez vu». A notre retour, il avait écrit quarante cartes de visite qu'il nous montre avec fierté, et peut-être avait-il aussi travaillé à sa pastorale !
A quatre heures, nous doublons le cap de Christiansund, trop connu des touristes ! L'abbé Jouin est particulièrement éprouvé. A 10 heures du soir, nous débarquons à Molde.
De la ville, des groupes sortent et se dirigent vers la campagne. Ils vont fleurir la tombe de leurs morts : le cimetière, couvert de roses éclatantes, est un véritable parterre. De retour vers minuit, nous nous couchons ; c'est la troisième fois depuis une semaine.
Alors commence la terrible randonnée. Il s'agit de franchir en six jours la région montagneuse qui sépare Molde de Christiania ; car l'abbé Jouin a expédié tous nos bagages et notre chapelle portative par chemin de fer à Christiania où il nous faut arriver avant dimanche, si nous voulons y célébrer la Messe. La Messe ! A aucun prix, l'abbé Jouin n'aurait vou-lu y manquer, encore moins la faire manquer à ses compagnons. Et c'est la raison de cette course haletante, de jour et de nuit, qui va commencer aujourd'hui. Mais il vaut mieux laisser la parole à notre compagnon de route.
Dimanche 25 - Dans l'après-midi l'abbé Jouin se fait indiquer un guide. A coups de dictionnaire et par signes, nous lui expliquons notre intention de gagner un village dont nous lui faisons lire le nom sur la carte. Le guide, déjà âgé, bonne fi-gure, grand de taille, fait un signe négatif :
- Snow, fait-il.
- Que dit-il ? demande l'abbé.
- Il y a de la neige, lui explique-t-on.
- Eh bien ! qu'est-ce que cela peut faire ?
Et, de force, il entraîne le guide, qui se décide à le suivre, non sans avoir embrassé sa femme et pris quelques provi-sions. J'ai le pressentiment de quelque coup de l'abbé Jouin. Je me souviens de certains voyages où nous sommes res-tés une journée sans prendre de nourriture avant le soir. En cachette, je me précipite vers une petite boutique et j'enfouis quelques vivres dans mes poches. L'abbé m'a vu et me reproche en termes vifs de retarder le départ.
Nous partons : marche pénible, d'abord, à travers un terrain coupé de ruisseaux et de marécages, puis montée assez rude. Vers huit heures, le guide s'arrête, capte un filet d'eau qui coule sur le talus et entame ses provisions. Mes trois compagnons interrogent du regard l'abbé Jouin qui se tait. Je tire alors de mes poches ce que j'y avais enfoui et j'obtiens un succès auquel ma vanité n'est pas insensible. L'abbé Jouin lui-même prend sa part de cette modique collation. Une bouchée pour chacun. Personne n'ose faire de réflexions sur la frugalité de ces modestes agapes.
Une heure après, la neige apparaît, neige fondante, (nous sommes le 25 juin) dans laquelle nous enfonçons jusqu'à la cheville, jusqu'à mi-jambe, jusqu'au genou, parfois jusqu'à mi-corps.
Pour nous tirer de ces trous glacés, il faut souvent l'aide d'un compagnon. M Guillonneau, haletant, le regard inquiet, toujours le dernier, enfonce plus profondément que nous, car il met ses pieds dans l'empreinte des nôtres. II s'affole, re-proche à l'abbé Jouin, qui ne l'entend pas, de l'avoir entraîné, lui, un père de famille... trois enfants !... dans cette péril-leuse aventure. Il se relève pour retomber encore. A bout de forces, il déclare qu'il n'ira pas plus loin : qu'on l'abandonne I
Nous le remontons physiquement et moralement.
Warmbrodt est un montagnard, il supporte la marche sans se plaindre. Alternativement avec moi, il porte même le pe-tit bagage de l'escouade. Mais il a perdu toute sa saison dernière, retenu au lit par de violents rhumatismes et il me montre ses vêtements ruisselants de neige. Sans conviction, j'essaye de le rassurer : il fait comme nous un traitement homéopathique !
M. Vivet, le plus jeune d'entre nous, reste silencieux et paraît déprimé. Pour moi, en essayant de me tirer d'un trou, je me sens tout à coup paralysé par une crampe douloureuse. Assis sur une pierre, je vois le guide s'arrêter hésitant : Faut-il chercher plus haut une neige plus solide ?... Faut-il revenir en arrière ?
L'abbé Jouin que la traversée de la veille a fortement ébranlé, semble exténué. Pâle comme la neige où nous avan-çons, il accepte le bras du guide.
Le danger est réel. Nous entendons le bruit sourd que font à droite, à gauche, sous nos pas, les ruisseaux qui se dé-versent un peu plus bas dans d'immenses cuvettes.
Enfin la neige devient plus ferme. Nous avons atteint le col, et le versant sur lequel nous descendons maintenant pa-rait moins périlleux. Le guide s'arrête encore. De la main il nous montre une troupe de rennes la tête dressée et immo-biles, surpris de la présence de ces êtres étranges qui osent violer leur domaine. Ils nous ont vus : les voilà partis à toutes jambes. Ah I si nous pouvions avoir leur agilité !
Enfin, la région des neiges est dépassée et le sentier apparaît. Mais une pluie fine achève de tremper nos vêtements. Une chaumière est en vue. Nous entrons ; le guide explique notre cas. On prépare un breuvage chaud et l'on refait les lits pour nous les offrir. L'un de nous commence à quitter la chaussure qui le fait souffrir. Mais l'abbé Jouin survient. Il ins-pecte la pauvre masure et déclare qu'il y a un hôtel plus bas et il nous force à partir, sans rien prendre, à la surprise de ces braves gens qui n'y comprennent rien. Pendant plus d'une heure nous marchons, ou plutôt nous nous traînons, l'un de nous sa bottine à la main. Exaspérés cette fois, presque révoltés, nous allons dire son fait au chef impitoyable. Mais lui, sentant l'orage venir a retrouvé ses jambes et échappe à notre atteinte.
Enfin, après quatorze heures de marche, nous nous trouvons en face d'une seconde chaumière toute semblable à la première. Rien à manger ni à boire. D'ailleurs nous ne demandons qu'à dormir.
Ici ma mémoire fait défaut. Que devinrent mes compagnons ? Je sais seulement que l'on m'offrit, en guise de lit, une sorte de caisse remplie de paille, j'y tombai courbé en deux. Lorsque j'ouvris les yeux, j'avais devant moi le terrible abbé Jouin et j'entendais le mot fatidique : «Filons» ! Je regardai ma montre : nous avions reposé deux heures I Mes vête-ments étaient aussi trempés qu'auparavant.
Une carriole était là. Sans avoir rien pris, nous nous y installons, domptés par cette volonté de fer. A deux heures nous arrivions dans une gracieuse bourgade, au bord d'un lac aux eaux transparentes. Après un jeûne de plus de vingt-quatre heures, le repas fut le bienvenu.
Mais bientôt, infatigable, l'abbé Jouin, m'envoyait au port. Il fallait une barque et des rameurs pour traverser le fiord. A cinq heures, nous voguions vers une région inconnue. De hautes falaises dominaient les eaux, des cascades se jetaient dans la mer de hauteurs impressionnantes, et le vent parfois violent agitait notre frêle embarcation jusqu'à nous donner de l'inquiétude. Sans appui pour notre pauvre tête fatiguée et lourde de sommeil, nous nous laissions aller au murmure des rames.
Enfin, après neuf heures, nous accostons. Courbés comme des vieillards, nous descendons. Un hôtel était là - un vé-ritable hôtel - où, après de longs appels, on nous accueillit. Le jour allait paraître...
Sept heures de repos ! - sept heures, uniquement parce que, vaincu par la fatigue, l'abbé Jouin ne s'était pas réveillé. Un bon déjeuner et le soleil nous rendirent notre entrain.
Ces sept heures données au sommeil, l'abbé Jouin saura bien nous les faire payer. Toute cette journée du mardi, les trois jours et trois nuits suivants - si l'on peut parler de nuit à cette latitude le 26 juin - ne seront qu'une course haletante, en carrioles (à deux places), en stoljere (à une place), en bateaux, à pied, à travers cols et rochers, avec de courts arrêts pour de rapides repas, tout cela pour arriver à prendre de justesse un bateau qui ne passe qu'une fois la semaine et peut, seul, nous conduire à travers l'immense Sognefiord jusqu'à la station de chemin de fer d'où part le train pour Christiania.
Phénomène singulier ! nous avons cessé de protester. L'audace du chef serait-elle contagieuse et nous aurait-il com-muniqué sa flamme ?... Le mercredi, un peu avant minuit, descendant d'un bateau, nous faisons téléphoner par le chef du relais aux deux stations suivantes : à la première nous demandons de tenir prêtes, pour cinq heures, des voitures pour cinq voyageurs pressés, à la seconde de chauffer spécialement pour nous un steamer, car il y a une traversée de trois heures. Au relais où nous nous trouvons, pas de cheval disponible, mais on en attend un d'un instant à l'autre. Nous laissons M. Vivet, plus jeune et plus fatigué, et nous voilà sur la route qui monte en interminables lacets. C'est alors que, dans l'espoir de gagner du temps, Warmbrodt et moi, nous proposons au chef de monter à pic vers le sommet, au milieu des rochers et des fourrés, ayant pour fil conducteur, dans cette marche à travers une région inconnue, le fil téléphonique qui doit, nous le supposons, aboutir au relais où nous sommes annoncés. Entreprise audacieuse !
A 4 heures, n'en pouvant plus, ayant épuisé tous les sujets de conversation (les fameux procès de Joinville, notam-ment), tombant de sommeil, nous arrivons à une avenue au fond de laquelle, sur le perron d'un hôtel, un garçon en livrée semble attendre un voyageur. Quel bon déjeuner ! que vient bientôt partager M. Vivet, pâle et défait. Mais la joie du repos nous fait oublier nos autres compagnons. Au bout d'une heure, ils arrivent épuisés et nous trouvent attablés, sans souci de leur fatigue. Justement mécontents de ce que nous ne leur avions pas envoyé la voiture devenue disponible, ils nous adressent de vifs reproches.
Sentant venir l'orage, je saute dans une des stoljere qui nous attendent dans la cour et m'empare des rênes, tout sur-pris de me trouver, pour mes débuts, assez bon conducteur. Je me demandais si j'avais pris, la bonne route, lorsque mes compagnons me rejoignent à toute vitesse.
La route, semblable à une montagne russe, traverse une contrée ravissante.
C'est dans une halte, au cours de cette journée, que l'abbé Jouin découvre deux charmantes mélodies de Grieg dont il s'empare aussitôt pour sa Pastorale. L'avant-dernier jour, nous déjeunions, à la hâte, comme toujours, au bord d'un lac (ou d'un fiord) enchanteur : un repas appétissant, comme nous n'en avions pas fait depuis longtemps, nous est servi. Nous commencions à lui faire honneur, quand, maladroitement, je fais remarquer que c'est vendredi. «Trouble-fête !» me crie-t-on. Mais nous n'avions plus le temps de faire préparer des aliments maigres, et, la conscience tranquille, nous achevons notre «chateaubriand».
La fin de cette semaine nous réservait d'autres émotions et nous faillîmes échouer au port. Dans la nuit du samedi, nous arrivions au bord du dernier, mais aussi du plus vaste fiord que nous eussions eu à traverser jusqu'alors : le Sogne-fiord. J'avertis le garçon de notre intention de prendre le bateau de six heures pour Lillehammer.
- «No boat !» répond celui-ci.
- «Boat !» réplique l'abbé Jouin, devenu subitement fort en anglais.
- «No boat !» répète le garçon, plus affirmatif.
Pour abréger une discussion qui me paraît devoir se prolonger sans résultat, je me permets d'intervenir.
- «Ne ferions-nous pas mieux d'aller nous coucher ? Il est trois heures du matin, et voici quatre jours que nous n'avons reposé dans un lit».
La majorité se range à mon avis. Et chacun se retire sur ses positions, je veux dire dans sa chambre. J'entends bien, à un moment, l'abbé Jouin - dont je partage la chambre - procéder à sa toilette.
Tout à coup, un cri secoue ma torpeur :
- «Boat ten minutes !» C'est le garçon qui s'est rappelé que, le samedi 1er juillet, commence, en effet, un nouveau ser-vice de bateaux, et le nôtre partait dans dix minutes I
Nous arrivâmes, mais en quelle tenue ! Seul, l'abbé Jouin, correct dans son costume de Clergyman, avait pris le temps de se faire la barbe.
Affalés sur les banquettes du bateau, encore mal éveillés, nous étions là depuis cinq heures. A une station, où l'arrêt se prolongeait outre mesure, nous sortons, surpris de ne voir aucun voyageur sur le pont. Les mariniers embarquaient du charbon. Stupides, nous les regardions aller et venir quand, à cinquante mètres de nous, le sifflet d'une locomotive et le bruit d'un train qui s'arrête nous révélèrent la situation.
Nous étions depuis quinze minutes à la station terminus, et notre bateau allait repartir vers son point de départ. Aussi-tôt, comme de concert, sans prononcer un mot, nous filons à toute vitesse et arrivons tout juste pour prendre le train qui, en deux heures, nous amenait enfin à Christiania... Mais quelle idée ont dû se faire de nous ces mariniers qui nous virent partir, comme nous étions arrivés, au pas de course ? Peut-être s'imaginaient-ils que nous avions pris un billet d'aller et retour !
Dimanche 2 - Me Fabre nous fait visiter la ville et ses environs. Ils doivent être ravissants. Mais le sommeil appesantit nos paupières. Depuis le matin, l'abbé Jouin paraissait sous le coup d'une profonde humiliation. MM. Vivet et Warmbrodt, tombant de fatigue, n'avaient pu se faire entendre pendant la messe et, honteux, s'étaient dérobés aux regards de la foule accourue pour entendre «les grands artistes de Paris». Son erreur - ou sa faute - avait été de croire ses compa-gnons, à la hauteur de son énergie et de ses forces.
Le soir même, la course reprend de plus belle. Nous voyons Copenhague, son musée et son Parc Royal en une jour-née - Berlin, l'allée des Tilleuls et ses palais en quatre heures, après une nuit terrible, où nous avions dû changer trois fois de bateau, deux fois de train et subi trois douanes - Cologne, où nous passons deux heures - Aix-la-Chapelle où nous faisons une halte d'une heure - puis Amiens, où l'abbé Jouin voulait rendre visite à son ami Mgr Renou - Rouen, où il avait des amis à saluer - Sénarpont, résidence d'été d'Auguez, - enfin Paris, où nous arrivons le vendredi, vingt-quatre heures avant le terme fixé.
Plus heureux que Philéas Fog, c'est à notre seule vaillance, et non à une erreur de calcul, que nous devions cette avance considérable dans un voyage de 18 jours, durant lequel nous avions traversé la Belgique, la Hollande, le Dane-mark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, les Bords du Rhin et la Normandie, voyage incroyable où nous avions reposé neuf fois dans un lit, mangé de temps à autre, et qui nous laissa à tous pendant quinze jours, une sensation de vertige - voyage légendaire qui défraya pendant longtemps les conversations des amis de l'abbé Jouin.
Cinq ans plus tard, parlant de cette aventure aux fabriciens de Saint-Médard, il racontait la fameuse traversée dans la neige molle et des dangers qu'il y avait courus. «Ce qui nous frappa dans ce récit, disait l'un de ses auditeurs, le distin-gué Sous-Directeur de la Cie du P. L. M., c'est le souvenir qu'en avait gardé M. Jouin, et l'accent de conviction avec lequel il déclarait que l'obligation de sanctifier le dimanche par la messe est encore plus impérieuse pour le prêtre que pour les fidèles et qu'on y doit satisfaire au prix des plus grands efforts».
«Mais enfin, lui demandait-on parfois, qu'étiez-vous allé faire dans ces régions Scandinaves, et quel profit avez-vous retiré de cette course folle ?»
- «Un très grand, répondait-il. J'ai rapporté de Norvège deux airs délicieux pour ma Nativité : l'air du Départ des Ber-gers et celui de la Danse du couvre-feu».
L'esprit reposé, il se remit à l'œuvre avec des forces décuplées. Sous sa direction, on travaillait fébrilement. M. Vivet achevait l'orchestration de la musique et commençait les répétitions des chants. M. Enfert («le Saint Vincent de Paul de la Maison-Blanche») commandait les costumes d'après Racinet. Un peintre de l'Opéra, M. Karl, brossait les dix décors, que des machinistes du «Chatelet» installaient. Le Régisseur de la scène de l'Opéra, M. Pluque, et l'un de ses profes-seurs dressaient la danse du «Couvre feu» et celle des prêtres Saliens, sur un chœur de Bizet - les artistes répétaient les morceaux particulièrement difficiles : le trio de Saint-Saëns, le quatuor de la Messe en Ré et le chœur de la IXe sympho-nie.
Quant à lui, il s'était réservé le rôle difficile de mettre d'accord comme chef d'orchestre, les artistes chantant à l'avant-scène et les acteurs évoluant sur le théâtre.
La première représentation de la Nativité, bientôt suivie de sept autres, eut lieu en décembre 1893. L'«Univers», sous la signature du Marquis de Ségur en donna un compte-rendu, qui est une analyse parfaite de la pièce.
«Cette pastorale, ou ce mystère, comme on voudra l'appeler, est pour les yeux, l'esprit et le cœur, un des spec-tacles les plus touchants et les plus curieux, une des prédications les plus pénétrantes qu'on puisse imaginer...
«C'est une œuvre à la fois historique, théologique, poétique, musicale, théâtrale même par la recherche des cos-tumes, le nombre des exécutants, la beauté des décors .Elle unit à l'attrait d'une féerie l'intérêt supérieur d'un orato-rio, le charme chrétien d'un mystère et la nouveauté hardie d'une exécution partagée entre des artistes célèbres et des jeunes gens du peuple de Paris.
«Toute la partie scénique est livrée à l'inexpérience pleine de verve et de naïveté d'enfants, d'adolescents, de jeunes employés sortis des écoles laïques et appartenant au Patronage paroissial de Saint-Augustin. Quant à la par-tie artistique, elle est confiée à des chanteurs hors ligne comme MM. Auguez, Vergnet et Warmbrodt, à des canta-trices dignes d'eux, Mmes Auguez de Montalant, Boidin-Puisais, Mlle Moulor, à des musiciens choisis dans les pre-miers orchestres de Paris. L'orgue est tenu par M. Gigout ; le piano, par M. Vivet.
«Or, de toutes ces sciences et de ces inexpériences, de ces grandeurs et de ces humilités, de ce concours de maîtres de l'art et de novices, de cette fusion téméraire, qui semblerait devoir aboutir à une désastreuse confusion, sort une unité merveilleuse d'expression et d'impression, un ensemble harmonieux, oh le ciel et la terre se marient et s'épanouissent en une floraison originale et charmante, exhalant un parfum de fleurs et d'encens.
«La musique présente les mêmes caractères de contrastes et d'étrangetés. Les chanteurs placés à la gauche de la scène, les musiciens à droite, figurent un double promontoire qui s'avance de chaque côté sur la mer vivante et mobile de l'auditoire.
«Autre anomalie tout aussi nouvelle, tout aussi heureuse ; cette musique sans nom d'auteur, a été puisée à des sources diverses et est exécutée par des artistes plus divers encore. M. l'abbé Jouin l'a empruntée à de grands com-positeurs sans distinction de temps, ni de pays, depuis Bach et Beethoven, jusqu'à Berlioz, Franck, Saint-Saëns et Gounod. Et, par un contraste qui devrait choquer et qui charme, ces airs et ces chœurs magnifiques, chantés par les voix des plus grands artistes et joués par les instruments les plus harmonieux, sont entremêlés de cantiques popu-laires, Venez, divin Messie ; Gloria in excelsis Deo, chantés, comme au catéchisme, par les plus jeunes figurants ali-gnés ou répandus en groupes sur la scène.
«Le libretto reproduit la pensée maîtresse de l'ouvrage, cette pensée profondément philosophique et religieuse de la diversité dans l'unité. Des scènes en vers composés par l'auteur et le plus souvent accompagnés de musique, succèdent à des dialogues en prose sobrement écrits et fortement pensés...
«La première partie, intitulée «Bethléem», pleine de mouvement et de vérité, est enlevée vigoureusement, sans un moment de défaillance, y compris une danse de prêtres saliens, sorte de ronde guerrière, accompagnée de grands coups de glaives sur des boucliers que nos jeunes Parisiens exécutent avec une précision étonnante et une furie vertigineuse.
«La scène se passe sur la grande place de la ville. Le père de Judas, le futur traître, hôtelier du Veau d'or, discute avec les bergers des campagnes voisines, en présence de Cyrinus, l'envoyé de César, et de ses officiers récemment arrivés pour le recensement. La venue prochaine du Messie, objet de l'attente universelle, occupe tous les esprits et excite la verve impie du vieux juif. Il insulte d'avance à la royauté de ce Sauveur sans palais et sans garde, se raille de sa pauvreté volontaire et expose avec un cynisme insolent son programme, suivi par les fils d'Israël depuis la ruine de Jérusalem et leur dispersion dans le monde : Ne rien donner, tout vendre, tout prendre, avoir pour dieu le veau d'or, pour ennemi tout ce qui ne s'agenouille pas devant lui.
«A ce moment, apparaît un étranger, grave, simple et touchant dans sa dignité et sa modestie : c'est Joseph, le menuisier de Nazareth, qui n'a ni or, ni argent, et qui demande la charité d'un humble logement pour Marie, sa jeune femme, sur le point de mettre au monde l'Enfant-Dieu.
«Touchés de son aspect et de sa prière, les bergers l'entourent, le consolent, lui offrent leurs services... Mais Si-mon-Judas les écarte, se moque de ce mendiant qui vient troubler leurs fêtes, et soulève, contre lui la populace de Bethléem. Joseph se retire humblement, comme il est venu ; et pendant qu'il s'éloigne les officiers romains indignés, s'écrient : «Peuple vil, peuple flétri ! Si Dieu te sauve, ce ne sera que pour ces bergers et par eux !»
«Le mystère de la Nativité renferme une seconde scène aussi vraie et plus frappante encore que celle-là ; c'est une séance du Sanhédrin, le conseil suprême du peuple juif. Au point de vue doctrinal, littéraire et historique, c'est la page la plus importante de cette belle œuvre.
«Le vieillard Siméon, qui a vu les Mages, qui a tenu dans ses bras l'Enfant-Jésus, annonce à tous ces Pharisiens, ces Saducéens, ces Hérodiens assemblés, l'avènement du Messie. Ils le pressent de questions, d'arguties, de me-naces, et se réunissent presque tous dans une négation hautaine et sacrilège. Toutes les divisions de ces sectes en-nemies, qui devaient s'unir un jour pour condamner le Sauveur, sont admirablement indiquées et rendues.
«Un Messie qui serait pour le monde entier ? - Un Messie qui se serait révélé à des bergers, et pas à nous ? - Qui serait né dans une étable ? - Qui nous enlèverait le peuple ? - Un Messie qui trahirait notre cause ? - «C'est vous qui le trahirez, répond Siméon. - Nous le trahirons, s'il le faut ! s'écrie Caïphe, déjà membre du Sanhédrin. - Et si cet homme était le Fils de Dieu ? - Qu'importe I II faut qu'il soit Juif avant tout ! - Eh quoi ! vous mettriez à mort le Fils de Dieu lui-même ? - Ton Messie, fût-il Dieu, reprend Caïphe, si c'est le Messie de la pauvreté, si c'est un roi sans ar-mées, si c'est le sauveur du genre humain, nous choisirons une montagne, et nous l’élèverons sur une croix, pour qu'il voie au loin le royaume universel qu'il aura rêvé. - Et si son sang criait vengeance et retombait sur vos têtes ? - Nous avons les promesses éternelles !»
«A ce dernier mot, Siméon se redresse et leur jette à tous cette foudroyante apostrophe : «Oui, vous vivrez, mais vous ne serez plus comme aujourd'hui, un peuple de désir, d'espérance, de rayonnement et d'avenir, parce que vos aspirations sont terrestres, vénales et égoïstes. Vous attendrez vainement un Messie qui est déjà venu, et j'entrevois, dans un temps prochain, deux peuples qui rempliront l'univers jusqu'à la consommation des siècles, le peuple du Messie de Bethléem, peuple catholique, peuple conquérant devenu le peuple de Dieu, et le peuple juif, peuple errant, sans unité, sans patrie, avide d'or et de jouissance comme vous, Saducéens ; ambitieux du pouvoir comme vous, Pharisiens, et portant dans la suite des âges la marque indélébile d'une écrasante malédiction. O Dieu ! qui m'avez donné de porter dans mes mains le Sauveur du monde, épargnez à ma vieillesse d'être le témoin attristé de l'aveu-glement et des crimes de Votre peuple. Ma tâche est finie, nul ici ne m'écoute ; prenez l'âme de Votre serviteur et qu'elle repose dans Votre paix éternelle !»
«Pour ne pas multiplier, en me répétant et en fatiguant le lecteur, les formules de mon émotion et de mon enthou-siasme, je laisse de côté les scènes charmantes où les bergers devisent entre eux du Messie attendu, leurs gracieux cantiques, la prière que la voix délicieuse de Warmbrodt exhale comme un pur encens, puis l'apparition des Anges, le chant céleste du Gloria in excelsis Deo, et la joie de ces âmes simples en apprenant la bonne nouvelle de la nais-sance du Sauveur.
«J'ai hâte d'arriver au point culminant du Mystère, à la scène ineffable de l'adoration des bergers, dont l'adoration des Mages n'est guère que la reproduction magnifique, à cette apparition de la Sainte Famille dans l'étable de Be-thléem, qui offre enfin à nos regards et à notre foi ce qu'il y a de plus grand dans ce monde, la Trinité humaine de Jé-sus, Marie et Joseph.
«Aux premiers accords du sublime Benedictus de Beethoven, chanté en quatuor par le chœur et l'orchestre, un ri-deau qui voilait l'arrière-scène se lève et présente aux yeux ravis des spectateurs un tableau digne du pur regard des anges.
«Sous un appentis adossé à la grotte et dont la large ouverture laisse voir le ciel étoile, la nuit lumineuse de Noël, l'Enfant-Jésus repose dans sa crèche, entre la Vierge Marie, qui l'adore à genoux, et saint Joseph debout qui le con-temple dans une muette extase.
«Ce petit enfant, beau comme un ange, semble dormir d'un profond sommeil, aussi immobile dans son misérable berceau que Marie et Joseph dans leur adoration. Cette immobilité de la Sainte Famille se prolonge jusqu'à la fin de la scène, et donne l'illusion de l'extase éternelle des Bienheureux. C'est vraiment une vision du Paradis.
«Le rôle redoutable de la Vierge Marie est rempli par un adolescent de treize ou quatorze ans, choisi parmi les plus purs de visage et de cœur, et qui, par ses traits, la candeur de sa physionomie, la noble simplicité de son atti-tude, personnifie merveilleusement la plus divine des créatures. Chastement enveloppée d'une robe et d'un voile éclatants de blancheur, penchée sur son fils nouveau-né, Marie respire l'humilité, la douceur, l'intensité du saint amour et de l'adoration. Raphaël n'a pas fait une Sainte-Famille plus idéalement belle. Ce tableau seul suffirait à l'admiration d'une soirée tout entière.
«L'adoration des bergers se déroule dans un ordre pieux, dans une harmonie parfaite. Accompagnés des chants délicieux du chœur, ils semblent des premiers communiants venant tour à tour s'agenouiller devant la sainte Table.
«L'Enfant-Jésus demeure jusqu'à la fin dans son sommeil mystique. Mais, au moment où le dernier venu, un petit pâtre de sept ou huit ans, se prosterne devant lui, le Dieu nouveau-né ouvre les yeux, se soulève et, passant ses bras autour du cou de son petit frère, l'embrasse longuement. Rien ne peut donner une idée de l'émotion que soulève cette adorable simplicité. C'est un trait de génie que ce réveil et ce baiser de Jésus.
«L'émotion redouble quand le Fils de Dieu, se redressant, approche Son visage du visage de Marie et pose Ses lèvres, les lèvres du Verbe Éternel, sur la joue virginale de Sa Mère. Dans cette attitude pleine de grâce, Il forme avec elle un tableau divin qui rappelle celui de la Madone du Grand Duc par Raphaël, et qui même le surpasse.
«La toile se baisse comme à regret sur cette scène ineffable, plus éloquente dans son silence que les créations les plus admirées des plus grands génies.
«Que dire après cela de l'adoration des Mages ? Moins touchante que celle des bergers, elle est plus imposante par l'attitude de l’Enfant-Jésus, qui reçoit leurs hommages et leurs présents, debout sur les genoux de la Vierge Ma-rie et les bras étendus comme pour bénir. On ne sait où ce petit enfant a pris cette majesté, et le fils n'est pas moins étonnant que la mère. On dirait que, dans ces scènes plus célestes que terrestres, ces enfants de Paris sont dans leur élément et qu'ils se meuvent dans cette atmosphère surnaturelle, comme dans l'air vicié que leurs lèvres et leur âmes sont condamnées à respirer chaque jour. Il y a pourtant loin de l'école laïque à Bethléem. Mais l'intervention de l'Église a comblé cet abîme, et les enfants de l'athéisme officiel sont redevenus les enfants de Dieu.
«Dans cette troisième partie du mystère, une mélopée admirable, tirée de l'oratorio de notre cher et grand Gou-nod, Rédemption, a soulevé l'enthousiasme de toute l'assistance.
«Enfin, dans un épilogue où le tableau de Merson représentant la Fuite en Egypte est reproduit avec une saisis-sante beauté, le sommeil de l'Enfant-Jésus sur les genoux de Sa mère endormie, à l'ombre d'un sphinx gigantesque mutilé, est accompagné d'un chant merveilleux tiré de l’Enfance du Christ de Berlioz.
«C'est sur cette scène de paix et de grandeur, suivie d'une éclatante apothéose, que finit la représentation et que la foule se retire émue, charmée et toute pénétrée d'impressions religieuses et mystiques.
«M. l'abbé Jouin a fait une grande et sainte œuvre, et nous nous permettons de lui en adresser, en finissant, nos respectueuses et reconnaissantes félicitations. Mais nous osons dire que son Patronage de jeunes gens est une œuvre plus belle et plus sainte encore que sa Nativité».
L'abbé Jouin reçut des félicitations de source plus humble mais aussi non moins touchantes. Un curé de la Mayenne lui écrivait l'année suivante :
«Oh ! c'est une belle œuvre que vous avez faite au point de vue de l'art, il n'y a qu'une voix pour le dire ; mais ce qui me frappe surtout, c'est que cet art captive même les illettrés. Notre assistance à Evron était certes des plus mé-langées. Eh bien ! elle a suivi avec un intérêt marqué la scène elle-même du Sanhédrin et l'interrogatoire d'Hérode. Par ailleurs, nos ressources, sous le rapport du chant et des acteurs, étaient bien misérables en comparaison des vôtres ; et malgré cela, notre monde est complètement enthousiasmé».
Il y avait alors à Paris un musicien viennois de talent et qui allait bientôt se faire, comme compositeur symphonique, une renommée mondiale. Juif d'origine et de religion, il fut amené par l'une des solistes à la troisième représentation de la Nativité. Il entendit sans broncher la tirade contre le peuple juif. Mais dès la première phrase chantée par les onze petits choristes vêtus du peplum grec, sur un récitatif de l'abbé Jouin : Nous vous annonçons le Mystère de la Nativité, il s'était senti remué et, tout en redisant : «Peuple sans unité, sans patrie»..., dans la nuit qui suivit, il composait un Noël de gra-cieuse inspiration, se terminant par un acte de foi.
Il l'apporta comme un hommage à l'abbé Jouin et fut bientôt admis dans le cercle des artistes qui fréquentaient l'ave-nue Portalis, et sur lesquels il exerçait déjà une si bienfaisante influence.
Il est hors de doute que les huit représentations du Mystère de la Nativité furent le point de départ d'un mouvement re-ligieux très profond dans ce monde de chanteurs et d'artistes - les plus réputés de Paris en cette fin de siècle. On ne sau-rait douter que c'est à la bénédiction de cet Enfant-Jésus, si bien représenté par un enfant de trois ans, qu'il faut attribuer tant de conversions qui viendront bientôt réjouir l'âme de l'abbé Jouin.
Disons dès maintenant, que le jeune adolescent, dont le Marquis de Ségur avait remarqué la pureté de visage et de cœur et qui, «par ses traits, la candeur de sa physionomie personnifiait merveilleusement la plus divine des créatures», s'envolait de cette terre à l'aube de sa vingtième année dans des sentiments d'une piété si achevée qu'on peut croire que c'est la Vierge elle-même qui descendit cueillir son âme avant que le mal n'en eût terni la fraîcheur.
«La Nativité» fut bientôt représentée avec un égal succès sur un grand nombre de scènes d'œuvres, à Paris, en pro-vince et jusqu'en Amérique.
La Semaine Religieuse de Paris lui avait consacré un article élogieux, et le Directeur du Grand-Séminaire demanda à l'auteur d'en donner une représentation à Saint-Sulpice. L'impossibilité de supprimer les voix de femmes pour la partie musicale arrêta ce projet.
L'abbé Jouin avait fait, en fondant son patronage, «une œuvre encore plus belle que celle de sa Nativité». Ce juge-ment du Marquis de Ségur, le cardinal Richard semble avoir voulu le ratifier lorsque, au milieu de l'été 1894, il proposa au 1er Vicaire de Saint-Augustin la cure de Saint-Médard, devenue vacante par l'élévation de M. l'abbé Latty à l'évêché de Châlons ; et le Gouvernement s'honora en signant, sans mauvaise grâce, cette nomination de l'ancien curé de Joinville à cette cure de seconde classe.
(à suivre...)
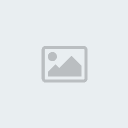
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 5)
CHAPITRE V LE CURÉ DE SAINT-MÉDARD. (1894-1898)
LE QUARTIER MOUFFETARD ET LA PAROISSE SAINT-MEDARD. LA REORGANISATION DES CATECHISMES ET LA FONDATION D'UN PATRONAGE POUR LES GARÇONS. - UNE BELLE CONQUETE DE L'ABBE JOUIN : L'ABBE BOSSARD. - LA REPRISE DES REPRESENTATIONS DE LA NATIVITE A CHAILLOT ET A L'ALCAZAR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CHANOINE HONORAIRE D'ANGERS. - FONDATION D'UN CATECHISME POUR LES PETITS ET DE LA DOCTRINE CHRETIENNE. - LE CULTE DIVIN A SAINT-MEDARD. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES ; NOMBREUSES CONVERSIONS. - LE REGISSEUR DE LA SCENE DE L'OPERA FAIT SA PREMIERE COMMUNION A 72 ANS. - L'ORATORIO DE N.-D. DE LOURDES. - L'ABBE JOUIN FONDE UNE SECONDE MAISON DE SER-VANTES DES PAUVRES. - ON L'APPELLE LUI-MEME LE PERE DES PAUVRES. - SON DEVOUEMENT ET SA CHARITE POUR LES MALADES. - DEUX EVEQUES VEULENT FAIRE ELEVER L'ABBE JOUIN A L'EPISCOPAT. - IL EST NOMME CURE DE SAINT-AUGUSTIN. - IL QUITTE SAINT-MEDARD EN BEAUTE.
Quelques jours avant son installation, l'abbé Jouin, «son abbé» et un autre prêtre - l'abbé Bossard - arrivaient, par l'omnibus légendaire Panthéon-Courcelles, à la Place de la Contrescarpe, à la lisière de la paroisse de Saint-Médard. Le premier Vicaire, l'abbé Souques, les attendait. Ensemble, ils descendirent la rue Mouffetard : Mons cetardus, expliqua l'abbé Bossard, qui avait étudié son «Vieux-Paris». C'est par ce chemin que, du Palais de Julien, au temps de Clovis et de Geneviève, les habitants de Lutèce, à travers des enclos plantés de vignes, gagnaient les bords de la Bièvre et la campagne parisienne.
- Hélas, soupira l'abbé Jouin, à la place de ces vignes disparues quel amas de maisons sordides I...
- Voici la rue Saint-Médard, reprit l'abbé Souques. Ici commence votre domaine.
- Je la connais, dit l'abbé Jouin. Quand j'étais vicaire à Saint-Étienne du Mont, plus d'une fois pour des malades je fus appelé dans ces taudis, «La Reine des Chiffonniers» y réside-t-elle toujours ?
- Je le crois. Ses sujets sont nombreux. Mais vous ne les verrez pas souvent à l'église, pas plus, d'ailleurs, que ces boutiquiers et ces acheteurs qui encombrent la rue et gênent notre marche. Le commerce est toute la religion de ces gens…
- «Voici, à gauche, la rue Gracieuse ; à droite, celle du Pot de Fer, le passage des Patriarches, et tout près, dans la rue de l’Épée de Bois, la maison, qui fut, jadis, la résidence de là fameuse Sœur Rosalie ; c'est aujourd'hui, le siège de l'Œuvre italienne, dont l'aumônier est un jeune secrétaire de la Nonciature, l'abbé Granito di Belmonte.
- Sœur Rosalie ! murmura l'abbé Jouin, il m'en faudrait une de cette taille. Et sa pensée se tourna vers Mère Agnès et les petites Servantes des Pauvres.
Au coin de la rue de l'Arbalète, nous croisons, un groupe d'écoliers, tout surpris à la vue de tant de «curés».
- Leurs regards ne sont pas mauvais, dit l'abbé Bossard ; mais aucun ne nous a salués. Ils doivent ignorer le prêtre.
- Nous le leur ferons aimer, affirma le nouveau Pasteur. Du reste, pour suppléer à l'école libre de garçons qui manque ici, il faudra créer un patronage, comme à Saint-Augustin.
- Un patronage ! Je redoute pour vous un échec. Tous Ces Messieurs vous le diront : les trois écoles officielles nous envoient de cent, à cent dix enfants pour la Première Communion, et, l'année d'après, il s'en présente cinq à six pour le renouvellement solennel, et encore on ne saurait affirmer qu'ils aient assisté à la messe du dimanche...
- Et les filles ?
- Multipliez par trois, dit l'abbé Souques, qui était chargé de leur instruction religieuse. L'opinion des vicaires qui con-naissent le quartier, est qu'il n'y a rien à faire.
- Ou plutôt tout est à créer, rectifia l'abbé Jouin. Et ce disant, il regardait l'abbé Bossard. Celui-ci comprit son appel muet.
- Demandez, comme vicaire, l'abbé Sauvêtre, dit-il. A nous deux, et avec Bouloff (Bouloff était le caniche de l'abbé Bossard) nous ouvrirons, dans un an, le patronage. En attendant, je viendrai vous aider pour les catéchismes.
- Merci, dit le Curé, car il faudra les multiplier, comme à Saint-Augustin et comme à Joinville.
Le premier Vicaire eut un geste de scepticisme.
- Etes-vous sûr du consentement des parents ? question-na-t-il.
- Il le faudra bien, affirma le Curé.
Nous étions arrivés au bas de la rue Mouffetard, sur les bords de la Bièvre. La petite rivière de ce nom, avant de se je-ter dans la Seine, traverse en effet la paroisse dans toute sa longueur et confond ses eaux boueuses avec celles du fleuve au Pont d'Austerlitz, toujours sur le territoire de Saint-Médard. L'abbé Souques nous expliqua que la Bièvre, recou-verte, coulait à quelques pas de nous, mais qu'un peu plus haut, dans la rue des Gobelins, ou plus bas, rue Censier, elle était visible. Les tanneurs l'utilisent pour leurs cuirs ; aussi ses parfums ne sont-ils pas ceux du Parc Monceau.
Peu importait ! Nous étions entrés dans l'église, gracieux monument de la Renaissance, mais mal entretenue, pauvre comme le quartier qui l'entoure, enterrée au Sud par le square voisin, et, au Nord, à moitié aveuglée par les marchan-dises de toutes sortes : bois, charbons et matériaux divers que les commerçants, propriétaires des terrains adjacents, en-tassent jusqu'à boucher les fenêtres. La sacristie est humide et en contrebas d'un mètre du square voisin. Le presbytère, attenant à l'église, ne voit jamais le soleil. Au chevet de l'église, deux couloirs de 2 m 50 sur 17, servent de chapelle pour les catéchismes. Entre les deux, une courette, dernier vestige du fameux cimetière Saint-Médard. C'est là qu'au XVIIIe siècle, les convulsionnaires jansénistes se livraient à leurs manifestations grotesques avant l’interdiction du Parlement et qu'on pouvait lire l'ironique inscription d'un plaisant : DE PAR LE ROI, DEFENSE A DIEU DE FAIRE MIRACLE EN CE LIEU !
En traversant, au retour, le Jardin des Plantes, le Curé songeur, récapitulait : «Une chapelle des Catéchismes, une salle d'Œuvres, l'agrandissement de la sacristie, le parquetage de la chapelle de la Sainte Vierge dont le dallage, complè-tement usé, lui semblait bien froid pour les pieds des vieilles gens... tout cela coûtera bien cent mille francs, auxquels viendront s'ajouter les frais annuels d'une maison de Servantes des Pauvres, et, sur le champ, dans son esprit, il rédi-geait la circulaire qu'il adresserait à ses futurs paroissiens.
Aussitôt après l'installation, présidée par M. L'Archidiacre Bureau, le jeune Curé entreprit la réorganisation des caté-chismes pour les enfants des écoles laïques. Les pronostics sur l'opposition des parents ne se réalisèrent pas. Après une tentative de résistance esquissée par quelques-uns, - le Curé leur donnait d'ailleurs toute permission d'envoyer leurs en-fants aux catéchismes de la paroisse voisine - tous finirent par accepter les deux réunions hebdomadaires pour la pre-mière année et les trois séances pour la seconde.
Bientôt les familles se montrèrent satisfaites de l'intérêt porté à leurs enfants. L'un d'eux venait-il à manquer, soit au catéchisme, soit à la messe, aussitôt, la dame catéchiste se présentait chez les parents pour s'informer du motif de l'ab-sence. Les récompenses trimestrielles, le dévouement des dames, et surtout le zèle du Pasteur et de son collaborateur, l'abbé Bossard, achevèrent de gagner le cœur de cette centaine de petits laïques dont on avait dit tant de mal.
Bien plus, dès la fin de la seconde année, trois d'entre eux entraient au Petit Séminaire. L'un devint plus tard vicaire de l'abbé Jouin à Saint-Augustin ; le second est un de nos vaillants missionnaires diocésains et curé de Paris ; le troi-sième, Anatole Béry, esprit philosophique supérieur, mourut quelques années après son ordination.
Au bout d'un an, le Curé de Saint-Médard put obtenir «son abbé» pour second vicaire. D'autre part, l'abbé Bossard, laissant définitivement la maison de préparation aux examens, qu'il avait fondée dans la Plaine Monceau, venait habiter Saint-Médard pour se consacrer entièrement aux œuvres de l'abbé Jouin. Cette conquête - une des plus belles et des plus fécondes du Curé de Saint-Médard - l'abbé Jouin la racontait en ces termes, au lendemain de la mort de son ami : «Docteur ès-lettres, professeur remarquable, écrivain mordant, il avait été surtout, un homme de caractère et un homme de foi vendéenne. Mais renseignement de l'histoire, même de celle de la Vendée, sur laquelle il a laissé de nombreux écrits, pouvait-il satisfaire aux exigences de sa vocation ?»
«C'est la question qu'il se posa le jour où il quitta sa maison d'éducation à Paris. Et comme il n'osait la résoudre, se sentant juge et partie, il me fit l'honneur de me consulter par une lettre de douze pages. (Que n'ai-je cette lettre ? Mais comment aurais-je pu pressentir qu'il me devancerait dans la tombe ?) Toute sa vie, toute son âme était là. Si large et si édifiante que fût la tâche historique qu'il s'était tracée, il craignait de faillir à sa mission sacerdotale. Il m'exposait ses scrupules, et je puis dire qu'il inclinait de lui-même vers la vraie solution : ce fut de venir, quatre ans, faire avec moi, non plus de l'éducation littéraire, mais un simple catéchisme et de l'éducation morale près des enfants des Écoles communales et des patronages dans la paroisse Saint-Médard. Et bien ! je ne crains pas d'être démenti en affirmant que, ce jour-là, il avait trouve sa voie. Mis en contact direct avec les âmes jeunes et neuves, il lui était donné de semer enfin, lui aussi, le froment catholique, de creuser son sillon avec méthode, d'éveiller du même coup la science et l'amour du Christ son Maître, de fouiller parfois jusqu'au cœur pour y détruire les premiers germes d’ivraie, et de communiquer avec une intensité si ardente sa vieille foi vendéenne, que ses catéchisés entendent en-core le son de sa parole, vibrante d'enthousiasme et de conviction. C'est tellement vrai que l'un d'eux, mourant, quelques années plus tard, l'appelait de son nom comme pour l'aider dans le suprême combat de l'agonie, et l'abbé Bossard écrivait : Que ne l'ai-je su à temps ? mais j'aurais fait cent lieues pour le bénir, l'embrasser et lui ouvrir le ciel»
Au mois de juin 1896, le dimanche après la première Communion, on voyait un groupe d'enfants se diriger en bon ordre vers la Seine. Deux abbés les conduisaient s'entretenant paternellement avec eux. Mais ce qui piquait surtout la cu-riosité des passants amusés, c'était la présence et les aboiements joyeux d'un joli caniche, courant de la queue à la tête et de la tête à la queue de la colonne, stimulant les traînards, et prenant au sérieux son rôle de chien de berger .
- Quels sont ces enfants, se demandait-on intrigué ?
- C'est, répondit l'un d'eux, le Patronage Saint-Maurice de Saint-Médard qui fait sa première sortie. Nous allons pren-dre le bateau pour le Bois de Vincennes».
Même après que le successeur de l'abbé Jouin, eût abrité l'Œuvre dans le local de la rue Censier, les promenades continuèrent chaque dimanche, - à pied, en hiver -, en bateau ou en chemin de fer, dans le reste de l'année. Dans ces courses à travers les Bois de Vincennes, de Meudon et de Chaville, les enfants s'entraînaient pour les futures ascensions du Parmelan, de la Tournette, voire du Mont-Blanc. Car l'abbé Jouin voulut que le nom du géant de la Savoie fût gravé sur l’alpenstock de son patronage et que la gloire de cette ascension fût acquise à l'Œuvre qu'il n'avait pas cessé de pro-téger. C'était en 1906. Les aînés du Patronage se trouvaient en colonie de vacances à Thônes en pleine Haute-Savoie. L'abbé Jouin, sous le coup d'une crise néphrétique très douloureuse, était venu les rejoindre. Et, pour le distraire, ces jeunes gens avaient organisé, dans le jardin de la maison amie dont il recevait l'hospitalité, une séance récréative à la-quelle il avait assisté du balcon de sa chambre. Le soir, il dit tout à coup à «son abbé» :
- Il faut conduire les jeunes gens au Mont-Blanc. Celui-ci le regardait étonné.
- Oui, reprit-il, j'ai étudié l'ascension. Par les Houches, le placier de Bionassay et l'Aiguille du Goûter, elle n'offre pas de difficultés. Vous prendrez de bons guides, et j'assume tous les frais.
- Mais, c'est impossible, répliqua l'abbé ! Je n'ai jamais fait de courses de glaciers. Je ne suis pas alpiniste. Ces jeunes gens encore moins et quelques-uns sont arrivés d'hier pour une semaine seulement. Ils ne sont pas équipés pour une ascension de cette importance. - Il avait réponse à tout.
- Sauf les chutes de pierres à l’Aiguille du Goûter - et encore, le matin, elles sont plus rares - il n'y a pas de danger.
De guerre lasse, l'abbé court chez le docteur du pays pour se faire délivrer une défense en règle. Le Docteur semblait ne pas l'entendre : «Alors, fit-il, vous allez au Mont- Blanc ? Je suis des vôtres : voici dix ans que je rêve de cette ascen-sion !
- Mais non, je ne vais pas au Mont-Blanc, et je viens, au contraire, vous demander de me l'interdire. Ces jeunes gens...
- Je les examinerai, j'écarterai les faibles. Et puis, ils sont entrâmes au sport, ils sont disciplinés. Dans ces conditions, avec des guides expérimentés, l'ascension du Mont-Blanc n'offre pas de danger et ne réclame que de l'endurance.
Et voilà comment, quelques jours plus tard, une caravane composée de cinq jeunes parisiens, du Dr M., de deux ab-bés, dont l'un était un vicaire de l'Abbé Jouin et son futur successeur, de quatre porteurs et de deux guides, gravissait vers midi l'arête des Rognes, visitait le glacier de Bionassay, couchait à Tête-Rousse (3000 m.), escaladait le lendemain l’Aiguille du Goûter (4000 m.) parvenait enfin à la Cabane Vallot (4362 m.) d'où les guides, inquiets du mauvais temps, l'arrachait aussitôt, et, par les Grands-Mulets, la ramenait saine et sauve, le soir du second jour. Tous avaient franchi al-lègrement séracs et crevasses et rentraient le soir à Chamonix. Complimentés pour leur endurance par les touristes qui, d'en bas, lorgnettes en main, avaient suivi les péripéties de leur descente sur les échelles, les jeunes alpinistes s'atten-daient à recevoir de M. le Curé de Saint-Augustin des compliments non moins chaleureux : «Oui, leur dit-il, ce n'est pas mal. Mais vous n'êtes pas allés jusqu'au sommet. Vous vous êtes arrêtés à 4362 mètres ! C'est regrettable». Et dans ce regret perçait presque un reproche.
Nul doute que, sans son indisposition, malgré ses 63 ans, il ne se fût joint à la caravane. Il avait la passion de la mon-tagne et ignorait le vertige. On le vit bien l'année suivante, quand avec les mêmes jeunes gens, l'abbé Raymond et «son abbé», il fit l'ascension de la Pointe percée, haut sommet de la chaîne des Aravis (3200 m.), et qu'il voulut franchir, de-bout, l'arête finale, dominant à gauche et à droite un précipice de mille mètres, arête que la plupart ne passent qu'en se mettant à cheval : prouesse que ses compagnons, moins entraînés ou plus timides taxèrent de témérité. Lui, se croyait simplement audacieux et ne prétendait que donner à ces jeunes gens un exemple de sang-froid et d'intrépidité.
* * *
Les dix représentations du Mystère de la Nativité avaient eu trop de retentissement à Paris et en province pour qu'on ne pressât pas l'abbé Jouin de les reprendre sur une scène plus spacieuse. Les Parisiens eurent donc la satisfaction d'applaudir ce spectacle sur le théâtre paroissial de Saint-Pierre de Chaillot d'abord et, l'année suivante, sur la scène dé-saffectée de l'Alcazar, rue du faubourg Poissonnière. «Ce fut, dit le chroniqueur de la Semaine Religieuse de Paris, un régal des yeux, des oreilles, de l'esprit et du cœur». Une foule avide de beauté et de sensations mystiques se pressait à ce spectacle nouveau dans sa grandeur et sa simplicité. La plupart des Curés de Paris, les directeurs du Grand Sémi-naire de Saint-Sulpice, des religieux et des religieuses, le nonce du Vatican à Paris, Mgr Clari, vinrent tour à tour assister à la Pastorale de la Nativité.
L'Évêque d'Angers, Mgr Mathieu, avait présidé la séance du 23 février 1895, à Chaillot. A l'entr’acte, provoqué par un mot spirituel et gracieux de l'abbé Jouin, l'Évêque, au cours d'une improvisation charmante où il disait sa joie et sa fierté d'Angevin, déclara qu'en témoignage de son estime affectueuse pour l'auteur, il voulait, puisque l'occasion lui en était of-ferte, accomplir en pleine séance ce qu'il avait résolu de faire en quittant Angers et dont il avait parlée la veille, à S.E. le Cardinal de Paris. Il le fera, ajoutait-il, il en était sûr, aux applaudissements de tous les spectateurs auxquels répondront les bravos de tout l'Anjou : il nommait donc le Curé de Saint-Médard, Chanoine honoraire de la Cathédrale d'Angers.
«A ce moment même, au milieu d'un tonnerre d'applaudissements prolongés, disait le chroniqueur de la Semaine Religieuse d'Angers, un enfant du Patronage Saint-Médard, un de ces jeunes enfants qu'on dit si sceptiques, s'ap-procha vivement d'une dame et lui demanda d'une voix un peu troublée : «Mais M. le Curé ne quittera pas Saint-Médard, n'est-ce pas ? - Mais non, mais non. - Oh ! alors tant mieux, c'est de l'avancement sur place. - Je ne sais, ajoutait l'abbé Bossard, mais il me semble que, même après la grande joie d'être chanoine de l'insigne église cathé-drale d'Angers, j'aurais aussi quelque joie d'avoir provoqué la demande et la boutade».
* * *
Loin d'absorber son activité, ces représentations n'étaient pour l'abbé Jouin qu'un stimulant à de nouveaux travaux.
Sur une petite feuille trouvée dans un vieux bréviaire après sa mort, nous lisons sous le titre : Retraite de 1894, ce ré-sumé de la tâche que le Curé s'était imposée à Saint-Médard :
1° - Pour moi : Veiller à mon oraison.
2° - Pour les autres :
I. Veiller à ce que l’on confesse, c'est la vie paroissiale.
II. Veiller au service des malades. Leur éternité : est proche.
III. Organiser les catéchismes.
IV. Veiller au culte divin.
Un de ses premiers soucis, après l'organisation des catéchismes, fut en effet de ramener à Saint-Médard ceux, des paroissiens que le voisinage de la rue Mouffetard semblait écarter. Ce but, il l'atteignit en donnant aux cérémonies reli-gieuses un éclat inaccoutumé. Comme à Joinville, et mieux encore, il faisait venir d'Angers fleurs et plantes vertes à pro-fusion, les disposait lui-même sur les gradins qui s'élevaient jusqu'à couvrir l'espace réservé à la maîtrise derrière le maître-autel, commandait deux grands lampadaires à l'entrée du chœur : fleurs et lumières mariées avec goût, formaient un ensemble des plus harmonieux.
Sa maîtrise était des plus modestes : un organiste, deux chantres, trois ou quatre enfants mal formés. Aux jours de fêtes, l'abbé Jouin la renforçait par des concours étrangers si nombreux, que pour contenir tous ces chanteurs, il fallait écarter les grilles du chœur et, pour les diriger, faire appel à un musicien éprouvé, M. Louis Pister. Aux grandes solenni-tés, à Pâques, à Noël, à la Toussaint, le jour de la Première Communion, à la Fête-Dieu, il convoquait ses artistes de la Nativité. C'est ainsi qu'on entendit à Saint-Médard les plus beaux chefs d'œuvres de la musique sacrée : des messes de Mozart, de Beethoven, de Schubert et jusqu'au Magnificat de Bach, que le Curé, une partition à la main, suivait dans sa stalle : on pouvait lire sur ses traits sa joie de voir son Maître ainsi glorifié par le génie et la voix de l'homme.
Le maître de chapelle de Saint-Augustin se plaignait bien et s'étonnait qu'on lui enlevât, notamment à la Messe de Mi-nuit, celui qu'on ne se lassait pas d'entendre, le premier des chanteurs d'église à cette époque, M. Auguez. Il ignorait la force du lien qui unissait désormais, et pour la vie, le chanteur au prêtre qui l'avait sauvé de la ruine. Spectacle touchant, un jour de Toussaint, après les longs offices de cette fête, le grand artiste resta encore pour chanter, de sa voix magis-trale, devant le Curé et quelques rares fidèles, l’Invitatoire des matines des morts.
Tous ces artistes s'empressaient de répondre à ses moindres appels et lui donnaient de leur attachement de tou-chants témoignages. Plusieurs d'entre eux étaient venus, trois soirs de suite, prêter leur concours à des conférences po-pulaires que M. le Curé prêchait pour les hommes. Celui-ci ne prenait son dîner qu'après la cérémonie. L'on vit alors ce spectacle original d'un Curé de Paris soupant, seul, pendant que des musiciens de talent lui faisaient entendre des trios de Mozart.
Une ou deux fois l'an, il recevait à sa table : chanteurs, instrumentistes, organistes du Grand et du Petit orgue. Dans ces réunions, après le repas - toujours choisi - les conversations s'engageaient entre abbés et musiciens, des jeux fami-liers s'organisaient, des liens se créaient.
Derrière le musicien et le poète, les artistes découvraient l'homme, admiraient la vivacité de son intelligence, subis-saient l'ascendant de sa volonté, et se laissaient gagner par la bonté d'un cœur sensible à tous les besoins. A leur insu, ils étaient conquis par l'action du prêtre et l'heure allait venir où plusieurs d'entre eux, de la passion de l'art et du beau, s'élèveraient à la connaissance et au culte du véritable Artiste et de la suprême Beauté. Le premier à revenir au Dieu en-trevu dans son enfance fut M. Pluque, A douze ans, déjà petit danseur à l'Opéra, on l'avait, pour son inexactitude, ren-voyé du catéchisme de Saint-Roch. Longtemps il en eut du regret. Au contact de l'abbé Jouin, à l'occasion de la Nativité, ce regret se changeait en désir. En 1897, gravement malade, le Régisseur de la scène de l'Opéra appelait l'abbé Jouin, apprenait de lui son catéchisme, se confessait comme un petit enfant et, à l'âge de 72 ans, communiait enfin pour la première fois. «Jamais, disait-il, en pleurant, je n'ai connu pareil bonheur !» Son entourage pleurait comme lui.
Vers la même époque, le professeur et danseur Wazquez accourait au presbytère de Saint-Médard, réclamant l'abbé Jouin pour sa belle-sœur qui se mourait à l'autre bout de Paris. En l'absence du Curé, «son abbé» s'offrit et, après quelques visites, préparait cette âme de bonne volonté à paraître devant Dieu.
L'action du Curé de Saint-Médard s'exerçait non moins heureuse sur un jeune compositeur viennois, M. Mandl, dont nous avons déjà parlé à l'occasion de «la Nativité». A sa demande l'abbé Jouin avait composé une poésie sur ce thème : Un père pleure sur la mort de son enfant, et le musicien était ravi de son poète. Voici le début de cette pièce gracieuse :
En un berceau tout rose,
Là-bas, dans le ciel bleu,
Mon doux enfant repose
Sous le regard de Dieu.
Mais l’ange qui te verse
La coupe aux rêves d'or
Et par ses chants te berce,
Comme moi ne t'aime pas encor.
En ce jour que j'appelle,
Que je voudrais demain,
Dans la paix éternelle,
Mon doux enfant, dors bien !
En cette même année 1897, le Curé de Saint-Médard achevait, à la gloire de la Vierge les paroles d'un poème de 420 vers : Notre-Dame de Lourdes, oratorio en trois parties : le Divin Conseil - l'Élue - L'Apparition. Il eut la pensée d'en con-fier la musique à Richard Mandl qui ne cachait pas son attrait pour la beauté du culte catholique. II l'emmena à la Grotte au moment d'un grand pèlerinage, et l'artiste se mit au travail. Déjà il avait mis en musique ces paroles par lesquelles, dans l'Oratorio, les Anges saluent Bernadette :
Quelle est l'âme
Dont la flamme
A le parfum de l'encensoir ;
Si limpide,
Si candide
Que la Vierge descend la voir ?
Trois fillettes sont là, glanant un peu de bois.
- Mais une seule est en prière,
- Combien douce est sa voix I
- Que son âme est légère !
- Combien pur est son cœur !
- Naïve sa pensée !
- Anges, c'est notre sœur.
Mais l'artiste viennois n'avançait pas assez vite au gré de l'auteur. Au bout d'un an, il lui redemanda son livret pour le donner à un autre compositeur, M. Alexandre Georges, déjà connu par les Chansons de Miarka et son opéra de Char-lotte Corday. Le compositeur nous a raconté comment, en l'emmenant à Lourdes, l'abbé Jouin, qui regrettait de ne pou-voir harmoniser lui-même les morceaux qu'il composait, s'enquit aussitôt des règles de l'harmonie, des moyens de l'ap-prendre et, séance tenante, lui demanda un devoir. Le travail de l'élève achevé, l'artiste le corrigeait... ainsi se passa tout le temps du voyage. Alexandre Georges ne se lassait pas d'admirer l'activité de ce prêtre qui ne déposait son papier de musique que pour prendre son bréviaire : «Je m'aperçus bien vite, écrit-il, qu'il regrettait de ne pouvoir, à cause de son sacerdoce, se consacrer davantage à la composition musicale».
Le musicien lui apportait au fur et à mesure les morceaux composés.
C'était l'orgueilleuse apostrophe de Lucifer aux anges demeurés fidèles, auxquels l'ange révolté reproche leur servili-té. Et l'artiste, pour la traduire avait trouvé des notes frémissantes :
C'était l'heure où, sous les coupoles d'or du Ciel,
Quand l'aurore ici-bas se lève ensoleillée,
Les Fils du Tout-Puissant adorent l'Éternel
Qui va leur découvrir sa divine pensée.
Satan, tout en rampant, s'était glissé près d'eux.
SATAN.
Beaux anges asservis, vous me faites pitié !
Ah I gardez votre ciel et laissez-moi la terre.
Cœurs sans amour et sans fierté,
Tremblez devant la Trinité
Qui n'a créé que l'esclavage !
Je suis ivre de liberté.
Et contre la Divinité
J'assouvirai !si bien ma rage,
Que votre ciel sera désert ;
Et vous regretterez l'enfer
D'où montera la haine aux clameurs ironiques.
Étouffant dans la peur vos éternels cantiques !
Tantôt c'était la description de la Grotte dont l'auteur, plus fort que la souffrance, avait composé les vers au presbytère de son ami, le Curé de Dampierre, entre deux crises néphrétiques.
O roche Massabielle !
O vieux mont souverain !
Ton sommet regarde la citadelle
Du château-fort, prison d'airain.
A tes pieds, accourant de Gavarnie,
Le Gave t'apporte, en fuyant,
De l'ouragan la sublime harmonie,
Ou des neiges l'air fraîchissant.
Dans tes flancs, d'un coup de main, la Nature
Creuse une grotte au premier plan
Et sculpte au-dessus la fine arcature
D'un gracieux vitrail roman.
La baie attendait sa riche verrière,
Ou bien quelque saint de granit ;
Lorsque le Ciel, l'enviant à Ta terre,
La Vierge Sainte y descendit.
Un peu plus tard c'était l'humble et candide prière de l'enfant à la «Dame» et pour laquelle l'artiste avait trouvé des ac-cents suppliants et caressants comme les paroles elles-mêmes.
O vous, dont la robe traînante
Plus blanche qu'une âme d'enfant,
Porte une ceinture ondoyante,
Teinte du bleu du firmament,
Dont le voile est une parure
Vierge comme celle du lys,
Et dont les pieds n'ont pour chaussure
Qu'une rose du paradis.
Madame, faites qu'il éclose,
Dans l'églantier que vous foulez,
De la terre une pauvre rose,
Pour dire que vous m'écoutez.
De vos yeux le doux reflet
M'enveloppe de mystère ;
Nous descendez-vous des Cieux ?
Etes-vous Vierge ?... Etes-vous Mère ?
Ou bien... êtes-vous les deux ?
Tout en vous est pureté...
Seriez-vous Sainte Marie ?
Vos lèvres disent bonté
Et vous êtes toute belle.
Une autre fois, l'artiste avait trouvé pour le chœur des Anges, emportant vers la terre de France la Vierge immaculée, une mélodie gracieuse, aérienne, immatérielle comme les esprits célestes et, d'une voix toute vibrante, il venait la chanter à son poète :
D'une céleste envolée
Nous te porterons là-bas,
Vers la rive ensoleillée
Où tu diriges tes pas.
Repose-toi sur nos ailes,
Pour te bercer mollement,
Loin des sphères éternelles,
Par delà le firmament.
C'était sans doute à la Grotte, où le prêtre avait conduit son musicien, qu'Alexandre Georges avait trouvé, sous l'inspi-ration de la Vierge et de Bernadette, la note émue et tendre qui devait bientôt émouvoir les auditeurs de Notre-Dame de Lourdes,
Lorsque l'artiste venait ainsi chanter au presbytère les morceaux qu'il avait composés, il arrivait que des vicaires pré-sents demandaient au Maître de leur faire entendre quelqu'une de ses Chansons de Miarka, et peu à peu le musicien se laissait pénétrer par cette atmosphère sympathique. Bientôt, revenant à la pratique oubliée de sa foi, il confiait au Curé de Saint-Médard le soin de sa conscience. «Quand je me relevais, après l'absolution, disait-il, l'abbé m'embrassait comme son enfant». L'artiste, en évoquant devant nous ces souvenirs vieux de près de quarante ans, avait encore des larmes dans les yeux.
M. Louis Pister, chef d'orchestre, le fondateur des Concerts du Palmariam, bénéficia, lui aussi, de l'action bienfaisante de l'abbé Jouin. Malade, c'est au presbytère de Saint-Médard qu'il enverra frapper pour recevoir, dans ses derniers ins-tants, les consolations religieuses.
Mais celui qui subissait le plus profondément l'influence religieuse de l'abbé Jouin, c'était Auguez. Nous avons fait al-lusion à l'événement qui fut à l'origine de ses relations avec l'abbé Jouin. En 1886, l'artiste venait de voir toutes ses éco-nomies englouties dans l'affaire du Panama. L'abbé Jouin avait eu l'occasion d'entendre l'artiste au Panthéon ; il apprend sa ruine et, spontanément, lui offre vingt mille francs. Auguez, ne pouvant croire à tant de générosité, n'osait accepter pa-reille largesse :
- «Je ne pourrai jamais vous rembourser».
- Qu'à cela ne tienne, répondit l'abbé. Vous me payerez en chantant pour mes œuvres».
Ce qui n'empêchait pas l'abbé Jouin, à chaque séance de la Nativité, de lui remettre un généreux cachet. Celui-ci chanta donc dans tous les concerts organisés par le vicaire de Saint-Augustin ou le Curé de Saint-Médard. Parfois, le dimanche, après les grands concerts du Châtelet, où il partageait avec Warmbrodt un succès toujours croissant, les deux grands artistes venaient se détendre en dînant au presbytère. On faisait signe à M. Vivet, l'organiste de Saint-Augustin. Après le repas, le ténor et le baryton, oubliant leur fatigue, déchiffraient toute une partition, l’Enfance du Christ ou la Damnation de Faust. Auguez, qu'on disait affilié à une société secrète, subissait l'influence du prêtre. La conversion était proche ; elle devait être éclatante. Déjà cette âme droite se faisait apôtre. En reconduisant le prêtre qu'il avait mandé près de sa belle-mère mourante, il disait : «Voyez-vous, l'abbé, avec la vie les idées se modifient !» Elles se modifièrent à ce point que bientôt se sentant malade, il appelait l'abbé Jouin pour mettre ordre à sa conscience et communiait deux fois de sa main.
Warmbrodt, protestant avait plus de chemin à parcourir. S'il ne parvint pas jusqu'à l'abjuration, du moins, devant l'exemple d'Auguez et la conversion du violoniste Bild, il sentit ses préjugés anticatholiques s'évanouir, et demanda à «l'abbé» de baptiser et de préparer ses deux neveux à leur première Communion.
L'action religieuse de l'abbé Jouin s'exerçait encore à des degrés divers sur des israélites de passage à Paris - Foers-ter - Harold-Bauer - Lévin - sur des cantatrices comme Mme Eleonore Blanc, Louise Moulor, Madame Boidin-Puisais et même sur des artistes de la Comédie-Française. Cette lettre, qu'une tragédienne bien connue lui adressait dans sa ma-ladie, nous laisse entrevoir quelque chose du bien qui s'opérait dans ces âmes d'artistes sous l'influence de ce prêtre, ar-tiste lui-même, et, plus encore, apôtre :
«Si vous saviez, Monsieur le Curé, combien vous m'avez fait de joie avec vos quatre mots reçus hier et le Jésus offert à ma petite fille, vous seriez heureux d'avoir eu cette bonne pensée. Elle porte depuis hier la petite croix et j'ose à peine vous avouer que je mets un peu de superstition à ne pas la lui ôter. Merci donc de tout mon cœur... Aussi bien que de mercis je vous dois depuis longtemps déjà, et que d'excuses. Je ne voulais pas vous voir, j'espérais bien que vous ne saviez pas, que vous ne sauriez jamais, et maintenant je suis si contente, que je ne me cache pas du tout.
«Venez me voir, si vous voulez bien me donner quelques minutes, Monsieur le Curé,... je ne puis bouger et serai tout à fait heureuse de vous recevoir.
* * *
«Veiller au service des malades : leur éternité est proche».
L'abbé Jouin n'oubliait pas cet article de son programme pastoral, et dès le premier jour, il se mettait en relations avec Dom Leduc, cherchait pour le couvent des Servantes des Pauvres qu'il voulait établir une maison isolée et convenable. Il la trouva rue du Pôt-de-Fer - et, le 7 novembre 1896, la Révérende Mère Agnès quittait la maison de Joinville pour fon-der, avec trois autres religieuses, la première maison de Servantes des Pauvres à Paris, à Saint-Médard. «Saint- Mé-dard ! disait-il, la paroisse par excellence pour les Servantes des Pauvres, où il en faudrait trente ou quarante pour fournir aux mille nécessités créées par la misère ! Or, au début, elles étaient quatre sœurs».
Mais les vaillantes religieuses se multipliaient. Nul repos : leurs journées, leurs nuits mêmes appartenaient aux ma-lades. La Mère Agnès, malgré son âge, en passait trois par semaine, au chevet des agonisants. Par elles, l'abbé Jouin connaissait la détresse de certains foyers et il s'ingéniait à la soulager. Ruelle des Gobelins, une famille nombreuse ne pouvait acheter de viande que le dimanche : «Je veux, dit le Curé, qu'à partir de ce jour, elle en mange tous les jours de la semaine, et à mes frais». - L'abbé Ménard, chargé de dépouiller les demandes des pauvres, proposait parfois un chiffre qu'il croyait généreux : 10, 20, 50 francs. Régulièrement le Curé doublait la somme.
Ses fonctions pastorales, la présence de six vicaires auraient pu le dispenser de visiter personnellement les malades. Il le faisait cependant chaque fois que sa visite pouvait contribuer au bien moral ou religieux des pauvres infirmes. «Je l'accompagnais un jour, - nous écrit le Curé d'une importante paroisse parisienne - chez un malheureux atteint d'un can-cer à la bouche. De ses lèvres meurtries coulait, par moments, un liquide sanglant et nauséabond. Transporté de joie à la vue de son Curé, il lui saisit les mains, les retenait longuement pressées sur sa poitrine, balbutiant des paroles de recon-naissance. Des gouttes sanglantes tombaient sur les mains qui ne se retiraient pas. Quand nous fûmes sortis, pendant qu'il se lavait au bassin du Jardin des Plantes, je lui disais ma surprise et lui, simplement, de répondre :
- «Que voulez-vous ? Il était si content de me voir et de me remercier. Je ne pouvais le priver de cette satisfaction...».
«Si j'ai toujours aimé les pauvres, continuait l'abbé Stalter, si, pour rester son vicaire à Saint-Médard, j'ai refusé des postes plus brillants, c'est parce que M. Jouin m'apprit par ses exemples à aimer les pauvres et les malades». Aussi, l'appelait-on bientôt «le père des pauvres».
Où donc l'abbé Jouin, sans ressources personnelles, et dans une paroisse qui suffisait à peine à faire vivre son cler-gé, trouvait-il les sommes nécessaires à des charges si lourdes ? Contribution à l'école libre de la paroisse voisine, que fréquentaient les garçons de Saint-Médard ; entretien de dix élèves ecclésiastiques ; charges de deux maisons de Ser-vantes des Pauvres et des malades qu'elles assistent ; dépenses considérables pour le culte, tout cela s'élevait à un chiffre très élevé. Et cependant il trouvait encore le moyen de subventionner un prêtre de sa paroisse pour des fouilles entreprises à Ephèse, dans l'espoir d'y découvrir le Tombeau de la Sainte Vierge, et d'encourager de ses conseils et de sa bourse un jeune orientaliste dans la publication du Recueil des écrivains chrétiens orientaux.
Vers 1898, l'abbé Chabot, familier du presbytère de Saint-Médard, parlait un jour, devant lui, de l'importante contribu-tion que pourrait fournir à l'Histoire de l'Église et, en particulier, à l'Histoire des dogmes, la connaissance de nombreux ouvrages laissés par les écrivains chrétiens de l'Orient, pour la plupart encore inédits. Entreprise difficile, car elle com-prenait avec l'édition des textes leur traduction latine - entreprise coûteuse, au début surtout. «L'abbé Jouin offrit géné-reusement d'y participer et, de fait, écrit l'abbé Chabot, il solda le déficit des six premiers volumes . Le projet ayant ré-ussi au-delà des prévisions, il eut la satisfaction, quelques années plus tard, de voir le Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium adopté par les deux Universités catholiques de Louvain et de Washington, qui assurent désormais la conti-nuation de cette publication vraiment grandiose - elle compte aujourd'hui près de 100 volumes - dont il fut le véritable ins-tigateur».
«Ce n'est pas, ajoute l'abbé Chabot, aujourd'hui Membre de l'Institut, un des moindres services que l'abbé Jouin rendit à l'Église».
Il protégeait aussi l'Œuvre italienne dirigée par l'admirable sœur Helena et dont l'aumônier était alors un jeune secré-taire de la Nonciature, l'abbé Granito di Belmonte. C'est à Saint-Médard que le futur prince de l'Église commença à ap-précier l'abbé Jouin.
Généreux et prodigue pour les autres, il était pour lui-même parcimonieux, ne se donnant que le nécessaire. Une dame de Saint-Augustin qui apportait au presbytère de Saint-Médard des vêtements pour les pauvres, reçut de la domes-tique de l'abbé Jouin cette boutade : «Vous feriez bien mieux de lui apporter des chemises. Il vient de donner sa meil-leure et je ne suffis pas à réparer les vieilles !»
Où l'abbé Jouin puisait-il l'argent ?... La clef du mystère ne serait-elle point dans ce petit billet trouvé en son absence par «son abbé» dans un tronc de l'église ? «Saint Antoine, donnez-moi du pain pour mes pauvres. En échange, je vous promets de faire tous les jours mon oraison. - Il célébrait avec solennité la fête du Saint, ami des Pauvres, disait chaque semaine la messe dans la chapelle qu'il lui avait dédiée et commanda à un peintre angevin douze panneaux représentant la vie du saint thaumaturge pour en décorer les murs de sa chapelle privée : double témoignage de sa piété envers le Saint, et de sa charité pour un artiste qui n'avait pas encore rencontré la fortune.
Comme tous les hommes d'œuvres, l'abbé Jouin se confiait à la Providence, à cette Providence qui remplit tous les jours la caisse des Petites Sœurs des Pauvres et qui, à cette même époque, donnait à un Don Bosco, à Turin, à un abbé Fouque, à Marseille, les moyens d'établir ! et de fonder les œuvres que le monde admire aujourd'hui. «Panier percé», di-sait le Directeur des Cultes, M. Dumay, auquel on parlait de l'abbé Jouin. «Cœur ouvert et mains toujours tendues», re-prenaient ceux qui connaissaient bien dans quelles mains se répandaient les libéralités du Curé de Saint- Médard».
Il ne distribuait pas avec une moindre magnificence le pain spirituel aux âmes de ses paroissiens. Outre les caté-chismes, de première communion et les œuvres de persévérance dont nous avons parlé, dès le premier jour, il établit un catéchisme pour les enfants de 7 à 9 ans et en confia la direction à des dames.
Dès le premier jour aussi, il instituait une œuvre nouvelle pour l'instruction religieuse de la classe populaire : la Doc-trine Chrétienne. Chaque mercredi, on y expliquait familièrement une vérité religieuse. L'instruction terminée et le Saint-Sacrement retiré, après la bénédiction, on tirait une tombola. Les heureux gagnants emportaient toutes sortes de choses utiles : vêtements, ustensiles de ménage, divers objets chers aux ménagères. A l'époque de Noël, à l'Epiphanie, on dis-tribuait ainsi des mètres de boudin, une oie, une galette large comme une table, à Pâques, une pièce montée remplie de jolis œufs rouges. Aussi se pressait-on à la Doctrine Chrétienne.
Lui-même prêchait régulièrement et longuement. Ses prônes duraient une demi-heure. Il prêchait souvent à la place des autres : il lui arriva, plus d'une fois, de remplacer au pied levé tel vicaire défaillant, ou d'écrire pour un autre moins éloquent le sermon que celui-ci n'avait plus qu'à apprendre. Deux ans de suite, invité par son prédécesseur, Mgr Latty, il prononça deux importants discours à l'occasion du pèlerinage de Châlons au sanctuaire de N.-D. de l'Épine. Voici quelle était sa méthode de travail pour ses prônes : Une fois son sujet et son plan arrêtés, il faisait relever dans la Catena aurea de saint Thomas d'Aquin tous les textes patrologiques se rapportant à son idée et les enchâssait très heureusement dans le sermon - improvisé d'ailleurs - qui contenait ainsi la moelle des Docteurs et des Pères. Plus dogmatique que moraliste, il estimait que les résolutions pratiques germent spontanément dans un esprit éclairé par la foi et dans un cœur convain-cu.
Ces travaux - et beaucoup d'autres encore - n'épuisaient pas d'ailleurs cette prodigieuse activité : Il faisait construire une chapelle dans le Patronage des jeunes filles, aménageait une chapelle de nuit pour le Saint-Sacrement ; restaurait celle de la Sainte-Vierge et dressait les plans pour la construction d'une chapelle et d'une salle de fête et l'agrandisse-ment de la sacristie : deux projets que le temps et l'opposition des architectes de la Ville ne lui permirent pas de mener à bonne fin ; et il trouvait encore le temps de réunir les éléments d'un «Mystère de la Passion», de travailler à la rédaction de ses explications du Catéchisme - pour lequel son programme prévoyait une heure et demie de travail par jour -, et sur-tout de composer les 420 vers de son Oratorio de Notre-Dame de Lourdes.
Quand Alexandre Georges en eut achevé la musique, l'abbé Jouin en eut une telle joie, qu'une seconde fois il emme-na l'artiste à Lourdes pour un pèlerinage d'action de grâces, qui fut aussi, nous l'avons dit, un pèlerinage de conversion pour le musicien.
Le renom de l'abbé Jouin dépassait les limites de la paroisse Saint-Médard. Le succès de la «Nativité», son cano-nicat angevin, l'éclat de ses œuvres, frappaient ses compatriotes. Déjà en 1893, pour ses Noces d'Argent, il avait reçu à Saint-Augustin les confrères de son cours auxquels il avait comme toujours, offert le gîte, le couvert et le voyage. Une messe solennelle avait été chantée à la paroisse. Le dîner avait été suivi d'une soirée dramatique et musicale dans la-quelle il avait produit ses enfants et ses artistes. Quatre ans plus tard, en 1897, le cours se réunissait dans un presbytère d'Anjou. A la fin du repas, le plus brillant du cours M. Mauvif de Montergon, égaya ses confrères en rimant sur le nom de chacun des trente convives, ce qu'il appelait un «Mot vif» et plaisant. Voici le quatrain consacré par le poète, à notre hé-ros :
Quand on dit Saint-Médard, aussitôt chacun nomme
Un curé de Paris accompli de tous points,
Et s'étonne à bon droit de voir qu'en un seul homme
Tant d'esprit et de cœur puissent se trouver joints .
* * *
Les paroissiens de Saint-Médard se demandaient parfois si on leur laisserait longtemps «un curé accompli de tous points». Il est trop bien pour nous, disaient-ils humblement. N'allait-on point, une fois encore, leur enlever leur Curé pour en faire un évêque ?
- L'abbé Jouin doit être évêque, avaient déclaré deux prélats, ses amis, devant une assistance d'élite, que le premier vicaire de Saint-Augustin avait conviée à fêter leur élévation à l'épiscopat ; et Mgr Renou, évêque d'Amiens, et Mgr Bon-nefoy, évêque de la Rochelle, avaient posé la candidature du Curé de Saint-Médard au siège vacant du Mans. Ils avaient bon espoir de voir son nom accepté par le Ministère des Cultes, où l'on semblait avoir oublié les procès déjà lointains de Joinville. Mais une visite s'imposait à la Direction des cultes : «Vous avez, lui disait-on, un concurrent dont la sœur et les amis se remuent beaucoup en faveur de leur candidat. Il faut aller voir M. Dumay». L'abbé Jouin, qui tenait à son indé-pendance, ne se décida pas à faire la démarche : «Il y avait en lui, dira son panégyriste de 1918, une volonté capable de s'incliner quand elle le doit, mais qui ne se courbe jamais».
Cependant sa mère eût été fière de voir la mitre sur la tête de son curé et sa déception se trahit par une parole de re-gret. Il la consola par ce mot : «Déjà, vous vous plaignez de la rareté de mes visites depuis que je suis curé. Que diriez-vous donc si j'étais envoyé comme évêque au fond d'une province ? Vous ne me verriez presque plus». L'abbé Jouin ne fut donc pas évêque. Mais - le cycle des quatre ans était révolu - le cardinal Richard lui offrit de devenir le successeur de M. l'abbé Brisset, à la cure de Saint-Augustin. Cette nomination le surprit tout le premier, et il demandait à l'abbé Mac-chiavelli, qui était en très bons termes avec un Archidiacre de Paris, s'il n'était pas pour quelque chose dans sa nomina-tion. Le Cardinal Richard le jugeait plus justement. L'abbé Jouin, ayant cru devoir faire remarquer que, ne faisant pas de visites, il n'était peut-être pas le prêtre indiqué pour cette riche paroisse, le Cardinal passa outre. II lui demanda seule-ment de renoncer désormais à diriger lui-même, à l'orchestre, les chants de sa Pastorale : sacrifice bien léger, que l'Auteur de la Nativité n'eût pas de peine à faire au désir de son vieil Archevêque.
L'abbé Jouin se prépara donc à quitter Saint-Médard. En arrivant, il avait dit cette parole : «Un curé doit travailler à sa paroisse comme s'il devait y rester toujours, et être prêt à la quitter dès demain, si ses supérieurs le lui demandent».
Il partit, mais il voulut partir en beauté. La lettre que nous allons citer nous montre bien la grandeur de son âme. Elle est d'un ami, d'un ancien collègue à Saint-Augustin, alors curé de Saint-Ouen, où l'Archevêque l'a envoyé pour bâtir une église, créer une seconde paroisse et établir un troisième centre d'œuvres. Pour tout cela il lui faut plus d'un million et, ce million, c'est de Paris, de Saint-Augustin surtout que l'abbé Macchiavelli l'attend. L'abbé Jouin le savait, mais ce qu'il ignorait, ce sont les terribles épreuves auxquelles son ami était soumis depuis cinq ans . Par la réponse, on peut entre-voir la générosité des propositions qui avaient été faites.
Saint-Ouen, le 20 Décembre 1898.
Cher Monsieur Jouin,
Une circonstance imprévue m'a empêché hier de vous faire la visite que je vous dois, et que mon cœur avait réso-lue. Ce n'est que partie remise ; mais j'ai l'obligation de répondre par écrit à votre chère lettre du 15 courant, au lieu de le faire de vive voix comme j'y avais compté.
Vous ne saurez jamais comme votre lettre m'a remué : il y a des années que je n'ai ressenti pareille impression, une impression qui demeure et demeurera. Je croyais avoir mesuré votre cœur : nous m'avez montré que je dois élargir les frontières dans lesquelles il épanouit sa bonté.
Par exemple, il me semble que l'affectueuse reconnaissance du mien suit le vôtre dans la manifestation de sa gé-nérosité.
Ceci dit, je reprends votre chère lettre, point par point.
Avant tout, vous ne devez qu'à vous-même la cure de Saint-Augustin : cela est trop évident pour que je cherche à le prouver. Je suis peut-être plus convaincu de vos aptitudes spéciales que d'autres, parce que je vous connais mieux, et c'est tout. Veuillez croire d'ailleurs que c'est pour Saint-Augustin que j'ai dit mon Te Deum de votre nomina-tion ; pour vous, je dis souvent mon Veni Creator ; vous avez à faire une œuvre d'une portée immense, puisque vos paroissiens de demain sont, non des soldats, mais les chefs naturels de la société.
Et maintenant, j'en arrive aux préoccupations de votre cœur à mon endroit : et j'y réponds avec la simplicité de la reconnaissance.
Depuis quatre ans je suis entièrement libre du côté de Nancy. Non seulement je suis libre, mais je viens de tou-cher les 50.000 francs que j'avais assuré comme nantissement, et j'ai payé avec cette somme un beau terrain, à Cayenne, partie de ma paroisse, distante de mon presbytère de trois kilomètres, où il y a déjà 9000 habitants privés de tous secours religieux ; quelque jour on devra élever là-bas une chapelle. Vous le voyez, je suis entièrement libre : plus de dettes, plus d'argent.
Relativement à un sermon de charité, je vous remercie pour 1899. M. le Curé de la Madeleine a bien voulu me donner le dernier jour de son Adoration perpétuelle, à condition que je la prêche. Mais j'accepte avec reconnaissance le bon jour que vous me choisissez pour 1900.
De mon église en construction, je vous parlerai longuement à l'occasion. Qu'il me suffise de vous dire aujourd'hui que ma dette en ce moment n'est pas de vingt mille francs pour cette année. Je compte que la douce Providence me continuera Ses bontés ; vous verrez bien, dans votre amitié généreuse, le moyen de provoquer la charité de quelque lieutenant de cette Providence.
Reste la question du confessionnal à reprendre à Saint-Augustin, et de la façon si affectueuse dont vous arrangez nos vendredis. Là, je suis plus ému encore : car je ne puis pas ne pas comparer. Évidemment, je ferai sur ce point, ce que vous désirez ; et je vous prie de croire que chez vous, je ne renoncerai pas à la réserve dont je me suis fait une loi. D'ailleurs, nous en causerons, et je suivrai en tout vos avis.
Cher Monsieur Jouin, je vous dis mal mon émotion reconnaissante : mais je crois la sentir, comme il convient à un cœur qu'un grand cœur a affectueusement touché, et en vous embrassant comme je vous aime, je vous redis mes félicitations et l'assurance de ma respectueuse affection.
Macchiavelli.
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 5)
CHAPITRE V LE CURÉ DE SAINT-MÉDARD. (1894-1898)
LE QUARTIER MOUFFETARD ET LA PAROISSE SAINT-MEDARD. LA REORGANISATION DES CATECHISMES ET LA FONDATION D'UN PATRONAGE POUR LES GARÇONS. - UNE BELLE CONQUETE DE L'ABBE JOUIN : L'ABBE BOSSARD. - LA REPRISE DES REPRESENTATIONS DE LA NATIVITE A CHAILLOT ET A L'ALCAZAR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CHANOINE HONORAIRE D'ANGERS. - FONDATION D'UN CATECHISME POUR LES PETITS ET DE LA DOCTRINE CHRETIENNE. - LE CULTE DIVIN A SAINT-MEDARD. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES ; NOMBREUSES CONVERSIONS. - LE REGISSEUR DE LA SCENE DE L'OPERA FAIT SA PREMIERE COMMUNION A 72 ANS. - L'ORATORIO DE N.-D. DE LOURDES. - L'ABBE JOUIN FONDE UNE SECONDE MAISON DE SER-VANTES DES PAUVRES. - ON L'APPELLE LUI-MEME LE PERE DES PAUVRES. - SON DEVOUEMENT ET SA CHARITE POUR LES MALADES. - DEUX EVEQUES VEULENT FAIRE ELEVER L'ABBE JOUIN A L'EPISCOPAT. - IL EST NOMME CURE DE SAINT-AUGUSTIN. - IL QUITTE SAINT-MEDARD EN BEAUTE.
Quelques jours avant son installation, l'abbé Jouin, «son abbé» et un autre prêtre - l'abbé Bossard - arrivaient, par l'omnibus légendaire Panthéon-Courcelles, à la Place de la Contrescarpe, à la lisière de la paroisse de Saint-Médard. Le premier Vicaire, l'abbé Souques, les attendait. Ensemble, ils descendirent la rue Mouffetard : Mons cetardus, expliqua l'abbé Bossard, qui avait étudié son «Vieux-Paris». C'est par ce chemin que, du Palais de Julien, au temps de Clovis et de Geneviève, les habitants de Lutèce, à travers des enclos plantés de vignes, gagnaient les bords de la Bièvre et la campagne parisienne.
- Hélas, soupira l'abbé Jouin, à la place de ces vignes disparues quel amas de maisons sordides I...
- Voici la rue Saint-Médard, reprit l'abbé Souques. Ici commence votre domaine.
- Je la connais, dit l'abbé Jouin. Quand j'étais vicaire à Saint-Étienne du Mont, plus d'une fois pour des malades je fus appelé dans ces taudis, «La Reine des Chiffonniers» y réside-t-elle toujours ?
- Je le crois. Ses sujets sont nombreux. Mais vous ne les verrez pas souvent à l'église, pas plus, d'ailleurs, que ces boutiquiers et ces acheteurs qui encombrent la rue et gênent notre marche. Le commerce est toute la religion de ces gens…
- «Voici, à gauche, la rue Gracieuse ; à droite, celle du Pot de Fer, le passage des Patriarches, et tout près, dans la rue de l’Épée de Bois, la maison, qui fut, jadis, la résidence de là fameuse Sœur Rosalie ; c'est aujourd'hui, le siège de l'Œuvre italienne, dont l'aumônier est un jeune secrétaire de la Nonciature, l'abbé Granito di Belmonte.
- Sœur Rosalie ! murmura l'abbé Jouin, il m'en faudrait une de cette taille. Et sa pensée se tourna vers Mère Agnès et les petites Servantes des Pauvres.
Au coin de la rue de l'Arbalète, nous croisons, un groupe d'écoliers, tout surpris à la vue de tant de «curés».
- Leurs regards ne sont pas mauvais, dit l'abbé Bossard ; mais aucun ne nous a salués. Ils doivent ignorer le prêtre.
- Nous le leur ferons aimer, affirma le nouveau Pasteur. Du reste, pour suppléer à l'école libre de garçons qui manque ici, il faudra créer un patronage, comme à Saint-Augustin.
- Un patronage ! Je redoute pour vous un échec. Tous Ces Messieurs vous le diront : les trois écoles officielles nous envoient de cent, à cent dix enfants pour la Première Communion, et, l'année d'après, il s'en présente cinq à six pour le renouvellement solennel, et encore on ne saurait affirmer qu'ils aient assisté à la messe du dimanche...
- Et les filles ?
- Multipliez par trois, dit l'abbé Souques, qui était chargé de leur instruction religieuse. L'opinion des vicaires qui con-naissent le quartier, est qu'il n'y a rien à faire.
- Ou plutôt tout est à créer, rectifia l'abbé Jouin. Et ce disant, il regardait l'abbé Bossard. Celui-ci comprit son appel muet.
- Demandez, comme vicaire, l'abbé Sauvêtre, dit-il. A nous deux, et avec Bouloff (Bouloff était le caniche de l'abbé Bossard) nous ouvrirons, dans un an, le patronage. En attendant, je viendrai vous aider pour les catéchismes.
- Merci, dit le Curé, car il faudra les multiplier, comme à Saint-Augustin et comme à Joinville.
Le premier Vicaire eut un geste de scepticisme.
- Etes-vous sûr du consentement des parents ? question-na-t-il.
- Il le faudra bien, affirma le Curé.
Nous étions arrivés au bas de la rue Mouffetard, sur les bords de la Bièvre. La petite rivière de ce nom, avant de se je-ter dans la Seine, traverse en effet la paroisse dans toute sa longueur et confond ses eaux boueuses avec celles du fleuve au Pont d'Austerlitz, toujours sur le territoire de Saint-Médard. L'abbé Souques nous expliqua que la Bièvre, recou-verte, coulait à quelques pas de nous, mais qu'un peu plus haut, dans la rue des Gobelins, ou plus bas, rue Censier, elle était visible. Les tanneurs l'utilisent pour leurs cuirs ; aussi ses parfums ne sont-ils pas ceux du Parc Monceau.
Peu importait ! Nous étions entrés dans l'église, gracieux monument de la Renaissance, mais mal entretenue, pauvre comme le quartier qui l'entoure, enterrée au Sud par le square voisin, et, au Nord, à moitié aveuglée par les marchan-dises de toutes sortes : bois, charbons et matériaux divers que les commerçants, propriétaires des terrains adjacents, en-tassent jusqu'à boucher les fenêtres. La sacristie est humide et en contrebas d'un mètre du square voisin. Le presbytère, attenant à l'église, ne voit jamais le soleil. Au chevet de l'église, deux couloirs de 2 m 50 sur 17, servent de chapelle pour les catéchismes. Entre les deux, une courette, dernier vestige du fameux cimetière Saint-Médard. C'est là qu'au XVIIIe siècle, les convulsionnaires jansénistes se livraient à leurs manifestations grotesques avant l’interdiction du Parlement et qu'on pouvait lire l'ironique inscription d'un plaisant : DE PAR LE ROI, DEFENSE A DIEU DE FAIRE MIRACLE EN CE LIEU !
En traversant, au retour, le Jardin des Plantes, le Curé songeur, récapitulait : «Une chapelle des Catéchismes, une salle d'Œuvres, l'agrandissement de la sacristie, le parquetage de la chapelle de la Sainte Vierge dont le dallage, complè-tement usé, lui semblait bien froid pour les pieds des vieilles gens... tout cela coûtera bien cent mille francs, auxquels viendront s'ajouter les frais annuels d'une maison de Servantes des Pauvres, et, sur le champ, dans son esprit, il rédi-geait la circulaire qu'il adresserait à ses futurs paroissiens.
Aussitôt après l'installation, présidée par M. L'Archidiacre Bureau, le jeune Curé entreprit la réorganisation des caté-chismes pour les enfants des écoles laïques. Les pronostics sur l'opposition des parents ne se réalisèrent pas. Après une tentative de résistance esquissée par quelques-uns, - le Curé leur donnait d'ailleurs toute permission d'envoyer leurs en-fants aux catéchismes de la paroisse voisine - tous finirent par accepter les deux réunions hebdomadaires pour la pre-mière année et les trois séances pour la seconde.
Bientôt les familles se montrèrent satisfaites de l'intérêt porté à leurs enfants. L'un d'eux venait-il à manquer, soit au catéchisme, soit à la messe, aussitôt, la dame catéchiste se présentait chez les parents pour s'informer du motif de l'ab-sence. Les récompenses trimestrielles, le dévouement des dames, et surtout le zèle du Pasteur et de son collaborateur, l'abbé Bossard, achevèrent de gagner le cœur de cette centaine de petits laïques dont on avait dit tant de mal.
Bien plus, dès la fin de la seconde année, trois d'entre eux entraient au Petit Séminaire. L'un devint plus tard vicaire de l'abbé Jouin à Saint-Augustin ; le second est un de nos vaillants missionnaires diocésains et curé de Paris ; le troi-sième, Anatole Béry, esprit philosophique supérieur, mourut quelques années après son ordination.
Au bout d'un an, le Curé de Saint-Médard put obtenir «son abbé» pour second vicaire. D'autre part, l'abbé Bossard, laissant définitivement la maison de préparation aux examens, qu'il avait fondée dans la Plaine Monceau, venait habiter Saint-Médard pour se consacrer entièrement aux œuvres de l'abbé Jouin. Cette conquête - une des plus belles et des plus fécondes du Curé de Saint-Médard - l'abbé Jouin la racontait en ces termes, au lendemain de la mort de son ami : «Docteur ès-lettres, professeur remarquable, écrivain mordant, il avait été surtout, un homme de caractère et un homme de foi vendéenne. Mais renseignement de l'histoire, même de celle de la Vendée, sur laquelle il a laissé de nombreux écrits, pouvait-il satisfaire aux exigences de sa vocation ?»
«C'est la question qu'il se posa le jour où il quitta sa maison d'éducation à Paris. Et comme il n'osait la résoudre, se sentant juge et partie, il me fit l'honneur de me consulter par une lettre de douze pages. (Que n'ai-je cette lettre ? Mais comment aurais-je pu pressentir qu'il me devancerait dans la tombe ?) Toute sa vie, toute son âme était là. Si large et si édifiante que fût la tâche historique qu'il s'était tracée, il craignait de faillir à sa mission sacerdotale. Il m'exposait ses scrupules, et je puis dire qu'il inclinait de lui-même vers la vraie solution : ce fut de venir, quatre ans, faire avec moi, non plus de l'éducation littéraire, mais un simple catéchisme et de l'éducation morale près des enfants des Écoles communales et des patronages dans la paroisse Saint-Médard. Et bien ! je ne crains pas d'être démenti en affirmant que, ce jour-là, il avait trouve sa voie. Mis en contact direct avec les âmes jeunes et neuves, il lui était donné de semer enfin, lui aussi, le froment catholique, de creuser son sillon avec méthode, d'éveiller du même coup la science et l'amour du Christ son Maître, de fouiller parfois jusqu'au cœur pour y détruire les premiers germes d’ivraie, et de communiquer avec une intensité si ardente sa vieille foi vendéenne, que ses catéchisés entendent en-core le son de sa parole, vibrante d'enthousiasme et de conviction. C'est tellement vrai que l'un d'eux, mourant, quelques années plus tard, l'appelait de son nom comme pour l'aider dans le suprême combat de l'agonie, et l'abbé Bossard écrivait : Que ne l'ai-je su à temps ? mais j'aurais fait cent lieues pour le bénir, l'embrasser et lui ouvrir le ciel»
Au mois de juin 1896, le dimanche après la première Communion, on voyait un groupe d'enfants se diriger en bon ordre vers la Seine. Deux abbés les conduisaient s'entretenant paternellement avec eux. Mais ce qui piquait surtout la cu-riosité des passants amusés, c'était la présence et les aboiements joyeux d'un joli caniche, courant de la queue à la tête et de la tête à la queue de la colonne, stimulant les traînards, et prenant au sérieux son rôle de chien de berger .
- Quels sont ces enfants, se demandait-on intrigué ?
- C'est, répondit l'un d'eux, le Patronage Saint-Maurice de Saint-Médard qui fait sa première sortie. Nous allons pren-dre le bateau pour le Bois de Vincennes».
Même après que le successeur de l'abbé Jouin, eût abrité l'Œuvre dans le local de la rue Censier, les promenades continuèrent chaque dimanche, - à pied, en hiver -, en bateau ou en chemin de fer, dans le reste de l'année. Dans ces courses à travers les Bois de Vincennes, de Meudon et de Chaville, les enfants s'entraînaient pour les futures ascensions du Parmelan, de la Tournette, voire du Mont-Blanc. Car l'abbé Jouin voulut que le nom du géant de la Savoie fût gravé sur l’alpenstock de son patronage et que la gloire de cette ascension fût acquise à l'Œuvre qu'il n'avait pas cessé de pro-téger. C'était en 1906. Les aînés du Patronage se trouvaient en colonie de vacances à Thônes en pleine Haute-Savoie. L'abbé Jouin, sous le coup d'une crise néphrétique très douloureuse, était venu les rejoindre. Et, pour le distraire, ces jeunes gens avaient organisé, dans le jardin de la maison amie dont il recevait l'hospitalité, une séance récréative à la-quelle il avait assisté du balcon de sa chambre. Le soir, il dit tout à coup à «son abbé» :
- Il faut conduire les jeunes gens au Mont-Blanc. Celui-ci le regardait étonné.
- Oui, reprit-il, j'ai étudié l'ascension. Par les Houches, le placier de Bionassay et l'Aiguille du Goûter, elle n'offre pas de difficultés. Vous prendrez de bons guides, et j'assume tous les frais.
- Mais, c'est impossible, répliqua l'abbé ! Je n'ai jamais fait de courses de glaciers. Je ne suis pas alpiniste. Ces jeunes gens encore moins et quelques-uns sont arrivés d'hier pour une semaine seulement. Ils ne sont pas équipés pour une ascension de cette importance. - Il avait réponse à tout.
- Sauf les chutes de pierres à l’Aiguille du Goûter - et encore, le matin, elles sont plus rares - il n'y a pas de danger.
De guerre lasse, l'abbé court chez le docteur du pays pour se faire délivrer une défense en règle. Le Docteur semblait ne pas l'entendre : «Alors, fit-il, vous allez au Mont- Blanc ? Je suis des vôtres : voici dix ans que je rêve de cette ascen-sion !
- Mais non, je ne vais pas au Mont-Blanc, et je viens, au contraire, vous demander de me l'interdire. Ces jeunes gens...
- Je les examinerai, j'écarterai les faibles. Et puis, ils sont entrâmes au sport, ils sont disciplinés. Dans ces conditions, avec des guides expérimentés, l'ascension du Mont-Blanc n'offre pas de danger et ne réclame que de l'endurance.
Et voilà comment, quelques jours plus tard, une caravane composée de cinq jeunes parisiens, du Dr M., de deux ab-bés, dont l'un était un vicaire de l'Abbé Jouin et son futur successeur, de quatre porteurs et de deux guides, gravissait vers midi l'arête des Rognes, visitait le glacier de Bionassay, couchait à Tête-Rousse (3000 m.), escaladait le lendemain l’Aiguille du Goûter (4000 m.) parvenait enfin à la Cabane Vallot (4362 m.) d'où les guides, inquiets du mauvais temps, l'arrachait aussitôt, et, par les Grands-Mulets, la ramenait saine et sauve, le soir du second jour. Tous avaient franchi al-lègrement séracs et crevasses et rentraient le soir à Chamonix. Complimentés pour leur endurance par les touristes qui, d'en bas, lorgnettes en main, avaient suivi les péripéties de leur descente sur les échelles, les jeunes alpinistes s'atten-daient à recevoir de M. le Curé de Saint-Augustin des compliments non moins chaleureux : «Oui, leur dit-il, ce n'est pas mal. Mais vous n'êtes pas allés jusqu'au sommet. Vous vous êtes arrêtés à 4362 mètres ! C'est regrettable». Et dans ce regret perçait presque un reproche.
Nul doute que, sans son indisposition, malgré ses 63 ans, il ne se fût joint à la caravane. Il avait la passion de la mon-tagne et ignorait le vertige. On le vit bien l'année suivante, quand avec les mêmes jeunes gens, l'abbé Raymond et «son abbé», il fit l'ascension de la Pointe percée, haut sommet de la chaîne des Aravis (3200 m.), et qu'il voulut franchir, de-bout, l'arête finale, dominant à gauche et à droite un précipice de mille mètres, arête que la plupart ne passent qu'en se mettant à cheval : prouesse que ses compagnons, moins entraînés ou plus timides taxèrent de témérité. Lui, se croyait simplement audacieux et ne prétendait que donner à ces jeunes gens un exemple de sang-froid et d'intrépidité.
* * *
Les dix représentations du Mystère de la Nativité avaient eu trop de retentissement à Paris et en province pour qu'on ne pressât pas l'abbé Jouin de les reprendre sur une scène plus spacieuse. Les Parisiens eurent donc la satisfaction d'applaudir ce spectacle sur le théâtre paroissial de Saint-Pierre de Chaillot d'abord et, l'année suivante, sur la scène dé-saffectée de l'Alcazar, rue du faubourg Poissonnière. «Ce fut, dit le chroniqueur de la Semaine Religieuse de Paris, un régal des yeux, des oreilles, de l'esprit et du cœur». Une foule avide de beauté et de sensations mystiques se pressait à ce spectacle nouveau dans sa grandeur et sa simplicité. La plupart des Curés de Paris, les directeurs du Grand Sémi-naire de Saint-Sulpice, des religieux et des religieuses, le nonce du Vatican à Paris, Mgr Clari, vinrent tour à tour assister à la Pastorale de la Nativité.
L'Évêque d'Angers, Mgr Mathieu, avait présidé la séance du 23 février 1895, à Chaillot. A l'entr’acte, provoqué par un mot spirituel et gracieux de l'abbé Jouin, l'Évêque, au cours d'une improvisation charmante où il disait sa joie et sa fierté d'Angevin, déclara qu'en témoignage de son estime affectueuse pour l'auteur, il voulait, puisque l'occasion lui en était of-ferte, accomplir en pleine séance ce qu'il avait résolu de faire en quittant Angers et dont il avait parlée la veille, à S.E. le Cardinal de Paris. Il le fera, ajoutait-il, il en était sûr, aux applaudissements de tous les spectateurs auxquels répondront les bravos de tout l'Anjou : il nommait donc le Curé de Saint-Médard, Chanoine honoraire de la Cathédrale d'Angers.
«A ce moment même, au milieu d'un tonnerre d'applaudissements prolongés, disait le chroniqueur de la Semaine Religieuse d'Angers, un enfant du Patronage Saint-Médard, un de ces jeunes enfants qu'on dit si sceptiques, s'ap-procha vivement d'une dame et lui demanda d'une voix un peu troublée : «Mais M. le Curé ne quittera pas Saint-Médard, n'est-ce pas ? - Mais non, mais non. - Oh ! alors tant mieux, c'est de l'avancement sur place. - Je ne sais, ajoutait l'abbé Bossard, mais il me semble que, même après la grande joie d'être chanoine de l'insigne église cathé-drale d'Angers, j'aurais aussi quelque joie d'avoir provoqué la demande et la boutade».
* * *
Loin d'absorber son activité, ces représentations n'étaient pour l'abbé Jouin qu'un stimulant à de nouveaux travaux.
Sur une petite feuille trouvée dans un vieux bréviaire après sa mort, nous lisons sous le titre : Retraite de 1894, ce ré-sumé de la tâche que le Curé s'était imposée à Saint-Médard :
1° - Pour moi : Veiller à mon oraison.
2° - Pour les autres :
I. Veiller à ce que l’on confesse, c'est la vie paroissiale.
II. Veiller au service des malades. Leur éternité : est proche.
III. Organiser les catéchismes.
IV. Veiller au culte divin.
Un de ses premiers soucis, après l'organisation des catéchismes, fut en effet de ramener à Saint-Médard ceux, des paroissiens que le voisinage de la rue Mouffetard semblait écarter. Ce but, il l'atteignit en donnant aux cérémonies reli-gieuses un éclat inaccoutumé. Comme à Joinville, et mieux encore, il faisait venir d'Angers fleurs et plantes vertes à pro-fusion, les disposait lui-même sur les gradins qui s'élevaient jusqu'à couvrir l'espace réservé à la maîtrise derrière le maître-autel, commandait deux grands lampadaires à l'entrée du chœur : fleurs et lumières mariées avec goût, formaient un ensemble des plus harmonieux.
Sa maîtrise était des plus modestes : un organiste, deux chantres, trois ou quatre enfants mal formés. Aux jours de fêtes, l'abbé Jouin la renforçait par des concours étrangers si nombreux, que pour contenir tous ces chanteurs, il fallait écarter les grilles du chœur et, pour les diriger, faire appel à un musicien éprouvé, M. Louis Pister. Aux grandes solenni-tés, à Pâques, à Noël, à la Toussaint, le jour de la Première Communion, à la Fête-Dieu, il convoquait ses artistes de la Nativité. C'est ainsi qu'on entendit à Saint-Médard les plus beaux chefs d'œuvres de la musique sacrée : des messes de Mozart, de Beethoven, de Schubert et jusqu'au Magnificat de Bach, que le Curé, une partition à la main, suivait dans sa stalle : on pouvait lire sur ses traits sa joie de voir son Maître ainsi glorifié par le génie et la voix de l'homme.
Le maître de chapelle de Saint-Augustin se plaignait bien et s'étonnait qu'on lui enlevât, notamment à la Messe de Mi-nuit, celui qu'on ne se lassait pas d'entendre, le premier des chanteurs d'église à cette époque, M. Auguez. Il ignorait la force du lien qui unissait désormais, et pour la vie, le chanteur au prêtre qui l'avait sauvé de la ruine. Spectacle touchant, un jour de Toussaint, après les longs offices de cette fête, le grand artiste resta encore pour chanter, de sa voix magis-trale, devant le Curé et quelques rares fidèles, l’Invitatoire des matines des morts.
Tous ces artistes s'empressaient de répondre à ses moindres appels et lui donnaient de leur attachement de tou-chants témoignages. Plusieurs d'entre eux étaient venus, trois soirs de suite, prêter leur concours à des conférences po-pulaires que M. le Curé prêchait pour les hommes. Celui-ci ne prenait son dîner qu'après la cérémonie. L'on vit alors ce spectacle original d'un Curé de Paris soupant, seul, pendant que des musiciens de talent lui faisaient entendre des trios de Mozart.
Une ou deux fois l'an, il recevait à sa table : chanteurs, instrumentistes, organistes du Grand et du Petit orgue. Dans ces réunions, après le repas - toujours choisi - les conversations s'engageaient entre abbés et musiciens, des jeux fami-liers s'organisaient, des liens se créaient.
Derrière le musicien et le poète, les artistes découvraient l'homme, admiraient la vivacité de son intelligence, subis-saient l'ascendant de sa volonté, et se laissaient gagner par la bonté d'un cœur sensible à tous les besoins. A leur insu, ils étaient conquis par l'action du prêtre et l'heure allait venir où plusieurs d'entre eux, de la passion de l'art et du beau, s'élèveraient à la connaissance et au culte du véritable Artiste et de la suprême Beauté. Le premier à revenir au Dieu en-trevu dans son enfance fut M. Pluque, A douze ans, déjà petit danseur à l'Opéra, on l'avait, pour son inexactitude, ren-voyé du catéchisme de Saint-Roch. Longtemps il en eut du regret. Au contact de l'abbé Jouin, à l'occasion de la Nativité, ce regret se changeait en désir. En 1897, gravement malade, le Régisseur de la scène de l'Opéra appelait l'abbé Jouin, apprenait de lui son catéchisme, se confessait comme un petit enfant et, à l'âge de 72 ans, communiait enfin pour la première fois. «Jamais, disait-il, en pleurant, je n'ai connu pareil bonheur !» Son entourage pleurait comme lui.
Vers la même époque, le professeur et danseur Wazquez accourait au presbytère de Saint-Médard, réclamant l'abbé Jouin pour sa belle-sœur qui se mourait à l'autre bout de Paris. En l'absence du Curé, «son abbé» s'offrit et, après quelques visites, préparait cette âme de bonne volonté à paraître devant Dieu.
L'action du Curé de Saint-Médard s'exerçait non moins heureuse sur un jeune compositeur viennois, M. Mandl, dont nous avons déjà parlé à l'occasion de «la Nativité». A sa demande l'abbé Jouin avait composé une poésie sur ce thème : Un père pleure sur la mort de son enfant, et le musicien était ravi de son poète. Voici le début de cette pièce gracieuse :
En un berceau tout rose,
Là-bas, dans le ciel bleu,
Mon doux enfant repose
Sous le regard de Dieu.
Mais l’ange qui te verse
La coupe aux rêves d'or
Et par ses chants te berce,
Comme moi ne t'aime pas encor.
En ce jour que j'appelle,
Que je voudrais demain,
Dans la paix éternelle,
Mon doux enfant, dors bien !
En cette même année 1897, le Curé de Saint-Médard achevait, à la gloire de la Vierge les paroles d'un poème de 420 vers : Notre-Dame de Lourdes, oratorio en trois parties : le Divin Conseil - l'Élue - L'Apparition. Il eut la pensée d'en con-fier la musique à Richard Mandl qui ne cachait pas son attrait pour la beauté du culte catholique. II l'emmena à la Grotte au moment d'un grand pèlerinage, et l'artiste se mit au travail. Déjà il avait mis en musique ces paroles par lesquelles, dans l'Oratorio, les Anges saluent Bernadette :
Quelle est l'âme
Dont la flamme
A le parfum de l'encensoir ;
Si limpide,
Si candide
Que la Vierge descend la voir ?
Trois fillettes sont là, glanant un peu de bois.
- Mais une seule est en prière,
- Combien douce est sa voix I
- Que son âme est légère !
- Combien pur est son cœur !
- Naïve sa pensée !
- Anges, c'est notre sœur.
Mais l'artiste viennois n'avançait pas assez vite au gré de l'auteur. Au bout d'un an, il lui redemanda son livret pour le donner à un autre compositeur, M. Alexandre Georges, déjà connu par les Chansons de Miarka et son opéra de Char-lotte Corday. Le compositeur nous a raconté comment, en l'emmenant à Lourdes, l'abbé Jouin, qui regrettait de ne pou-voir harmoniser lui-même les morceaux qu'il composait, s'enquit aussitôt des règles de l'harmonie, des moyens de l'ap-prendre et, séance tenante, lui demanda un devoir. Le travail de l'élève achevé, l'artiste le corrigeait... ainsi se passa tout le temps du voyage. Alexandre Georges ne se lassait pas d'admirer l'activité de ce prêtre qui ne déposait son papier de musique que pour prendre son bréviaire : «Je m'aperçus bien vite, écrit-il, qu'il regrettait de ne pouvoir, à cause de son sacerdoce, se consacrer davantage à la composition musicale».
Le musicien lui apportait au fur et à mesure les morceaux composés.
C'était l'orgueilleuse apostrophe de Lucifer aux anges demeurés fidèles, auxquels l'ange révolté reproche leur servili-té. Et l'artiste, pour la traduire avait trouvé des notes frémissantes :
C'était l'heure où, sous les coupoles d'or du Ciel,
Quand l'aurore ici-bas se lève ensoleillée,
Les Fils du Tout-Puissant adorent l'Éternel
Qui va leur découvrir sa divine pensée.
Satan, tout en rampant, s'était glissé près d'eux.
SATAN.
Beaux anges asservis, vous me faites pitié !
Ah I gardez votre ciel et laissez-moi la terre.
Cœurs sans amour et sans fierté,
Tremblez devant la Trinité
Qui n'a créé que l'esclavage !
Je suis ivre de liberté.
Et contre la Divinité
J'assouvirai !si bien ma rage,
Que votre ciel sera désert ;
Et vous regretterez l'enfer
D'où montera la haine aux clameurs ironiques.
Étouffant dans la peur vos éternels cantiques !
Tantôt c'était la description de la Grotte dont l'auteur, plus fort que la souffrance, avait composé les vers au presbytère de son ami, le Curé de Dampierre, entre deux crises néphrétiques.
O roche Massabielle !
O vieux mont souverain !
Ton sommet regarde la citadelle
Du château-fort, prison d'airain.
A tes pieds, accourant de Gavarnie,
Le Gave t'apporte, en fuyant,
De l'ouragan la sublime harmonie,
Ou des neiges l'air fraîchissant.
Dans tes flancs, d'un coup de main, la Nature
Creuse une grotte au premier plan
Et sculpte au-dessus la fine arcature
D'un gracieux vitrail roman.
La baie attendait sa riche verrière,
Ou bien quelque saint de granit ;
Lorsque le Ciel, l'enviant à Ta terre,
La Vierge Sainte y descendit.
Un peu plus tard c'était l'humble et candide prière de l'enfant à la «Dame» et pour laquelle l'artiste avait trouvé des ac-cents suppliants et caressants comme les paroles elles-mêmes.
O vous, dont la robe traînante
Plus blanche qu'une âme d'enfant,
Porte une ceinture ondoyante,
Teinte du bleu du firmament,
Dont le voile est une parure
Vierge comme celle du lys,
Et dont les pieds n'ont pour chaussure
Qu'une rose du paradis.
Madame, faites qu'il éclose,
Dans l'églantier que vous foulez,
De la terre une pauvre rose,
Pour dire que vous m'écoutez.
De vos yeux le doux reflet
M'enveloppe de mystère ;
Nous descendez-vous des Cieux ?
Etes-vous Vierge ?... Etes-vous Mère ?
Ou bien... êtes-vous les deux ?
Tout en vous est pureté...
Seriez-vous Sainte Marie ?
Vos lèvres disent bonté
Et vous êtes toute belle.
Une autre fois, l'artiste avait trouvé pour le chœur des Anges, emportant vers la terre de France la Vierge immaculée, une mélodie gracieuse, aérienne, immatérielle comme les esprits célestes et, d'une voix toute vibrante, il venait la chanter à son poète :
D'une céleste envolée
Nous te porterons là-bas,
Vers la rive ensoleillée
Où tu diriges tes pas.
Repose-toi sur nos ailes,
Pour te bercer mollement,
Loin des sphères éternelles,
Par delà le firmament.
C'était sans doute à la Grotte, où le prêtre avait conduit son musicien, qu'Alexandre Georges avait trouvé, sous l'inspi-ration de la Vierge et de Bernadette, la note émue et tendre qui devait bientôt émouvoir les auditeurs de Notre-Dame de Lourdes,
Lorsque l'artiste venait ainsi chanter au presbytère les morceaux qu'il avait composés, il arrivait que des vicaires pré-sents demandaient au Maître de leur faire entendre quelqu'une de ses Chansons de Miarka, et peu à peu le musicien se laissait pénétrer par cette atmosphère sympathique. Bientôt, revenant à la pratique oubliée de sa foi, il confiait au Curé de Saint-Médard le soin de sa conscience. «Quand je me relevais, après l'absolution, disait-il, l'abbé m'embrassait comme son enfant». L'artiste, en évoquant devant nous ces souvenirs vieux de près de quarante ans, avait encore des larmes dans les yeux.
M. Louis Pister, chef d'orchestre, le fondateur des Concerts du Palmariam, bénéficia, lui aussi, de l'action bienfaisante de l'abbé Jouin. Malade, c'est au presbytère de Saint-Médard qu'il enverra frapper pour recevoir, dans ses derniers ins-tants, les consolations religieuses.
Mais celui qui subissait le plus profondément l'influence religieuse de l'abbé Jouin, c'était Auguez. Nous avons fait al-lusion à l'événement qui fut à l'origine de ses relations avec l'abbé Jouin. En 1886, l'artiste venait de voir toutes ses éco-nomies englouties dans l'affaire du Panama. L'abbé Jouin avait eu l'occasion d'entendre l'artiste au Panthéon ; il apprend sa ruine et, spontanément, lui offre vingt mille francs. Auguez, ne pouvant croire à tant de générosité, n'osait accepter pa-reille largesse :
- «Je ne pourrai jamais vous rembourser».
- Qu'à cela ne tienne, répondit l'abbé. Vous me payerez en chantant pour mes œuvres».
Ce qui n'empêchait pas l'abbé Jouin, à chaque séance de la Nativité, de lui remettre un généreux cachet. Celui-ci chanta donc dans tous les concerts organisés par le vicaire de Saint-Augustin ou le Curé de Saint-Médard. Parfois, le dimanche, après les grands concerts du Châtelet, où il partageait avec Warmbrodt un succès toujours croissant, les deux grands artistes venaient se détendre en dînant au presbytère. On faisait signe à M. Vivet, l'organiste de Saint-Augustin. Après le repas, le ténor et le baryton, oubliant leur fatigue, déchiffraient toute une partition, l’Enfance du Christ ou la Damnation de Faust. Auguez, qu'on disait affilié à une société secrète, subissait l'influence du prêtre. La conversion était proche ; elle devait être éclatante. Déjà cette âme droite se faisait apôtre. En reconduisant le prêtre qu'il avait mandé près de sa belle-mère mourante, il disait : «Voyez-vous, l'abbé, avec la vie les idées se modifient !» Elles se modifièrent à ce point que bientôt se sentant malade, il appelait l'abbé Jouin pour mettre ordre à sa conscience et communiait deux fois de sa main.
Warmbrodt, protestant avait plus de chemin à parcourir. S'il ne parvint pas jusqu'à l'abjuration, du moins, devant l'exemple d'Auguez et la conversion du violoniste Bild, il sentit ses préjugés anticatholiques s'évanouir, et demanda à «l'abbé» de baptiser et de préparer ses deux neveux à leur première Communion.
L'action religieuse de l'abbé Jouin s'exerçait encore à des degrés divers sur des israélites de passage à Paris - Foers-ter - Harold-Bauer - Lévin - sur des cantatrices comme Mme Eleonore Blanc, Louise Moulor, Madame Boidin-Puisais et même sur des artistes de la Comédie-Française. Cette lettre, qu'une tragédienne bien connue lui adressait dans sa ma-ladie, nous laisse entrevoir quelque chose du bien qui s'opérait dans ces âmes d'artistes sous l'influence de ce prêtre, ar-tiste lui-même, et, plus encore, apôtre :
«Si vous saviez, Monsieur le Curé, combien vous m'avez fait de joie avec vos quatre mots reçus hier et le Jésus offert à ma petite fille, vous seriez heureux d'avoir eu cette bonne pensée. Elle porte depuis hier la petite croix et j'ose à peine vous avouer que je mets un peu de superstition à ne pas la lui ôter. Merci donc de tout mon cœur... Aussi bien que de mercis je vous dois depuis longtemps déjà, et que d'excuses. Je ne voulais pas vous voir, j'espérais bien que vous ne saviez pas, que vous ne sauriez jamais, et maintenant je suis si contente, que je ne me cache pas du tout.
«Venez me voir, si vous voulez bien me donner quelques minutes, Monsieur le Curé,... je ne puis bouger et serai tout à fait heureuse de vous recevoir.
* * *
«Veiller au service des malades : leur éternité est proche».
L'abbé Jouin n'oubliait pas cet article de son programme pastoral, et dès le premier jour, il se mettait en relations avec Dom Leduc, cherchait pour le couvent des Servantes des Pauvres qu'il voulait établir une maison isolée et convenable. Il la trouva rue du Pôt-de-Fer - et, le 7 novembre 1896, la Révérende Mère Agnès quittait la maison de Joinville pour fon-der, avec trois autres religieuses, la première maison de Servantes des Pauvres à Paris, à Saint-Médard. «Saint- Mé-dard ! disait-il, la paroisse par excellence pour les Servantes des Pauvres, où il en faudrait trente ou quarante pour fournir aux mille nécessités créées par la misère ! Or, au début, elles étaient quatre sœurs».
Mais les vaillantes religieuses se multipliaient. Nul repos : leurs journées, leurs nuits mêmes appartenaient aux ma-lades. La Mère Agnès, malgré son âge, en passait trois par semaine, au chevet des agonisants. Par elles, l'abbé Jouin connaissait la détresse de certains foyers et il s'ingéniait à la soulager. Ruelle des Gobelins, une famille nombreuse ne pouvait acheter de viande que le dimanche : «Je veux, dit le Curé, qu'à partir de ce jour, elle en mange tous les jours de la semaine, et à mes frais». - L'abbé Ménard, chargé de dépouiller les demandes des pauvres, proposait parfois un chiffre qu'il croyait généreux : 10, 20, 50 francs. Régulièrement le Curé doublait la somme.
Ses fonctions pastorales, la présence de six vicaires auraient pu le dispenser de visiter personnellement les malades. Il le faisait cependant chaque fois que sa visite pouvait contribuer au bien moral ou religieux des pauvres infirmes. «Je l'accompagnais un jour, - nous écrit le Curé d'une importante paroisse parisienne - chez un malheureux atteint d'un can-cer à la bouche. De ses lèvres meurtries coulait, par moments, un liquide sanglant et nauséabond. Transporté de joie à la vue de son Curé, il lui saisit les mains, les retenait longuement pressées sur sa poitrine, balbutiant des paroles de recon-naissance. Des gouttes sanglantes tombaient sur les mains qui ne se retiraient pas. Quand nous fûmes sortis, pendant qu'il se lavait au bassin du Jardin des Plantes, je lui disais ma surprise et lui, simplement, de répondre :
- «Que voulez-vous ? Il était si content de me voir et de me remercier. Je ne pouvais le priver de cette satisfaction...».
«Si j'ai toujours aimé les pauvres, continuait l'abbé Stalter, si, pour rester son vicaire à Saint-Médard, j'ai refusé des postes plus brillants, c'est parce que M. Jouin m'apprit par ses exemples à aimer les pauvres et les malades». Aussi, l'appelait-on bientôt «le père des pauvres».
Où donc l'abbé Jouin, sans ressources personnelles, et dans une paroisse qui suffisait à peine à faire vivre son cler-gé, trouvait-il les sommes nécessaires à des charges si lourdes ? Contribution à l'école libre de la paroisse voisine, que fréquentaient les garçons de Saint-Médard ; entretien de dix élèves ecclésiastiques ; charges de deux maisons de Ser-vantes des Pauvres et des malades qu'elles assistent ; dépenses considérables pour le culte, tout cela s'élevait à un chiffre très élevé. Et cependant il trouvait encore le moyen de subventionner un prêtre de sa paroisse pour des fouilles entreprises à Ephèse, dans l'espoir d'y découvrir le Tombeau de la Sainte Vierge, et d'encourager de ses conseils et de sa bourse un jeune orientaliste dans la publication du Recueil des écrivains chrétiens orientaux.
Vers 1898, l'abbé Chabot, familier du presbytère de Saint-Médard, parlait un jour, devant lui, de l'importante contribu-tion que pourrait fournir à l'Histoire de l'Église et, en particulier, à l'Histoire des dogmes, la connaissance de nombreux ouvrages laissés par les écrivains chrétiens de l'Orient, pour la plupart encore inédits. Entreprise difficile, car elle com-prenait avec l'édition des textes leur traduction latine - entreprise coûteuse, au début surtout. «L'abbé Jouin offrit géné-reusement d'y participer et, de fait, écrit l'abbé Chabot, il solda le déficit des six premiers volumes . Le projet ayant ré-ussi au-delà des prévisions, il eut la satisfaction, quelques années plus tard, de voir le Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium adopté par les deux Universités catholiques de Louvain et de Washington, qui assurent désormais la conti-nuation de cette publication vraiment grandiose - elle compte aujourd'hui près de 100 volumes - dont il fut le véritable ins-tigateur».
«Ce n'est pas, ajoute l'abbé Chabot, aujourd'hui Membre de l'Institut, un des moindres services que l'abbé Jouin rendit à l'Église».
Il protégeait aussi l'Œuvre italienne dirigée par l'admirable sœur Helena et dont l'aumônier était alors un jeune secré-taire de la Nonciature, l'abbé Granito di Belmonte. C'est à Saint-Médard que le futur prince de l'Église commença à ap-précier l'abbé Jouin.
Généreux et prodigue pour les autres, il était pour lui-même parcimonieux, ne se donnant que le nécessaire. Une dame de Saint-Augustin qui apportait au presbytère de Saint-Médard des vêtements pour les pauvres, reçut de la domes-tique de l'abbé Jouin cette boutade : «Vous feriez bien mieux de lui apporter des chemises. Il vient de donner sa meil-leure et je ne suffis pas à réparer les vieilles !»
Où l'abbé Jouin puisait-il l'argent ?... La clef du mystère ne serait-elle point dans ce petit billet trouvé en son absence par «son abbé» dans un tronc de l'église ? «Saint Antoine, donnez-moi du pain pour mes pauvres. En échange, je vous promets de faire tous les jours mon oraison. - Il célébrait avec solennité la fête du Saint, ami des Pauvres, disait chaque semaine la messe dans la chapelle qu'il lui avait dédiée et commanda à un peintre angevin douze panneaux représentant la vie du saint thaumaturge pour en décorer les murs de sa chapelle privée : double témoignage de sa piété envers le Saint, et de sa charité pour un artiste qui n'avait pas encore rencontré la fortune.
Comme tous les hommes d'œuvres, l'abbé Jouin se confiait à la Providence, à cette Providence qui remplit tous les jours la caisse des Petites Sœurs des Pauvres et qui, à cette même époque, donnait à un Don Bosco, à Turin, à un abbé Fouque, à Marseille, les moyens d'établir ! et de fonder les œuvres que le monde admire aujourd'hui. «Panier percé», di-sait le Directeur des Cultes, M. Dumay, auquel on parlait de l'abbé Jouin. «Cœur ouvert et mains toujours tendues», re-prenaient ceux qui connaissaient bien dans quelles mains se répandaient les libéralités du Curé de Saint- Médard».
Il ne distribuait pas avec une moindre magnificence le pain spirituel aux âmes de ses paroissiens. Outre les caté-chismes, de première communion et les œuvres de persévérance dont nous avons parlé, dès le premier jour, il établit un catéchisme pour les enfants de 7 à 9 ans et en confia la direction à des dames.
Dès le premier jour aussi, il instituait une œuvre nouvelle pour l'instruction religieuse de la classe populaire : la Doc-trine Chrétienne. Chaque mercredi, on y expliquait familièrement une vérité religieuse. L'instruction terminée et le Saint-Sacrement retiré, après la bénédiction, on tirait une tombola. Les heureux gagnants emportaient toutes sortes de choses utiles : vêtements, ustensiles de ménage, divers objets chers aux ménagères. A l'époque de Noël, à l'Epiphanie, on dis-tribuait ainsi des mètres de boudin, une oie, une galette large comme une table, à Pâques, une pièce montée remplie de jolis œufs rouges. Aussi se pressait-on à la Doctrine Chrétienne.
Lui-même prêchait régulièrement et longuement. Ses prônes duraient une demi-heure. Il prêchait souvent à la place des autres : il lui arriva, plus d'une fois, de remplacer au pied levé tel vicaire défaillant, ou d'écrire pour un autre moins éloquent le sermon que celui-ci n'avait plus qu'à apprendre. Deux ans de suite, invité par son prédécesseur, Mgr Latty, il prononça deux importants discours à l'occasion du pèlerinage de Châlons au sanctuaire de N.-D. de l'Épine. Voici quelle était sa méthode de travail pour ses prônes : Une fois son sujet et son plan arrêtés, il faisait relever dans la Catena aurea de saint Thomas d'Aquin tous les textes patrologiques se rapportant à son idée et les enchâssait très heureusement dans le sermon - improvisé d'ailleurs - qui contenait ainsi la moelle des Docteurs et des Pères. Plus dogmatique que moraliste, il estimait que les résolutions pratiques germent spontanément dans un esprit éclairé par la foi et dans un cœur convain-cu.
Ces travaux - et beaucoup d'autres encore - n'épuisaient pas d'ailleurs cette prodigieuse activité : Il faisait construire une chapelle dans le Patronage des jeunes filles, aménageait une chapelle de nuit pour le Saint-Sacrement ; restaurait celle de la Sainte-Vierge et dressait les plans pour la construction d'une chapelle et d'une salle de fête et l'agrandisse-ment de la sacristie : deux projets que le temps et l'opposition des architectes de la Ville ne lui permirent pas de mener à bonne fin ; et il trouvait encore le temps de réunir les éléments d'un «Mystère de la Passion», de travailler à la rédaction de ses explications du Catéchisme - pour lequel son programme prévoyait une heure et demie de travail par jour -, et sur-tout de composer les 420 vers de son Oratorio de Notre-Dame de Lourdes.
Quand Alexandre Georges en eut achevé la musique, l'abbé Jouin en eut une telle joie, qu'une seconde fois il emme-na l'artiste à Lourdes pour un pèlerinage d'action de grâces, qui fut aussi, nous l'avons dit, un pèlerinage de conversion pour le musicien.
Le renom de l'abbé Jouin dépassait les limites de la paroisse Saint-Médard. Le succès de la «Nativité», son cano-nicat angevin, l'éclat de ses œuvres, frappaient ses compatriotes. Déjà en 1893, pour ses Noces d'Argent, il avait reçu à Saint-Augustin les confrères de son cours auxquels il avait comme toujours, offert le gîte, le couvert et le voyage. Une messe solennelle avait été chantée à la paroisse. Le dîner avait été suivi d'une soirée dramatique et musicale dans la-quelle il avait produit ses enfants et ses artistes. Quatre ans plus tard, en 1897, le cours se réunissait dans un presbytère d'Anjou. A la fin du repas, le plus brillant du cours M. Mauvif de Montergon, égaya ses confrères en rimant sur le nom de chacun des trente convives, ce qu'il appelait un «Mot vif» et plaisant. Voici le quatrain consacré par le poète, à notre hé-ros :
Quand on dit Saint-Médard, aussitôt chacun nomme
Un curé de Paris accompli de tous points,
Et s'étonne à bon droit de voir qu'en un seul homme
Tant d'esprit et de cœur puissent se trouver joints .
* * *
Les paroissiens de Saint-Médard se demandaient parfois si on leur laisserait longtemps «un curé accompli de tous points». Il est trop bien pour nous, disaient-ils humblement. N'allait-on point, une fois encore, leur enlever leur Curé pour en faire un évêque ?
- L'abbé Jouin doit être évêque, avaient déclaré deux prélats, ses amis, devant une assistance d'élite, que le premier vicaire de Saint-Augustin avait conviée à fêter leur élévation à l'épiscopat ; et Mgr Renou, évêque d'Amiens, et Mgr Bon-nefoy, évêque de la Rochelle, avaient posé la candidature du Curé de Saint-Médard au siège vacant du Mans. Ils avaient bon espoir de voir son nom accepté par le Ministère des Cultes, où l'on semblait avoir oublié les procès déjà lointains de Joinville. Mais une visite s'imposait à la Direction des cultes : «Vous avez, lui disait-on, un concurrent dont la sœur et les amis se remuent beaucoup en faveur de leur candidat. Il faut aller voir M. Dumay». L'abbé Jouin, qui tenait à son indé-pendance, ne se décida pas à faire la démarche : «Il y avait en lui, dira son panégyriste de 1918, une volonté capable de s'incliner quand elle le doit, mais qui ne se courbe jamais».
Cependant sa mère eût été fière de voir la mitre sur la tête de son curé et sa déception se trahit par une parole de re-gret. Il la consola par ce mot : «Déjà, vous vous plaignez de la rareté de mes visites depuis que je suis curé. Que diriez-vous donc si j'étais envoyé comme évêque au fond d'une province ? Vous ne me verriez presque plus». L'abbé Jouin ne fut donc pas évêque. Mais - le cycle des quatre ans était révolu - le cardinal Richard lui offrit de devenir le successeur de M. l'abbé Brisset, à la cure de Saint-Augustin. Cette nomination le surprit tout le premier, et il demandait à l'abbé Mac-chiavelli, qui était en très bons termes avec un Archidiacre de Paris, s'il n'était pas pour quelque chose dans sa nomina-tion. Le Cardinal Richard le jugeait plus justement. L'abbé Jouin, ayant cru devoir faire remarquer que, ne faisant pas de visites, il n'était peut-être pas le prêtre indiqué pour cette riche paroisse, le Cardinal passa outre. II lui demanda seule-ment de renoncer désormais à diriger lui-même, à l'orchestre, les chants de sa Pastorale : sacrifice bien léger, que l'Auteur de la Nativité n'eût pas de peine à faire au désir de son vieil Archevêque.
L'abbé Jouin se prépara donc à quitter Saint-Médard. En arrivant, il avait dit cette parole : «Un curé doit travailler à sa paroisse comme s'il devait y rester toujours, et être prêt à la quitter dès demain, si ses supérieurs le lui demandent».
Il partit, mais il voulut partir en beauté. La lettre que nous allons citer nous montre bien la grandeur de son âme. Elle est d'un ami, d'un ancien collègue à Saint-Augustin, alors curé de Saint-Ouen, où l'Archevêque l'a envoyé pour bâtir une église, créer une seconde paroisse et établir un troisième centre d'œuvres. Pour tout cela il lui faut plus d'un million et, ce million, c'est de Paris, de Saint-Augustin surtout que l'abbé Macchiavelli l'attend. L'abbé Jouin le savait, mais ce qu'il ignorait, ce sont les terribles épreuves auxquelles son ami était soumis depuis cinq ans . Par la réponse, on peut entre-voir la générosité des propositions qui avaient été faites.
Saint-Ouen, le 20 Décembre 1898.
Cher Monsieur Jouin,
Une circonstance imprévue m'a empêché hier de vous faire la visite que je vous dois, et que mon cœur avait réso-lue. Ce n'est que partie remise ; mais j'ai l'obligation de répondre par écrit à votre chère lettre du 15 courant, au lieu de le faire de vive voix comme j'y avais compté.
Vous ne saurez jamais comme votre lettre m'a remué : il y a des années que je n'ai ressenti pareille impression, une impression qui demeure et demeurera. Je croyais avoir mesuré votre cœur : nous m'avez montré que je dois élargir les frontières dans lesquelles il épanouit sa bonté.
Par exemple, il me semble que l'affectueuse reconnaissance du mien suit le vôtre dans la manifestation de sa gé-nérosité.
Ceci dit, je reprends votre chère lettre, point par point.
Avant tout, vous ne devez qu'à vous-même la cure de Saint-Augustin : cela est trop évident pour que je cherche à le prouver. Je suis peut-être plus convaincu de vos aptitudes spéciales que d'autres, parce que je vous connais mieux, et c'est tout. Veuillez croire d'ailleurs que c'est pour Saint-Augustin que j'ai dit mon Te Deum de votre nomina-tion ; pour vous, je dis souvent mon Veni Creator ; vous avez à faire une œuvre d'une portée immense, puisque vos paroissiens de demain sont, non des soldats, mais les chefs naturels de la société.
Et maintenant, j'en arrive aux préoccupations de votre cœur à mon endroit : et j'y réponds avec la simplicité de la reconnaissance.
Depuis quatre ans je suis entièrement libre du côté de Nancy. Non seulement je suis libre, mais je viens de tou-cher les 50.000 francs que j'avais assuré comme nantissement, et j'ai payé avec cette somme un beau terrain, à Cayenne, partie de ma paroisse, distante de mon presbytère de trois kilomètres, où il y a déjà 9000 habitants privés de tous secours religieux ; quelque jour on devra élever là-bas une chapelle. Vous le voyez, je suis entièrement libre : plus de dettes, plus d'argent.
Relativement à un sermon de charité, je vous remercie pour 1899. M. le Curé de la Madeleine a bien voulu me donner le dernier jour de son Adoration perpétuelle, à condition que je la prêche. Mais j'accepte avec reconnaissance le bon jour que vous me choisissez pour 1900.
De mon église en construction, je vous parlerai longuement à l'occasion. Qu'il me suffise de vous dire aujourd'hui que ma dette en ce moment n'est pas de vingt mille francs pour cette année. Je compte que la douce Providence me continuera Ses bontés ; vous verrez bien, dans votre amitié généreuse, le moyen de provoquer la charité de quelque lieutenant de cette Providence.
Reste la question du confessionnal à reprendre à Saint-Augustin, et de la façon si affectueuse dont vous arrangez nos vendredis. Là, je suis plus ému encore : car je ne puis pas ne pas comparer. Évidemment, je ferai sur ce point, ce que vous désirez ; et je vous prie de croire que chez vous, je ne renoncerai pas à la réserve dont je me suis fait une loi. D'ailleurs, nous en causerons, et je suivrai en tout vos avis.
Cher Monsieur Jouin, je vous dis mal mon émotion reconnaissante : mais je crois la sentir, comme il convient à un cœur qu'un grand cœur a affectueusement touché, et en vous embrassant comme je vous aime, je vous redis mes félicitations et l'assurance de ma respectueuse affection.
Macchiavelli.
(à suivre...)
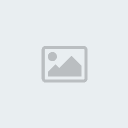
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 6)
CHAPITRE VI LE CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN. (1899-1932)
LA TACHE IMMENSE DU CURE DE SAINT-AUGUSTIN.
L'HOMME D'ETUDE : CHAQUE DIMANCHE LA MESSE DU JOUR EXPLIQUEE EST DISTRIBUEE AUX PAROISSIENS. FONDATION DE LA REVUE : LE CA-TECHISME. - IL ENTREPREND UN TRAVAIL COLOSSAL SUR LES EVANGILES. - LE THEATRE CHRETIEN : LE MYSTERE DE LA PASSION», «LE MYSTERE DE JEANNE D'ARC», CLOTILDE, BERNADETTE. - AUTRES ECRITS DE L'ABBE JOUIN : DISCOURS D'INSTALLATIONS ; DISCOURS SUR LA MUSIQUE ET SUR LES MUSICIENS. - POLEMIQUE AVEC M. CAMILLE BELLAÏGNE A PROPOS DE LA MUSIQUE SACREE.
L'HOMME D'ACTION : LES INVENTAIRES A SAINT-AUGUSTIN. L'ABBE JOUIN INVITE SES PAROISSIENS A UNE MESSE DE «DEUIL ARME». IL EST TRA-DUIT EN POLICE CORRECTIONNELLE ET CONDAMNE A 16 FRANCS D'AMENDE. - SA FIERE DECLARATION DEVANT SES JUGES.
L'HOMME DE CŒUR : FONDATION D'UNE TROISIEME MAISON DE SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE L'HOPITAL 139.
SES EPREUVES : IL PERD SA MERE ET SON FRERE HENRY JOUIN. - LA «PASSION» AU NOUVEAU THEATRE. - EPREUVES PATRIOTIQUES. - LA MOBILI-SATION DE LA PRIERE.
«Cette tâche immense» qu'on imposait à l'abbé Jouin, celui-ci était de taille à l'entreprendre. Il venait d'atteindre sa cinquante-quatrième année et, en dépit des premières attaques d'une affection qui ne devait avoir raison de sa résistance que longtemps plus tard, sa santé s'était raffermie. Un portrait de lui de cette époque respire la force et la vie. L'abbé Jouin est debout. Une main serre le bréviaire - l'arme surnaturelle de la prière - l'autre est libre, prête à se tendre pour l'action. L'œil est vif et pénétrant ; le front, sans ride, abrite une pensée forte et réfléchie ; la bouche largement fendue annonce l'orateur, mais le menton carré exprime une volonté tenace. L'ensemble donne l'impression de l'énergie éclairée par une belle intelligence et mise au service d'un cœur qu'on devine très bon. Esprit ouvert, volonté ferme, bonté accueil-lante : trois mots qui résument l'activité pastorale de l'abbé Jouin au cours de cette étape de trente-trois ans, la dernière de sa longue existence.
On se tromperait si l'on croyait que même à cette époque il n'y eût que des «chefs» à Saint-Augustin. Des gens de service, des employés, de petits commerçants, des pauvres même côtoyaient à l'église des familles nobles, des amiraux en retraite, d'éminents avocats, des magistrats réputés, de savants praticiens, des professeurs en renom, des industriels, des hommes d'affaires. Plus en vue en raison de leur culture et de leur situation sociale, la plupart faisaient rayonner au-tour d'eux sur les «simples soldats» l'exemple de leurs pratiques chrétiennes. On les voyait nombreux à la Sainte-Table, même au prône de la grand'messe. Mais à côté d'eux, beaucoup de demi-chrétiens se pressaient aux messes de onze heures, de midi et même d'une heure, - où l'on ne prêchait pas. Le regard distrait, les lèvres closes, parfois debout, ces mondains, ces mondaines, pour qui la messe du dimanche et le devoir pascal étaient le dernier mot de la religion pra-tique, priaient-ils, et que savaient-ils du grand «mystère de la foi» auquel, par habitude, peut-être, ils venaient assister de corps plus que d'esprit ? Le nouveau pasteur résolut de le leur apprendre : désormais et pendant des années, chaque paroissien trouvera sur son prie-Dieu, en venant remplir le devoir dominical, une brochure où la Messe du Jour lui était commentée dans ses parties principales ou ses rites les plus frappants. Plus de quatre cent mille de ces brochures furent ainsi imprimées et distribuées aux frais du Curé pour qui l'argent comptait peu au regard du bien spirituel de ses parois-siens. Un des premiers devoirs du pasteur, répétait-il dans ses discours d'installation de ses vicaires ou de ses amis, c'est d'enseigner la doctrine à son peuple.
Pour lui, il voulut faire plus. Afin de combattre au loin l'ignorance religieuse dont il disait que «la France se meurt bien plus que d'impiété», pour restaurer «dans les villes comme dans les campagnes l'enseignement parfois trop négligé du Catéchisme», avec le concours d'ecclésiastiques et d'amis, il entreprit la publication d'une Revue d'enseignement reli-gieux. «Notre premier but, écrivait-il au cardinal Richard, serait d'être utile à tous ceux qui, par vocation ou par piété, se livrent à l'enseignement de la religion ; le second sera réalisé le jour où pénétrant dans les familles, nous y apporterons un accroissement de foi pratique et de vie chrétienne».
Le Catéchisme parut le 10 avril 1900, avec la bénédiction et les encouragements du Cardinal. L'instruction sous toutes ses formes et pour tous les âges, tel était le programme de la nouvelle publication. «Aux explications du Caté-chisme, nous nous proposons d'ajouter des articles suivis sur l'ancien et le nouveau Testament, l'Histoire évangélique et, plus tard, l'Histoire de l'Église, et de fortifier également le côté de la prédication, au point de vue de l'homélie et du mot de piété, par de sérieuses connaissances patrologiques et hagiographiques. Nous offrirons de la sorte à la jeunesse et à ceux mêmes qui sont chargés de l'instruire une synthèse complète de l'enseignement religieux».
Dans le premier numéro, l'abbé Polack, second vicaire de Saint-Augustin, commençait une explication de l'Histoire sainte, et le R. P. Magnié, S.J., donnait un premier article sur la Sainteté .et un autre sur la Vie des Saints. D'autres colla-borateurs, comme l'abbé Villien, doyen de la Faculté de droit canonique, et l'abbé Bossard, viendront se joindre aux pre-miers. Pour l'abbé Jouin, il se réserve l'explication du Catéchisme : littérale, pour les petits ; logique, pour la Première Communion ; supérieure, pour la Persévérance. Dans la Revue paraîtront peu à peu ces explications logiques par de-mandes et par réponses auxquelles il travaillait depuis vingt ans, et dont la publication était souhaitée par un grand nombre de catéchistes. (Nous espérons qu'un jour ces articles, détachés de la Revue, seront publiés en volume).
Enfin, dans ce même numéro, il commençait la publication de la Somme de tous les Catéchismes français : «Il ne saurait échapper à personne, soulignait-il, de quel prix serait ce travail, si l’Episcopat, se conformant un jour à un vœu qui devient universel, acceptait l'unité du Catéchisme pour la France. Cette publication renfermerait alors tous les matériaux de la nouvelle et unique rédaction».
Au Congrès sacerdotal qui se tint à Bourges cette même année 1900, l'abbé Jouin fut invité par l'abbé Lemire à pro-noncer le discours d'ouverture et il y traita de cette importante question du Catéchisme.
Cette compétence du Curé de Saint-Augustin dans la question de l'enseignement catéchistique, le désigna au choix du Cardinal Amette, successeur du Cardinal Richard, pour l'étude des mesures pratiques à établir pour l'application à Pa-ris du Décret de Pie X sur l'âge de la première communion des enfants.
L'usage, presque général en France, était, on le sait, de n'admettre les enfants à l'Eucharistie que vers onze ans, après une instruction qui durait deux années, et à la suite d'une retraite de trois jours, à la fin de laquelle l'enfant faisait une confession générale et recevait l'absolution de ses fautes.
Toutefois, au cours des deux années préparatoires les enfants se confessaient régulièrement et beaucoup de prêtres les préparaient à l'absolution, quand ils en avaient besoin, surtout à la fin de la première année de catéchisme.
La solennité dont on entourait la première rencontre de l'enfant avec l'Eucharistie exerçait sur lui et sur les parents une impression profonde. A partir de ce jour, il était admis dans les rangs de la famille chrétienne et reçus comme tous les chrétiens à la participation des Sacrements. Le soir du «Grand Jour», l'enfant avait renouvelé solennellement et per-sonnellement les promesses faites en son nom le jour de son baptême. Si, dans le cours de la vie, il lui arrivait de les vio-ler, le souvenir de sa première communion devenait souvent pour le prodigue le principe de son retour à Dieu.
Mais en privant jusqu'à 11, 12 et même jusqu'à 14 ans, comme en Allemagne, les enfants du bienfait de l'Eucharistie et de la Pénitence, ne sacrifiait-on pas à un souci exagéré de leur instruction religieuse leur innocence et leur vie mo-rale ? Ne valait-il pas mieux prévenir le mal qu'avoir à le guérir ?
Le Pape l'avait pensé et, par le décret Quam singulari, il avait établi que désormais, à de certaines conditions de piété et de science proportionnées à leur âge et avec le consentement des parents, les enfants seraient admis à communier dès l'âge de raison, c'est-à-dire vers leur septième année, plus ou moins, sans solennité. L'appareil extérieur était réservé pour une communion qui devait marquer la fin des catéchismes tels qu'on les faisait jusqu'alors.
Ce décret, qui bouleversait les méthodes suivies et que le clergé de Paris, en particulier, appliquait avec un zèle en-core accru par la laïcisation des écoles officielles, provoqua une émotion considérable. Un double courant se formait : les uns, par un zèle exagéré, faisaient communier des enfants de cinq ans, ou sans tenir compte des conditions posées par le décret, d'autres se préoccupaient à l'excès de sa répercussion sur les catéchismes préparatoires à la Communion so-lennelle et sur ceux de persévérance. A quel âge fallait-il fixer cette communion solennelle qui marquerait - on n'en pou-vait douter - la fin de l'instruction religieuse ? En la maintenant à onze ans, pourrait-on retenir jusque là des enfants ayant commencé à communier depuis trois ou quatre ans ?
En l'avançant à dix ans, on les libérait du catéchisme à l'âge même où leur jeune esprit pouvait en profiter. Qu'allaient devenir les catéchismes de persévérance ? Pour un petit nombre d'enfants de familles pieuses, n'allait-on point en sacri-fier des milliers d'autres que des familles indifférentes avaient confié à l'école laïque ?...
Pour résoudre ces difficultés le Cardinal prit l'avis de ses curés. Il chargea celui de Saint-Augustin d'un travail sur ces graves problèmes.
C'est l'origine du Commentaire sur le Décret, commentaire qui ne fut pas publié.
L'étude se terminait par ces conclusions pratiques :
Il ressort du Décret et de la doctrine des théologiens sur lesquels il s'appuie
1° que les enfants doivent communier dès l'âge de discrétion ; c'est à dire vers 7 ans, plus ou moins, mais que, d'après les théologiens cités dans le décret les enfants n'atteignent, d'une manière générale, cet usage de la raison re-quis pour communier que de 9 à 11 ans, si bien que communément l'âge de 10 ans est accepté comme étant normale-ment et de droit commun, sauf les cas exceptionnels, l'âge de discrétion eucharistique.
2° que la première communion des enfants qui auront atteint, avant les autres, l'âge de discrétion, se fera sous forme privée ; mais que le Décret maintient et ordonne dans toute l'Église la première communion solennelle et publique, pré-cédée d'une retraite.
3° que l'âge de discrétion suppose, en principe dans l'enfant, en plus de la pureté, deux conditions essentielles : a) une instruction suffisante pour discerner le pain eucharistique du pain matériel, et pour comprendre suivant sa capacité, les mystères de la foi, nécessaires de nécessité de moyen, b) la dévotion au Saint-Sacrement et le désir de la commu-nion.
4° que les parents, les instituteurs, le confesseur et le curé sont juges de l'âge de discrétion de l'enfant et de sa prépa-ration suffisante à la réception des Sacrements, mais qu'il faut prendre garde que les parents ne veuillent hâter la pre-mière communion, par suite de motifs humains, comme : la vanité d'avoir un enfant plus avancé que les autres ; d'éviter les frais d'une communion solennelle ; la préoccupation des études et des examens qui contrarierait le catéchisme, etc.
5° que le Décret enjoint aux nouveaux communiants de suivre les catéchismes après leur première communion, et or-donne à ceux qui ont la charge des enfants d'y veiller et de les faire communier fréquemment et dévotement.
Mais qu'il est d'expérience notoire que les catéchismes de persévérance sont bien moins suivis et bien moins fruc-tueux, surtout pour les garçons, que le catéchisme de première communion.
Le Curé de Saint-Augustin se préoccupait aussi des tendances d'un certain nombre d'esprits qui semblaient alors faire fi des traditions de l'Église. Il se rencontrait d'ailleurs sur ce terrain avec le Souverain Pontife, Pie X, dont l'Encyclique Pascendi, du 8 décembre 1907, dévoilait et condamnait une hérésie d'une extrême habileté, qui se répandait en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Les écrivains qui la propageaient, hommes de talent et de style, prenaient soin de ne la présenter que morcelée, cachée, camouflée. Sous des formules de respect et avec le désir apparent de réconcilier l'Église avec son temps et de la moderniser pour son plus grand bien, ces prétendus rénovateurs, historiens, théologiens, exégètes ou romanciers, la ruinaient entièrement dans son autorité, son dogme et sa morale.
L'abbé Jouin crut qu'on pouvait combattre le modernisme et lui enlever ses armes par l'autorité des Pères de l'Église et leurs commentaires. Il se mit à l'œuvre, sans souci du temps et des efforts qu'elle exigerait.
Après avoir relevé et copié dans la Patrologie grecque et latine toutes les références se rapportant à chaque verset de la Bible, le travail personnel consistait à faire la critique du texte biblique : critique textuelle, philologique, exégétique, his-torique, théologique, liturgique et même artistique. La critique exégétique, à elle seule, comprenait l'opinion de tous les Pères et des commentateurs modernes. Le travail était partagé par sections : Prologue de saint Luc, Annonciation, Visita-tion, etc. Œuvre gigantesque, dont le cadre préparé depuis des années se voyait dans la bibliothèque du Curé de Saint- Augustin : vingt-cinq cartons in-folio contenant, au témoignage de M. l'abbé Viteau, sept mille feuilles et pesant 150 Kilos.
Il faudrait pour achever ce travail qui ne tend à rien moins qu'à la refonte de la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin, une vie entière ou une réunion d'ecclésiastiques, comme celle des Bollandistes. C'était d'ailleurs le rêve de l'ab-bé Jouin de fonder dans le clergé de Paris un groupement de prêtres se consacrant à ces travaux. Volontiers il en fut de-venu le chef et plus volontiers encore, le Mécène.
«Seule, nous dit le savant Professeur de l'Institut Catholique, auquel l'abbé Jouin avait demandé de continuer ce travail, seule la section de l'Enfance et le Prologue de saint Luc ont été traités.
«Je m'y suis adonné pendant des années, La guerre l'arrêta... La conception de ce plan révèle une hardiesse de vues étonnante et il fallait une rare fermeté pour l'entreprendre. Les travaux de références contenus dans les vingt-cinq cartons sont uniques au monde, et c'est un instrument de travail inappréciable pour le spécialiste du Nouveau Testament qui désire faire œuvre originale».
* * *
L'abbé Jouin aimait à se délasser de ces graves travaux par des occupations de moindre importance. Le succès con-tinu de la Nativité et celui de l'Oratorio de Notre-Dame de Lourdes à la salle Gaveau avait attiré sur lui l'attention du direc-teur d'une scène parisienne. Ce dernier s'était présenté à lui sous les auspices d'un conseiller municipal catholique de Paris, lui demandant une pièce sur un sujet religieux : «Donnez-moi la Passion, me disait-il, raconte l'abbé Jouin, et, pour triompher de mon indécision : Vous verrez, ajoutait-il, que tous les deux, nous ferons beaucoup de bien». «Un mois plus tard, ajoute l'abbé, j'étais prêt».
Telle est l'origine de la Passion, Mystère en 16 tableaux, musique d'Alexandre Georges. C'est un Oratorio, entremêlé de quelques récits, et dont l'exécution, au Nouveau Théâtre, allait se heurter aux scrupules du cardinal Richard. Peu après, il publiait une seconde Passion, Mystère en 20 tableaux, drame sacré entremêlé de chants, et dont la représenta-tion demandait une journée. L'auteur en fit plus tard une réduction qui la ramenait aux proportions d'un spectacle ordi-naire.
Représentée souvent à Saint-Ouen, sur une scène spécialement aménagée, et dans un grand nombre de théâtres de province, cette œuvre attire encore maintenant un grand concours d'auditeurs vivement impressionnés par les scènes évangéliques et par la musique empruntée à tous les Maîtres anciens.
Au cours des années suivantes, cédant à des sollicitations renouvelées et soucieux lui-même d'enrichir le répertoire théâtral des œuvres catholiques de pièces religieuses ou patriotiques, il publiait, en 1907, Clotilde, drame historique, dont le sujet avait souri au directeur de la scène dont nous avons parlé - puis Bernadette, drame historique qui met en scène les événements de Lourdes, les apparitions de la Grotte et la mort, à Nevers, de la Voyante - enfin, en 1909, Jeanne d'Arc, Mystère en cinq actes et dix-huit tableaux, orchestration de la partie musicale par M. A. Vivet, Maître de chapelle de Saint-Augustin.
Ce mystère qui avait été écrit pour le théâtre de la Passion, à Nancy, n'y fut pas représenté.
Paul Déroulède, paroissien de Saint-Augustin, auquel l'abbé Jouin avait dédié sa Clotilde, le remercia par ce billet :
«J'ai commencé hier soir et fini ce matin votre très remarquable et très intéressante étude dramatique sur Clotilde et sur Clovis. L'œuvre est forte et haute. La foi la soulève et l'émotion la soutient. Elle est tout entière écrite d'une main de chrétien et de lettré. J'en accepte avec gratitude la dédicace».
G. Goyau, à qui Jeanne d'Arc avait été dédiée, lui écrivait, à son tour :
«C'est avec émotion que j'ai suivi toutes les phases de votre beau «Mystère», où la physionomie de Jeanne, avec toutes ses beautés, resplendit si glorieusement. Vous avez fait une œuvre que depuis quatre siècles on aurait dû faire». L'ancien ministre des Affaires Étrangères, M. Flourens, avait été frappé de la portée patriotique de cette œuvre «Je vous remercie, écrivait-il à l'abbé Jouin, de me l'avoir envoyée, et vous remercie pour mon pays de l'avoir écrite».
Au lendemain de la première représentation qui avait eu lieu à Saint-Augustin, devant une assistance choisie, le R. P. Delaporte, auteur de plusieurs tragédies et d'une pièce sur la Pucelle, rendait à l'abbé Jouin ce témoignage : «Vous avez tout vu, tout cueilli, votre travail est merveilleux, votre science colossale. Je reviens ébloui de tout ce que j'ai vu et admi-ré».
Science colossale !... Le mot n'est pas exagéré. Les pièces de l'abbé Jouin sont des pages d'histoire. Elles supposent un travail énorme de recherches et la lecture de tous les ouvrages parus sur la question. Pour Clotilde, l'auteur a dépouil-lé non seulement G. Kurth et d'Arbois de Jubainville, Emile Roy et Ozanam, mais vingt autres ouvrages sur la poésie Scandinave, et, pour Jeanne d'Arc, Quicherat, Hanotaux et tous les écrivains qui ont parlé de la Pucelle.
L'imprésario pour qui Clotilde avait été écrite, ayant quitté le théâtre qu'il dirigeait avant l'achèvement de la pièce, l'ab-bé Jouin eût renoncé à son travail, s'il n'avait été encouragé par une sociétaire de la Comédie-Française, Mme Second-Weber, qui lui avait exprimé le désir de lire le premier acte. La pièce ne fut pas jouée. L'abbé Jouin s'en consolait en pen-sant qu'un jour, cette première page de notre histoire pourrait tenter un homme de génie, surtout par l'heureuse constata-tion de n'avoir pas à faire le travail ingrat de recherches laborieuses et préjudiciables à l'inspiration. Nulle épopée, ajou-tait-il, n'est plus grandiose.
«Le colosse romain s'affaisse dans la boue et le sang, les invasions barbares se pressent comme les vagues en furie, le paganisme et l'hérésie menacent l'Église elle-même, et du sein de cette effrayante oscillation du monde, le souffle divin et l'idéal évangélique vont créer l'âme d'un peuple et faire une nation catholique avec la vocation sublime d'être à jamais le soldat du Christ».
Autre remarque : chez l'abbé Jouin, le souci de la science historique poussé parfois jusqu'au scrupule, n'étouffe pas l'inspiration. Elle la soutient plutôt et, souvent, devient source d'émotion vraie.
Dans sa prison, Jeanne regrette de n'être pas tombée pour la France sur un champ de bataille, et sa mère fait cette belle réponse : «Non, ma fille, sur un champ de bataille, tu serais tombée pour la patrie, mais non pour Dieu, et tu n'au-rais pas expié les péchés de la France : ton martyre est sa rançon». Et, comme Jeanne veut écarter sa mère du bûcher, l'héroïque femme proteste : Tu te diras que dans cette foule, qui poursuit de sa haine la pauvre fille de France, il y a une femme qui t'aime ; que dans cette foule, qui se rit de la pauvre fille au grand cœur, il y a une femme qui pleure ; que dans cette foule, qui maudit la pauvre fille de Dieu, il y a une femme qui la bénit ; et que cette femme qui t'aime, qui pleure et qui te bénit, enfant, c'est ta mère !»
Dans le «Mystère de la Passion», Jésus, sur le point de monter au Calvaire, révèle à Sa mère, dans sa plénitude, le mystère de la Croix et la part qu'elle y prendra : avec Lui, elle «sauvera le monde».
Marie. - Le monde ! mais il vous poursuivra de ses opprobres ! vous voyez bien qu'il n'a pour vous qu'un gibet. Prière, larmes, sang divin, tout sera perdu, et demain, ce sera l'oubli ! Ah ! ne mourez pas pour des ingrats !
Jésus. - Mère ! Ils souffrent, eux aussi ; et dans la servitude du péché, dans l'oppression du remords, dans l'étreinte du désespoir, ils n'ont personne qui les console.
Marie. - Vous les aimez, mon Fils ?
Jésus. - Vous les aimerez comme Je les aime.
Marie. - Jusqu'à la mort ?
Jésus. - Davantage !
Marie. - Jusqu'à la mort... de mon Fils ?
Jésus. - Plus encore !
Marie. - Je ne puis.
Jésus. - Jusqu'à devenir leur Mère !
Marie. - C'est l'excès du sacrifice !
Jésus. - Votre mission est là, ma Mère... Eve enfanta dans la mort, vous enfanterez mystérieusement dans la vie. Ah ! que de fois l'humanité pécheresse passera d'âge en âge au pied du Calvaire se riant du Crucifié ! Mais quand, à son tour, une génération aura plus profondément enfoncé les clous dans Mes blessures, elle sera saisie d'une poignante émotion en voyant vos larmes et votre immense douleur. Vous retiendrez alors ceux qui passaient à la hâte sous l'arbre de la Croix, vous leur parlerez de paix, de bonheur, d'éternité, et ces révoltés, dont Mon supplice avivait la haine, tomberont à genoux parce qu'ils sentiront que vous êtes leur Mère.
Marie. - Pauvres égarés !
Jésus. - Encore un peu, et vous serez la Mère des âmes tombées ; vous les arracherez avec Moi au serpent infernal, dont vous écraserez la tête. Vous serez la Mère des âmes pardonnées, que, dans le combat de la vie, vous soutiendrez jusqu'à la victoire. Vous serez la Mère des âmes qui saignent et qui pleurent, vous verserez en elles votre infinie pitié, et votre sourire les enveloppera comme un rayon de soleil. Vous serez la Mère des âmes vaillantes, vous les précéderez pour qu'elles gravissent sans défaillance les pentes du Golgotha jusqu'à l'héroïsme, jusqu'au martyre... Mère, Mère, notre œuvre est magnifique !
Un peu plus loin, l'abbé Jouin met sur les lèvres de Madeleine, désolée de n'avoir pu ramener Judas à Jésus, cette ré-flexion profonde : «Je ne suis donc pas pardonnée, que je n'aie pu convertir une âme !» On reconnaît à ce trait le mys-tique qui savait à quel prix se rachètent les âmes.
Il n'est pas moins heureux quand il fait parler les enfants : le jeune Eliacin, tirant Jésus par sa tunique et lui disant : «Jésus, pourquoi quittes-tu Ta Mère qui pleure», nous émeut. Et Jésus de répondre : «Enfant, c'est pour t'ouvrir le para-dis !»
Le théâtre, que l'abbé Jouin cherchait ainsi à rénover pour le rendre à sa mission : l'exaltation de la patrie et l'exten-sion de la foi, c'était le théâtre des «Mystères» du Moyen- Age, que la représentation du jeu de la Passion d'Arnoul Gré-ban devant Notre-Dame vient de remettre à l'honneur. Dans un discours prononcé aux fêtes du centenaire de Combrée, dans la salle même construite à ses frais, il disait : «Bientôt le peuple n'apprendra plus l'histoire de Dieu en ce monde que dans nos vieux Mystères rajeunis», et il exhortait professeurs et élèves à effeuiller avec amour notre grande épopée na-tionale.
«Elle est belle, disait-il, et nous avons le droit de relever la tête dans l'oubli momentané du présent pour regarder le passé et y chercher l'avenir : «C'est Clotilde, tenant dans sa main les destinées de notre pays ; c'est Clovis menant triomphalement la France à son baptême et faisant d'elle, sur le champ de bataille de Vouillé, la fille aînée de l'Église. - C'est l'immense chevauchée de Charlemagne et de Roland. - Ce sont les Croisades : les prêtres qui rentrent dans Jérusalem avec l'hostie consacrée sur la poitrine, pour que le Christ vivant reprenne possession de Son tombeau ; et, dans ce défilé vainqueur, les peuples se découvrent devant nos chevaliers, en disant : Gesta Dei per Francos ! C'est Louis IX, le roi que grandit la captivité, le saint qui grandit la France. - C'est Jeanne d'Arc, que Jehan Gerson nomme «le miracle de Dieu». C'est la Ligue, qui empêche la France de devenir protestante ; c'est la Vendée, qui l'empêche de devenir athée, et cette femme que les bleus voulaient mettre à genoux pour la fusiller, et qui répondait : Je ne m'agenouille que devant Dieu !»
On retrouve dans cette page, comme dans vingt autres de même allure, le patriote ardent, le prêtre convaincu qui ai-mait du même amour son Dieu et sa patrie.
Cette recherche du document et cette chaleur d'expression se retrouvent dans les autres écrits de l'abbé Jouin à cette époque : articles dans le Bulletin de l’Association paroissiale de Saint-Augustin ou dans la Revue du R.P. Gaudeau, La Foi Catholique, dans le discours prononcé à l'occasion des vœux du clergé au Cardinal Amette, après son élévation au cardinalat ; dans les oraisons funèbres de M. l'abbé Brisset, de M. l'abbé Girodon, de M. le Chanoine Huvelin, dans celle qu'il prononça à Angers pour le service de la R. Mère Agnès, fondatrice de quatre maisons de Servantes des Pauvres , à Paris, ou dans les discours d'installation de plusieurs curés, ses anciens vicaires ou ses amis - discours qui dépassaient souvent les proportions ordinaires de ces sortes d'allocutions : il lui arriva de les prolonger au delà d'une heure. Une fois même, à Saint-Étienne du Mont, au cours d'une allocution qui dura sept quarts d'heure, un orage épouvantable se déchaîna sur Paris, plongeant l'église dans l'obscurité. Imperturbable au milieu des éclairs, l'orateur n'en continuait pas moins son discours qu'il terminait par un remarquable parallèle entre trois prêtres éminents de cette époque : l'abbé Lesêtre, l'abbé de Broglie et l'abbé Huvelin. - Discours sur la musique, à l'occasion de la restauration et, plus tard, de l'agrandissement du grand orgue, et des noces d'or de son ami, Eugène Gigout.
A côté de connaissances techniques peu communes sur l'art musical, l'abbé Jouin y déploya un talent oratoire où il semble s'être surpassé.
«A Saint-Augustin, disait l'orateur (il avait lui-même alors 84 ans) l'église, l'orgue et l'organiste sont du même âge, et aucun des trois n'a vieilli».
Aux noces de diamant du Maître, le Curé de Saint-Augustin louait en M. Gigout, l'harmoniste savant, l'improvisateur remarquable et l'organiste liturgiste.
En une page jolie, il caractérisait deux morceaux du Maître :
«Le Chœur dialogué où le motif principal parcourt les touches, les claviers et les jeux pour éclater en sonorités toujours variées, échapper à l'harmonie qui voudrait l'emprisonner et fatiguer ainsi les motifs secondaires qui ont peine à le suivre dans cette course échevelée. Puis, lorsqu'on le croit lui-même à bout de force mélodique, il reparaît tout à coup, par suite de modulations chromatiques, dans une autre tonalité qui ouvre le champ inexploré à son bril-lant essor ; ou bien, comme dans un magique changement à vue, il se sert d'une note enharmonique pour s'esquiver et se créer de plus vastes horizons ; ou enfin, dédaigneux des tonalités modernes que la sensible, impitoyable geô-lier, retient captives dans les sept notes diatoniques, il reprend les allures plus indécises, mais plus grandioses du plain-chant, commence une marche triomphale, - la Marche religieuse de notre grand maître, semblable aux magni-fiques processions de Lourdes -, il entraîne à sa suite toutes les puissances de l'orgue et, dans cet unique ensemble, se servant des gammes, des tonalités, des octaves, comme des degrés d'une échelle mystérieuse, il s'élève à de tels accords et à de telles inspirations que les harmonies de la terre se mêlent déjà aux harmonies du Ciel».
Et l'orateur cherche à scruter l'avenir. Il se demande quelle sera là-haut la place du Maître dans ce prestigieux or-chestre formé des deux chœurs des anges et des hommes.
«Que chanter après les Anges dont la mémoire, l'intelligence et la volonté envelopperont Dieu d'acclamations, d'actions de grâce et d'amour
«Et cependant, répond-il, en un écho légèrement atténué, le chœur des hommes répondra au chœur des anges. Le ton en sera moins éclatant, mais il sera dominé par une note plus vibrante, plus frémissante, plus déchirante, la note de la douleur humaine, divinisée par les souffrances du Christ Jésus et de la Vierge Marie ; et je vois les Anges, penchés vers nous, en proie à une sainte jalousie qu'ils tourneront à la gloire de Dieu».
«Ils sont au-dessus de nous, les Anges, mais il ne leur a pas été donné de marcher jusqu'à l'épuisement et de mendier sur la margelle du puits un peu d'eau à la Samaritaine. Ils n'ont pas des mains bénissantes pour caresser délicatement les plaies humaines et les guérir... Ils n'ont pas connu la poignante harmonie des sanglots et des larmes... Ils n'ont pu verser à flots ou répandre goutte à goutte le sang que les confesseurs de la foi viennent ajouter au calice de l'autel. Ils n'ont pas senti la blessure au cœur, blessure du cœur percé de Jésus. Ce chant d'appel des âmes égarées, ce chant de la douce pitié, ce chant voile des larmes, ce chant strident du martyre, ce chant du Cal-vaire, les Anges l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas chanté, car ils n'ont pas souffert, car ils n'ont pas pleuré, ni les larmes blanches des yeux, ni les larmes rouges du cœur...»
Et s'adressant au jubilaire, il terminait par ces mots :
«Maître, les larmes ne vous ont pas été épargnées : elles vous vaudront de chanter à votre tour, là-haut, le chant du Calvaire, et lorsque vos harmonies faites à jamais de plaintes consolées, de larmes essuyées, de douleurs divini-sées auront rempli de leurs majestueuses sonorités les océans de lumière du paradis, lorsque vous frapperez le der-nier accord du chant du Calvaire, les chœurs des Anges émus et ravis, laisseront négligemment tomber leurs harpes et leurs luths, et prosternés avec nous aux pieds du Sacré-Cœur, nous l'adorerons ensemble un instant dans un si-lence d'éternité, tibi silentium laus».
Cette admiration de l'abbé Jouin pour la musique n'était pas chez lui une attitude affectée et superficielle. Elle résul-tait, écrira son maître de chapelle, M. Vivet, d'un sentiment véritablement profond et inné. «Sa prodigieuse mémoire et la fréquentation des artistes lui avaient acquis une certaine expérience qui, dit-il, lui tint lieu de culture jusqu'au jour où dési-rant analyser ses sensations, il voulut, à l'âge mûr, étudier les règles de l'harmonie».
Celui qui parlait si bien de la musique n'en pouvait vouloir que d'excellente : chez lui, d'abord. Il ne laissait échapper aucune occasion pour attirer au presbytère les grands artistes de passage à Paris. Le nouveau chef de la Chapelle Six-tine, Mgr Perosi, se fit honneur de venir entendre dans les salons du presbytère, en compagnie du Nonce, une de ses œuvres, La Résurrection de Lazare, que l'abbé Jouin fit exécuter par ses artistes.
La musique religieuse surtout intéressait le Curé de Saint-Augustin. «Il ne la souffrait pas de qualité inférieure, dit M. Vivet, fût-ce dans les plus simples cérémonies du culte ; il la voulait digne de sa mission, de haute facture et parfaitement interprétée. A cette fin, il consentait des sacrifices personnels pour assurer à sa Maîtrise de belles voix et les meilleurs ar-tistes... Lorsque son maître de chapelle lui soumettait les programmes, il était heureux d'y ajouter ou d'y substituer quelque autre œuvre encore plus belle... «pour le bon Dieu», soulignait-il.
Il était de notoriété publique qu'à Saint-Augustin, le culte atteignait non seulement la décence souveraine à laquelle il a droit partout, mais à la splendeur qui convenait à cette pieuse et opulente paroisse.
«On ne laisse pas Jésus dans la misère quand on vit soi-même dans l'abondance, dira le R.P. Hébert, le jour des noces d'or du Curé de Saint-Augustin. Dès qu'on l'aime, on trouve naturellement qu'il n'y a rien de trop beau pour Lui. M. l'abbé Jouin est resté fidèle à cette tradition des âges et des peuples de foi. Il a tenu à honneur d'entretenir et de développer la splendeur du culte. Cérémonies parfaitement réglées et exécutées avec une dignité méticuleuse, or-nementation abondante des autels par la profusion des fleurs et des lumières, accompagnement musical aussi splendidement artistique que possible, il a tenu pendant vingt ans la main à tout. Je ne voudrais pas jurer, ajoutait l'orateur, qu'il fut, en ceci, toujours et par tous, parfaitement compris. Mais les critiques, où il ne se refuse pas de s'instruire, ne le déconcertent pas, ni ne le détournent jamais. Elles l'aident seulement à se dépasser lui-même, et il a coutume de les faire taire en visant toujours à une plus sévère perfection. Ainsi en a-t-il usé pour garder dans la pa-roisse la splendeur du service divin. Pour qui a vu, dans cette église, l'affluence énorme des grandes fêtes, il est ma-nifeste que le troupeau a, de toute son âme, partagé les goûts du Pasteur et témoigné du réconfort qu'il puisait à y trouver satisfaction».
A quelles critiques faisait allusion ce passage ? De quel tribunal semblait-il en appeler au jugement du troupeau pour justifier le Pasteur ?
Par un motu proprio du 22 novembre 1903, Pie X avait rappelé «les principes qui règlent la musique sacrée dans les fonctions du culte», et les prescriptions de l'Église contre les abus les plus répandus en cette matière. Mais, tout en don-nant la préférence au chant grégorien, et à la polyphonie classique palestinienne, il ne réprouvait pas la musique plus moderne.
M. Jouin n'avait pas attendu le motu proprio pour écarter de son église toutes les compositions musicales «renfermant des réminiscences de motifs usités au théâtre ou reproduisant, dans leurs formes extérieures, l'allure des morceaux pro-fanes. «Depuis longtemps, dit M. Vivet, il avait prohibé du sanctuaire les morceaux de théâtre ou à effets dramatiques, et banni les instruments de cuivre. Il réprouvait fortement encore l'abus des dissonances de la musique ultramoderne. Il ap-préciait peu l'école palestrinienne, à la longue monotone et conventionnelle. Quant au chant grégorien, avec les évêques qui ne l'ont pas adopté dans leurs diocèses, il n'en admettait pas l'exclusivité pour l'universalité catholique, la jugeant im-praticable à la plupart des maîtrises».
C'est alors que, dans le Temps du 14 février 1904, parut un article de M. Camille Bellaigue. Sous le titre de Sil-houettes de musiciens - Messieurs les Curés de Paris, le critique musical accusait ces derniers de «dissiper l'esprit des fidèles et de les détourner de la prière, de travestir le Christ en héros de théâtre en introduisant dans leurs offices des morceaux tirés d'opéras, au lieu d'y faire entendre exclusivement le chant grégorien».
L'auteur citait un «salut de Noël» à Saint-Augustin. «Le programme ou l'affiche, disait-il, se lisait à la porte de l'église. Il s'y vendra peut-être un jour avec la photographie et le portrait de tous les artistes».
Cette plaisanterie, le choix du journal à qui le critique confiait ses doléances, la désignation de la paroisse Saint-Augustin donnaient à M. l'abbé Jouin le droit de répondre. Il le fit en son nom et au nom de tous ses confrères dans un article du Gaulois.
Il citait, d'abord, les paroles du Pape :
«L'Église a toujours favorisé le progrès des arts, en admettant au service du culte tout ce que le génie a trouvé de bon et de beau dans le cours des siècles, sans toutefois violer jamais les lois de la liturgie. C'est pourquoi la musique plus moderne est aussi admise dans l'église, car elle fournit, elle aussi, des compositions dont la valeur, le sérieux, la gravité les rendent en tous points dignes des fonctions liturgiques».
L'abbé Jouin continuait :
«Je vais sans doute, cher Maître, vous faire sourire de pitié, je ne puis cependant vous cacher que, depuis plus de dix ans, tous mes efforts, dans le choix de la musique classique, dans le mélange des auteurs modernes, depuis Pa-lestrina, Vittoria, Bach, jusqu'à Franck, Saint-Saëns et même Gounod, tous mes efforts ont eu pour but de relever dans une idée large, la musique religieuse. J'estime, en effet, qu'elle n'est ni d'une époque, ni de quelques privilégiés ; que son inspiration est au fond de toute âme humaine, comme le sens religieux lui-même ; que tous les siècles, avec le progrès des instruments et des méthodes, doivent lui payer leur tribut ; que l'Église, étant divine, on lui dédie-ra à tous les âges des chants immortels, dont la diversité répond aux mille sentiments qui partagent nos cœurs et que nous avons dès lors le pieux devoir, tout en restant dans la note sacrée, de rejeter un exclusivisme qui, pour ali-menter la piété de rares fidèles, serait nuisible et fastidieux à la plupart».
Cette première lettre se terminait par ces mots :
«Je regrette que tout en défendant, dans un cercle rétréci, une bonne cause, vous rejetiez la responsabilité de son insuccès sur les Curés de Paris. N'est-ce pas battre en brèche la paroisse, notre suprême rempart aujourd'hui, et mettre dans une certaine mesure votre plume de critique autorisé au service de nos ennemis en nous jetant le dis-crédit et en nous tournant en dérision ?»
La polémique se poursuivit dans le Gaulois au cours de quatre articles sans apporter d'éléments nouveaux. Il était évident que le critique musical, dont les exigences allaient manifestement au-delà du décret, et le Curé de Saint-Augustin plaidant, pour la musique moderne dans les limites tracées par le motu proprio, ne pouvaient s'accorder : chacun des ad-versaires demeura sur ses positions.
* * *
Cette activité intellectuelle qu'il dépensait au service de Dieu dans ses livres, ses articles ou ses discours, ne l'absor-bait pas au point de lui faire oublier des travaux d'ordre moins relevé pour l'embellissement de son église : l'achèvement des décorations de la chapelle de la Sainte Vierge, les peintures murales des chapelles des catéchismes et du presby-tère, le relevage du Grand Orgue, le transfert de l'orgue d'accompagnement dans une tribune latérale, l'ouverture directe des portes sur la rue de la Bienfaisance à la place du labyrinthe obscur et dangereux d'autrefois, l'installation de l'éclai-rage électrique et surtout l'érection, à l'entrée du chœur, des statues monumentales de saint Augustin et de sainte Mo-nique, don de la paroisse à l'occasion, de son jubilé pastoral et œuvre du sculpteur Louis-Noël, doivent être attribuées à son administration.
Mais le meilleur de son temps, il le donnait à ses livres. Son panégyriste de 1918 nous le montre prenant sa revanche de n'avoir pu mener la vie dominicaine en se faisant, dans le monde, bénédictin, «passant ses jours au milieu des livres, disait-il, de ceux qu'il a écrit comme de ceux qu'il compulse de la même main nerveuse et infatigable : armée innombrable dont les vagues successives s'accroissent toujours et déferlent maintenant jusque dans sa chambre à coucher».
Ce que l'abbé Jouin cherchait dans l'étude c'était sa puissance de réalisation. Dans ces livres qui s'entassaient dans toutes les pièces du presbytère, il ne voyait que des instruments pour produire du bien. Aussi a-t-il pu sans scrupule se consacrer au travail, «sacrifiant tout ce qui lui paraissait moins utile : visites, lecture des journaux et jusqu'aux soins de sa santé». «Il me souvient, dit le P. Hébert, d'une après-midi d'automne où, me montrant, de son presbytère, l'église de Saint-Augustin, il me disait simplement : «Depuis quatre mois, sauf deux sorties, j'ai fait juste le chemin qui conduit d'ici à l'église et de l'église ici : l'avenue Portalis à traverser. Et il avait l'air si content ! Qu'en pensait au juste son médecin ?»
* * *
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 6)
CHAPITRE VI LE CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN. (1899-1932)
LA TACHE IMMENSE DU CURE DE SAINT-AUGUSTIN.
L'HOMME D'ETUDE : CHAQUE DIMANCHE LA MESSE DU JOUR EXPLIQUEE EST DISTRIBUEE AUX PAROISSIENS. FONDATION DE LA REVUE : LE CA-TECHISME. - IL ENTREPREND UN TRAVAIL COLOSSAL SUR LES EVANGILES. - LE THEATRE CHRETIEN : LE MYSTERE DE LA PASSION», «LE MYSTERE DE JEANNE D'ARC», CLOTILDE, BERNADETTE. - AUTRES ECRITS DE L'ABBE JOUIN : DISCOURS D'INSTALLATIONS ; DISCOURS SUR LA MUSIQUE ET SUR LES MUSICIENS. - POLEMIQUE AVEC M. CAMILLE BELLAÏGNE A PROPOS DE LA MUSIQUE SACREE.
L'HOMME D'ACTION : LES INVENTAIRES A SAINT-AUGUSTIN. L'ABBE JOUIN INVITE SES PAROISSIENS A UNE MESSE DE «DEUIL ARME». IL EST TRA-DUIT EN POLICE CORRECTIONNELLE ET CONDAMNE A 16 FRANCS D'AMENDE. - SA FIERE DECLARATION DEVANT SES JUGES.
L'HOMME DE CŒUR : FONDATION D'UNE TROISIEME MAISON DE SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE L'HOPITAL 139.
SES EPREUVES : IL PERD SA MERE ET SON FRERE HENRY JOUIN. - LA «PASSION» AU NOUVEAU THEATRE. - EPREUVES PATRIOTIQUES. - LA MOBILI-SATION DE LA PRIERE.
«Cette tâche immense» qu'on imposait à l'abbé Jouin, celui-ci était de taille à l'entreprendre. Il venait d'atteindre sa cinquante-quatrième année et, en dépit des premières attaques d'une affection qui ne devait avoir raison de sa résistance que longtemps plus tard, sa santé s'était raffermie. Un portrait de lui de cette époque respire la force et la vie. L'abbé Jouin est debout. Une main serre le bréviaire - l'arme surnaturelle de la prière - l'autre est libre, prête à se tendre pour l'action. L'œil est vif et pénétrant ; le front, sans ride, abrite une pensée forte et réfléchie ; la bouche largement fendue annonce l'orateur, mais le menton carré exprime une volonté tenace. L'ensemble donne l'impression de l'énergie éclairée par une belle intelligence et mise au service d'un cœur qu'on devine très bon. Esprit ouvert, volonté ferme, bonté accueil-lante : trois mots qui résument l'activité pastorale de l'abbé Jouin au cours de cette étape de trente-trois ans, la dernière de sa longue existence.
On se tromperait si l'on croyait que même à cette époque il n'y eût que des «chefs» à Saint-Augustin. Des gens de service, des employés, de petits commerçants, des pauvres même côtoyaient à l'église des familles nobles, des amiraux en retraite, d'éminents avocats, des magistrats réputés, de savants praticiens, des professeurs en renom, des industriels, des hommes d'affaires. Plus en vue en raison de leur culture et de leur situation sociale, la plupart faisaient rayonner au-tour d'eux sur les «simples soldats» l'exemple de leurs pratiques chrétiennes. On les voyait nombreux à la Sainte-Table, même au prône de la grand'messe. Mais à côté d'eux, beaucoup de demi-chrétiens se pressaient aux messes de onze heures, de midi et même d'une heure, - où l'on ne prêchait pas. Le regard distrait, les lèvres closes, parfois debout, ces mondains, ces mondaines, pour qui la messe du dimanche et le devoir pascal étaient le dernier mot de la religion pra-tique, priaient-ils, et que savaient-ils du grand «mystère de la foi» auquel, par habitude, peut-être, ils venaient assister de corps plus que d'esprit ? Le nouveau pasteur résolut de le leur apprendre : désormais et pendant des années, chaque paroissien trouvera sur son prie-Dieu, en venant remplir le devoir dominical, une brochure où la Messe du Jour lui était commentée dans ses parties principales ou ses rites les plus frappants. Plus de quatre cent mille de ces brochures furent ainsi imprimées et distribuées aux frais du Curé pour qui l'argent comptait peu au regard du bien spirituel de ses parois-siens. Un des premiers devoirs du pasteur, répétait-il dans ses discours d'installation de ses vicaires ou de ses amis, c'est d'enseigner la doctrine à son peuple.
Pour lui, il voulut faire plus. Afin de combattre au loin l'ignorance religieuse dont il disait que «la France se meurt bien plus que d'impiété», pour restaurer «dans les villes comme dans les campagnes l'enseignement parfois trop négligé du Catéchisme», avec le concours d'ecclésiastiques et d'amis, il entreprit la publication d'une Revue d'enseignement reli-gieux. «Notre premier but, écrivait-il au cardinal Richard, serait d'être utile à tous ceux qui, par vocation ou par piété, se livrent à l'enseignement de la religion ; le second sera réalisé le jour où pénétrant dans les familles, nous y apporterons un accroissement de foi pratique et de vie chrétienne».
Le Catéchisme parut le 10 avril 1900, avec la bénédiction et les encouragements du Cardinal. L'instruction sous toutes ses formes et pour tous les âges, tel était le programme de la nouvelle publication. «Aux explications du Caté-chisme, nous nous proposons d'ajouter des articles suivis sur l'ancien et le nouveau Testament, l'Histoire évangélique et, plus tard, l'Histoire de l'Église, et de fortifier également le côté de la prédication, au point de vue de l'homélie et du mot de piété, par de sérieuses connaissances patrologiques et hagiographiques. Nous offrirons de la sorte à la jeunesse et à ceux mêmes qui sont chargés de l'instruire une synthèse complète de l'enseignement religieux».
Dans le premier numéro, l'abbé Polack, second vicaire de Saint-Augustin, commençait une explication de l'Histoire sainte, et le R. P. Magnié, S.J., donnait un premier article sur la Sainteté .et un autre sur la Vie des Saints. D'autres colla-borateurs, comme l'abbé Villien, doyen de la Faculté de droit canonique, et l'abbé Bossard, viendront se joindre aux pre-miers. Pour l'abbé Jouin, il se réserve l'explication du Catéchisme : littérale, pour les petits ; logique, pour la Première Communion ; supérieure, pour la Persévérance. Dans la Revue paraîtront peu à peu ces explications logiques par de-mandes et par réponses auxquelles il travaillait depuis vingt ans, et dont la publication était souhaitée par un grand nombre de catéchistes. (Nous espérons qu'un jour ces articles, détachés de la Revue, seront publiés en volume).
Enfin, dans ce même numéro, il commençait la publication de la Somme de tous les Catéchismes français : «Il ne saurait échapper à personne, soulignait-il, de quel prix serait ce travail, si l’Episcopat, se conformant un jour à un vœu qui devient universel, acceptait l'unité du Catéchisme pour la France. Cette publication renfermerait alors tous les matériaux de la nouvelle et unique rédaction».
Au Congrès sacerdotal qui se tint à Bourges cette même année 1900, l'abbé Jouin fut invité par l'abbé Lemire à pro-noncer le discours d'ouverture et il y traita de cette importante question du Catéchisme.
Cette compétence du Curé de Saint-Augustin dans la question de l'enseignement catéchistique, le désigna au choix du Cardinal Amette, successeur du Cardinal Richard, pour l'étude des mesures pratiques à établir pour l'application à Pa-ris du Décret de Pie X sur l'âge de la première communion des enfants.
L'usage, presque général en France, était, on le sait, de n'admettre les enfants à l'Eucharistie que vers onze ans, après une instruction qui durait deux années, et à la suite d'une retraite de trois jours, à la fin de laquelle l'enfant faisait une confession générale et recevait l'absolution de ses fautes.
Toutefois, au cours des deux années préparatoires les enfants se confessaient régulièrement et beaucoup de prêtres les préparaient à l'absolution, quand ils en avaient besoin, surtout à la fin de la première année de catéchisme.
La solennité dont on entourait la première rencontre de l'enfant avec l'Eucharistie exerçait sur lui et sur les parents une impression profonde. A partir de ce jour, il était admis dans les rangs de la famille chrétienne et reçus comme tous les chrétiens à la participation des Sacrements. Le soir du «Grand Jour», l'enfant avait renouvelé solennellement et per-sonnellement les promesses faites en son nom le jour de son baptême. Si, dans le cours de la vie, il lui arrivait de les vio-ler, le souvenir de sa première communion devenait souvent pour le prodigue le principe de son retour à Dieu.
Mais en privant jusqu'à 11, 12 et même jusqu'à 14 ans, comme en Allemagne, les enfants du bienfait de l'Eucharistie et de la Pénitence, ne sacrifiait-on pas à un souci exagéré de leur instruction religieuse leur innocence et leur vie mo-rale ? Ne valait-il pas mieux prévenir le mal qu'avoir à le guérir ?
Le Pape l'avait pensé et, par le décret Quam singulari, il avait établi que désormais, à de certaines conditions de piété et de science proportionnées à leur âge et avec le consentement des parents, les enfants seraient admis à communier dès l'âge de raison, c'est-à-dire vers leur septième année, plus ou moins, sans solennité. L'appareil extérieur était réservé pour une communion qui devait marquer la fin des catéchismes tels qu'on les faisait jusqu'alors.
Ce décret, qui bouleversait les méthodes suivies et que le clergé de Paris, en particulier, appliquait avec un zèle en-core accru par la laïcisation des écoles officielles, provoqua une émotion considérable. Un double courant se formait : les uns, par un zèle exagéré, faisaient communier des enfants de cinq ans, ou sans tenir compte des conditions posées par le décret, d'autres se préoccupaient à l'excès de sa répercussion sur les catéchismes préparatoires à la Communion so-lennelle et sur ceux de persévérance. A quel âge fallait-il fixer cette communion solennelle qui marquerait - on n'en pou-vait douter - la fin de l'instruction religieuse ? En la maintenant à onze ans, pourrait-on retenir jusque là des enfants ayant commencé à communier depuis trois ou quatre ans ?
En l'avançant à dix ans, on les libérait du catéchisme à l'âge même où leur jeune esprit pouvait en profiter. Qu'allaient devenir les catéchismes de persévérance ? Pour un petit nombre d'enfants de familles pieuses, n'allait-on point en sacri-fier des milliers d'autres que des familles indifférentes avaient confié à l'école laïque ?...
Pour résoudre ces difficultés le Cardinal prit l'avis de ses curés. Il chargea celui de Saint-Augustin d'un travail sur ces graves problèmes.
C'est l'origine du Commentaire sur le Décret, commentaire qui ne fut pas publié.
L'étude se terminait par ces conclusions pratiques :
Il ressort du Décret et de la doctrine des théologiens sur lesquels il s'appuie
1° que les enfants doivent communier dès l'âge de discrétion ; c'est à dire vers 7 ans, plus ou moins, mais que, d'après les théologiens cités dans le décret les enfants n'atteignent, d'une manière générale, cet usage de la raison re-quis pour communier que de 9 à 11 ans, si bien que communément l'âge de 10 ans est accepté comme étant normale-ment et de droit commun, sauf les cas exceptionnels, l'âge de discrétion eucharistique.
2° que la première communion des enfants qui auront atteint, avant les autres, l'âge de discrétion, se fera sous forme privée ; mais que le Décret maintient et ordonne dans toute l'Église la première communion solennelle et publique, pré-cédée d'une retraite.
3° que l'âge de discrétion suppose, en principe dans l'enfant, en plus de la pureté, deux conditions essentielles : a) une instruction suffisante pour discerner le pain eucharistique du pain matériel, et pour comprendre suivant sa capacité, les mystères de la foi, nécessaires de nécessité de moyen, b) la dévotion au Saint-Sacrement et le désir de la commu-nion.
4° que les parents, les instituteurs, le confesseur et le curé sont juges de l'âge de discrétion de l'enfant et de sa prépa-ration suffisante à la réception des Sacrements, mais qu'il faut prendre garde que les parents ne veuillent hâter la pre-mière communion, par suite de motifs humains, comme : la vanité d'avoir un enfant plus avancé que les autres ; d'éviter les frais d'une communion solennelle ; la préoccupation des études et des examens qui contrarierait le catéchisme, etc.
5° que le Décret enjoint aux nouveaux communiants de suivre les catéchismes après leur première communion, et or-donne à ceux qui ont la charge des enfants d'y veiller et de les faire communier fréquemment et dévotement.
Mais qu'il est d'expérience notoire que les catéchismes de persévérance sont bien moins suivis et bien moins fruc-tueux, surtout pour les garçons, que le catéchisme de première communion.
Le Curé de Saint-Augustin se préoccupait aussi des tendances d'un certain nombre d'esprits qui semblaient alors faire fi des traditions de l'Église. Il se rencontrait d'ailleurs sur ce terrain avec le Souverain Pontife, Pie X, dont l'Encyclique Pascendi, du 8 décembre 1907, dévoilait et condamnait une hérésie d'une extrême habileté, qui se répandait en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Les écrivains qui la propageaient, hommes de talent et de style, prenaient soin de ne la présenter que morcelée, cachée, camouflée. Sous des formules de respect et avec le désir apparent de réconcilier l'Église avec son temps et de la moderniser pour son plus grand bien, ces prétendus rénovateurs, historiens, théologiens, exégètes ou romanciers, la ruinaient entièrement dans son autorité, son dogme et sa morale.
L'abbé Jouin crut qu'on pouvait combattre le modernisme et lui enlever ses armes par l'autorité des Pères de l'Église et leurs commentaires. Il se mit à l'œuvre, sans souci du temps et des efforts qu'elle exigerait.
Après avoir relevé et copié dans la Patrologie grecque et latine toutes les références se rapportant à chaque verset de la Bible, le travail personnel consistait à faire la critique du texte biblique : critique textuelle, philologique, exégétique, his-torique, théologique, liturgique et même artistique. La critique exégétique, à elle seule, comprenait l'opinion de tous les Pères et des commentateurs modernes. Le travail était partagé par sections : Prologue de saint Luc, Annonciation, Visita-tion, etc. Œuvre gigantesque, dont le cadre préparé depuis des années se voyait dans la bibliothèque du Curé de Saint- Augustin : vingt-cinq cartons in-folio contenant, au témoignage de M. l'abbé Viteau, sept mille feuilles et pesant 150 Kilos.
Il faudrait pour achever ce travail qui ne tend à rien moins qu'à la refonte de la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin, une vie entière ou une réunion d'ecclésiastiques, comme celle des Bollandistes. C'était d'ailleurs le rêve de l'ab-bé Jouin de fonder dans le clergé de Paris un groupement de prêtres se consacrant à ces travaux. Volontiers il en fut de-venu le chef et plus volontiers encore, le Mécène.
«Seule, nous dit le savant Professeur de l'Institut Catholique, auquel l'abbé Jouin avait demandé de continuer ce travail, seule la section de l'Enfance et le Prologue de saint Luc ont été traités.
«Je m'y suis adonné pendant des années, La guerre l'arrêta... La conception de ce plan révèle une hardiesse de vues étonnante et il fallait une rare fermeté pour l'entreprendre. Les travaux de références contenus dans les vingt-cinq cartons sont uniques au monde, et c'est un instrument de travail inappréciable pour le spécialiste du Nouveau Testament qui désire faire œuvre originale».
* * *
L'abbé Jouin aimait à se délasser de ces graves travaux par des occupations de moindre importance. Le succès con-tinu de la Nativité et celui de l'Oratorio de Notre-Dame de Lourdes à la salle Gaveau avait attiré sur lui l'attention du direc-teur d'une scène parisienne. Ce dernier s'était présenté à lui sous les auspices d'un conseiller municipal catholique de Paris, lui demandant une pièce sur un sujet religieux : «Donnez-moi la Passion, me disait-il, raconte l'abbé Jouin, et, pour triompher de mon indécision : Vous verrez, ajoutait-il, que tous les deux, nous ferons beaucoup de bien». «Un mois plus tard, ajoute l'abbé, j'étais prêt».
Telle est l'origine de la Passion, Mystère en 16 tableaux, musique d'Alexandre Georges. C'est un Oratorio, entremêlé de quelques récits, et dont l'exécution, au Nouveau Théâtre, allait se heurter aux scrupules du cardinal Richard. Peu après, il publiait une seconde Passion, Mystère en 20 tableaux, drame sacré entremêlé de chants, et dont la représenta-tion demandait une journée. L'auteur en fit plus tard une réduction qui la ramenait aux proportions d'un spectacle ordi-naire.
Représentée souvent à Saint-Ouen, sur une scène spécialement aménagée, et dans un grand nombre de théâtres de province, cette œuvre attire encore maintenant un grand concours d'auditeurs vivement impressionnés par les scènes évangéliques et par la musique empruntée à tous les Maîtres anciens.
Au cours des années suivantes, cédant à des sollicitations renouvelées et soucieux lui-même d'enrichir le répertoire théâtral des œuvres catholiques de pièces religieuses ou patriotiques, il publiait, en 1907, Clotilde, drame historique, dont le sujet avait souri au directeur de la scène dont nous avons parlé - puis Bernadette, drame historique qui met en scène les événements de Lourdes, les apparitions de la Grotte et la mort, à Nevers, de la Voyante - enfin, en 1909, Jeanne d'Arc, Mystère en cinq actes et dix-huit tableaux, orchestration de la partie musicale par M. A. Vivet, Maître de chapelle de Saint-Augustin.
Ce mystère qui avait été écrit pour le théâtre de la Passion, à Nancy, n'y fut pas représenté.
Paul Déroulède, paroissien de Saint-Augustin, auquel l'abbé Jouin avait dédié sa Clotilde, le remercia par ce billet :
«J'ai commencé hier soir et fini ce matin votre très remarquable et très intéressante étude dramatique sur Clotilde et sur Clovis. L'œuvre est forte et haute. La foi la soulève et l'émotion la soutient. Elle est tout entière écrite d'une main de chrétien et de lettré. J'en accepte avec gratitude la dédicace».
G. Goyau, à qui Jeanne d'Arc avait été dédiée, lui écrivait, à son tour :
«C'est avec émotion que j'ai suivi toutes les phases de votre beau «Mystère», où la physionomie de Jeanne, avec toutes ses beautés, resplendit si glorieusement. Vous avez fait une œuvre que depuis quatre siècles on aurait dû faire». L'ancien ministre des Affaires Étrangères, M. Flourens, avait été frappé de la portée patriotique de cette œuvre «Je vous remercie, écrivait-il à l'abbé Jouin, de me l'avoir envoyée, et vous remercie pour mon pays de l'avoir écrite».
Au lendemain de la première représentation qui avait eu lieu à Saint-Augustin, devant une assistance choisie, le R. P. Delaporte, auteur de plusieurs tragédies et d'une pièce sur la Pucelle, rendait à l'abbé Jouin ce témoignage : «Vous avez tout vu, tout cueilli, votre travail est merveilleux, votre science colossale. Je reviens ébloui de tout ce que j'ai vu et admi-ré».
Science colossale !... Le mot n'est pas exagéré. Les pièces de l'abbé Jouin sont des pages d'histoire. Elles supposent un travail énorme de recherches et la lecture de tous les ouvrages parus sur la question. Pour Clotilde, l'auteur a dépouil-lé non seulement G. Kurth et d'Arbois de Jubainville, Emile Roy et Ozanam, mais vingt autres ouvrages sur la poésie Scandinave, et, pour Jeanne d'Arc, Quicherat, Hanotaux et tous les écrivains qui ont parlé de la Pucelle.
L'imprésario pour qui Clotilde avait été écrite, ayant quitté le théâtre qu'il dirigeait avant l'achèvement de la pièce, l'ab-bé Jouin eût renoncé à son travail, s'il n'avait été encouragé par une sociétaire de la Comédie-Française, Mme Second-Weber, qui lui avait exprimé le désir de lire le premier acte. La pièce ne fut pas jouée. L'abbé Jouin s'en consolait en pen-sant qu'un jour, cette première page de notre histoire pourrait tenter un homme de génie, surtout par l'heureuse constata-tion de n'avoir pas à faire le travail ingrat de recherches laborieuses et préjudiciables à l'inspiration. Nulle épopée, ajou-tait-il, n'est plus grandiose.
«Le colosse romain s'affaisse dans la boue et le sang, les invasions barbares se pressent comme les vagues en furie, le paganisme et l'hérésie menacent l'Église elle-même, et du sein de cette effrayante oscillation du monde, le souffle divin et l'idéal évangélique vont créer l'âme d'un peuple et faire une nation catholique avec la vocation sublime d'être à jamais le soldat du Christ».
Autre remarque : chez l'abbé Jouin, le souci de la science historique poussé parfois jusqu'au scrupule, n'étouffe pas l'inspiration. Elle la soutient plutôt et, souvent, devient source d'émotion vraie.
Dans sa prison, Jeanne regrette de n'être pas tombée pour la France sur un champ de bataille, et sa mère fait cette belle réponse : «Non, ma fille, sur un champ de bataille, tu serais tombée pour la patrie, mais non pour Dieu, et tu n'au-rais pas expié les péchés de la France : ton martyre est sa rançon». Et, comme Jeanne veut écarter sa mère du bûcher, l'héroïque femme proteste : Tu te diras que dans cette foule, qui poursuit de sa haine la pauvre fille de France, il y a une femme qui t'aime ; que dans cette foule, qui se rit de la pauvre fille au grand cœur, il y a une femme qui pleure ; que dans cette foule, qui maudit la pauvre fille de Dieu, il y a une femme qui la bénit ; et que cette femme qui t'aime, qui pleure et qui te bénit, enfant, c'est ta mère !»
Dans le «Mystère de la Passion», Jésus, sur le point de monter au Calvaire, révèle à Sa mère, dans sa plénitude, le mystère de la Croix et la part qu'elle y prendra : avec Lui, elle «sauvera le monde».
Marie. - Le monde ! mais il vous poursuivra de ses opprobres ! vous voyez bien qu'il n'a pour vous qu'un gibet. Prière, larmes, sang divin, tout sera perdu, et demain, ce sera l'oubli ! Ah ! ne mourez pas pour des ingrats !
Jésus. - Mère ! Ils souffrent, eux aussi ; et dans la servitude du péché, dans l'oppression du remords, dans l'étreinte du désespoir, ils n'ont personne qui les console.
Marie. - Vous les aimez, mon Fils ?
Jésus. - Vous les aimerez comme Je les aime.
Marie. - Jusqu'à la mort ?
Jésus. - Davantage !
Marie. - Jusqu'à la mort... de mon Fils ?
Jésus. - Plus encore !
Marie. - Je ne puis.
Jésus. - Jusqu'à devenir leur Mère !
Marie. - C'est l'excès du sacrifice !
Jésus. - Votre mission est là, ma Mère... Eve enfanta dans la mort, vous enfanterez mystérieusement dans la vie. Ah ! que de fois l'humanité pécheresse passera d'âge en âge au pied du Calvaire se riant du Crucifié ! Mais quand, à son tour, une génération aura plus profondément enfoncé les clous dans Mes blessures, elle sera saisie d'une poignante émotion en voyant vos larmes et votre immense douleur. Vous retiendrez alors ceux qui passaient à la hâte sous l'arbre de la Croix, vous leur parlerez de paix, de bonheur, d'éternité, et ces révoltés, dont Mon supplice avivait la haine, tomberont à genoux parce qu'ils sentiront que vous êtes leur Mère.
Marie. - Pauvres égarés !
Jésus. - Encore un peu, et vous serez la Mère des âmes tombées ; vous les arracherez avec Moi au serpent infernal, dont vous écraserez la tête. Vous serez la Mère des âmes pardonnées, que, dans le combat de la vie, vous soutiendrez jusqu'à la victoire. Vous serez la Mère des âmes qui saignent et qui pleurent, vous verserez en elles votre infinie pitié, et votre sourire les enveloppera comme un rayon de soleil. Vous serez la Mère des âmes vaillantes, vous les précéderez pour qu'elles gravissent sans défaillance les pentes du Golgotha jusqu'à l'héroïsme, jusqu'au martyre... Mère, Mère, notre œuvre est magnifique !
Un peu plus loin, l'abbé Jouin met sur les lèvres de Madeleine, désolée de n'avoir pu ramener Judas à Jésus, cette ré-flexion profonde : «Je ne suis donc pas pardonnée, que je n'aie pu convertir une âme !» On reconnaît à ce trait le mys-tique qui savait à quel prix se rachètent les âmes.
Il n'est pas moins heureux quand il fait parler les enfants : le jeune Eliacin, tirant Jésus par sa tunique et lui disant : «Jésus, pourquoi quittes-tu Ta Mère qui pleure», nous émeut. Et Jésus de répondre : «Enfant, c'est pour t'ouvrir le para-dis !»
Le théâtre, que l'abbé Jouin cherchait ainsi à rénover pour le rendre à sa mission : l'exaltation de la patrie et l'exten-sion de la foi, c'était le théâtre des «Mystères» du Moyen- Age, que la représentation du jeu de la Passion d'Arnoul Gré-ban devant Notre-Dame vient de remettre à l'honneur. Dans un discours prononcé aux fêtes du centenaire de Combrée, dans la salle même construite à ses frais, il disait : «Bientôt le peuple n'apprendra plus l'histoire de Dieu en ce monde que dans nos vieux Mystères rajeunis», et il exhortait professeurs et élèves à effeuiller avec amour notre grande épopée na-tionale.
«Elle est belle, disait-il, et nous avons le droit de relever la tête dans l'oubli momentané du présent pour regarder le passé et y chercher l'avenir : «C'est Clotilde, tenant dans sa main les destinées de notre pays ; c'est Clovis menant triomphalement la France à son baptême et faisant d'elle, sur le champ de bataille de Vouillé, la fille aînée de l'Église. - C'est l'immense chevauchée de Charlemagne et de Roland. - Ce sont les Croisades : les prêtres qui rentrent dans Jérusalem avec l'hostie consacrée sur la poitrine, pour que le Christ vivant reprenne possession de Son tombeau ; et, dans ce défilé vainqueur, les peuples se découvrent devant nos chevaliers, en disant : Gesta Dei per Francos ! C'est Louis IX, le roi que grandit la captivité, le saint qui grandit la France. - C'est Jeanne d'Arc, que Jehan Gerson nomme «le miracle de Dieu». C'est la Ligue, qui empêche la France de devenir protestante ; c'est la Vendée, qui l'empêche de devenir athée, et cette femme que les bleus voulaient mettre à genoux pour la fusiller, et qui répondait : Je ne m'agenouille que devant Dieu !»
On retrouve dans cette page, comme dans vingt autres de même allure, le patriote ardent, le prêtre convaincu qui ai-mait du même amour son Dieu et sa patrie.
Cette recherche du document et cette chaleur d'expression se retrouvent dans les autres écrits de l'abbé Jouin à cette époque : articles dans le Bulletin de l’Association paroissiale de Saint-Augustin ou dans la Revue du R.P. Gaudeau, La Foi Catholique, dans le discours prononcé à l'occasion des vœux du clergé au Cardinal Amette, après son élévation au cardinalat ; dans les oraisons funèbres de M. l'abbé Brisset, de M. l'abbé Girodon, de M. le Chanoine Huvelin, dans celle qu'il prononça à Angers pour le service de la R. Mère Agnès, fondatrice de quatre maisons de Servantes des Pauvres , à Paris, ou dans les discours d'installation de plusieurs curés, ses anciens vicaires ou ses amis - discours qui dépassaient souvent les proportions ordinaires de ces sortes d'allocutions : il lui arriva de les prolonger au delà d'une heure. Une fois même, à Saint-Étienne du Mont, au cours d'une allocution qui dura sept quarts d'heure, un orage épouvantable se déchaîna sur Paris, plongeant l'église dans l'obscurité. Imperturbable au milieu des éclairs, l'orateur n'en continuait pas moins son discours qu'il terminait par un remarquable parallèle entre trois prêtres éminents de cette époque : l'abbé Lesêtre, l'abbé de Broglie et l'abbé Huvelin. - Discours sur la musique, à l'occasion de la restauration et, plus tard, de l'agrandissement du grand orgue, et des noces d'or de son ami, Eugène Gigout.
A côté de connaissances techniques peu communes sur l'art musical, l'abbé Jouin y déploya un talent oratoire où il semble s'être surpassé.
«A Saint-Augustin, disait l'orateur (il avait lui-même alors 84 ans) l'église, l'orgue et l'organiste sont du même âge, et aucun des trois n'a vieilli».
Aux noces de diamant du Maître, le Curé de Saint-Augustin louait en M. Gigout, l'harmoniste savant, l'improvisateur remarquable et l'organiste liturgiste.
En une page jolie, il caractérisait deux morceaux du Maître :
«Le Chœur dialogué où le motif principal parcourt les touches, les claviers et les jeux pour éclater en sonorités toujours variées, échapper à l'harmonie qui voudrait l'emprisonner et fatiguer ainsi les motifs secondaires qui ont peine à le suivre dans cette course échevelée. Puis, lorsqu'on le croit lui-même à bout de force mélodique, il reparaît tout à coup, par suite de modulations chromatiques, dans une autre tonalité qui ouvre le champ inexploré à son bril-lant essor ; ou bien, comme dans un magique changement à vue, il se sert d'une note enharmonique pour s'esquiver et se créer de plus vastes horizons ; ou enfin, dédaigneux des tonalités modernes que la sensible, impitoyable geô-lier, retient captives dans les sept notes diatoniques, il reprend les allures plus indécises, mais plus grandioses du plain-chant, commence une marche triomphale, - la Marche religieuse de notre grand maître, semblable aux magni-fiques processions de Lourdes -, il entraîne à sa suite toutes les puissances de l'orgue et, dans cet unique ensemble, se servant des gammes, des tonalités, des octaves, comme des degrés d'une échelle mystérieuse, il s'élève à de tels accords et à de telles inspirations que les harmonies de la terre se mêlent déjà aux harmonies du Ciel».
Et l'orateur cherche à scruter l'avenir. Il se demande quelle sera là-haut la place du Maître dans ce prestigieux or-chestre formé des deux chœurs des anges et des hommes.
«Que chanter après les Anges dont la mémoire, l'intelligence et la volonté envelopperont Dieu d'acclamations, d'actions de grâce et d'amour
«Et cependant, répond-il, en un écho légèrement atténué, le chœur des hommes répondra au chœur des anges. Le ton en sera moins éclatant, mais il sera dominé par une note plus vibrante, plus frémissante, plus déchirante, la note de la douleur humaine, divinisée par les souffrances du Christ Jésus et de la Vierge Marie ; et je vois les Anges, penchés vers nous, en proie à une sainte jalousie qu'ils tourneront à la gloire de Dieu».
«Ils sont au-dessus de nous, les Anges, mais il ne leur a pas été donné de marcher jusqu'à l'épuisement et de mendier sur la margelle du puits un peu d'eau à la Samaritaine. Ils n'ont pas des mains bénissantes pour caresser délicatement les plaies humaines et les guérir... Ils n'ont pas connu la poignante harmonie des sanglots et des larmes... Ils n'ont pu verser à flots ou répandre goutte à goutte le sang que les confesseurs de la foi viennent ajouter au calice de l'autel. Ils n'ont pas senti la blessure au cœur, blessure du cœur percé de Jésus. Ce chant d'appel des âmes égarées, ce chant de la douce pitié, ce chant voile des larmes, ce chant strident du martyre, ce chant du Cal-vaire, les Anges l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas chanté, car ils n'ont pas souffert, car ils n'ont pas pleuré, ni les larmes blanches des yeux, ni les larmes rouges du cœur...»
Et s'adressant au jubilaire, il terminait par ces mots :
«Maître, les larmes ne vous ont pas été épargnées : elles vous vaudront de chanter à votre tour, là-haut, le chant du Calvaire, et lorsque vos harmonies faites à jamais de plaintes consolées, de larmes essuyées, de douleurs divini-sées auront rempli de leurs majestueuses sonorités les océans de lumière du paradis, lorsque vous frapperez le der-nier accord du chant du Calvaire, les chœurs des Anges émus et ravis, laisseront négligemment tomber leurs harpes et leurs luths, et prosternés avec nous aux pieds du Sacré-Cœur, nous l'adorerons ensemble un instant dans un si-lence d'éternité, tibi silentium laus».
Cette admiration de l'abbé Jouin pour la musique n'était pas chez lui une attitude affectée et superficielle. Elle résul-tait, écrira son maître de chapelle, M. Vivet, d'un sentiment véritablement profond et inné. «Sa prodigieuse mémoire et la fréquentation des artistes lui avaient acquis une certaine expérience qui, dit-il, lui tint lieu de culture jusqu'au jour où dési-rant analyser ses sensations, il voulut, à l'âge mûr, étudier les règles de l'harmonie».
Celui qui parlait si bien de la musique n'en pouvait vouloir que d'excellente : chez lui, d'abord. Il ne laissait échapper aucune occasion pour attirer au presbytère les grands artistes de passage à Paris. Le nouveau chef de la Chapelle Six-tine, Mgr Perosi, se fit honneur de venir entendre dans les salons du presbytère, en compagnie du Nonce, une de ses œuvres, La Résurrection de Lazare, que l'abbé Jouin fit exécuter par ses artistes.
La musique religieuse surtout intéressait le Curé de Saint-Augustin. «Il ne la souffrait pas de qualité inférieure, dit M. Vivet, fût-ce dans les plus simples cérémonies du culte ; il la voulait digne de sa mission, de haute facture et parfaitement interprétée. A cette fin, il consentait des sacrifices personnels pour assurer à sa Maîtrise de belles voix et les meilleurs ar-tistes... Lorsque son maître de chapelle lui soumettait les programmes, il était heureux d'y ajouter ou d'y substituer quelque autre œuvre encore plus belle... «pour le bon Dieu», soulignait-il.
Il était de notoriété publique qu'à Saint-Augustin, le culte atteignait non seulement la décence souveraine à laquelle il a droit partout, mais à la splendeur qui convenait à cette pieuse et opulente paroisse.
«On ne laisse pas Jésus dans la misère quand on vit soi-même dans l'abondance, dira le R.P. Hébert, le jour des noces d'or du Curé de Saint-Augustin. Dès qu'on l'aime, on trouve naturellement qu'il n'y a rien de trop beau pour Lui. M. l'abbé Jouin est resté fidèle à cette tradition des âges et des peuples de foi. Il a tenu à honneur d'entretenir et de développer la splendeur du culte. Cérémonies parfaitement réglées et exécutées avec une dignité méticuleuse, or-nementation abondante des autels par la profusion des fleurs et des lumières, accompagnement musical aussi splendidement artistique que possible, il a tenu pendant vingt ans la main à tout. Je ne voudrais pas jurer, ajoutait l'orateur, qu'il fut, en ceci, toujours et par tous, parfaitement compris. Mais les critiques, où il ne se refuse pas de s'instruire, ne le déconcertent pas, ni ne le détournent jamais. Elles l'aident seulement à se dépasser lui-même, et il a coutume de les faire taire en visant toujours à une plus sévère perfection. Ainsi en a-t-il usé pour garder dans la pa-roisse la splendeur du service divin. Pour qui a vu, dans cette église, l'affluence énorme des grandes fêtes, il est ma-nifeste que le troupeau a, de toute son âme, partagé les goûts du Pasteur et témoigné du réconfort qu'il puisait à y trouver satisfaction».
A quelles critiques faisait allusion ce passage ? De quel tribunal semblait-il en appeler au jugement du troupeau pour justifier le Pasteur ?
Par un motu proprio du 22 novembre 1903, Pie X avait rappelé «les principes qui règlent la musique sacrée dans les fonctions du culte», et les prescriptions de l'Église contre les abus les plus répandus en cette matière. Mais, tout en don-nant la préférence au chant grégorien, et à la polyphonie classique palestinienne, il ne réprouvait pas la musique plus moderne.
M. Jouin n'avait pas attendu le motu proprio pour écarter de son église toutes les compositions musicales «renfermant des réminiscences de motifs usités au théâtre ou reproduisant, dans leurs formes extérieures, l'allure des morceaux pro-fanes. «Depuis longtemps, dit M. Vivet, il avait prohibé du sanctuaire les morceaux de théâtre ou à effets dramatiques, et banni les instruments de cuivre. Il réprouvait fortement encore l'abus des dissonances de la musique ultramoderne. Il ap-préciait peu l'école palestrinienne, à la longue monotone et conventionnelle. Quant au chant grégorien, avec les évêques qui ne l'ont pas adopté dans leurs diocèses, il n'en admettait pas l'exclusivité pour l'universalité catholique, la jugeant im-praticable à la plupart des maîtrises».
C'est alors que, dans le Temps du 14 février 1904, parut un article de M. Camille Bellaigue. Sous le titre de Sil-houettes de musiciens - Messieurs les Curés de Paris, le critique musical accusait ces derniers de «dissiper l'esprit des fidèles et de les détourner de la prière, de travestir le Christ en héros de théâtre en introduisant dans leurs offices des morceaux tirés d'opéras, au lieu d'y faire entendre exclusivement le chant grégorien».
L'auteur citait un «salut de Noël» à Saint-Augustin. «Le programme ou l'affiche, disait-il, se lisait à la porte de l'église. Il s'y vendra peut-être un jour avec la photographie et le portrait de tous les artistes».
Cette plaisanterie, le choix du journal à qui le critique confiait ses doléances, la désignation de la paroisse Saint-Augustin donnaient à M. l'abbé Jouin le droit de répondre. Il le fit en son nom et au nom de tous ses confrères dans un article du Gaulois.
Il citait, d'abord, les paroles du Pape :
«L'Église a toujours favorisé le progrès des arts, en admettant au service du culte tout ce que le génie a trouvé de bon et de beau dans le cours des siècles, sans toutefois violer jamais les lois de la liturgie. C'est pourquoi la musique plus moderne est aussi admise dans l'église, car elle fournit, elle aussi, des compositions dont la valeur, le sérieux, la gravité les rendent en tous points dignes des fonctions liturgiques».
L'abbé Jouin continuait :
«Je vais sans doute, cher Maître, vous faire sourire de pitié, je ne puis cependant vous cacher que, depuis plus de dix ans, tous mes efforts, dans le choix de la musique classique, dans le mélange des auteurs modernes, depuis Pa-lestrina, Vittoria, Bach, jusqu'à Franck, Saint-Saëns et même Gounod, tous mes efforts ont eu pour but de relever dans une idée large, la musique religieuse. J'estime, en effet, qu'elle n'est ni d'une époque, ni de quelques privilégiés ; que son inspiration est au fond de toute âme humaine, comme le sens religieux lui-même ; que tous les siècles, avec le progrès des instruments et des méthodes, doivent lui payer leur tribut ; que l'Église, étant divine, on lui dédie-ra à tous les âges des chants immortels, dont la diversité répond aux mille sentiments qui partagent nos cœurs et que nous avons dès lors le pieux devoir, tout en restant dans la note sacrée, de rejeter un exclusivisme qui, pour ali-menter la piété de rares fidèles, serait nuisible et fastidieux à la plupart».
Cette première lettre se terminait par ces mots :
«Je regrette que tout en défendant, dans un cercle rétréci, une bonne cause, vous rejetiez la responsabilité de son insuccès sur les Curés de Paris. N'est-ce pas battre en brèche la paroisse, notre suprême rempart aujourd'hui, et mettre dans une certaine mesure votre plume de critique autorisé au service de nos ennemis en nous jetant le dis-crédit et en nous tournant en dérision ?»
La polémique se poursuivit dans le Gaulois au cours de quatre articles sans apporter d'éléments nouveaux. Il était évident que le critique musical, dont les exigences allaient manifestement au-delà du décret, et le Curé de Saint-Augustin plaidant, pour la musique moderne dans les limites tracées par le motu proprio, ne pouvaient s'accorder : chacun des ad-versaires demeura sur ses positions.
* * *
Cette activité intellectuelle qu'il dépensait au service de Dieu dans ses livres, ses articles ou ses discours, ne l'absor-bait pas au point de lui faire oublier des travaux d'ordre moins relevé pour l'embellissement de son église : l'achèvement des décorations de la chapelle de la Sainte Vierge, les peintures murales des chapelles des catéchismes et du presby-tère, le relevage du Grand Orgue, le transfert de l'orgue d'accompagnement dans une tribune latérale, l'ouverture directe des portes sur la rue de la Bienfaisance à la place du labyrinthe obscur et dangereux d'autrefois, l'installation de l'éclai-rage électrique et surtout l'érection, à l'entrée du chœur, des statues monumentales de saint Augustin et de sainte Mo-nique, don de la paroisse à l'occasion, de son jubilé pastoral et œuvre du sculpteur Louis-Noël, doivent être attribuées à son administration.
Mais le meilleur de son temps, il le donnait à ses livres. Son panégyriste de 1918 nous le montre prenant sa revanche de n'avoir pu mener la vie dominicaine en se faisant, dans le monde, bénédictin, «passant ses jours au milieu des livres, disait-il, de ceux qu'il a écrit comme de ceux qu'il compulse de la même main nerveuse et infatigable : armée innombrable dont les vagues successives s'accroissent toujours et déferlent maintenant jusque dans sa chambre à coucher».
Ce que l'abbé Jouin cherchait dans l'étude c'était sa puissance de réalisation. Dans ces livres qui s'entassaient dans toutes les pièces du presbytère, il ne voyait que des instruments pour produire du bien. Aussi a-t-il pu sans scrupule se consacrer au travail, «sacrifiant tout ce qui lui paraissait moins utile : visites, lecture des journaux et jusqu'aux soins de sa santé». «Il me souvient, dit le P. Hébert, d'une après-midi d'automne où, me montrant, de son presbytère, l'église de Saint-Augustin, il me disait simplement : «Depuis quatre mois, sauf deux sorties, j'ai fait juste le chemin qui conduit d'ici à l'église et de l'église ici : l'avenue Portalis à traverser. Et il avait l'air si content ! Qu'en pensait au juste son médecin ?»
* * *
(à suivre...)
Dernière édition par Hercule le Lun 17 Oct - 8:32, édité 3 fois
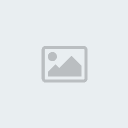
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 7)
* * *
Homme d'étude et de cabinet, M. Jouin fut aussi et au même degré, un homme d'action. Le caractère et la volonté étaient chez lui à la hauteur de l'esprit. «Les livres sont pourtant d'indulgents amis, remarquait encore le R.P. Hébert. On ne prend pas dans leur commerce tranquille l'habitude de la lutte, et même il arrive qu'on en perde complètement la ca-pacité et le goût», Studieux, M. Jouin n'était pas un timide. Sous cette physionomie empreinte de calme et de bienveil-lance, il y avait une énergie de fer qui veillait sans défaillance. «Que l'occasion s'en présente, on la verra sur le champ surgir et se dresser».
Depuis vingt ans, ces occasions n'avaient pas manqué. Témoin ou, pour mieux dire, soldat dans les premiers com-bats livrés à l'Église par la Libre pensée sous le nom de laïcisation, il avait payé de sa cure sa résistance aux Francs-Maçons de Joinville. Il assistait maintenant aux assauts répétés de la secte, sûre de son triomphe. Successivement, et en dépit des «attentions, des services, des efforts» de Léon XIII et de Pie X, il avait vu la loi néfaste du divorce votée, les prières publiques pour la France supprimées, les Congréganistes exclus de l'enseignement public et, bientôt après, de tout enseignement quel qu'il soit, les clercs astreints au service militaire, les religieux dispersés et dépouillés de leurs biens ; le crucifix banni des tribunaux, des écoles et de tous les établissements publics ; la fermeture de toutes les écoles con-gréganistes décrétée dans un délai qui ne devait pas dépasser 1914 : autant d'étapes vers le but persévéramment poursuivi de la séparation officielle et définitive de l'Église et de l'État.
Elaborée depuis vingt-cinq ans dans les Loges, habilement soutenue par un franc-maçon, M. Briand, la loi de Sépara-tion fut votée par le Parlement, le 11 Décembre 1905 : c'était en réalité une loi d'apostasie officielle et de confiscation. Après avoir proclamé que la République Française ne reconnaît et ne salarie aucun culte, elle se déclarait, par un acte unilatéral, déchargée de l'obligation de payer le traitement du clergé qui n'était pourtant qu'une restitution partielle des biens enlevés à l'Église pendant la période révolutionnaire - elle s'emparait des sommes confiées à l'Église pour que des messes fussent dites à perpétuité à l'intention des fondateurs - attribuait aux communes la propriété des églises, le prêtre n'y étant plus qu'un occupant et un usager sans aucun titre - ordonnait qu'inventaire serait fait par l'État de tous les objets mobiliers, sans aucune mention qui empêchât les agents publics d'ouvrir les tabernacles - instituait enfin des associations cultuelles qui ne seraient pas nécessairement dirigées par l'Évêque et qui devaient posséder et gérer ce qui restait des biens d'Église, des quêtes et des autres revenus, et verser les fonds de réserve, soigneusement limités, entre les mains de l'État. Les catholiques avaient un an pour constituer ces associations. Passé ce délai, tous les biens mobiliers et im-mobiliers : églises, presbytères, évêchés, séminaires, seraient confisqués et mis sous séquestre.
Deux mois après, Pie X adressait aux Archevêques, aux Évêques, au clergé et à tout le peuple français, une première encyclique, jugeant et condamnant la Loi de Séparation «comme profondément injurieuse vis à vis de Dieu, qu'elle renie officiellement... comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité publique due aux traités... comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels et à sa liberté... enfin, comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples».
Par une seconde encyclique, du 10 août 1906, le Pape rejetait et condamnait les Associations cultuelles, comme con-traires à la constitution de l'Église.
Pouvait-on étudier l'établissement d'associations légales et canoniques où serait sauvegardée, dans une certaine me-sure, l'autorité de la hiérarchie catholique - et l'on disait le ministère favorable à ce projet - la majorité des évêques le pensait. Mais le Pape refusa. Il estimait, lui le Chef souverain, que les modifications proposées ne donneraient point aux catholiques de sécurité suffisante. Il jugeait l'Église de France assez généreuse pour payer de tous ses biens la rançon de sa liberté.
Dès la promulgation de la loi, les inventaires avaient commencé dans toutes les églises de France, provoquant partout l'émotion et des troubles. A Paris - à Saint-François-Xavier, au Gros-Caillou, à Sainte-Clotilde - des fidèles, de leur propre initiative, s'opposaient à l'exécution de l'inventaire ; l'effervescence grandissait.
Le Curé de Saint-Augustin n'avait pas attendu le vote de la loi pour alerter ses paroissiens. Dans des Conférences à l'Association Paroissiale qu'il venait de fonder et dans ses prônes, il ne cessait de les exciter non seulement à garder leur foi, mais, à la défendre. Un trop grand nombre, inconscients de la situation faite à l'Église de France, se montraient trop préoccupés de leurs plaisirs, leur unique souci était de continuer sans trouble leur vie facile et joyeuse.
L'inventaire de l'Église Saint-Augustin avait été fixé au 31 janvier. Les ordres du Cardinal Richard, comme ceux du Souverain Pontife, étaient formels : protester contre la violation des droits de l'Église, mais éviter «d'agir d'une façon sédi-tieuse et violente».
Bien que la résistance passive à une loi injuste soit, d'après saint Thomas, non seulement légitime mais obligatoire, dût-il en résulter quelque trouble, on n'éleva aucune barricade dans l'église. Mais ce jour-là, les fidèles furent convoqués à assister à une «messe de deuil», le deuil de l'Église. Après la messe, l'abbé Jouin, entouré de son clergé et des con-seillers de fabrique, attendait à la sacristie l'inspecteur des domaines, prêt à faire entendre sa protestation. Laissons l'Ab-bé Jouin faire un an plus tard, devant la 9e chambre du tribunal correctionnel, le récit de cette tentative :
«Ce jour-là, même par la suite, il n'y eut aucun trouble à Saint-Augustin, et je n'ai pas vu l'agent des domaines, M. Bonnefoy. Il est venu, conduit dans l'église par un de mes vicaires, mais il n'est pas entré à la sacristie : les fidèles l'en ont empêché sans que je fusse averti de leur dessein.
«Je l'avais vu la veille, au presbytère, lui-même m'avait dit qu'il serait bon d'avoir beaucoup de monde dans l'église, et il s'est enquis s'il avait quelque chose à craindre.
«Je lui avais répondu négativement. Le lendemain, il vint me féliciter de la parfaite attitude de mes paroissiens, et fut désireux de connaître les noms des deux messieurs qui l'avaient poliment reconduit à la porte. Je m'empressai de les lui taire».
Tout s'était passé dans un calme relatif, mais sans la moindre violence, raconte le Bulletin.
«L'Inspecteur parti, M. le Curé était monté en chaire pour donner lecture de sa protestation contre l'inventaire «première mesure d'exécution de la loi de Séparation». Le Curé et MM. les Fabriciens estiment, avec S. E. le Cardi-nal Archevêque de Paris, que cet inventaire constitue un premier acte de mainmise sur les biens qui sont la propriété de la Fabrique», toute coopération de leur part serait sacrilège, puisque les biens et les lieux inventoriés sont consa-crés au culte ; déloyale, puisqu'ils en ont la garde et la responsabilité».
Il avait ajouté :
«Mes chers paroissiens, merci d'être venus. Vous êtes aujourd'hui la paroisse sous les armes, je suis fier de vous. Aujourd'hui, notre protestation est pacifique, mais je sais maintenant que, s'il faut demain une protestation plus éner-gique, vous serez là».
Pendant toute l'après-midi, la grande porte de l'église resta ouverte et une foule de fidèles constamment renouvelée vint s'agenouiller devant le Saint-Sacrement rappelant le jour du Vendredi-Saint. C'était bien aussi un jour de deuil pour les paroissiens de Saint-Augustin. C'est alors que l'abbé Jouin se décida à établir la garde de son église.
Quelle était cette garde et pour quelle raison fût-elle organisée ?
L'Inventaire n'ayant pu avoir lieu, le Procureur devait, aux termes d'une circulaire de M. Bienvenu-Martin, Ministre des Cultes, ou bien procéder à cette opération après une démarche officieuse auprès du «représentant légal», c'est-à-dire du Curé, ou bien, si cette intervention ne lui semblait pas suffisante, le mettre en demeure, par un arrêté, d'avoir, à une date fixée, à remettre les clefs à l'agent des Domaines, faute de quoi il serait procédé à l'ouverture des portes avec le con-cours d'un officier de police.
Aucun avertissement n'ayant jamais été adressé au Curé, celui-ci pouvait se demander si l'agent n'allait pas chercher à opérer par surprise et faire ouvrir le coffre-fort par la force. Des troubles pouvaient survenir.
«Chargé, sous le Concordat, de la garde de mon église, dira, un an après, l'abbé Jouin, j'ai pu légalement l'orga-niser comme il me plaisait, soit contre les policiers, soit contre une jeunesse trop bruyante qu'on accusait à tort d'ail-leurs d'obéir à des instructions venues de Rome ou des Evêques».
Cette garde, il l'assure avec le concours de l'Association Paroissiale. A chaque porte, en permanence, des escouades de veilleurs, comme dans une place assiégée, se succèdent sans relâche du 13 février au 9 juin. Quant à lui, il s'est ré-servé la garde de nuit et s'est installé dans une des tours de l'église.
Un lit de camp lui a été dressé dans la lingerie. Le soir venu, les portes de l'église fermées, on peut le voir, une lan-terne à la main, gravir les étages de sa tour ; la lumière ne s'éteint souvent que tard dans la nuit : l'abbé Jouin travaille à sa Jeanne d'Arc ou à sa Clotilde.
Au premier son de l’Angelus, il est en bas, donne ses ordres, et ainsi pendant quatre mois.
Entre temps, le Curé de Saint-François-Xavier, l'abbé Gréa, poursuivi pour résistance aux Inventaires, avait été ac-quitté, et l'abbé Richard, curé du Gros-Caillou, où la résistance avait été plus vive et nécessité l'intervention des pom-piers, inculpé d'abord, avait été l'objet d'un non-lieu.
Qu'attendait le Gouvernement pour reprendre les opérations à Saint-Augustin ? Surpris de la résistance qui se faisait chaque jour plus vive en province, où le sang d'une victime, André Régis, avait coulé, le Président du Conseil, M. Cle-menceau, suspendit les Inventaires et l'abbé Jouin put se relâcher de sa vigilance. Mais, au mois de novembre, pré-voyant la reprise des hostilités, il confia à une personne de son entourage son intention de reprendre, lui aussi, sa garde. Quelle ne fut pas sa douleur, le lendemain, d'apprendre que l'inspecteur des domaines, accompagné d'un serrurier, s'est présenté à l’improviste et, avec une équipe de policiers et de serruriers, procède à l'inventaire. L'abbé Jouin accourt, et, comme l'un des vicaires, le voyant pâlir en face du coffre-fort éventré, lui exprimait sa surprise d'une si violente émotion : «Malheureux, répondit le Curé, vous ne savez donc pas que c'est l'Église qui est violée ?»
Entre temps, le Pape ayant repoussé les Associations Cultuelles, le Gouvernement annonça la dévolution des biens de l'Église. On voulait bien, au moins provisoirement, laisser les églises à la disposition des catholiques. Ils pouvaient s'y réunir, à condition d'en faire la déclaration. Cette déclaration assimilait les exercices du culte à des réunions publiques : comme tous les curés de Paris, l'abbé Jouin s'y refusa : «Pour nous, dira-t-il, l'Église de France a fait sa déclaration au baptême de Clovis... Il a fallu l'apostasie de la France pour en exiger une nouvelle».
Le 11 décembre 1906, un réquisitoire introductif d'instance fut pris contre trois curés de Paris, comme coupables de s'être opposés par la violence à l'exécution d'une loi de l'État, et contre Mgr Montagnini, chargé des archives de la Non-ciature depuis le départ du Nonce, comme complice du délit commis par les précédents. Le 13, le juge d'instruction faisait subir à l'abbé Jouin, l'un des trois curés mis en cause, un premier interrogatoire au sujet d'un écrit distribué par lui «dans les lieux où s'exerce le culte, contenant, disait l'inculpation, une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, et tendant à soulever et à armer une partie des citoyens contre les autres».
Cet écrit est intitulé : Messe de deuil En voici le texte :
LE MERCREDI, 12 DECEMBRE 1906, A 9 HEURES.
Cette semaine voit se consommer l'apostasie de la France officielle et sa rupture avec l'Église, qu'elle ne connaî-tra plus que pour la persécuter.
Nos biens sont confisqués, les volontés suprêmes des défunts ne sont même pas respectées, et désormais l'État ne fera pas acquitter les messes de fondation.
Nos églises sont livrées au séquestre, au maire et au commissaire de police. Le seul qui devienne un étranger, c'est le Curé lui-même, que le Ministre tient pour un occupant sans titre juridique. (Circulaire du 1er décembre 1906).
Avant d'inaugurer ce nouvel état de choses, j'estime répondre à vos pieuses intentions en célébrant une messe de deuil mercredi prochain. Cette Messe s'appliquera tout particulièrement aux âmes qui vont perdre le bénéfice des fondations. Je vous exhorte à faire dire une messe de plus chaque année, en compensation du grave préjudice que vont subir dans notre pays les âmes aimées du Purgatoire.
La lutte est commencée ; soutenons-la vaillamment et chrétiennement ; et laissez-moi vous le redire, comme au jour des Inventaires, en janvier : il faut que notre deuil, si triste et si profond qu'il puisse être, soit un deuil armé.
Garder la foi ne suffit plus, nous devons la défendre».
Cette demande d'information, bientôt suivie d'inculpation, n'avait été que le prétexte cherché par le Président du Con-seil, M. Clemenceau, pour perquisitionner à la Nonciature et mettre en cause le Vatican. Le jour même de cette perquisi-tion qui provoqua une vive émotion dans les milieux diplomatiques, Mgr Montagnini, gardien des Archives pontificales, était expulsé et, le 11 avril suivant, l'abbé Jouin, seul des trois curés, était cité devant la 9e chambre de police correction-nelle.
Très calme, en attendant l'ouverture de l'audience, l'abbé Jouin feuilletait les épreuves d'un drame de sa composition. Les débats étaient dirigés par M. Toutain, juge-doyen à la 9e Chambre, que le Parquet avait en vain voulu écarter de la présidence.
Par son attitude, par ses réponses nettes et franches et par ses fières et viriles revendications, l'abbé Jouin sut s'atti-rer les respectueuses sympathies d'un auditoire très mélangé où se coudoyaient les représentants de tous les journaux, même les plus avancés, et les membres de la fameuse Commission parlementaire.
Invité à fournir des explications sur les cinq dernières lignes de son écrit, les seules que l'inculpation avait retenues, il fît la déclaration suivante :
«La lutte est commencée», c'est évident. On ne saurait nier qu'on fasse la guerre à l'Église, qe la loi dite de Sépa-ration, soit par la confiscation de nos biens, soit par la situation précaire faite au Curé, ne soit mise nous et n'ait créé un état aigu d'hostilité. D'ailleurs, le 11 décembre, M. Clemenceau disait lui-même «qu'il avait tiré le premier coup de canon». C'est contestable.
En tout cas, il y avait longtemps que le premier coup de revolver avait couché une première victime : Régis André, demandant grâce au gendarme qui l'achevait sans pitié.
J'ai dit qu'il fallait soutenir la lutte «vaillamment et chrétiennement». Je pense que personne ne peut trouver à re-dire à ces paroles».
L'abbé Jouin explique ensuite que par les paroles «Comme au jour des Inventaires», il n'a voulu parler que de l'Inven-taire de Saint-Augustin et de la Messe de deuil à laquelle il avait convié ses paroissiens en leur disant que, si l'Inventaire marquait le début de la lutte et imposait le deuil aux catholiques, il fallait du moins que ce fût un deuil armé.
«Quel sens ai-je attribué à ces paroles ?
Évidemment, un sens figuré. J'en ai donné comme preuve directe avec l’instruction qu'aucun de mes paroissiens n'est venu à la Messe de deuil du 11 décembre, ni en deuil, ni armé.
Mais pourquoi demander un deuil armé, et le demander sans cesse ?... Un premier acte d'accusation englobait toutes mes prédications depuis trois ans, ce n'était pas assez. Il y a bientôt quarante ans que je prêche de même.
Toutefois, si j'appuie en ce moment sur le besoin d'avoir un deuil armé, c'est qu'une notable partie des catholiques ne comprennent pas la situation actuelle faite à l'Église de France. A ceux dont l'unique souci est de continuer leur vie facile et joyeuse, je dis : Quand l'Église pleure, vous devez être en deuil. Et à ceux qui se plaignent constamment, et répètent que tout est fini et qu'il n'y a rien à faire, je dis : Soyez armés, soyez debout, vous n'avez pas le droit de vous désespérer, et surtout de désespérer les autres...
C'est donc dans un sens figuré que j'ai pris les mots de «deuil armé».
Et l'abbé Jouin en donne pour raison que le Souverain Pontife, tout en demandant aux enfants de l'Église de se «revê-tir des armes de lumière» pour combattre de toutes leurs forces pour la Vérité et la Justice», leur interdit d'agir d'une fa-çon séditieuse et violente ; que, lui-même ne pouvant prendre les armes, il n'aurait pas voulu demander à ses paroissiens de risquer leur vie... et surtout pour cette raison que ce ne sont pas des armes qu'il faut à l'Église, mais des soldats, des chrétiens convaincus, des catholiques militants, revêtus de l'armure de la foi.
Et l'abbé Jouin explique ce qu'il entend par une foi armée et défendue :
«Je veux une foi dont la conviction soit éclairée, profonde, lumineuse, ne flottant pas dans l'indécision, ne se retran-chant pas dans des parallèles entre Léon XIII et Pie X, et n'étant pas obligée d'apprendre de M. Combes, comme Ta fait M. Briand, quelle est la constitution de l'Église, et pourquoi le Pape ne pouvait accepter les Associations cultuelles.
«Je veux une foi qui, de la conviction passe dans la parole : et je m'appuie sur le programme que le Souverain Pontife traçait naguère à l'Association catholique de la Jeunesse Française : «Se tenir en dehors des disputes et des passions politiques, mais poursuivre sur le terrain social toutes les revendications religieuses, et le faire vigoureuse-ment par la parole, la conférence, la presse, les écrits».
«Je veux enfin une foi d'action qui s'affirme et se défende. Et cette affirmation, dans la lutte actuelle, doit aller jus-qu'au bout, malgré la délation et les fiches, dût-on briser son épée ou sa carrière. Mais aussi je réclame de ceux qui sont les témoins de tels sacrifices, de tenir pour un devoir sacré de refaire ces situations brisées, et de ne pas s'ou-blier jusqu'à laisser dans la misère leurs frères vaincus, comme on l'a fait pour certains magistrats qui avaient donné jadis leur démission, lors des décrets.
«Telle est la foi, vivante, consciente d'elle-même, militante, qui nous unira dans l'action catholique, et nous assu-rera le triomphe. Tel est le sens de mon deuil armé, sens figuré, spirituel, mais énergique, pour la défense des droits de Dieu».
Ce «deuil armé» n'a provoqué aucune résistance à l'exécution de la loi :
«Je tiens à dire toutefois, ajoute l'abbé Jouin, qu'aucune loi, en contradiction avec mon ministère sacerdotal, ne me fera fléchir. Après l'essai d'inventaire dont j'ai parlé, la police vint me trouver trois fois ; au fond, on me demandait de livrer mon église. J'ai refusé, et j'ai établi ma garde.
«Avec la grâce de Dieu, j'espère ne pas connaître ces capitulations de conscience. Je ne saurais être traditeur des biens d'Église, puisqu'on les a tous volés ; mais il me reste les âmes, et je ne serai jamais, ne fût-ce qu'en appa-rence, un traditeur d'âmes».
Puis passant hardiment à l'offensive :
«J'ai été inculpé, pour permettre à M. Clemenceau d'engager des perquisitions d'ordre judiciaire à la Nonciature et de m'adjoindre Mgr Montagnini comme complice. Le président du Conseil l'a affirmé le jour même à la Chambre des Députés. L'accusation était fausse, mais elle a été maintenue ; et, bien que les deux curés de Paris inculpés avec moi aient bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, il n'en reste pas moins que c'est à la faveur de ce subterfuge que l'on a saisi les papiers diplomatiques de Mgr Montagnini».
«M. Clemenceau a commis un acte retentissant en saisissant ce dossier, c'est son affaire ; il veut, dit-on, y trouver la preuve de menées politiques qui se dérouleraient à une autre Cour, cela le regarde encore, mais qu'il ait au moins la franchise de l'avouer. Il me suffit d'avoir couvert ses délits diplomatiques, et je ne veux pas être une seconde fois, sans protester hautement, le chaperon de son manque de courage».
Me Danet, avocat de l'abbé Jouin, après avoir stigmatisé, comme il convenait, l'illégalité de la perquisition faite aux ar-chives de la Nonciature, n'eut pas de peine à prouver le caractère figuré et tout de rhétorique du «deuil armé», et le de-voir pour tout prêtre, comme pour tout catholique, de défendre la foi. «Cette foi, s'écriait l'éminent avocat, vous voulez l'arracher de l'âme de nos enfants, et cela nous ne le voulons pas !... Vous pouvez continuer votre lutte, nous sommes de ceux qu'on ne terrassera jamais !»
En dépit du talent du défenseur, l'abbé Jouin fut condamné à 16 francs d'amende.
«Peu importe le montant de sa condamnation : les juges ont pris soin de nous prévenir, dans leur sentence, qu'ils ont réduit la peine à son minimum, pour habituer l'opinion publique à l'introduction dans la jurisprudence d'un délit nouveau. Une autre fois, la condamnation sera plus sévère et entraînera, pour le prêtre condamné, des consé-quences plus graves. L'abbé Jouin fut condamné, non pour avoir incité à la rébellion, le tribunal le constate, mais pour avoir, en tout et pour tout, engagé en principe ses paroissiens à résister aux mesures vexatoires qui violente-raient les consciences et porteraient atteinte aux droits de l'Église. En un mot, il ne fut pas condamné pour avoir dé-sobéi à la loi de l'État, mais pour avoir obéi à la loi de Dieu».
Ainsi s'exprimait, au lendemain du procès, un ancien Ministre des Affaires étrangères, M. Flourens.
Une loi qui conduit à de tels excès est elle-même condamnée par la conscience. Les juges le reconnaissent dans leurs considérants, en appelant la Loi de Séparation «une loi d'exception exorbitante du droit commun, en ce qu'elle crée un délit spécial aux ministres du culte devenus pourtant, par son effet, de simples citoyens». Elle créait aussi une juridic-tion spéciale : le tribunal, au lieu de la cour d'assises, et une catégorie spéciale de citoyens : le prêtre. Deux mots de combat, au figuré, en feront un criminel.
«Quand on envoie une idée dans les cachots, disait Louis Veuillot, c'est le geôlier qui se charge de chaînes. Quand on l'envoie au bourreau, c'est le bourreau qui meurt». Malgré les 16 francs d'amende du tribunal, l'abbé Jouin ne sortit point diminué de ces débats. Ils le grandirent aux yeux de l'opinion. Il avait fait entendre de fières paroles et revendiqué hautement les droits de l'Église. Les vrais condamnés, c'étaient les auteurs de cette loi, loi de spoliation, loi qui préparait le schisme et contre laquelle le Pape a élevé une protestation qui demeure.
* * *
Si le commerce des livres n'avait point amolli le caractère de l'abbé Jouin, les luttes qu'on lui imposa n'avaient point desséché son cœur. Ce fort restait toujours profondément bon, et de cette bonté il donnait chaque jour des preuves.
Un de ses premiers soins, en prenant possession de sa charge, avait été d'appeler à Saint-Augustin les Servantes des Pauvres. Les malades indigents ne manquaient pas dans cette opulente paroisse dont les pauvres occupent les mansardes des sixièmes étages. Les religieuses de Dom Leduc, cette fois encore, étaient conduites par la R. Mère Agnès. L'infatigable religieuse allait achever sa carrière active dans cette Maison Saint-Antoine, dont elle devint prieure. Huit ans plus tard, elle y célébrera ses noces d'or de vie religieuse avant d'aller rendre son âme à Dieu au milieu de ses sœurs, au Noviciat d'Angers. Mieux que personne, l'abbé Jouin avait pu apprécier ses rares vertus, à Joinville et à Saint- Médard. Appelé à prononcer son éloge funèbre, il pourra parler de celle qui avait été une Servante des Pauvres dès la première heure et la première Supérieure générale de la Congrégation.
Désormais, l'abbé Jouin a donc la charge de trois maisons de Servantes des Pauvres et des malades qu'elles assis-tent. Sa charité d'ailleurs ne reste sourde à aucun appel. Les curés de campagne, chez lesquels il aime à passer une par-tie de ses vacances, les prêtres, les séminaristes, ses familiers connaissent tour à tour ses libéralités et vident sa bourse sans épuiser son cœur.
Les billets de mille francs sortent à tout instant de sa bourse. Un de ses fidèles employés, trop confiant, s'est laissé voler le prix d'une cérémonie religieuse qu'il venait d'encaisser. Le lendemain, le Curé rembourse les 3000 francs. Il prend à sa charge cinq orphelins dons les parents - neveu et nièce de sa servante - ont péri dans l'incendie de l'Opéra-Comique. - Une autre domestique, pour établir son fils, a épuisé toutes ses économies ; à plusieurs reprises, il lui glisse sous enveloppe un billet de mille francs. - Deux personnes peu fortunées, dont il utilise les services pour sa Revue, par-taient en pèlerinage à Lourdes : la veille du départ, il leur remet l'argent du voyage et du séjour.
Les curés, bâtisseurs d'églises ou constructeurs d'écoles, ne frappent jamais en vain à sa porte.
Il se laisse prendre jusqu'à son temps, pourtant si précieux : pendant près de dix ans, il accorde une audience quoti-dienne et prolongée à une modeste paroissienne dont l'état d'âme lui semble réclamer ce sacrifice.
Son hospitalité était proverbiale, et ses domestiques trouvaient que les deux chambres d'amis dont il disposait étaient bien rarement inoccupées, et sa table entourée d'hôtes sans cesse renouvelés.
Il aimait à «faire plaisir pour attirer les âmes à Dieu», c'était la résolution prise dans l’une de ses dernières retraites.
Les enfants avaient ses faveurs à l'égal des grandes personnes : à ceux que la maladie avait empêchés de suivre la retraite de première communion, il tenait à prêcher lui-même une retraite spéciale pour leur permettre de communier le jour du renouvellement. Ils sont trois, deux, parfois même il n'y en a qu'un. Qu'importe ? Ils auront chaque jour les deux exercices et tous les avis nécessaires pour s'approcher dignement de Notre-Seigneur. Vienne la première communion de deux enfants abandonnés dont il a pris la charge ; il s'en ira avec la mère adoptive de l'un d'eux assister à cette fête. Eux aussi, du moins en ce jour, ils auront la joie d'avoir une famille.
Il donnait à ses familiers des marques touchantes d'affection et leur parlait avec bonté. Chaque soir, la journée finie, il les recevait, leur serrait la main et leur adressait quelques bonnes paroles.
Sa vieille servante Joséphine, qui l'avait suivi depuis le Panthéon, vint à mourir. On le vit s'agenouiller longuement et à diverses reprises dans la chambre mortuaire. Il fit ensuite descendre le corps dans la chapelle du presbytère et y célébra la messe avant la cérémonie funèbre qu'il présida jusqu'au cimetière. Le lendemain, il exprimait sa peine dans une poé-sie naïve dont il composa la musique :
Ma bonne si fidèle
Est morte hier,
Partant, comme hirondelle
Avant l'hiver.
Mon cœur vers elle clame
Plus que ne dis :
Seigneur, prenez son âme
En Paradis.
* * *
Henri Bordeaux a dit de l'abbé Fouque - un émule de l'abbé Jouin - «qu'il avait un cœur affectueux et que ce cœur fut percé de flèches innombrables»... «Géant de la charité, dit-il encore, mais aussi géant de la douleur».
On peut appliquer ces paroles à l'abbé Jouin. Lui aussi connut la douleur, il n'en pouvait être autrement. On n'émerge pas sans éveiller de mesquines jalousies, et les bienfaits tombent parfois sur des ingrats. On n'a pas sous ses ordres, en quarante ans de cure, une trentaine de vicaires sans rencontrer un jour ou l'autre, l'opposition ou la résistance. Les supé-rieurs eux-mêmes ne comprennent pas toujours les initiatives des hommes d'œuvres. Ils peuvent se tromper, «il est bon même qu'ils se trompent, dit encore Henri Bordeaux. Les débuts des saints sont toujours un peu déconcertants. On ne s'habitue pas d'emblée à leurs procédés. Je crois même que l'épreuve leur est nécessaire et qu'ils doivent d'abord se heurter à la résistance de l'autorité. L'autorité, même ecclésiastique, de la meilleure foi du monde, peut se tromper. Il est même préférable qu'elle se trompe plutôt que de donner des adhésions trop faciles. L'épreuve est indispensable, non seulement aux saints, mais aux artistes, aux écrivains, aux héros, à tous ceux qui, appelés à sortir de la voie normale, doivent mériter ce privilège et prouver leur vocation».
L'abbé Jouin n'échappa point à cette loi. Il avait fait jouer nombre de fois à Paris la pastorale de la Nativité, et, au dé-but, il en dirigeait lui-même l'orchestre et les chants, la baguette à la main. Curé de Saint-Médard, il avait continué. Passe encore dans une paroisse de faubourg ! mais à Saint-Augustin ? on lui avait demandé d'y renoncer, et de bonne grâce, il s'était soumis. Mais ne voilà-t-il pas qu'en collaboration avec Alexandre Georges, il a composé un nouveau Mystère, la Passion, et qu'un imprésario va le mettre à la scène avec de vrais acteurs, sur un vrai théâtre, et les auteurs n'ont pas soumis leur projet à l'Archevêché. «Des observations diverses et souvent contradictoires se produisent». Tout près de l'abbé Jouin, il le sait, on s'est vanté de faire interdire sa pièce : et le Cardinal veut faire connaître sa pensée sur cette question. «Sans doute, disait-il, les populations s'intéressent vivement à la représentation des mystères évangéliques. Mais nous ne sommes plus aux âges de foi où ces représentations étaient habituelles et faisaient en quelque sorte partie de nos solennités. Aujourd'hui, en représentant la Passion dans un théâtre, on s'expose à faire considérer par le public les mystères de la religion comme un drame tout humain, en même temps qu'on encourage les fidèles à substituer à la méditation de la Passion une récréation pieuse». En considération, toutefois, des engagements pris par des hommes ho-norables auxquels la pièce a été livrée par les auteurs, on veut bien n'en pas interdire la représentation.
«De plus, pour sauvegarder le respect dû aux trois derniers jours de la Semaine Sainte, nous avons demandé aux or-ganisateurs de cesser toute représentation durant ces trois jours. Ce qu'ils se sont empressés d'accepter avec une docili-té dont nous leur savons particulièrement gré».
Ce «communiqué» de la Semaine Religieuse ne disait pas que cet engagement n'avait été pris qu'à la condition qu'aucune note ne serait publiée. De plus, il jetait le discrédit sur les représentations. Les recettes s'en ressentirent. La salle et les acteurs ayant été retenus pour un mois, les organisateurs subissaient un grave préjudice et se montraient menaçants. Pour éviter un scandale, l'abbé Jouin crut devoir les indemniser. C'était pour lui-même une perte matérielle considérable en même temps qu'une atteinte à son prestige. Il n'ignorait pas les influences qui avaient obtenu l'interven-tion du Cardinal. Il prit sa plume pour se justifier et dire sa surprise et sa douleur de ce «soufflet, le plus magnifique qu'il eût jamais reçu». Puis, il se rappela son vœu d'obéissance : la lettre écrite, mise sous enveloppe timbrée, puis décache-tée, ne fut pas envoyée. Moins de vingt ans après cet événement, on donnait dans un grand cinéma de Paris un film sur la Passion ; on y vit l'Archevêque et tout le clergé : nul ne s'étonna de leur présence. Le tort de l'abbé Jouin était d'avoir été en avance sur son temps.
Le cardinal Richard ne devait pas tenir rigueur au Curé de Saint-Augustin. Trois ans après, il lui écrivait :
Cher Monsieur le Curé,
Voilà bien des années déjà que vous travaillez avec dévouement pour cette chère Église de Paris. Les fondations que vous avez laissées dans les paroisses de Joinville-le-Pont, de Saint-Médard et de Saint-Laurent demeurent le témoignage de votre sollicitude pour le soin des pauvres et des malades. Vos travaux pour l'enseignement du Caté-chisme répondent à la pensée de notre Saint Père Pie X qui nous recommande avec tant d'instance de refaire une société chrétienne par l'instruction religieuse.
Je suis heureux, cher Monsieur le Curé, de vous témoigner, en vous nommant chanoine honoraire, la reconnais-sance de votre vieil Archevêque pour les services rendus au diocèse.
† Fr. Cardinal RICHARD, arch. de Paris.
Sur l'enveloppe contenant la note de la Semaine Religieuse et la réponse dont nous venons de parler, on peut lire ces deux dates écrites par l'abbé Jouin :
14 Mars 1902 : Note du Cardinal.
14 Mars 1903 : Mort de ma mère.
A un an de distance, jour pour jour, son grand cœur ressentait les plus grandes douleurs de sa vie.
Madame Jouin avait 88 ans quand parut la Passion. L'abbé Jouin l'avait dédiée «A sa Mère, à la mémoire du P. Au-gustin Jouin et à son frère Henry». Aussitôt, elle répondit à son fils, lui donnant le titre de «cher Maître», et le félicitant d'avoir parlé la langue des Anges pour louer son Dieu, le Seigneur Jésus. «Si le Père, votre parrain, était parmi nous, comme il vous féliciterait. Du moins, il vous inspire». Au terme de sa mission, elle ne devait par tarder à disparaître. Na-ture énergique, femme d'une foi profonde, veuve à trente-quatre ans avec la charge d'élever trois fils, elle avait voulu en faire des natures fortes, à l'abri des tempêtes du cœur et du doute. Le succès avait couronné ses efforts. Quelques an-nées plus tôt, gravement malade et invitée par une amie à se préparer à la mort, elle avait répondu : «Oh ! je suis bien tranquille. Je dirai à Dieu : Vous m'avez donné trois fils, j'en ai fait trois saints. Quant à mes défauts de caractère, ajoutait-elle, c'est Vous qui me les avez donnés, mon Dieu, faites pour le mieux... Je m'en remets à Vous».
Plus humble aujourd'hui, elle se demandait si, en voulant être forte, elle n'avait point été dure et parfois injuste, et de-manda pardon à sa bru avec laquelle elle vivait et s'ouvrit de ses inquiétudes à son fils qui calma ses scrupules. «Je dé-sire mourir dans votre amitié et dans votre estime ; je vous remercie de l'amour filial que vous m'avez témoigné. Je bénis mes fils, ma belle-fille et mes petits-enfants : Fanny et Amédée». Elle avait le droit de nous bénir, ajoute l'abbé Jouin, au terme de son ministère maternel rempli comme un sacerdoce. Consolée par les sacrements que lui donna l'évêque de Troyes, Mgr de Pélacot, elle s'endormit dans le baiser du Seigneur, pendant que son fils récitait les prières des agoni-sants.
Huit ans plus tard, l'abbé Jouin rendait les mêmes devoirs à son frère Henry.
C'est dans ce même chalet Notre-Dame, à Hermanville, où Madame Jouin était revenue en 1889 si profondément at-tristée, que mourut à vingt-quatre ans de distance, son second frère Henry Jouin. D'une santé chancelante depuis plu-sieurs années, il ne donnait pas cependant d'imminentes inquiétudes. Toutefois, les forces trahissaient un peu chaque jour l'infatigable travailleur, à qui le repos fut inconnu plus de cinquante ans de sa vie.
«II fléchissait, raconte son frère ; mais avec l'espoir de retrouver au bord de la mer sa vigueur coutumière. Or, ce fut au cours de ce voyage qu'Henry Jouin fut pris d'un évanouissement terminé par une hémorragie stomacale. Dans la nuit de nouveaux vomissements de sang lui enlevèrent le meilleur de ses forces. Cette crise devait être la dernière, maintenant il allait s'éteindre comme la lampe du sanctuaire qui consacre à Dieu, dans un suprême effort, ses lueurs saccadées et vacillantes. Lueurs cependant qui furent encore des éclairs de rare vitalité et qui témoignent d'une pré-sence d'esprit et d'une énergie de volonté surprenantes. II envoya aux riverains de la brèche d'Hermanville une double circulaire pour la défense de leurs intérêts. Sans cesse il me demandait de revoir les épreuves de sa Revue «Jehanne la Pucelle» et de préparer les numéros suivants. Chaque jour, il dictait son courrier. Le dimanche 27 juillet, il s'entretint plusieurs heures avec notre ami le sénateur Dominique Delahaye des questions apparentées aux graves intérêts de l'Église et de la Patrie, et des efforts tardifs de quelques sommités catholiques pour une action commune. Toutefois les sujets qu'il traitait, les projets même qu'il semblait former ne le distrayaient pas entièrement de la pen-sée de la mort. Il m'en parlait constamment pour me dire que son œuvre n'était pas finie et qu'il me confiait une lourde charge : «Sa Jeanne d'Arc monumentale» . Il me disait encore que je n'avais plus qu'à lui donner les derniers sacrements et à le regarder mourir... Son âme repliait lentement ses ailes dans son corps endormi.
«Le lundi 11 août, il fit comme d'habitude, avec son fils à genoux au pied de son lit, sa prière à haute voix. Nous l'entendîmes, non sans émotion, réciter le De profundis et nommer un à un le cortège funèbre des proches et des amis disparus. Dans la soirée, je le confessai, et nous causâmes une demi-heure. Comme il semblait mieux, je lui dis sincèrement quelques paroles d'espoir : «Je ne sais, me répondit-il, quelle est la volonté de Dieu, mais j'ai fait le sa-crifice de ma vie, il y a longtemps déjà, afin de mériter, si je le puis, pour mes enfants, surtout pour Amédée, une vo-cation chrétienne». Ce fut son testament d'amour familial. Le soir, il pâlit subitement ; je n'eus que le temps de lui donner l'extrême onction et d'y ajouter le Proficiscere, anima Christiana, des prières des agonisants, il n'était déjà plus. Sa femme, ses enfants Fanny et Amédée, une amie fidèle, Mme Barrault, et moi nous récitâmes pour lui le De Profundis qu'il avait récité le matin pour les autres. Sa femme, Mary, jalouse de son trésor perdu, l'emporta seule dans la chambre voisine. Les enfants pleuraient ; pour nous, les pleurs mouillaient à peine la paupière. Quand on est jeune, on verse les larmes des yeux ; à l'âge mûr, on verse les larmes du cœur, larmes de sang, que personne ne voit, et que Dieu seul entend, pendant qu'elles tombent, silencieuses, goutte à goutte dans l'abîme sans fond de nos amours évanouis...
«Après le saisissement du coup de la mort, venue comme un voleur, il fallut nous rendre à l'inconsolable constata-tion que celui que nous aimions était parti pour ce voyage que nous ferons tous... tout nous rappelait ce qu'il fut, sans nous dire ce qu'il était ; cette immobilité rigide contrastait singulièrement avec cette force d'action, victorieuse (durant bientôt les trois quarts d'un siècle) de toute infirmité humaine ; ses yeux fermés donnaient à son visage l'aspect des statues antiques qu'il avait naguère encore amoureusement contemplées ; ses lèvres n'esquissaient plus un sourire de bonté ou une parole de pardon ; le crucifix posé sur sa poitrine témoignait qu'il porta la croix dès son berceau ; le chapelet ne glissait plus grain par grain sous ses doigts, sa prière se terminait dans un monde meilleur. - Alors, en face de cet effondrement, je pensais, Seigneur, que Vous veniez de lui apparaître et que, dans cette première ren-contre, Vos surabondantes bénédictions avaient couvert aux yeux de Votre inexorable justice les défaillances soli-daires de notre fragile humanité. Et j'ai cru Vous voir, ô Jésus, couvrir de toute Votre infinie pitié ce blessé, ce meurtri que Vous aviez Vous-même si supérieurement marqué du sceau de la souffrance, montrer à Vos élus ce travailleur aux mains pleines ; nommer par son nom à Votre Père ce lutteur qui Vous a toujours confessé devant les hommes ; et qu'en récompense de son indéfectible fidélité dans les plus petites choses, Vous lui aviez dit de Votre voix qui, à elle seule est une extase et un ravissement : «Confiance, bon serviteur, entre dans les joies du Seigneur, ton Dieu».
Le 14 août, la cérémonie funèbre fut célébrée dans l'église d'Hermanville-sur-mer. Puis, ce fut le retour, le chemin du Calvaire ; et le 15 août, l'inhumation eut lieu dans le caveau de famille, au cimetière Montparnasse. La maîtrise de Saint- Augustin, malgré les offices du jour, voulut venir chanter sur cette tombe le De Profundis. Le clergé de cette paroisse et de nombreux amis m'y ont accompagné. Après les prières, M. Jules Delahaye, député de Cholet, un ami de jeunesse, angevin comme nous, prononça des paroles d'adieu, pleines de cœur et de vérité».
Après ces hommages émouvants rendus à la mémoire des siens, l'abbé Jouin ajoute : «Maintenant, tous les trois sont partis et j'espère qu'ils me continueront leurs prières et leurs inspirations». Et, par la foi, il voit sa mère conduisant ses deux frères dans les sentiers du Paradis. Car maintenant «ils voient Dieu, dit-il, ils aiment Dieu, ils jouissent de Dieu, parce qu'ils sont de Sa famille rentrés dans la maison paternelle. Voilà mon Credo, et cet acte de foi peuple ma solitude d'espérances consolatrices déjà tout ensoleillées de divins rayonnements».
Aux deuils de famille allaient bientôt se joindre pour l'abbé Jouin d'autres épreuves, et son activité charitable allait s'exercer sur un nouveau théâtre.
* * *
Les premiers bruits de guerre le surprirent au retour d'un voyage en Dauphiné entrepris pour la santé d'un prêtre ami, et au cours duquel il avait revu les lieux de sa jeunesse monastique : le couvent de Saint-Maximin et la Sainte-Baume.
Les hostilités commencées, sa décision est bientôt prise : il mobilise toutes les forces spirituelles et charitables de Saint-Augustin. Pendant qu'il convie ses paroissiens à la prière et à la pénitence, il s'entend avec l’Union des Femmes de France pour la fourniture des lits et du matériel chirurgical et radiologique nécessaires à l'ambulance qu'il voulait établir ; obtient le concours du professeur Mauclaire, chirurgien de la Charité, et du docteur P. Moizard, ses paroissiens ; de-mande aux Servantes des Pauvres le sacrifice de leur chapelle pour l'hospitalisation des soldats et des officiers ; enrôle comme infirmières l'élite active des dames de sa paroisse et sollicite des autres leurs offrandes et leur aide, payant lui-même, dans une large mesure, de sa personne et de sa bourse et supportant seul, au début, des dépenses énormes, jusqu'au jour où le Comité de la Colonie parisienne de l'Equateur voudra bien les partager avec lui. Du 6 septembre 1914, où arrivèrent les premiers blessés de la Marne, au 30 août 1919 qui vit partir le dernier soldat guéri, il y eut, au té-moignage du docteur Mauclaire, 1275 entrées de soldats ou d'officiers, 300 opérations de grands ou moyens blessés, sur lesquels trois seulement succombèrent, et les dépenses s'élevèrent à 396.000 francs.
L'abbé Jouin veillait à tout, n'hésitant pas au début à prendre le pinceau ou le marteau, assistait à toutes les opéra-tions, visitait chaque jour les blessés auxquels il distribuait des douceurs et de fortifiantes paroles, et donnait à tous l'exemple du dévouement et de l'abnégation. L'exemple était suivi.
«Une infirmière, disait un jour l'abbé Jouin au Cardinal Dubois, m'édifiait entre toutes. Bien que d'un âge avancé, elle choisissait les travaux les plus pénibles et les plus répugnants et elle excellait à s'effacer en tout. Un jour, elle m'arrêta pour me dire d'une voix émue jusqu'aux larmes combien elle était touchée de mes visites quotidiennes. Je rougis intérieurement du peu que je faisais en face de cette âme dévouée jusqu'à l'héroïsme».
Ce prêtre qui rougissait du peu qu'il faisait, en comparaison de ses infirmières, on l'avait vu cependant, revêtu d'une blouse, transporter les matelas sur sa tête d'une salle à l'autre, peindre les escaliers, se prêter à toutes les besognes ; on le voyait assister à toutes les opérations - il s'en était fait une règle absolue - Elles avaient généralement lieu immédiate-ment après le déjeuner. Il fallait précipiter le repas et partir aussitôt, demeurer debout, dans une atmosphère de clinique, pendant une heure ou deux - fatigue excessive pour un homme dont les reins étaient malades et qui jusque là était resté étranger aux émotions des opérations chirurgicales.
Il avait tenu au début à dire lui-même la messe à ses soldats. Mais au bout de quelques mois, il avait dû y renoncer. Le jour de la Toussaint 1914, après avoir dit la messe de 6 heures à l’ambulance, il était allé chanter la grand'messe à la paroisse, puis était revenu près de ses chers soldats. Il fut pris de vives douleurs dans le dos et eut un commencement de syncope ; on dut le ramener chez lui en voiture. Il n'en fallut pas moins pour le convaincre qu'il avait excédé la limite de ses forces.
Cet héroïsme frappait les blessés qui en étaient l'objet. «L'ambulance 139, disait l'un d'eux qui pouvait comparer avec un autre hôpital, est le paradis, et l'abbé Jouin est la bonté personnifiée, une vivante image de la charité... Je suis per-suadé que nous devons pour une grande part notre guérison à ses prières. Je lui dois avec ma santé le réveil de ma foi». On peut imaginer le bien moral et religieux qui se faisait dans ces pauvres âmes parfois plus meurtries que leurs corps, les conversions, les unions régularisées, les consciences pacifiées.
De cette action bienfaisante, nul n'était exclu : Musulmans, Israélites, incroyants étaient traités avec la même bonté. Un blessé était en danger, et la sœur qui l'exhortait à se préparer à la mort apprend qu'il est israélite. Aussitôt l'abbé Jouin fait venir le rabbin. Après le décès, c'est encore lui qui prend à sa charge les frais du rapatriement, et le journal israélite de la région rendait un témoignage chaleureux à la charité et au tact de ce curé catholique ainsi qu'à celui du personnel de l'ambulance qui avait accompagné jusqu'à la gare la dépouille du soldat tombé pour la patrie.
La guerre ne faisait pas de victimes qu'au front. L'arrière avait aussi ses fléaux. Un jour d'hiver, une pauvre femme suivie d'un jeune enfant tombait d'épuisement au seuil de l'ambulance et y mourait bientôt. L'abbé Jouin ne voulut pas abandonner à l'Assistance Publique l'orphelin que la Providence lui envoyait. Il le garda à l'hôpital, l'adopta, prit soin de son éducation, lui procura du travail. Il est aujourd'hui à son tour, soldat, et est heureux de toucher chaque mois une pe-tite somme que son bienfaiteur lui a réservée.
«Peu de temps après, nous raconte une infirmière - une artiste qui, autrefois, avait joué la tragédie avec Sarah Bernhardt et maintenant remplissait le rôle plus grand devant Dieu de nettoyeuse de crachoirs - l'abbé Jouin arrive tout joyeux. Quelle grande nouvelle nous apportez-vous donc, lui demandai-je ? - Une très grande, répondit-il, je suis père pour la seconde fois... Oui, reprit-il, hier, entre deux portes de l'église, on a trouvé une enfant de quelques jours, et je la garde». Et il fit pour la petite orpheline comme il avait fait pour le petit garçon. Il la confia à des personnes dont le cœur était à la mesure du sien. Elles l’élevèrent à ses frais ; l'une d'elles l'adopta et, après lui avoir donné son nom, lui prodigue aujourd'hui tout l'amour d'une véritable mère.
Vers la fin de la guerre, le Président de la République visita l'ambulance 139 ; aux éminents praticiens, aux infirmières volontaires, il adressa ses remerciements et ses félicitations. En partant, il ne fit qu'un oubli : celui d'épingler la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine du fondateur et du soutien de l'ambulance. Est-ce parce que cette poitrine battait sous la soutane du prêtre ?
De front avec la mobilisation de la charité, l'abbé Jouin avait fait la mobilisation de la prière et, là encore, fait preuve d'une ténacité peu commune. Pour toucher le cœur de Dieu, il fallait, dans l'épreuve qui s'abattait sur la France, des âmes pures et pénitentes. Aussi, dès les premiers jours, organisait-il dans la paroisse l'exercice du chemin de croix per-pétuel et conviait-il les associés du Rosaire et tous les fidèles à prier celle qui, à Lépante, sauva l'Europe de l'invasion musulmane. Les paroissiens répondirent par centaines à son appel. Chaque soir, depuis le 2 août 1914 jusqu'au 30 août 1919, ils le voyaient arriver au milieu d'eux et d'une voix vibrante réciter les quinze dizaines jusqu'au dernier Ave.
C'est à cette fidélité que la paroisse Saint-Augustin attribua la protection spéciale dont elle fut l'objet. Malgré le voisi-nage de la gare Saint-Lazare spécialement visée, aucun obus de jour ou de nuit n'est tombé sur son territoire. Quand, au mois de décembre 1918, pour le 74e anniversaire de l'abbé Jouin, la Confrérie du Rosaire convia les paroissiens à offrir à leur pasteur un témoignage de reconnaissance et d'admiration, elle ne crut mieux faire que de lui remettre, avec une large offrande pour l'ambulance, un rosaire d'or et d'améthystes, un «rosaire de guerre».
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 7)
* * *
Homme d'étude et de cabinet, M. Jouin fut aussi et au même degré, un homme d'action. Le caractère et la volonté étaient chez lui à la hauteur de l'esprit. «Les livres sont pourtant d'indulgents amis, remarquait encore le R.P. Hébert. On ne prend pas dans leur commerce tranquille l'habitude de la lutte, et même il arrive qu'on en perde complètement la ca-pacité et le goût», Studieux, M. Jouin n'était pas un timide. Sous cette physionomie empreinte de calme et de bienveil-lance, il y avait une énergie de fer qui veillait sans défaillance. «Que l'occasion s'en présente, on la verra sur le champ surgir et se dresser».
Depuis vingt ans, ces occasions n'avaient pas manqué. Témoin ou, pour mieux dire, soldat dans les premiers com-bats livrés à l'Église par la Libre pensée sous le nom de laïcisation, il avait payé de sa cure sa résistance aux Francs-Maçons de Joinville. Il assistait maintenant aux assauts répétés de la secte, sûre de son triomphe. Successivement, et en dépit des «attentions, des services, des efforts» de Léon XIII et de Pie X, il avait vu la loi néfaste du divorce votée, les prières publiques pour la France supprimées, les Congréganistes exclus de l'enseignement public et, bientôt après, de tout enseignement quel qu'il soit, les clercs astreints au service militaire, les religieux dispersés et dépouillés de leurs biens ; le crucifix banni des tribunaux, des écoles et de tous les établissements publics ; la fermeture de toutes les écoles con-gréganistes décrétée dans un délai qui ne devait pas dépasser 1914 : autant d'étapes vers le but persévéramment poursuivi de la séparation officielle et définitive de l'Église et de l'État.
Elaborée depuis vingt-cinq ans dans les Loges, habilement soutenue par un franc-maçon, M. Briand, la loi de Sépara-tion fut votée par le Parlement, le 11 Décembre 1905 : c'était en réalité une loi d'apostasie officielle et de confiscation. Après avoir proclamé que la République Française ne reconnaît et ne salarie aucun culte, elle se déclarait, par un acte unilatéral, déchargée de l'obligation de payer le traitement du clergé qui n'était pourtant qu'une restitution partielle des biens enlevés à l'Église pendant la période révolutionnaire - elle s'emparait des sommes confiées à l'Église pour que des messes fussent dites à perpétuité à l'intention des fondateurs - attribuait aux communes la propriété des églises, le prêtre n'y étant plus qu'un occupant et un usager sans aucun titre - ordonnait qu'inventaire serait fait par l'État de tous les objets mobiliers, sans aucune mention qui empêchât les agents publics d'ouvrir les tabernacles - instituait enfin des associations cultuelles qui ne seraient pas nécessairement dirigées par l'Évêque et qui devaient posséder et gérer ce qui restait des biens d'Église, des quêtes et des autres revenus, et verser les fonds de réserve, soigneusement limités, entre les mains de l'État. Les catholiques avaient un an pour constituer ces associations. Passé ce délai, tous les biens mobiliers et im-mobiliers : églises, presbytères, évêchés, séminaires, seraient confisqués et mis sous séquestre.
Deux mois après, Pie X adressait aux Archevêques, aux Évêques, au clergé et à tout le peuple français, une première encyclique, jugeant et condamnant la Loi de Séparation «comme profondément injurieuse vis à vis de Dieu, qu'elle renie officiellement... comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité publique due aux traités... comme contraire à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels et à sa liberté... enfin, comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples».
Par une seconde encyclique, du 10 août 1906, le Pape rejetait et condamnait les Associations cultuelles, comme con-traires à la constitution de l'Église.
Pouvait-on étudier l'établissement d'associations légales et canoniques où serait sauvegardée, dans une certaine me-sure, l'autorité de la hiérarchie catholique - et l'on disait le ministère favorable à ce projet - la majorité des évêques le pensait. Mais le Pape refusa. Il estimait, lui le Chef souverain, que les modifications proposées ne donneraient point aux catholiques de sécurité suffisante. Il jugeait l'Église de France assez généreuse pour payer de tous ses biens la rançon de sa liberté.
Dès la promulgation de la loi, les inventaires avaient commencé dans toutes les églises de France, provoquant partout l'émotion et des troubles. A Paris - à Saint-François-Xavier, au Gros-Caillou, à Sainte-Clotilde - des fidèles, de leur propre initiative, s'opposaient à l'exécution de l'inventaire ; l'effervescence grandissait.
Le Curé de Saint-Augustin n'avait pas attendu le vote de la loi pour alerter ses paroissiens. Dans des Conférences à l'Association Paroissiale qu'il venait de fonder et dans ses prônes, il ne cessait de les exciter non seulement à garder leur foi, mais, à la défendre. Un trop grand nombre, inconscients de la situation faite à l'Église de France, se montraient trop préoccupés de leurs plaisirs, leur unique souci était de continuer sans trouble leur vie facile et joyeuse.
L'inventaire de l'Église Saint-Augustin avait été fixé au 31 janvier. Les ordres du Cardinal Richard, comme ceux du Souverain Pontife, étaient formels : protester contre la violation des droits de l'Église, mais éviter «d'agir d'une façon sédi-tieuse et violente».
Bien que la résistance passive à une loi injuste soit, d'après saint Thomas, non seulement légitime mais obligatoire, dût-il en résulter quelque trouble, on n'éleva aucune barricade dans l'église. Mais ce jour-là, les fidèles furent convoqués à assister à une «messe de deuil», le deuil de l'Église. Après la messe, l'abbé Jouin, entouré de son clergé et des con-seillers de fabrique, attendait à la sacristie l'inspecteur des domaines, prêt à faire entendre sa protestation. Laissons l'Ab-bé Jouin faire un an plus tard, devant la 9e chambre du tribunal correctionnel, le récit de cette tentative :
«Ce jour-là, même par la suite, il n'y eut aucun trouble à Saint-Augustin, et je n'ai pas vu l'agent des domaines, M. Bonnefoy. Il est venu, conduit dans l'église par un de mes vicaires, mais il n'est pas entré à la sacristie : les fidèles l'en ont empêché sans que je fusse averti de leur dessein.
«Je l'avais vu la veille, au presbytère, lui-même m'avait dit qu'il serait bon d'avoir beaucoup de monde dans l'église, et il s'est enquis s'il avait quelque chose à craindre.
«Je lui avais répondu négativement. Le lendemain, il vint me féliciter de la parfaite attitude de mes paroissiens, et fut désireux de connaître les noms des deux messieurs qui l'avaient poliment reconduit à la porte. Je m'empressai de les lui taire».
Tout s'était passé dans un calme relatif, mais sans la moindre violence, raconte le Bulletin.
«L'Inspecteur parti, M. le Curé était monté en chaire pour donner lecture de sa protestation contre l'inventaire «première mesure d'exécution de la loi de Séparation». Le Curé et MM. les Fabriciens estiment, avec S. E. le Cardi-nal Archevêque de Paris, que cet inventaire constitue un premier acte de mainmise sur les biens qui sont la propriété de la Fabrique», toute coopération de leur part serait sacrilège, puisque les biens et les lieux inventoriés sont consa-crés au culte ; déloyale, puisqu'ils en ont la garde et la responsabilité».
Il avait ajouté :
«Mes chers paroissiens, merci d'être venus. Vous êtes aujourd'hui la paroisse sous les armes, je suis fier de vous. Aujourd'hui, notre protestation est pacifique, mais je sais maintenant que, s'il faut demain une protestation plus éner-gique, vous serez là».
Pendant toute l'après-midi, la grande porte de l'église resta ouverte et une foule de fidèles constamment renouvelée vint s'agenouiller devant le Saint-Sacrement rappelant le jour du Vendredi-Saint. C'était bien aussi un jour de deuil pour les paroissiens de Saint-Augustin. C'est alors que l'abbé Jouin se décida à établir la garde de son église.
Quelle était cette garde et pour quelle raison fût-elle organisée ?
L'Inventaire n'ayant pu avoir lieu, le Procureur devait, aux termes d'une circulaire de M. Bienvenu-Martin, Ministre des Cultes, ou bien procéder à cette opération après une démarche officieuse auprès du «représentant légal», c'est-à-dire du Curé, ou bien, si cette intervention ne lui semblait pas suffisante, le mettre en demeure, par un arrêté, d'avoir, à une date fixée, à remettre les clefs à l'agent des Domaines, faute de quoi il serait procédé à l'ouverture des portes avec le con-cours d'un officier de police.
Aucun avertissement n'ayant jamais été adressé au Curé, celui-ci pouvait se demander si l'agent n'allait pas chercher à opérer par surprise et faire ouvrir le coffre-fort par la force. Des troubles pouvaient survenir.
«Chargé, sous le Concordat, de la garde de mon église, dira, un an après, l'abbé Jouin, j'ai pu légalement l'orga-niser comme il me plaisait, soit contre les policiers, soit contre une jeunesse trop bruyante qu'on accusait à tort d'ail-leurs d'obéir à des instructions venues de Rome ou des Evêques».
Cette garde, il l'assure avec le concours de l'Association Paroissiale. A chaque porte, en permanence, des escouades de veilleurs, comme dans une place assiégée, se succèdent sans relâche du 13 février au 9 juin. Quant à lui, il s'est ré-servé la garde de nuit et s'est installé dans une des tours de l'église.
Un lit de camp lui a été dressé dans la lingerie. Le soir venu, les portes de l'église fermées, on peut le voir, une lan-terne à la main, gravir les étages de sa tour ; la lumière ne s'éteint souvent que tard dans la nuit : l'abbé Jouin travaille à sa Jeanne d'Arc ou à sa Clotilde.
Au premier son de l’Angelus, il est en bas, donne ses ordres, et ainsi pendant quatre mois.
Entre temps, le Curé de Saint-François-Xavier, l'abbé Gréa, poursuivi pour résistance aux Inventaires, avait été ac-quitté, et l'abbé Richard, curé du Gros-Caillou, où la résistance avait été plus vive et nécessité l'intervention des pom-piers, inculpé d'abord, avait été l'objet d'un non-lieu.
Qu'attendait le Gouvernement pour reprendre les opérations à Saint-Augustin ? Surpris de la résistance qui se faisait chaque jour plus vive en province, où le sang d'une victime, André Régis, avait coulé, le Président du Conseil, M. Cle-menceau, suspendit les Inventaires et l'abbé Jouin put se relâcher de sa vigilance. Mais, au mois de novembre, pré-voyant la reprise des hostilités, il confia à une personne de son entourage son intention de reprendre, lui aussi, sa garde. Quelle ne fut pas sa douleur, le lendemain, d'apprendre que l'inspecteur des domaines, accompagné d'un serrurier, s'est présenté à l’improviste et, avec une équipe de policiers et de serruriers, procède à l'inventaire. L'abbé Jouin accourt, et, comme l'un des vicaires, le voyant pâlir en face du coffre-fort éventré, lui exprimait sa surprise d'une si violente émotion : «Malheureux, répondit le Curé, vous ne savez donc pas que c'est l'Église qui est violée ?»
Entre temps, le Pape ayant repoussé les Associations Cultuelles, le Gouvernement annonça la dévolution des biens de l'Église. On voulait bien, au moins provisoirement, laisser les églises à la disposition des catholiques. Ils pouvaient s'y réunir, à condition d'en faire la déclaration. Cette déclaration assimilait les exercices du culte à des réunions publiques : comme tous les curés de Paris, l'abbé Jouin s'y refusa : «Pour nous, dira-t-il, l'Église de France a fait sa déclaration au baptême de Clovis... Il a fallu l'apostasie de la France pour en exiger une nouvelle».
Le 11 décembre 1906, un réquisitoire introductif d'instance fut pris contre trois curés de Paris, comme coupables de s'être opposés par la violence à l'exécution d'une loi de l'État, et contre Mgr Montagnini, chargé des archives de la Non-ciature depuis le départ du Nonce, comme complice du délit commis par les précédents. Le 13, le juge d'instruction faisait subir à l'abbé Jouin, l'un des trois curés mis en cause, un premier interrogatoire au sujet d'un écrit distribué par lui «dans les lieux où s'exerce le culte, contenant, disait l'inculpation, une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, et tendant à soulever et à armer une partie des citoyens contre les autres».
Cet écrit est intitulé : Messe de deuil En voici le texte :
LE MERCREDI, 12 DECEMBRE 1906, A 9 HEURES.
Cette semaine voit se consommer l'apostasie de la France officielle et sa rupture avec l'Église, qu'elle ne connaî-tra plus que pour la persécuter.
Nos biens sont confisqués, les volontés suprêmes des défunts ne sont même pas respectées, et désormais l'État ne fera pas acquitter les messes de fondation.
Nos églises sont livrées au séquestre, au maire et au commissaire de police. Le seul qui devienne un étranger, c'est le Curé lui-même, que le Ministre tient pour un occupant sans titre juridique. (Circulaire du 1er décembre 1906).
Avant d'inaugurer ce nouvel état de choses, j'estime répondre à vos pieuses intentions en célébrant une messe de deuil mercredi prochain. Cette Messe s'appliquera tout particulièrement aux âmes qui vont perdre le bénéfice des fondations. Je vous exhorte à faire dire une messe de plus chaque année, en compensation du grave préjudice que vont subir dans notre pays les âmes aimées du Purgatoire.
La lutte est commencée ; soutenons-la vaillamment et chrétiennement ; et laissez-moi vous le redire, comme au jour des Inventaires, en janvier : il faut que notre deuil, si triste et si profond qu'il puisse être, soit un deuil armé.
Garder la foi ne suffit plus, nous devons la défendre».
Cette demande d'information, bientôt suivie d'inculpation, n'avait été que le prétexte cherché par le Président du Con-seil, M. Clemenceau, pour perquisitionner à la Nonciature et mettre en cause le Vatican. Le jour même de cette perquisi-tion qui provoqua une vive émotion dans les milieux diplomatiques, Mgr Montagnini, gardien des Archives pontificales, était expulsé et, le 11 avril suivant, l'abbé Jouin, seul des trois curés, était cité devant la 9e chambre de police correction-nelle.
Très calme, en attendant l'ouverture de l'audience, l'abbé Jouin feuilletait les épreuves d'un drame de sa composition. Les débats étaient dirigés par M. Toutain, juge-doyen à la 9e Chambre, que le Parquet avait en vain voulu écarter de la présidence.
Par son attitude, par ses réponses nettes et franches et par ses fières et viriles revendications, l'abbé Jouin sut s'atti-rer les respectueuses sympathies d'un auditoire très mélangé où se coudoyaient les représentants de tous les journaux, même les plus avancés, et les membres de la fameuse Commission parlementaire.
Invité à fournir des explications sur les cinq dernières lignes de son écrit, les seules que l'inculpation avait retenues, il fît la déclaration suivante :
«La lutte est commencée», c'est évident. On ne saurait nier qu'on fasse la guerre à l'Église, qe la loi dite de Sépa-ration, soit par la confiscation de nos biens, soit par la situation précaire faite au Curé, ne soit mise nous et n'ait créé un état aigu d'hostilité. D'ailleurs, le 11 décembre, M. Clemenceau disait lui-même «qu'il avait tiré le premier coup de canon». C'est contestable.
En tout cas, il y avait longtemps que le premier coup de revolver avait couché une première victime : Régis André, demandant grâce au gendarme qui l'achevait sans pitié.
J'ai dit qu'il fallait soutenir la lutte «vaillamment et chrétiennement». Je pense que personne ne peut trouver à re-dire à ces paroles».
L'abbé Jouin explique ensuite que par les paroles «Comme au jour des Inventaires», il n'a voulu parler que de l'Inven-taire de Saint-Augustin et de la Messe de deuil à laquelle il avait convié ses paroissiens en leur disant que, si l'Inventaire marquait le début de la lutte et imposait le deuil aux catholiques, il fallait du moins que ce fût un deuil armé.
«Quel sens ai-je attribué à ces paroles ?
Évidemment, un sens figuré. J'en ai donné comme preuve directe avec l’instruction qu'aucun de mes paroissiens n'est venu à la Messe de deuil du 11 décembre, ni en deuil, ni armé.
Mais pourquoi demander un deuil armé, et le demander sans cesse ?... Un premier acte d'accusation englobait toutes mes prédications depuis trois ans, ce n'était pas assez. Il y a bientôt quarante ans que je prêche de même.
Toutefois, si j'appuie en ce moment sur le besoin d'avoir un deuil armé, c'est qu'une notable partie des catholiques ne comprennent pas la situation actuelle faite à l'Église de France. A ceux dont l'unique souci est de continuer leur vie facile et joyeuse, je dis : Quand l'Église pleure, vous devez être en deuil. Et à ceux qui se plaignent constamment, et répètent que tout est fini et qu'il n'y a rien à faire, je dis : Soyez armés, soyez debout, vous n'avez pas le droit de vous désespérer, et surtout de désespérer les autres...
C'est donc dans un sens figuré que j'ai pris les mots de «deuil armé».
Et l'abbé Jouin en donne pour raison que le Souverain Pontife, tout en demandant aux enfants de l'Église de se «revê-tir des armes de lumière» pour combattre de toutes leurs forces pour la Vérité et la Justice», leur interdit d'agir d'une fa-çon séditieuse et violente ; que, lui-même ne pouvant prendre les armes, il n'aurait pas voulu demander à ses paroissiens de risquer leur vie... et surtout pour cette raison que ce ne sont pas des armes qu'il faut à l'Église, mais des soldats, des chrétiens convaincus, des catholiques militants, revêtus de l'armure de la foi.
Et l'abbé Jouin explique ce qu'il entend par une foi armée et défendue :
«Je veux une foi dont la conviction soit éclairée, profonde, lumineuse, ne flottant pas dans l'indécision, ne se retran-chant pas dans des parallèles entre Léon XIII et Pie X, et n'étant pas obligée d'apprendre de M. Combes, comme Ta fait M. Briand, quelle est la constitution de l'Église, et pourquoi le Pape ne pouvait accepter les Associations cultuelles.
«Je veux une foi qui, de la conviction passe dans la parole : et je m'appuie sur le programme que le Souverain Pontife traçait naguère à l'Association catholique de la Jeunesse Française : «Se tenir en dehors des disputes et des passions politiques, mais poursuivre sur le terrain social toutes les revendications religieuses, et le faire vigoureuse-ment par la parole, la conférence, la presse, les écrits».
«Je veux enfin une foi d'action qui s'affirme et se défende. Et cette affirmation, dans la lutte actuelle, doit aller jus-qu'au bout, malgré la délation et les fiches, dût-on briser son épée ou sa carrière. Mais aussi je réclame de ceux qui sont les témoins de tels sacrifices, de tenir pour un devoir sacré de refaire ces situations brisées, et de ne pas s'ou-blier jusqu'à laisser dans la misère leurs frères vaincus, comme on l'a fait pour certains magistrats qui avaient donné jadis leur démission, lors des décrets.
«Telle est la foi, vivante, consciente d'elle-même, militante, qui nous unira dans l'action catholique, et nous assu-rera le triomphe. Tel est le sens de mon deuil armé, sens figuré, spirituel, mais énergique, pour la défense des droits de Dieu».
Ce «deuil armé» n'a provoqué aucune résistance à l'exécution de la loi :
«Je tiens à dire toutefois, ajoute l'abbé Jouin, qu'aucune loi, en contradiction avec mon ministère sacerdotal, ne me fera fléchir. Après l'essai d'inventaire dont j'ai parlé, la police vint me trouver trois fois ; au fond, on me demandait de livrer mon église. J'ai refusé, et j'ai établi ma garde.
«Avec la grâce de Dieu, j'espère ne pas connaître ces capitulations de conscience. Je ne saurais être traditeur des biens d'Église, puisqu'on les a tous volés ; mais il me reste les âmes, et je ne serai jamais, ne fût-ce qu'en appa-rence, un traditeur d'âmes».
Puis passant hardiment à l'offensive :
«J'ai été inculpé, pour permettre à M. Clemenceau d'engager des perquisitions d'ordre judiciaire à la Nonciature et de m'adjoindre Mgr Montagnini comme complice. Le président du Conseil l'a affirmé le jour même à la Chambre des Députés. L'accusation était fausse, mais elle a été maintenue ; et, bien que les deux curés de Paris inculpés avec moi aient bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, il n'en reste pas moins que c'est à la faveur de ce subterfuge que l'on a saisi les papiers diplomatiques de Mgr Montagnini».
«M. Clemenceau a commis un acte retentissant en saisissant ce dossier, c'est son affaire ; il veut, dit-on, y trouver la preuve de menées politiques qui se dérouleraient à une autre Cour, cela le regarde encore, mais qu'il ait au moins la franchise de l'avouer. Il me suffit d'avoir couvert ses délits diplomatiques, et je ne veux pas être une seconde fois, sans protester hautement, le chaperon de son manque de courage».
Me Danet, avocat de l'abbé Jouin, après avoir stigmatisé, comme il convenait, l'illégalité de la perquisition faite aux ar-chives de la Nonciature, n'eut pas de peine à prouver le caractère figuré et tout de rhétorique du «deuil armé», et le de-voir pour tout prêtre, comme pour tout catholique, de défendre la foi. «Cette foi, s'écriait l'éminent avocat, vous voulez l'arracher de l'âme de nos enfants, et cela nous ne le voulons pas !... Vous pouvez continuer votre lutte, nous sommes de ceux qu'on ne terrassera jamais !»
En dépit du talent du défenseur, l'abbé Jouin fut condamné à 16 francs d'amende.
«Peu importe le montant de sa condamnation : les juges ont pris soin de nous prévenir, dans leur sentence, qu'ils ont réduit la peine à son minimum, pour habituer l'opinion publique à l'introduction dans la jurisprudence d'un délit nouveau. Une autre fois, la condamnation sera plus sévère et entraînera, pour le prêtre condamné, des consé-quences plus graves. L'abbé Jouin fut condamné, non pour avoir incité à la rébellion, le tribunal le constate, mais pour avoir, en tout et pour tout, engagé en principe ses paroissiens à résister aux mesures vexatoires qui violente-raient les consciences et porteraient atteinte aux droits de l'Église. En un mot, il ne fut pas condamné pour avoir dé-sobéi à la loi de l'État, mais pour avoir obéi à la loi de Dieu».
Ainsi s'exprimait, au lendemain du procès, un ancien Ministre des Affaires étrangères, M. Flourens.
Une loi qui conduit à de tels excès est elle-même condamnée par la conscience. Les juges le reconnaissent dans leurs considérants, en appelant la Loi de Séparation «une loi d'exception exorbitante du droit commun, en ce qu'elle crée un délit spécial aux ministres du culte devenus pourtant, par son effet, de simples citoyens». Elle créait aussi une juridic-tion spéciale : le tribunal, au lieu de la cour d'assises, et une catégorie spéciale de citoyens : le prêtre. Deux mots de combat, au figuré, en feront un criminel.
«Quand on envoie une idée dans les cachots, disait Louis Veuillot, c'est le geôlier qui se charge de chaînes. Quand on l'envoie au bourreau, c'est le bourreau qui meurt». Malgré les 16 francs d'amende du tribunal, l'abbé Jouin ne sortit point diminué de ces débats. Ils le grandirent aux yeux de l'opinion. Il avait fait entendre de fières paroles et revendiqué hautement les droits de l'Église. Les vrais condamnés, c'étaient les auteurs de cette loi, loi de spoliation, loi qui préparait le schisme et contre laquelle le Pape a élevé une protestation qui demeure.
* * *
Si le commerce des livres n'avait point amolli le caractère de l'abbé Jouin, les luttes qu'on lui imposa n'avaient point desséché son cœur. Ce fort restait toujours profondément bon, et de cette bonté il donnait chaque jour des preuves.
Un de ses premiers soins, en prenant possession de sa charge, avait été d'appeler à Saint-Augustin les Servantes des Pauvres. Les malades indigents ne manquaient pas dans cette opulente paroisse dont les pauvres occupent les mansardes des sixièmes étages. Les religieuses de Dom Leduc, cette fois encore, étaient conduites par la R. Mère Agnès. L'infatigable religieuse allait achever sa carrière active dans cette Maison Saint-Antoine, dont elle devint prieure. Huit ans plus tard, elle y célébrera ses noces d'or de vie religieuse avant d'aller rendre son âme à Dieu au milieu de ses sœurs, au Noviciat d'Angers. Mieux que personne, l'abbé Jouin avait pu apprécier ses rares vertus, à Joinville et à Saint- Médard. Appelé à prononcer son éloge funèbre, il pourra parler de celle qui avait été une Servante des Pauvres dès la première heure et la première Supérieure générale de la Congrégation.
Désormais, l'abbé Jouin a donc la charge de trois maisons de Servantes des Pauvres et des malades qu'elles assis-tent. Sa charité d'ailleurs ne reste sourde à aucun appel. Les curés de campagne, chez lesquels il aime à passer une par-tie de ses vacances, les prêtres, les séminaristes, ses familiers connaissent tour à tour ses libéralités et vident sa bourse sans épuiser son cœur.
Les billets de mille francs sortent à tout instant de sa bourse. Un de ses fidèles employés, trop confiant, s'est laissé voler le prix d'une cérémonie religieuse qu'il venait d'encaisser. Le lendemain, le Curé rembourse les 3000 francs. Il prend à sa charge cinq orphelins dons les parents - neveu et nièce de sa servante - ont péri dans l'incendie de l'Opéra-Comique. - Une autre domestique, pour établir son fils, a épuisé toutes ses économies ; à plusieurs reprises, il lui glisse sous enveloppe un billet de mille francs. - Deux personnes peu fortunées, dont il utilise les services pour sa Revue, par-taient en pèlerinage à Lourdes : la veille du départ, il leur remet l'argent du voyage et du séjour.
Les curés, bâtisseurs d'églises ou constructeurs d'écoles, ne frappent jamais en vain à sa porte.
Il se laisse prendre jusqu'à son temps, pourtant si précieux : pendant près de dix ans, il accorde une audience quoti-dienne et prolongée à une modeste paroissienne dont l'état d'âme lui semble réclamer ce sacrifice.
Son hospitalité était proverbiale, et ses domestiques trouvaient que les deux chambres d'amis dont il disposait étaient bien rarement inoccupées, et sa table entourée d'hôtes sans cesse renouvelés.
Il aimait à «faire plaisir pour attirer les âmes à Dieu», c'était la résolution prise dans l’une de ses dernières retraites.
Les enfants avaient ses faveurs à l'égal des grandes personnes : à ceux que la maladie avait empêchés de suivre la retraite de première communion, il tenait à prêcher lui-même une retraite spéciale pour leur permettre de communier le jour du renouvellement. Ils sont trois, deux, parfois même il n'y en a qu'un. Qu'importe ? Ils auront chaque jour les deux exercices et tous les avis nécessaires pour s'approcher dignement de Notre-Seigneur. Vienne la première communion de deux enfants abandonnés dont il a pris la charge ; il s'en ira avec la mère adoptive de l'un d'eux assister à cette fête. Eux aussi, du moins en ce jour, ils auront la joie d'avoir une famille.
Il donnait à ses familiers des marques touchantes d'affection et leur parlait avec bonté. Chaque soir, la journée finie, il les recevait, leur serrait la main et leur adressait quelques bonnes paroles.
Sa vieille servante Joséphine, qui l'avait suivi depuis le Panthéon, vint à mourir. On le vit s'agenouiller longuement et à diverses reprises dans la chambre mortuaire. Il fit ensuite descendre le corps dans la chapelle du presbytère et y célébra la messe avant la cérémonie funèbre qu'il présida jusqu'au cimetière. Le lendemain, il exprimait sa peine dans une poé-sie naïve dont il composa la musique :
Ma bonne si fidèle
Est morte hier,
Partant, comme hirondelle
Avant l'hiver.
Mon cœur vers elle clame
Plus que ne dis :
Seigneur, prenez son âme
En Paradis.
* * *
Henri Bordeaux a dit de l'abbé Fouque - un émule de l'abbé Jouin - «qu'il avait un cœur affectueux et que ce cœur fut percé de flèches innombrables»... «Géant de la charité, dit-il encore, mais aussi géant de la douleur».
On peut appliquer ces paroles à l'abbé Jouin. Lui aussi connut la douleur, il n'en pouvait être autrement. On n'émerge pas sans éveiller de mesquines jalousies, et les bienfaits tombent parfois sur des ingrats. On n'a pas sous ses ordres, en quarante ans de cure, une trentaine de vicaires sans rencontrer un jour ou l'autre, l'opposition ou la résistance. Les supé-rieurs eux-mêmes ne comprennent pas toujours les initiatives des hommes d'œuvres. Ils peuvent se tromper, «il est bon même qu'ils se trompent, dit encore Henri Bordeaux. Les débuts des saints sont toujours un peu déconcertants. On ne s'habitue pas d'emblée à leurs procédés. Je crois même que l'épreuve leur est nécessaire et qu'ils doivent d'abord se heurter à la résistance de l'autorité. L'autorité, même ecclésiastique, de la meilleure foi du monde, peut se tromper. Il est même préférable qu'elle se trompe plutôt que de donner des adhésions trop faciles. L'épreuve est indispensable, non seulement aux saints, mais aux artistes, aux écrivains, aux héros, à tous ceux qui, appelés à sortir de la voie normale, doivent mériter ce privilège et prouver leur vocation».
L'abbé Jouin n'échappa point à cette loi. Il avait fait jouer nombre de fois à Paris la pastorale de la Nativité, et, au dé-but, il en dirigeait lui-même l'orchestre et les chants, la baguette à la main. Curé de Saint-Médard, il avait continué. Passe encore dans une paroisse de faubourg ! mais à Saint-Augustin ? on lui avait demandé d'y renoncer, et de bonne grâce, il s'était soumis. Mais ne voilà-t-il pas qu'en collaboration avec Alexandre Georges, il a composé un nouveau Mystère, la Passion, et qu'un imprésario va le mettre à la scène avec de vrais acteurs, sur un vrai théâtre, et les auteurs n'ont pas soumis leur projet à l'Archevêché. «Des observations diverses et souvent contradictoires se produisent». Tout près de l'abbé Jouin, il le sait, on s'est vanté de faire interdire sa pièce : et le Cardinal veut faire connaître sa pensée sur cette question. «Sans doute, disait-il, les populations s'intéressent vivement à la représentation des mystères évangéliques. Mais nous ne sommes plus aux âges de foi où ces représentations étaient habituelles et faisaient en quelque sorte partie de nos solennités. Aujourd'hui, en représentant la Passion dans un théâtre, on s'expose à faire considérer par le public les mystères de la religion comme un drame tout humain, en même temps qu'on encourage les fidèles à substituer à la méditation de la Passion une récréation pieuse». En considération, toutefois, des engagements pris par des hommes ho-norables auxquels la pièce a été livrée par les auteurs, on veut bien n'en pas interdire la représentation.
«De plus, pour sauvegarder le respect dû aux trois derniers jours de la Semaine Sainte, nous avons demandé aux or-ganisateurs de cesser toute représentation durant ces trois jours. Ce qu'ils se sont empressés d'accepter avec une docili-té dont nous leur savons particulièrement gré».
Ce «communiqué» de la Semaine Religieuse ne disait pas que cet engagement n'avait été pris qu'à la condition qu'aucune note ne serait publiée. De plus, il jetait le discrédit sur les représentations. Les recettes s'en ressentirent. La salle et les acteurs ayant été retenus pour un mois, les organisateurs subissaient un grave préjudice et se montraient menaçants. Pour éviter un scandale, l'abbé Jouin crut devoir les indemniser. C'était pour lui-même une perte matérielle considérable en même temps qu'une atteinte à son prestige. Il n'ignorait pas les influences qui avaient obtenu l'interven-tion du Cardinal. Il prit sa plume pour se justifier et dire sa surprise et sa douleur de ce «soufflet, le plus magnifique qu'il eût jamais reçu». Puis, il se rappela son vœu d'obéissance : la lettre écrite, mise sous enveloppe timbrée, puis décache-tée, ne fut pas envoyée. Moins de vingt ans après cet événement, on donnait dans un grand cinéma de Paris un film sur la Passion ; on y vit l'Archevêque et tout le clergé : nul ne s'étonna de leur présence. Le tort de l'abbé Jouin était d'avoir été en avance sur son temps.
Le cardinal Richard ne devait pas tenir rigueur au Curé de Saint-Augustin. Trois ans après, il lui écrivait :
Cher Monsieur le Curé,
Voilà bien des années déjà que vous travaillez avec dévouement pour cette chère Église de Paris. Les fondations que vous avez laissées dans les paroisses de Joinville-le-Pont, de Saint-Médard et de Saint-Laurent demeurent le témoignage de votre sollicitude pour le soin des pauvres et des malades. Vos travaux pour l'enseignement du Caté-chisme répondent à la pensée de notre Saint Père Pie X qui nous recommande avec tant d'instance de refaire une société chrétienne par l'instruction religieuse.
Je suis heureux, cher Monsieur le Curé, de vous témoigner, en vous nommant chanoine honoraire, la reconnais-sance de votre vieil Archevêque pour les services rendus au diocèse.
† Fr. Cardinal RICHARD, arch. de Paris.
Sur l'enveloppe contenant la note de la Semaine Religieuse et la réponse dont nous venons de parler, on peut lire ces deux dates écrites par l'abbé Jouin :
14 Mars 1902 : Note du Cardinal.
14 Mars 1903 : Mort de ma mère.
A un an de distance, jour pour jour, son grand cœur ressentait les plus grandes douleurs de sa vie.
Madame Jouin avait 88 ans quand parut la Passion. L'abbé Jouin l'avait dédiée «A sa Mère, à la mémoire du P. Au-gustin Jouin et à son frère Henry». Aussitôt, elle répondit à son fils, lui donnant le titre de «cher Maître», et le félicitant d'avoir parlé la langue des Anges pour louer son Dieu, le Seigneur Jésus. «Si le Père, votre parrain, était parmi nous, comme il vous féliciterait. Du moins, il vous inspire». Au terme de sa mission, elle ne devait par tarder à disparaître. Na-ture énergique, femme d'une foi profonde, veuve à trente-quatre ans avec la charge d'élever trois fils, elle avait voulu en faire des natures fortes, à l'abri des tempêtes du cœur et du doute. Le succès avait couronné ses efforts. Quelques an-nées plus tôt, gravement malade et invitée par une amie à se préparer à la mort, elle avait répondu : «Oh ! je suis bien tranquille. Je dirai à Dieu : Vous m'avez donné trois fils, j'en ai fait trois saints. Quant à mes défauts de caractère, ajoutait-elle, c'est Vous qui me les avez donnés, mon Dieu, faites pour le mieux... Je m'en remets à Vous».
Plus humble aujourd'hui, elle se demandait si, en voulant être forte, elle n'avait point été dure et parfois injuste, et de-manda pardon à sa bru avec laquelle elle vivait et s'ouvrit de ses inquiétudes à son fils qui calma ses scrupules. «Je dé-sire mourir dans votre amitié et dans votre estime ; je vous remercie de l'amour filial que vous m'avez témoigné. Je bénis mes fils, ma belle-fille et mes petits-enfants : Fanny et Amédée». Elle avait le droit de nous bénir, ajoute l'abbé Jouin, au terme de son ministère maternel rempli comme un sacerdoce. Consolée par les sacrements que lui donna l'évêque de Troyes, Mgr de Pélacot, elle s'endormit dans le baiser du Seigneur, pendant que son fils récitait les prières des agoni-sants.
Huit ans plus tard, l'abbé Jouin rendait les mêmes devoirs à son frère Henry.
C'est dans ce même chalet Notre-Dame, à Hermanville, où Madame Jouin était revenue en 1889 si profondément at-tristée, que mourut à vingt-quatre ans de distance, son second frère Henry Jouin. D'une santé chancelante depuis plu-sieurs années, il ne donnait pas cependant d'imminentes inquiétudes. Toutefois, les forces trahissaient un peu chaque jour l'infatigable travailleur, à qui le repos fut inconnu plus de cinquante ans de sa vie.
«II fléchissait, raconte son frère ; mais avec l'espoir de retrouver au bord de la mer sa vigueur coutumière. Or, ce fut au cours de ce voyage qu'Henry Jouin fut pris d'un évanouissement terminé par une hémorragie stomacale. Dans la nuit de nouveaux vomissements de sang lui enlevèrent le meilleur de ses forces. Cette crise devait être la dernière, maintenant il allait s'éteindre comme la lampe du sanctuaire qui consacre à Dieu, dans un suprême effort, ses lueurs saccadées et vacillantes. Lueurs cependant qui furent encore des éclairs de rare vitalité et qui témoignent d'une pré-sence d'esprit et d'une énergie de volonté surprenantes. II envoya aux riverains de la brèche d'Hermanville une double circulaire pour la défense de leurs intérêts. Sans cesse il me demandait de revoir les épreuves de sa Revue «Jehanne la Pucelle» et de préparer les numéros suivants. Chaque jour, il dictait son courrier. Le dimanche 27 juillet, il s'entretint plusieurs heures avec notre ami le sénateur Dominique Delahaye des questions apparentées aux graves intérêts de l'Église et de la Patrie, et des efforts tardifs de quelques sommités catholiques pour une action commune. Toutefois les sujets qu'il traitait, les projets même qu'il semblait former ne le distrayaient pas entièrement de la pen-sée de la mort. Il m'en parlait constamment pour me dire que son œuvre n'était pas finie et qu'il me confiait une lourde charge : «Sa Jeanne d'Arc monumentale» . Il me disait encore que je n'avais plus qu'à lui donner les derniers sacrements et à le regarder mourir... Son âme repliait lentement ses ailes dans son corps endormi.
«Le lundi 11 août, il fit comme d'habitude, avec son fils à genoux au pied de son lit, sa prière à haute voix. Nous l'entendîmes, non sans émotion, réciter le De profundis et nommer un à un le cortège funèbre des proches et des amis disparus. Dans la soirée, je le confessai, et nous causâmes une demi-heure. Comme il semblait mieux, je lui dis sincèrement quelques paroles d'espoir : «Je ne sais, me répondit-il, quelle est la volonté de Dieu, mais j'ai fait le sa-crifice de ma vie, il y a longtemps déjà, afin de mériter, si je le puis, pour mes enfants, surtout pour Amédée, une vo-cation chrétienne». Ce fut son testament d'amour familial. Le soir, il pâlit subitement ; je n'eus que le temps de lui donner l'extrême onction et d'y ajouter le Proficiscere, anima Christiana, des prières des agonisants, il n'était déjà plus. Sa femme, ses enfants Fanny et Amédée, une amie fidèle, Mme Barrault, et moi nous récitâmes pour lui le De Profundis qu'il avait récité le matin pour les autres. Sa femme, Mary, jalouse de son trésor perdu, l'emporta seule dans la chambre voisine. Les enfants pleuraient ; pour nous, les pleurs mouillaient à peine la paupière. Quand on est jeune, on verse les larmes des yeux ; à l'âge mûr, on verse les larmes du cœur, larmes de sang, que personne ne voit, et que Dieu seul entend, pendant qu'elles tombent, silencieuses, goutte à goutte dans l'abîme sans fond de nos amours évanouis...
«Après le saisissement du coup de la mort, venue comme un voleur, il fallut nous rendre à l'inconsolable constata-tion que celui que nous aimions était parti pour ce voyage que nous ferons tous... tout nous rappelait ce qu'il fut, sans nous dire ce qu'il était ; cette immobilité rigide contrastait singulièrement avec cette force d'action, victorieuse (durant bientôt les trois quarts d'un siècle) de toute infirmité humaine ; ses yeux fermés donnaient à son visage l'aspect des statues antiques qu'il avait naguère encore amoureusement contemplées ; ses lèvres n'esquissaient plus un sourire de bonté ou une parole de pardon ; le crucifix posé sur sa poitrine témoignait qu'il porta la croix dès son berceau ; le chapelet ne glissait plus grain par grain sous ses doigts, sa prière se terminait dans un monde meilleur. - Alors, en face de cet effondrement, je pensais, Seigneur, que Vous veniez de lui apparaître et que, dans cette première ren-contre, Vos surabondantes bénédictions avaient couvert aux yeux de Votre inexorable justice les défaillances soli-daires de notre fragile humanité. Et j'ai cru Vous voir, ô Jésus, couvrir de toute Votre infinie pitié ce blessé, ce meurtri que Vous aviez Vous-même si supérieurement marqué du sceau de la souffrance, montrer à Vos élus ce travailleur aux mains pleines ; nommer par son nom à Votre Père ce lutteur qui Vous a toujours confessé devant les hommes ; et qu'en récompense de son indéfectible fidélité dans les plus petites choses, Vous lui aviez dit de Votre voix qui, à elle seule est une extase et un ravissement : «Confiance, bon serviteur, entre dans les joies du Seigneur, ton Dieu».
Le 14 août, la cérémonie funèbre fut célébrée dans l'église d'Hermanville-sur-mer. Puis, ce fut le retour, le chemin du Calvaire ; et le 15 août, l'inhumation eut lieu dans le caveau de famille, au cimetière Montparnasse. La maîtrise de Saint- Augustin, malgré les offices du jour, voulut venir chanter sur cette tombe le De Profundis. Le clergé de cette paroisse et de nombreux amis m'y ont accompagné. Après les prières, M. Jules Delahaye, député de Cholet, un ami de jeunesse, angevin comme nous, prononça des paroles d'adieu, pleines de cœur et de vérité».
Après ces hommages émouvants rendus à la mémoire des siens, l'abbé Jouin ajoute : «Maintenant, tous les trois sont partis et j'espère qu'ils me continueront leurs prières et leurs inspirations». Et, par la foi, il voit sa mère conduisant ses deux frères dans les sentiers du Paradis. Car maintenant «ils voient Dieu, dit-il, ils aiment Dieu, ils jouissent de Dieu, parce qu'ils sont de Sa famille rentrés dans la maison paternelle. Voilà mon Credo, et cet acte de foi peuple ma solitude d'espérances consolatrices déjà tout ensoleillées de divins rayonnements».
Aux deuils de famille allaient bientôt se joindre pour l'abbé Jouin d'autres épreuves, et son activité charitable allait s'exercer sur un nouveau théâtre.
* * *
Les premiers bruits de guerre le surprirent au retour d'un voyage en Dauphiné entrepris pour la santé d'un prêtre ami, et au cours duquel il avait revu les lieux de sa jeunesse monastique : le couvent de Saint-Maximin et la Sainte-Baume.
Les hostilités commencées, sa décision est bientôt prise : il mobilise toutes les forces spirituelles et charitables de Saint-Augustin. Pendant qu'il convie ses paroissiens à la prière et à la pénitence, il s'entend avec l’Union des Femmes de France pour la fourniture des lits et du matériel chirurgical et radiologique nécessaires à l'ambulance qu'il voulait établir ; obtient le concours du professeur Mauclaire, chirurgien de la Charité, et du docteur P. Moizard, ses paroissiens ; de-mande aux Servantes des Pauvres le sacrifice de leur chapelle pour l'hospitalisation des soldats et des officiers ; enrôle comme infirmières l'élite active des dames de sa paroisse et sollicite des autres leurs offrandes et leur aide, payant lui-même, dans une large mesure, de sa personne et de sa bourse et supportant seul, au début, des dépenses énormes, jusqu'au jour où le Comité de la Colonie parisienne de l'Equateur voudra bien les partager avec lui. Du 6 septembre 1914, où arrivèrent les premiers blessés de la Marne, au 30 août 1919 qui vit partir le dernier soldat guéri, il y eut, au té-moignage du docteur Mauclaire, 1275 entrées de soldats ou d'officiers, 300 opérations de grands ou moyens blessés, sur lesquels trois seulement succombèrent, et les dépenses s'élevèrent à 396.000 francs.
L'abbé Jouin veillait à tout, n'hésitant pas au début à prendre le pinceau ou le marteau, assistait à toutes les opéra-tions, visitait chaque jour les blessés auxquels il distribuait des douceurs et de fortifiantes paroles, et donnait à tous l'exemple du dévouement et de l'abnégation. L'exemple était suivi.
«Une infirmière, disait un jour l'abbé Jouin au Cardinal Dubois, m'édifiait entre toutes. Bien que d'un âge avancé, elle choisissait les travaux les plus pénibles et les plus répugnants et elle excellait à s'effacer en tout. Un jour, elle m'arrêta pour me dire d'une voix émue jusqu'aux larmes combien elle était touchée de mes visites quotidiennes. Je rougis intérieurement du peu que je faisais en face de cette âme dévouée jusqu'à l'héroïsme».
Ce prêtre qui rougissait du peu qu'il faisait, en comparaison de ses infirmières, on l'avait vu cependant, revêtu d'une blouse, transporter les matelas sur sa tête d'une salle à l'autre, peindre les escaliers, se prêter à toutes les besognes ; on le voyait assister à toutes les opérations - il s'en était fait une règle absolue - Elles avaient généralement lieu immédiate-ment après le déjeuner. Il fallait précipiter le repas et partir aussitôt, demeurer debout, dans une atmosphère de clinique, pendant une heure ou deux - fatigue excessive pour un homme dont les reins étaient malades et qui jusque là était resté étranger aux émotions des opérations chirurgicales.
Il avait tenu au début à dire lui-même la messe à ses soldats. Mais au bout de quelques mois, il avait dû y renoncer. Le jour de la Toussaint 1914, après avoir dit la messe de 6 heures à l’ambulance, il était allé chanter la grand'messe à la paroisse, puis était revenu près de ses chers soldats. Il fut pris de vives douleurs dans le dos et eut un commencement de syncope ; on dut le ramener chez lui en voiture. Il n'en fallut pas moins pour le convaincre qu'il avait excédé la limite de ses forces.
Cet héroïsme frappait les blessés qui en étaient l'objet. «L'ambulance 139, disait l'un d'eux qui pouvait comparer avec un autre hôpital, est le paradis, et l'abbé Jouin est la bonté personnifiée, une vivante image de la charité... Je suis per-suadé que nous devons pour une grande part notre guérison à ses prières. Je lui dois avec ma santé le réveil de ma foi». On peut imaginer le bien moral et religieux qui se faisait dans ces pauvres âmes parfois plus meurtries que leurs corps, les conversions, les unions régularisées, les consciences pacifiées.
De cette action bienfaisante, nul n'était exclu : Musulmans, Israélites, incroyants étaient traités avec la même bonté. Un blessé était en danger, et la sœur qui l'exhortait à se préparer à la mort apprend qu'il est israélite. Aussitôt l'abbé Jouin fait venir le rabbin. Après le décès, c'est encore lui qui prend à sa charge les frais du rapatriement, et le journal israélite de la région rendait un témoignage chaleureux à la charité et au tact de ce curé catholique ainsi qu'à celui du personnel de l'ambulance qui avait accompagné jusqu'à la gare la dépouille du soldat tombé pour la patrie.
La guerre ne faisait pas de victimes qu'au front. L'arrière avait aussi ses fléaux. Un jour d'hiver, une pauvre femme suivie d'un jeune enfant tombait d'épuisement au seuil de l'ambulance et y mourait bientôt. L'abbé Jouin ne voulut pas abandonner à l'Assistance Publique l'orphelin que la Providence lui envoyait. Il le garda à l'hôpital, l'adopta, prit soin de son éducation, lui procura du travail. Il est aujourd'hui à son tour, soldat, et est heureux de toucher chaque mois une pe-tite somme que son bienfaiteur lui a réservée.
«Peu de temps après, nous raconte une infirmière - une artiste qui, autrefois, avait joué la tragédie avec Sarah Bernhardt et maintenant remplissait le rôle plus grand devant Dieu de nettoyeuse de crachoirs - l'abbé Jouin arrive tout joyeux. Quelle grande nouvelle nous apportez-vous donc, lui demandai-je ? - Une très grande, répondit-il, je suis père pour la seconde fois... Oui, reprit-il, hier, entre deux portes de l'église, on a trouvé une enfant de quelques jours, et je la garde». Et il fit pour la petite orpheline comme il avait fait pour le petit garçon. Il la confia à des personnes dont le cœur était à la mesure du sien. Elles l’élevèrent à ses frais ; l'une d'elles l'adopta et, après lui avoir donné son nom, lui prodigue aujourd'hui tout l'amour d'une véritable mère.
Vers la fin de la guerre, le Président de la République visita l'ambulance 139 ; aux éminents praticiens, aux infirmières volontaires, il adressa ses remerciements et ses félicitations. En partant, il ne fit qu'un oubli : celui d'épingler la croix de la Légion d'honneur sur la poitrine du fondateur et du soutien de l'ambulance. Est-ce parce que cette poitrine battait sous la soutane du prêtre ?
De front avec la mobilisation de la charité, l'abbé Jouin avait fait la mobilisation de la prière et, là encore, fait preuve d'une ténacité peu commune. Pour toucher le cœur de Dieu, il fallait, dans l'épreuve qui s'abattait sur la France, des âmes pures et pénitentes. Aussi, dès les premiers jours, organisait-il dans la paroisse l'exercice du chemin de croix per-pétuel et conviait-il les associés du Rosaire et tous les fidèles à prier celle qui, à Lépante, sauva l'Europe de l'invasion musulmane. Les paroissiens répondirent par centaines à son appel. Chaque soir, depuis le 2 août 1914 jusqu'au 30 août 1919, ils le voyaient arriver au milieu d'eux et d'une voix vibrante réciter les quinze dizaines jusqu'au dernier Ave.
C'est à cette fidélité que la paroisse Saint-Augustin attribua la protection spéciale dont elle fut l'objet. Malgré le voisi-nage de la gare Saint-Lazare spécialement visée, aucun obus de jour ou de nuit n'est tombé sur son territoire. Quand, au mois de décembre 1918, pour le 74e anniversaire de l'abbé Jouin, la Confrérie du Rosaire convia les paroissiens à offrir à leur pasteur un témoignage de reconnaissance et d'admiration, elle ne crut mieux faire que de lui remettre, avec une large offrande pour l'ambulance, un rosaire d'or et d'améthystes, un «rosaire de guerre».
(à suivre...)
Dernière édition par Hercule le Lun 17 Oct - 8:34, édité 1 fois
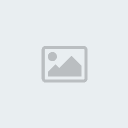
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 8°)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
La vieillesse qui, chez la plupart, arrête ou ralentit l'élan, semblait apporter à l'abbé Jouin des énergies nouvelles. Il avait 65 ans quand survint l'événement qui orienta son activité sur un nouveau théâtre. Il en a fait lui-même le récit :
«C'était en 1909. Un matin, celui qui avait fait tomber Combes et le général André vint chez moi et me dit sans préambule : «Je vous demande de composer contre la Franc-Maçonnerie un roman dans le genre populaire du Juif errant».
«Je n'étais pas assez naïf pour ne pas croire à la malfaisance de la Franc-Maçonnerie, mais je la connaissais trop peu pour en écrire et la combattre dans un roman.
- Vous êtes toujours les mêmes, reprit M. Jean Bidegain : les religieux ouvrent des collèges, les religieuses cons-truisent des chapelles ; les curés et les vicaires fondent des patronages, et quand on a ruiné vos œuvres, vous re-commencez patiemment ce travail de Pénélope. Mais, allez donc une bonne fois à l'ennemi, détruisez la Franc-Maçonnerie, et vous ferez ensuite ce que vous voudrez».
L'abbé Jouin savait par expérience ce qu'il en était. «Je vais m'y mettre, répondit-il».
Dès le lendemain, il entreprenait l'acquisition d'une bibliothèque maçonnique et occultiste. Quand il fut en face de «l'immense et déconcertante littérature» concernant ces matières, il estima, qu'il ne s'agissait plus de composer un ro-man, mais bien une revue scientifique comprenant les documents anciens et nouveaux sur ces multiples questions et s'adressant aux chercheurs aussi bien qu'aux simples lecteurs. Le 1er Janvier 1912, parut la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, - la R.I.S.S. - et, un an plus tard, la Ligue Franc-Catholique, association administrée par un Comité dont l'abbé Jouin se réservait la présidence à vie, et dont l'objet était l'étude des questions maçonniques.
«La même année, raconte-t-il, me trouvant trop surchargé avec mon zélé et intelligent collaborateur, M. Nicoul-laud, par les recherches inépuisables que nécessitaient notre travail et la confection de livraisons bi-mensuelles de 250 à 300 pages, je conçus l'idée d'un «Institut», organisé sur le modèle de la Société des Bollandistes. J'étais per-suadé que, concurremment avec la glorification de l'Église exaltée dans ses Saints, il y avait place pour les défen-seurs de la Foi contre la collusion des Juifs et des Maçons, cette formidable armée lancée par l'Enfer contre le Christ et les siens».
Ces défenseurs de la Foi se nommaient alors les abbés de Bessonies et Tourmentin qui venaient de livrer à la lumière les noms de 36.000 francs-maçons ; c'était la Ligue Militaire de M. de la Rive et la Ligue Française Antimaçonnique du Commandant de Fraville ; c'était M. Copin-Albancelli et son journal La Bastille. Dernier venu dans cette phalange, l'abbé Jouin ne tarda pas à voir la faiblesse de ces troupes rivales, jalouses les unes des autres et divisées jusqu'à se com-battre mutuellement. Comme Jeanne d'Arc, dont il avait pris la devise : Dieu premier servi, il conçut le projet d'établir entre elles une fédération. Chaque ligue - Association Antimaçonnique de France, de l'abbé Tourmentin, Ligue Française Antimaçonnique du Commandant de Fraville, Ligue Militaire, Ligue Franc-Catholique de l'abbé Jouin -, gardait son auto-nomie et son initiative, mais prenait un double engagement : celui de ne jamais attaquer comme personnes les membres des ligues fédérées, (tout litige étant déféré au Comité Fédératif), et celui de combattre systématiquement, en dehors des partis, la Franc-Maçonnerie, les Sociétés Secrètes et leurs filiales, comme la Ligue de l’Enseignement, les Jeunesses laïques et républicaines, la Ligue des Droits de l’Homme, les Ligues pacifistes et antimilitaristes, etc.
Ce projet avait l'approbation d'un haut personnage de Rome et du cardinal Amette. Il échoua cependant et les auteurs responsables de sa mort révélèrent dès ce jour les vrais sentiments qui les animaient : ils n'étaient point de sincères ad-versaires de l'ennemi commun.
Le premier fut M. Copin-Albancelli. Avisé, par une indiscrétion, de l'intention de l'abbé Jouin, il s'efforça de l'étouffer avant sa naissance et la combattit en des articles qui voyaient dans ce projet le résultat d'influences maçonniques et je-taient la suspicion sur le collaborateur de M. Jouin.
«Je n'ai point à discuter vos raisons, lui écrivit l'abbé Jouin. Je voulais l'union, vous n'en voulez pas, c'est votre droit ; mais vous auriez mieux fait, ce me semble, de m'en avertir, tout au moins, avant de jeter la chose dans le pu-blic. Je tiens seulement à constater que ce projet de Fédération vient uniquement de moi. Personne ne m'a suggéré mon plan. Ne cherchez donc pas ici d'infiltrations maçonniques ; et laissez-moi vous faire remarquer que c'est là une explication dont on abuse beaucoup trop parmi les anti-maçons. Pour moi, j'ai encore assez conscience de mes idées et je me sens une volonté trop personnelle pour prendre aux autres, à mon insu, ce que je pense et ce que je veux. Aussi je maintiens mon projet de Fédération, très sûr au reste que le pardon des injures n'est point théologi-quement un «luxe moral», mais que la charité passe avant la justice. Quant à M. Nicoullaud, je l'ai empêché de ré-pondre à vos articles et à votre lettre. Je ne veux aucune polémique, ni publique ni privée ; d'ailleurs vous auriez fort à faire avec lui ; il met les points sur les i à en briser sa plume».
Dans une seconde lettre, il ajoutait :
«Que la Fédération se fasse ou non, je serai toujours l'unique ennemi de la Maçonnerie et des Sociétés Secrètes et je combattrai dans les rangs de tous les anti-maçons, je veux la guerre étrangère et non pas la guerre civile».
Moins franche encore et plus suspecte fut l'opposition de la Ligue Française Antimaçonnique. Le Président, le Com-mandant de Fraville, était favorable au projet. Mais le Secrétaire général - M. Flavien Brenier - et l'abbé Duperron, qui n'en voulaient à aucun prix, l'obligèrent par leurs calomnies à donner sa démission. Maîtres de la place, ils insinuent d'abord, puis affirment que le projet est d'origine maçonnique, inspiré à l'abbé Jouin dupé par un ex-franc-maçon, M. Bidegain, ami et collaborateur du «théosophe Nicoullaud, pour qui la confiance de l'abbé Jouin est sans limite», et, en l'absence du Président, obtiennent de leur Ligue non seulement le rejet de la Fédération, «mais du principe même, pour le présent et pour l'avenir, d'un Comité fédéral antimaçonnique».
Quelques jours après, ému d'une note parue dans la Revue Internationale, le même Flavien Brenier osait écrire à l'abbé Jouin ces lignes hypocrites : «Il y a un malentendu. Nous estimons la Fédération comme absolument nécessaire et nous en avons voté le principe à l'unanimité». Sur quoi l'abbé Jouin fit cette réflexion. «Le double jeu de M. Flavien Bre-nier est indéniable. D'une part ma Fédération est nécessaire ; d'autre part, elle est un projet «funeste et maçonnique». Est-ce que M. Flavien Brenier serait l'homme à double face, comme le prétend l'article de M. Hoog dans la Démocratie... Je veux encore en douter».
Devant tant de mauvaise foi, M. Jouin ne pouvait plus songer à son projet d'union. Il y renonça, mais non sans avoir arraché le masque dont se couvraient en vain M. Flavien Brenier et l'abbé Duperron. Dans une brochure : La Lutte Anti-maçonnique - Une Exécution nécessaire, il laisse éclater son indignation.
«Le diable est menteur et homicide dès le commencement. Or, avouez-le, Messieurs, vos calomnies ont pour but de tuer les œuvres et les hommes.
«Vous avez voulu tuer la Fédération antimaçonnique en calomniant ceux qui lui étaient favorables. Vous avez voulu tuer le promoteur de cette idée, aussi féconde que chrétienne, en osant contester sa parole : vous en avez fait le jouet ridicule et sénile de prétendus ennemis de la religion. Vous avez voulu tuer M. Bidegain dans son honneur ; je n'ai pas à le défendre, mais j'ai à vous rappeler que seul, tout franc-maçon que vous le prétendez, il a frappé d'autres coups que vous deux, qui vous dites anti-maçons, et que ces coups-là ont forcé la Maçonnerie à reculer. Vous avez voulu tuer M. Nicoullaud en l'appelant théosophe : vous jetez d'un mot, avec une aisance troublante, la dif-famation sur ce catholique pratiquant et militant. Vous avez voulu tuer le Commandant de Fraville, vous n'avez pas craint de l'appeler menteur et traître pour le mettre hors de votre Ligue et l'acculer à sa démission.
«Et après ces exploits, vous venez écrire que mon projet de Fédération était une «manœuvre louche». Mais les manœuvres louches, elles se retrouvent à chaque page de votre rapport. Dire de M. de Fraville qu'il n'est pas un menteur, mais qu'il dissimule la vérité, et le couvrir de votre estime pour mieux lui tirer dans le dos, le juger sans ap-pel pendant son absence, cela se nomme partout des «manœuvres louches»... Je comprends le général de Kerdrel (membre pourtant de votre Ligue), m'écrivant : ce ne sont pas les procédés francs auxquels je suis habitué».
«J'espère que MM. Brenier et Duperron, ajoutait-il, ne m'accuseront plus de «manœuvres louches». Je ne me sens pas le courage de les imiter. Je tiens pour meilleure la devise du Sermon sur la Montagne : Est, est ; non, non, cela est ou cela n'est pas, c'est oui ou non. Si MM. Brenier ou Duperron avaient dit simplement : Nous ne voulons pas de la Fédération ; leur attitude eût été franche ; ils auraient usé de leur droit en toute liberté, sans calomnier ni ri-diculiser personne. Ils ont louvoyé, «louché» selon l'expression qui leur est chère, et, naturellement, ils ont abouti à une «manœuvre louche».
C'est leur affaire, comme c'est leur devoir de réparer le tort fait à la réputation du prochain. Pour ma part, je leur par-donne, en ce qui me regarde. Mais, puisque nos négociations sont terminées, je les prie de ne plus écrire qu'ils sont «ac-quis à la Fédération», et de vouloir bien conclure une «entente cordiale» avec ma Ligue Franc-Catholique, en ne s'occu-pant que de la leur. Ce sera encore le moyen d'appliquer mon second article : on n'attaquera pas les Anti-maçons, on les ignorera. Ce n'est pas parfait, mais le silence remplacera, momentanément, la charité et l'union».
* * *
De Clément XII, en 1738, jusqu'à Pie XI, tous les Papes ont condamné les sociétés secrètes. Dans un discours au Congrès de la Ligue, en 1930, l'abbé Jouin rappelait leurs anathèmes et citait ces paroles de l'Encyclique «Humanus ge-nus» : «...Il s'agit, dit Léon XIII, d'une secte qui a tout envahi,... qui, dans l'espace d'un siècle et demi, a fait d'incroyables progrès et commence à prendre, au sein des États modernes, une puissance qui équivaut presque à la souveraineté... Il ne suffit donc pas de se tenir sur la défensive, mais il faut descendre courageusement dans l'arène et la combattre de front».
Et, précisant sa pensée, le Pape ajoutait : «C'est ce que vous ferez en opposant publications à publications, écoles à écoles, associations à associations, congrès à congrès, actions à actions».
Docile à ce mot d'ordre, le Curé de Saint-Augustin descendit dans l'arène, opposant la Revue Internationale des So-ciétés Secrètes aux Bulletins des Loges, sa Ligue Franc-Catholique à leurs Sociétés, ses Congrès à leurs Convents. «Démasquez, disait encore Léon XIII, ces hommes qui se cachent pour organiser leurs complots, et faites la lumière sur leurs agissements».
Pour démasquer, il faut connaître ; pour connaître, il faut chercher, fouiller. Et M. Jouin, aidé de ses collaborateurs, se mit à dépouiller revues et journaux, bulletins, ouvrages anciens et récents sur les origines et l'histoire de la secte maçon-nique. Pendant que les uns traduisaient les articles russes ou anglais, d'autres photographiaient des documents secrets importants qu'on lui avait confiés, parfois pour quelques heures.
Et voici qu'en poursuivant, dans le passé et dans le présent, la Franc-Maçonnerie, il découvrit à côté et au-dessus d'elle deux autres puissances complices : le Protestantisme et la Juiverie, le Franc-Maçon et le Protestant s'élançant, la main dans la main, sous la conduite du Juif, à l'assaut de la Religion, de la Morale et de la Société. Même but : la des-truction de l'Église Catholique et de toute religion ; même tactique : la laïcité par le monopole de l'enseignement ; mêmes formules hypocrites et mensongères : défense de la République, triomphe de la Démocratie, laïcité de la paix par la So-ciété des Nations.
Dès 1916, Protestants et Francs-Maçons s'apprêtaient à célébrer «en bons frères», les uns le quatrième centenaire de Luther (1517), les autres le bicentenaire de la Maçonnerie.
«Car, disaient les Feuilles Romaines, Protestants et Francs-Maçons sont assez bien ensemble depuis long-temps». Naturellement on ne se contenterait pas de glorifier le passé, on préparerait un programme d'action, de «re-prise» en grand pour l'après-guerre». Et l'abbé Jouin surprenait des aveux de feuilles maçonniques, confirmant cette fraternité d'armes :
«Sans doute, disait la Fremdenblatt de Hambourg, c'est le hasard qui a réuni les deux fêtes dans la même année. Mais ce hasard fait qu'on se demande si ces deux forces spirituelles n'auraient pas aussi des relations intimes. Et ces relations les voici : «L'une des deux repose sur l'autre, comme sur sa base. Il n'y aurait pas de véritable Franc-Maçonnerie, s il n'y avait eu ni Luther, ni la Réforme... La Franc-Maçonnerie ne pouvait croître que sur le sol du libre Protestantisme. Et ce n'est sans doute point par un effet du hasard que l'on trouve au berceau de la Franc-Maçonnerie deux hommes fortement influencés par le Protestantisme, le fils d'un ministre réformé français, Désagu-liers, et le prédicateur écossais, James Anderson. Ce c'est pas non plus par un effet du hasard que, pendant ces deux cents ans de son existence, la Franc-Maçonnerie a trouvé son ennemi le plus acharné dans Rome, et ses amis les plus chauds et ses défenseurs les plus zélés parmi les hommes dont la formation intellectuelle se rattache à Lu-ther et à la Réforme, Lessing, Frédéric le Grand, Goethe».
A ces aveux, d'autres voix venues d'outre-mer, faisaient écho :
«Les Francs-Maçons, lisait-il dans The Light de Louisville, doivent s'intéresser tout particulièrement au 400e anni-versaire de la Réforme protestante... Les curieux des origines historiques de la Maçonnerie seront frappés des rap-ports de Luther avec les mystiques de son temps».
Et l'abbé Jouin de conclure :
«Il est évident que pour les Francs-Maçons américains, comme pour les nôtres, le déclenchement des forces libres-penseuses et athées remonte à Luther, et que la lutte anticléricale, sous sa forme actuelle, en est à son 400e anniversaire ».
Les mêmes feuilles protestantes et maçonniques lui apprenaient encore qu'aux États-Unis, les fêtes de Luther durè-rent un an, qu'elles avaient pour organisateurs des Francs-Maçons, en majeure partie membres du clergé protestant, et qu'une souscription de 40,000 dollars était lancée pour élever une statue à Luther,
On sait d'ailleurs qu'en Europe, le Kayser s'était vanté d'aller célébrer le centenaire du moine apostat à Rome même, sous les murs du Vatican, en témoignage de sa haine pour le catholicisme, haine qu'il exprimait dans ces paroles à sa cousine, la landgravine de Hesse : «Je hais cette religion que tu as embrassée... tu accèdes donc à cette superstition romaine, dont je considère la destruction comme le but suprême de ma vie !» Mais on sait aussi comment la Providence déjoua tous ces beaux projets, et comment la guerre qui devait humainement amener l'écrasement de la France aboutit à la victoire des alliés.
Ce fut une amère déception dans le camp des puissances maçonniques. L’Alpina, de Neuchatel, et la Frankishe, de Nuremberg, en étaient inconsolables :
«Tous les Maçons se seraient tendu la main. Qui sait ? Nous aurions peut-être vu se fonder des œuvres maçon-niques qui auraient fait notre joie et soulevé nos âmes d'une espérance sans limite dans la réalisation de la fraternité humaine».
Le centenaire maçonnique n'en fut pas moins célébré dans toutes les Loges et dans tous les pays. L'abbé Jouin en apporte des témoignages cueillis en plus de cinquante revues, articles ou livres publiés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Le Temps, dont on connaît les attaches protestantes à cette époque, donnait avec complaisance le compte-rendu de l'Assemblée générale du Grand-Orient de France du 23 septembre 1917, qui dé-nonçait la «propagande confessionnelle exercée aux armées, depuis le commencement de la guerre, de l'intérieur aux tranchées, sous le couvert de l'union sacrée et réclamait contre les coupables l'action de la justice». «La Franc-Maçonnerie, disait le rapporteur, signerait sa déchéance si elle se désintéressait de la République si sournoisement combattue».
Et aussitôt, dans tout le monde maçonnique, s'élabore un programme d'action énergique visant surtout la laïcisation complète et universelle de l'Enseignement. La Croix du 23 octobre 1917 publiait un article de M. Jean Guiraud : «Nou-velle Offensive Laïque», démontrant l'emprise maçonnique de la jeunesse française par l’école unique que continuerait l’enseignement postscolaire obligatoire.
«Ainsi, concluait l'abbé Jouin, aujourd'hui, en pleine guerre, aux heures les plus critiques et les plus angoissantes, sûrs que les catholiques seront trop français pour rompre «l'union sacrée», les Maçons ajoutent aux écoles sans Dieu l'enseignement postscolaire obligatoire pour donner, suivant le F∴ Viviani, auteur du projet, aux jeunes gens de 13 à 20 ans une éducation générale, «leur enseigner leurs devoirs politiques et former leur conscience».
L’American Freemason, le grand organe maçonnique des États-Unis, donnait en exemple aux Loges américaines la France qui «au milieu d'une guerre absorbante gardait assez de calme pour étudier les besoins de l'éducation actuelle et future du pays» et leur suggérait de consacrer leurs ressources à l'établissement du monopole de l'enseignement ma-çonnique :
«Songez maintenant, disait-il, aux résultats qu'on obtiendrait, si dans dix ans, vingt ans, cinquante ans une cen-taine ou quelques centaines des individus les meilleurs, les mieux pourvus au point de vue cérébral, sortaient chaque année des collèges avec une formation qui les rendrait capables de diriger leur génération, et si cela était réalisé grâce à la libéralité et à la prévoyance maçonniques... Faites des placements sur les cerveaux et les âmes de jeunes gens et de jeunes filles, donnez à ceux qui sont entravés par les circonstances les moyens de prendre la place qui leur revient dans l'œuvre mondiale, vous ferez taire ainsi l'ennemi le plus implacable de l'Ordre».
Et continuant à mettre au jour les articles de vingt revues étrangères, il montrait la lutte scolaire engagée partout aux États-Unis, en Floride, au Massachusetts, à Chicago, au Canada, au Manitoba, à l'Equateur ; dans la Colombie et le Ve-nezuela, au Mexique et dans l'Amérique latine. En résumé, pour lui,
«Le quatrocentenaire de Luther et le bicentenaire de la Maçonnerie semblent la date fatidique du triomphe du Laïcisme sur le surnaturel. La Maçonnerie, fille du Protestantisme, rallie à sa cause toutes les hérésies, et poursuit partout le même but, l'irréligion d'État. «Cette victoire contre Rome, contre l'Église, est escomptée par tous les pays protestants... Ce serait l'apothéose de la Réforme».
Toutes ces trouvailles, l'abbé Jouin les consigna dans une brochure parue en 1917 : Le Quatrocentenaire de Luther et le Bicentenaire de la Maçonnerie. Mais voici que ses recherches l'avaient amené à une autre découverte : Derrière, ou plutôt au-dessus du Franc-Maçon et du Protestant, il avait trouvé le Juif, complice et véritable inspirateur des Sociétés Secrètes.
LA JUDEO-MACONNERIE.
Parlant, en novembre 1928, au premier Congrès de la Ligue anti-judéo-maçonnique, Mgr Jouin faisait un retour sur le passé :
«Le 1er Janvier 1912, disait-il, parut la Revue Internationale des Sociétés Secrètes. Dès le premier article, j'appa-rentai les Juifs aux Maçons, en citant La Question juive et la Révolution sociale de M. le Marquis de La Tour du Pin Chambly et un ouvrage anonyme intitulé : Les Juifs en Russie. Mais je dois avouer que je n'ai soudé les uns et les autres dans le mot unique de Judéo-Maçonnerie qu'en 1920, lorsque je repris ma Revue interrompue par la guerre».
La Judéo-Maçonnerie «cette expression, dit M. Colmet-Daage, comme le drapeau tricolore, a fait le tour du monde et rien n'est venu amoindrir la découverte d'une soudure véritablement autogène».
«Que la Franc-Maçonnerie soit elle-même subordonnée à des groupes supérieurs, c'est un aveu d'autant plus rare que la plupart sont à ce sujet dupes et ignorants. Cette dépendance, voisine de la domesticité, est cependant accusée d'un manière indiscutable presque à chaque pas de l'histoire Maçonnique». A l'appui de cette affirmation, il apportait le témoignage de Weishaupt «ordonnant que dans chaque ville tant soit peu considérable, les chapitres se-crets établissent des Loges maçonniques des trois grades ordinaires et regardant comme très important d'étudier la constitution des autres Sociétés Secrètes et de les gouverner». (R.I.S.S., N°1, 1er janvier 1912).
Cette prédominance de la puissance secrète juive sur les autres groupes ne faisait aucun doute pour Mgr Jouin.
«Pour tout chercheur averti, dit-il, la question maçonnique se complique de la question juive. La Judéo-Maçonnerie est maîtresse du monde, mais à condition de rester une société secrète. Sans doute, la Maçonnerie, s'est trouvée singulièrement démasquée par la guerre mondiale ; il n'en fut pas de même de l'élément juif. Aussi, lorsque le Docteur Wichtl fit paraître son livre : Maçonnerie universelle. Révolution universelle, République univer-selle, il ne souleva la colère de toutes les Loges d'Allemagne, que parce qu'il mettait à nu la direction et les agisse-ments des Juifs sous le couvert des ateliers maçonniques, et qu'il apportait des listes de noms à l'appui». (Avant-propos de l'Édition des Protocols de Nilus 1930, p. 1)
* * *
Qu'il y ait une volonté juive de domination universelle, c'est aussi une affirmation que nous retrouvons à chaque page sous la plume de Mgr Jouin :
«En relisant les prétentions du peuple élu, disait-il dans un discours à la salle des Centraux, nous constatons l'im-périalisme d'une race qui se croit appelé par Dieu à gouverner le monde».
Et il écrivait encore :
«Israël est roi, le Maçon est son chambellan, le Bolcheviste est son bourreau. Le Juif croit à la domination mon-diale de sa race. «Depuis votre faux Messie, disait à Mgr Caron de Versailles un des rabbins les plus en vue, nous avons vainement attendu le nôtre. A la lumière des événements du jour, nous comprenons que notre peuple est le vrai Messie, car l'heure a sonné, le monde est à nous».
Cette conviction était chez Mgr Jouin le fruit d'une étude approfondie, conviction que les faits se chargeaient de con-firmer tous les jours.
Sa parfaite connaissance de l'Évangile lui montrait ce rêve de domination temporelle persistant jusqu'à l'Ascension chez les Apôtres eux-mêmes. De plus, il avait eu la patience de lire les livres talmudiques, compilation des sentences rabbiniques, qui se transmettaient déjà oralement du temps de Notre-Seigneur, la Mischna, qui est du deuxième siècle et la Gamara terminée au cinquième, le Talmud de Babylone beaucoup plus dépravé que celui de Jérusalem. Il connaissait la lettre du Cardinal de Crémone au Cardinal de Vienne affirmant que ces livres «contiennent non seulement des blas-phèmes exécrables contre Jésus-Christ, mais encore des préceptes contraires à la loi de Moïse, au droit des gens et à toutes les lois naturelles».
Il avait aussi étudié les documents modernes, lisait assidûment la presse juive : La Tribune Juive, L’Univers Israélite, Le Peuple Juif, Les Archives Israélites, etc., et publiait dans sa Revue le discours d'un rabbin au Congrès de Lemberg, la Conférence faite par le Dr A. Rappoport à Kief, les innombrables confirmations provenant des ouvrages juifs les plus in-discutés, de V. Sombart, de Bernard Lazare, de Max Nordau, de Simon Lévy et surtout les «Protocols des Sages de Sion» autour desquels s'éleva d'ailleurs une polémique qui dure encore. D'après les traducteurs et éditeurs qui les publiè-rent en 1919, «ils reproduisent le texte des procès-verbaux de réunions secrètes du Congrès Sioniste tenu à Bâle en 1897, sous la présidence de Théodore Herzl, appelé par ses coreligionnaires : le Prince de l'Exil».
«Le thème de ces procès-verbaux est le suivant : Les Juifs sont et demeurent le peuple élu de Dieu. Ils détiennent les richesses et en particulier l'or du monde. Ils s'en servent en suscitant des guerres, des révolutions, des crises économiques mondiales qui mettent les sots et naïfs «goym» à leur merci. La victoire sera d'autant plus facile que les Juifs auront, au préalable, endormi leurs adversaires en leur injectant le poison du libéralisme. »
Les «Protocols» sont-ils authentiques ? Mgr Jouin a longuement étudié la question dans la Préface de la première édi-tion, et il conclut : Le problème des «Protocols» reste donc irrésolu, l'énigme demeure entière, mais cependant une date brille comme un phare dans la nuit : le 10 août 1906, un exemplaire des «Protocols» est entré au British Muséum de Londres où il a été répertorié sous le n° 3926-D17».
Peu importe d'ailleurs que les «Protocols» soient authentiques. M. Jouin n'a jamais demandé à ses amis de croire à leur authenticité. Il suffit qu'ils soient vrais. «Les choses vues ne se prouvent pas. La véracité des «Protocols» nous dis-pense de tout autre argument touchant leur authenticité, elle en est l'irréfragable témoin».
Le résultat de ces études sur la question juive fut la publication du Péril Judéo-Maçonnique, six volumes dans lesquels il s'attache à dévoiler le plan des Juifs alliés à la Maçonnerie. «Ce plan comprend un but : l'hégémonie mondiale ; un moyen : l'or ; un résultat : le supergouvernement juif».
Plan insensé et paradoxal, dira-t-on, conte des Mille et Une Nuits. Comment un peuple de treize millions d'hommes, dispersé et universellement méprisé, peut-il se leurrer d'un tel rêve ?
«Ne concluons pas si précipitamment, répond M. Jouin. D'abord ce rêve talmudique berce les espoirs d'Israël de-puis 2000 ans», et ce paradoxe est presque une réalité.
«On est oblige de constater qu'au triple point de vue de la race, de la nationalité et de la religion, le Juif est deve-nu en général l'ennemi de l'humanité ».
Car la race juive existe toujours, le Juif se gardant bien de mélanger son sang et les rabbins fulminant sévèrement contre les mariages mixtes ; elle ressemble à un fleuve circulant au milieu de l'Océan des peuples sans y mélanger ses eaux. S'autorisant des promesses messianiques qu'elle interprète dans un sens matériel, elle revendique pour elle les ri-chesses de l'univers et la prédominance sur les autres races. Elle est le peuple élu, appelé à la domination universelle et sa littérature apocryphe postérieure au christianisme l'entretient dans cette idée.
«Après les siècles d'esclavage, Jéhovah reprendra ses guerres victorieuses, et le monde sera juif ou n'existera plus». Aussi le Qahal, cette organisation juive, n'a-t-il été organisé que «pour maintenir intacte et isolée la nation juive privée de sa patrie, jusqu'au jour où l'Éternel, par l'intermédiaire du vrai Messie, décidera de donner à Israël l'univer-selle souveraineté».
«Le Messie, dit-il encore, est l'unique raison d'Israël.
«Toute l'histoire du peuple juif : ses gloires et ses revers, ses récompenses et ses châtiments, ses grandeurs et ses décadences, ses espoirs constants dans son inconsistante dispersion, tout cela est d'ordre messianique. Abs-traction faite du Messie, la question juive devient une énigme dont les Juifs eux-mêmes ne peuvent apporter la solu-tion».
L'étude de la Nationalité juive l'amenait à la même conclusion. Car, malgré sa dispersion, la race juive a gardé sa na-tionalité. Cinq siècles avant Jésus-Christ, les colonies juives florissaient déjà sur tous les points de l'univers. Vaincus ou émigrants, par leur génie du commerce, leur soif de richesses, leur activité, elles étaient arrivées à une rapide prospérité. Mais ces «Juifs de la Dispersion» restaient toujours des Juifs, et le lien qui les unissait, c'était la commune attente du Messie auquel semblait attachée la domination du monde. Aussi envoyaient-ils à Jérusalem des délégations et leurs of-frandes pour le Temple.
Mais comment expliquer que, dispersé depuis bientôt deux mille ans, le Temple détruit, «le peuple Juif, l'éternel élu de Dieu, se regarde encore, suivant l'expression de Bernard Lazare, comme le peuple le plus un, le plus stable, le plus im-pénétrable, le plus irréductible ?» L'écrivain juif invoque l'unité religieuse d'Israël. «Mais alors, demande Mgr Jouin, pour-quoi la religion n'a-t-elle pas produit les mêmes effets chez les autres peuples disparus ?»... Les conditions sociales faites aux Juifs dans tous les pays, les contraignant à se grouper dans les ghettos, expliquent-elles ce phénomène ? Pas davantage. «Car les Juiveries ont disparu depuis plus de temps qu'il n'en a fallu pour engloutir les peuples anciens». Les rapports financiers ou commerciaux des Juifs n'expliquent pas davantage la survivance d'Israël, et l'on ne trouve pas là les caractères spécifiques d'une nationalité et, d'autre part, faire appel à la langue reçoit un démenti de l'histoire, quand on sait que les promoteurs eux-mêmes du premier Congrès Sioniste de Bâle, Théodore Herzl et Max Nordau, ignoraient la langue de leurs pères. La solution de l'énigme, d'après M. Bernard Lazare est dans la conscience qu'eurent toujours les Juifs d'être une nation.
«Quand ils quittèrent la Palestine, aux premiers siècles avant l'ère chrétienne, un lien continua de les relier à Jé-rusalem ; lorsque Jérusalem se fut abîmée dans les flammes, ils eurent leurs exilarques, leurs écoles de docteurs, écoles de Babylone, écoles de Palestine, puis écoles d'Egypte, enfin écoles d'Espagne et de France. La chaîne tradi-tionnelle ne fut jamais brisée. Toujours ils se considérèrent comme des exilés et se bercèrent du songe du rétablis-sement du royaume terrestre d'Israël. Tous les ans, à la veille de Pâques, ils psalmodièrent du plus profond de leur être, par trois fois, la phrase consacrée : «l'année prochaine à Jérusalem !» Et, malgré tous leurs malheurs, malgré les esclavages, ils se regardèrent comme le peuple élu, celui qui était supérieur à tous les peuples» (Bernard Lazare, L'Antisémitisme, son Histoire et ses Causes, p. 237).
L'établissement des Juifs en Palestine que préconise et favorise l'Angleterre prisonnière des banquiers juifs, calmera-t-elle, en les fixant, ces appétits de domination ? Mgr Jouin ne le croyait pas. Tout au plus Jérusalem redeviendrait la ca-pitale d'un royaume qui continuera à revendiquer l'univers pour territoire ; tandis que la masse des Juifs, les plus nom-breux et les plus riches, disséminés au milieu des peuples y poursuivront leur œuvre séculaire.
«Sionistes, cosmopolites, tous, enivrés du fol orgueil de leur patriotisme, s'estiment les citoyens d'une race supé-rieure en fonction d'une mission divine qui réalisera leur plan de domination universelle».
L'étude de la religion juive amenait Mgr Jouin à une conclusion identique, si toutefois l'on peut parler de religion chez un peuple qui n'a plus qu'un culte, celui de l'argent et de la puissance. C'est un Juif, M. Bernard Lazare, qui en fait la constatation :
«La plupart ne savent plus l'hébreu ; ils ont oublié le sens des antiques cérémonies ; ils ont transformé le Ju-daïsme rabbinique en un rationalisme religieux ; ils ont délaissé les observances familières, et l'exercice de la religion se réduit pour eux à passer quelques heures par an dans une synagogue en écoutant des hymnes qu'ils n'entendent plus. Ils ne peuvent pas se rattacher à un dogme, à un symbole : ils n'en ont pas... Le Juif n'a plus de foi religieuse, il ne pratique plus, il est irréligieux, il est quelquefois athée».
Chose étrange, remarquait Mgr Jouin, ce peuple qui n'a plus de religion «veut avant tout détruire les peuples catho-liques : la suprématie sociale qu'il ambitionne le condamne à un anticléricalisme militant et formidable». Le conflit qui op-pose les Juifs aux peuples chrétiens est un conflit religieux. Il a pris naissance au Calvaire ; il est, par conséquent, d'ori-gine messianique, et c'est cette dépendance messianique qui fait du peuple juif l'irréconciliable ennemi des peuples chré-tiens». M. Bernard Lazare le reconnaît :
«Le jour où le Juif a occupé une fonction civile, l'Etat chrétien a été en péril... l'entrée des Juifs dans la société a symbolisé la destruction de l'État, de l'État chrétien, bien entendu». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 361)
«Retenons, continue Mgr Jouin, l'action du Juif qui «travaille à son œuvre séculaire : l'anéantissement de la reli-gion du Christ».
Israël enveloppait d'ailleurs dans la même haine ceux de ses fils qui se convertissaient et qui désertaient le combat contre Rome et contre l'étranger.
«Ils devenaient, dit M. Bernard Lazare, des traîtres à la patrie, à la religion juive... C'est contre eux, contre ces an-ti-patriotes, que furent rédigées des formules de malédiction ; les Juifs les mirent au ban de leur société, il fut licite de les tuer, comme il était licite de tuer le meilleur des goïms». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 290)
«Voilà bien le Juif, concluait Mgr Jouin, haineusement antichrétien, d'une haine froide, calculée, absolue... C'est la tare du Juif. Cette sentence de mort du meilleur des goïms vient du Calvaire, où le Juste, le Saint, fut cloué sur une croix. Avec le Juif, il faut revenir, malgré tout, à son déicide».
Mgr Jouin n'avait donc pas tort d'appeler la Judéo-Maçonnerie la Contre-Église. Mais elle est aussi le Contre-État, car sa haine du Christianisme a pour corollaire naturel la haine des institutions des peuples catholiques. Les écrivains juifs ne s'en cachent pas.
«Le moderne judaïsme, dit encore M. Bernard Lazare, prétend n'être plus qu'une confession religieuse ; mais il est encore et en réalité un ethnos, puisqu'il croit l'être, puisqu'il a gardé ses préjugés, son égoïsme et sa vanité de peuple : croyance, préjugés, égoïsme et vanité qui le font apparaître comme étranger aux peuples dans le sein des-quels il subsiste». (Lib. cit. p. 291-293)
Et c'est cette conscience nationale, conclut Mgr Jouin, qui fait de tout Juif, en même temps, et parfois à son insu, un étranger et un révolutionnaire. Les pages suivantes du même écrivain, ajoutait-il, sont trop concluantes pour être abré-gées :
«Quant à leur action et à leur influence dans le socialisme contemporain, elle fut et elle est, on le sait, fort grande. On peut dire que les Juifs sont aux deux pôles de la société contemporaine. Ils ont été parmi les fondateurs du capi-talisme industriel et financier et ils ont protesté avec la plus extrême véhémence contre ce capital. A Rothschild cor-respondent Marx et Lassalle ; au combat pour l'argent, le combat contre l'argent, et le cosmopolitisme de l'agioteur devient l'internationalisme prolétarien et révolutionnaire. C'est Marx qui donna l'impulsion à l'Internationalisme par le Manifeste de 1847, rédigé par lui et il fut l'inspirateur du meeting ouvrier tenu à Londres en 1864, et d'où sortit l'asso-ciation... Beaucoup de Juifs affiliés à l'Internationale jouèrent plus tard un rôle pendant la Commune.
«Quant à l'organisation du parti socialiste, les Juifs y contribuèrent puissamment. Marx et Lassalle en Allemagne, Aaron Libermann et Adler en Autriche, Gompers, Kahn et Lion aux États-Unis, en sont encore les directeurs. Les Juifs russes doivent occuper une place à part dans ce résumé. Les jeunes étudiants participèrent à l'action nihiliste ; quelques-uns - parmi lesquels des femmes - sacrifièrent leur vie à la cause émancipatrice, et à côté de ces médecins et de ces avocats israélites, il faut placer la masse des réfugiés artisans qui ont fondé à Londres et à New York des centres de propagande socialiste et même communiste-anarchiste». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 343 et suiv.).
Dans ce tableau de l'histoire révolutionnaire des Juifs, l'écrivain dévoile comment «ils procédèrent idéologiquement et activement, comment ils furent de ceux qui préparent la révolution par la pensée et de ceux qui la traduisent en acte». Car, dit-il, les Juifs, même révolutionnaires, ont gardé l'esprit juif, et s'ils ont abandonné toute religion, ils n'en ont pas moins subi, ataviquement et éducativement, l'influence nationale juive».
Et il en donne «deux bons modèles de la première moitié du dernier siècle : Henri Heine et Karl Marx - Marx, ce des-cendant d'une lignée de rabbins, talmudiste lucide et clair, que n'embarrassaient pas les minuties niaises de la pratique, un talmudiste qui fit de la sociologie et appliqua ses qualités natives d'exégète à la critique de l'économie politique. Il fut animé de ce vieux matérialisme hébraïque qui rêva perpétuellement d'un paradis réalisé sur la terre ; mais il ne fut pas qu'un logicien, il fut aussi un révolté, un agitateur, un âpre polémiste, et il prit son don du sarcasme et de l'invective là où Heine l'avait pris : aux sources juives». Et, après avoir montré le même esprit chez d'autres philosophes ou sociologues israélites, Hess, Robert Blum et d'Israeli, il se demande s'il en est de même de «cette masse qui, actuellement, vient au socialisme ou à l'anarchie».
«Ici, répond-il, il faut distinguer. Les Juifs de Londres, des États-Unis, de Hollande, d'Allemagne acceptent les doctrines révolutionnaires, parce qu'ils sont des prolétaires en lutte avec le capital. Ils ne provoquent pas la révolu-tion, ils y adhèrent, ils la suivent, et cependant ces groupements ouvriers, ayant abandonné toute religion, n'étant plus Juifs au sens religieux du mot, sont Juifs au sens national... Ceux de Londres et des États-Unis, qui ont aban-donné leur pays d'origine, se sont fédérés entre eux, ils ont formé des groupes qui se font représenter aux Congrès ouvriers, sous le nom de «groupes de langue juive». Il en est de même en d'autres contrées, en Hollande, en Galicie, où les Juifs ouvriers nationaux forment des associations nationales. Donc, le Juif prend part à la révolution et il y prend part en tant que Juif, c'est-à-dire en restant Juif» (Bernard Lazare, p. 343).
Et les documents viennent s'accumuler sous la plume du polémiste, notamment une impressionnante nomenclature des noms de tous les personnages composant le personnel soviétique au début du Bolchevisme : «nomenclature qui im-pose cette conclusion que la révolution russe n'est pas autre chose que la prise du pouvoir russe par les Juifs».
La Judéo-Maçonnerie qui est la Contre-Église est donc aussi le Contre-État et, comme conséquence, la destructrice de l'idée de Patrie : le vaillant adversaire des Sociétés Secrètes devait aussi la combattre sur ce terrain.
* * *
Que le Juif, resté Juif, n'ait pas l'idée de la Patrie, cela n'a rien qui doive nous étonner, puisqu'il est lui-même sans pa-trie depuis vingt siècles.
«Pour nous, dit M. P. Leroy, dans un remarquable article de la R.I.S.S. sur Mgr Jouin, (P. Leroy, Mgr Jouin et la Patrie, R.I.S.S., n° du 15 août 1932) la Patrie n'est pas seulement un sol, des usines et des maisons de commerce. Elle groupe sous le symbole d'un nom maternel et vénéré, les traditions spirituelles, les affinements de la culture, les précieux souvenirs et mérites des morts, la fierté des gloires et la mémoire douloureuse des défaites et des sacri-fices». Elle est, comme le disait naguère le cardinal Pacelli, légat du Pape, à M. Charles Pichon, «cet ensemble un peu mystérieux sans doute, mais d'un mystère lumineux, car la Patrie est une des choses pour lesquelles le génie de saint Augustin a trouvé ces belles paroles : «Si vous ne me le demandez pas, je sais ce que c'est ; si vous me le de-mandez, je ne le sais plus». La Patrie, c'est plus qu'une idée, c'est un sentiment.
Le Juif, qui est cosmopolite et s'en fait gloire, ne peut comprendre ce sentiment. De là ces définitions et ces maximes glanées par le Fondateur de la R.I.S.S. dans les plus récents ouvrages de la littérature israélite et commentées par lui dans le Péril Judéo-Maçonnique : Celle-ci, d'abord, du Grand-Rabbin Simon-Lévy :
«Le beau nom de patrie n'appartient donc pas à la terre qui nous a vus naître, mais encore à celle qui nous a pris sous sa protection, qui nous nourrit aujourd'hui de ses produits et nous couvre de l'égide de sa sage législation... L'homme doit savoir se naturaliser dans tous les endroits du globe où on lui octroie ce qui lui est nécessaire pour le déploiement des facultés de son âme. Le cosmopolitisme est une vraie vertu».
Dans ces conditions, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de considérer le Juif comme un étranger. Sa Patrie est là où il se trouve bien».
C'est par centaines qu'on pourrait compter les définitions de la Patrie et du patriotisme qui ont été produites en ces cinquante dernières années. Elles portent toutes l'empreinte juive. Et l'on aboutit à l'articulation des thèses inter-nationalistes d'aujourd'hui, thèses qu'il faudrait nommer plus exactement antinationalistes. L'internationalisme n'est pas, par définition, l'ennemi des nations. Le Catholicisme, par exemple, qui est l'internationale des âmes, est à ce point respectueux des nations qu'il est le plus sûr foyer du patriotisme, même du plus jaloux et du plus fier. C'est la poussée juive qui a donné à l'internationalisme une définition et une portée antipatriotiques» (Paul Courcoural, Les Juifs et la Patrie, Péril Judéo-maçonnique, p. 137 et seq.).
Puis, cette définition d'un certain Jean Marnold : «La patrie comporte avant tout, un acquiescement individuel». Con-clusion : il peut donc cesser, et la patrie disparaître avec lui !
Pour un troisième, «la nation est une association politique engendrée par les circonstances».
Que les circonstances viennent à changer, on pourra donc changer de patrie. On trouve toujours, quand on veut s'évader d'une association, un prétexte suffisant.
Et enfin, pour abréger, cette conclusion piquante, mais combien vraie, de M. André Spire, un Juif cependant, dans son ouvrage : Les Juifs et la Guerre : «Pour donner aux Juifs le droit de citoyen, (c'est-à-dire de vrai fils d'une cité, de véri-table enfant de cette cité de cités qu'est une patrie), - je ne vois qu'un moyen, qui est de leur couper la tête en une nuit, à tous, et de leur en mettre une autre dans laquelle il n'y ait pas une seule idée juive !» (Paul Courcoural, lib. cit p. 146).
Et encore, après leur avoir ainsi changé la tête, faudrait-il leur changer aussi le cœur !
* * *
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 8°)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
La vieillesse qui, chez la plupart, arrête ou ralentit l'élan, semblait apporter à l'abbé Jouin des énergies nouvelles. Il avait 65 ans quand survint l'événement qui orienta son activité sur un nouveau théâtre. Il en a fait lui-même le récit :
«C'était en 1909. Un matin, celui qui avait fait tomber Combes et le général André vint chez moi et me dit sans préambule : «Je vous demande de composer contre la Franc-Maçonnerie un roman dans le genre populaire du Juif errant».
«Je n'étais pas assez naïf pour ne pas croire à la malfaisance de la Franc-Maçonnerie, mais je la connaissais trop peu pour en écrire et la combattre dans un roman.
- Vous êtes toujours les mêmes, reprit M. Jean Bidegain : les religieux ouvrent des collèges, les religieuses cons-truisent des chapelles ; les curés et les vicaires fondent des patronages, et quand on a ruiné vos œuvres, vous re-commencez patiemment ce travail de Pénélope. Mais, allez donc une bonne fois à l'ennemi, détruisez la Franc-Maçonnerie, et vous ferez ensuite ce que vous voudrez».
L'abbé Jouin savait par expérience ce qu'il en était. «Je vais m'y mettre, répondit-il».
Dès le lendemain, il entreprenait l'acquisition d'une bibliothèque maçonnique et occultiste. Quand il fut en face de «l'immense et déconcertante littérature» concernant ces matières, il estima, qu'il ne s'agissait plus de composer un ro-man, mais bien une revue scientifique comprenant les documents anciens et nouveaux sur ces multiples questions et s'adressant aux chercheurs aussi bien qu'aux simples lecteurs. Le 1er Janvier 1912, parut la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, - la R.I.S.S. - et, un an plus tard, la Ligue Franc-Catholique, association administrée par un Comité dont l'abbé Jouin se réservait la présidence à vie, et dont l'objet était l'étude des questions maçonniques.
«La même année, raconte-t-il, me trouvant trop surchargé avec mon zélé et intelligent collaborateur, M. Nicoul-laud, par les recherches inépuisables que nécessitaient notre travail et la confection de livraisons bi-mensuelles de 250 à 300 pages, je conçus l'idée d'un «Institut», organisé sur le modèle de la Société des Bollandistes. J'étais per-suadé que, concurremment avec la glorification de l'Église exaltée dans ses Saints, il y avait place pour les défen-seurs de la Foi contre la collusion des Juifs et des Maçons, cette formidable armée lancée par l'Enfer contre le Christ et les siens».
Ces défenseurs de la Foi se nommaient alors les abbés de Bessonies et Tourmentin qui venaient de livrer à la lumière les noms de 36.000 francs-maçons ; c'était la Ligue Militaire de M. de la Rive et la Ligue Française Antimaçonnique du Commandant de Fraville ; c'était M. Copin-Albancelli et son journal La Bastille. Dernier venu dans cette phalange, l'abbé Jouin ne tarda pas à voir la faiblesse de ces troupes rivales, jalouses les unes des autres et divisées jusqu'à se com-battre mutuellement. Comme Jeanne d'Arc, dont il avait pris la devise : Dieu premier servi, il conçut le projet d'établir entre elles une fédération. Chaque ligue - Association Antimaçonnique de France, de l'abbé Tourmentin, Ligue Française Antimaçonnique du Commandant de Fraville, Ligue Militaire, Ligue Franc-Catholique de l'abbé Jouin -, gardait son auto-nomie et son initiative, mais prenait un double engagement : celui de ne jamais attaquer comme personnes les membres des ligues fédérées, (tout litige étant déféré au Comité Fédératif), et celui de combattre systématiquement, en dehors des partis, la Franc-Maçonnerie, les Sociétés Secrètes et leurs filiales, comme la Ligue de l’Enseignement, les Jeunesses laïques et républicaines, la Ligue des Droits de l’Homme, les Ligues pacifistes et antimilitaristes, etc.
Ce projet avait l'approbation d'un haut personnage de Rome et du cardinal Amette. Il échoua cependant et les auteurs responsables de sa mort révélèrent dès ce jour les vrais sentiments qui les animaient : ils n'étaient point de sincères ad-versaires de l'ennemi commun.
Le premier fut M. Copin-Albancelli. Avisé, par une indiscrétion, de l'intention de l'abbé Jouin, il s'efforça de l'étouffer avant sa naissance et la combattit en des articles qui voyaient dans ce projet le résultat d'influences maçonniques et je-taient la suspicion sur le collaborateur de M. Jouin.
«Je n'ai point à discuter vos raisons, lui écrivit l'abbé Jouin. Je voulais l'union, vous n'en voulez pas, c'est votre droit ; mais vous auriez mieux fait, ce me semble, de m'en avertir, tout au moins, avant de jeter la chose dans le pu-blic. Je tiens seulement à constater que ce projet de Fédération vient uniquement de moi. Personne ne m'a suggéré mon plan. Ne cherchez donc pas ici d'infiltrations maçonniques ; et laissez-moi vous faire remarquer que c'est là une explication dont on abuse beaucoup trop parmi les anti-maçons. Pour moi, j'ai encore assez conscience de mes idées et je me sens une volonté trop personnelle pour prendre aux autres, à mon insu, ce que je pense et ce que je veux. Aussi je maintiens mon projet de Fédération, très sûr au reste que le pardon des injures n'est point théologi-quement un «luxe moral», mais que la charité passe avant la justice. Quant à M. Nicoullaud, je l'ai empêché de ré-pondre à vos articles et à votre lettre. Je ne veux aucune polémique, ni publique ni privée ; d'ailleurs vous auriez fort à faire avec lui ; il met les points sur les i à en briser sa plume».
Dans une seconde lettre, il ajoutait :
«Que la Fédération se fasse ou non, je serai toujours l'unique ennemi de la Maçonnerie et des Sociétés Secrètes et je combattrai dans les rangs de tous les anti-maçons, je veux la guerre étrangère et non pas la guerre civile».
Moins franche encore et plus suspecte fut l'opposition de la Ligue Française Antimaçonnique. Le Président, le Com-mandant de Fraville, était favorable au projet. Mais le Secrétaire général - M. Flavien Brenier - et l'abbé Duperron, qui n'en voulaient à aucun prix, l'obligèrent par leurs calomnies à donner sa démission. Maîtres de la place, ils insinuent d'abord, puis affirment que le projet est d'origine maçonnique, inspiré à l'abbé Jouin dupé par un ex-franc-maçon, M. Bidegain, ami et collaborateur du «théosophe Nicoullaud, pour qui la confiance de l'abbé Jouin est sans limite», et, en l'absence du Président, obtiennent de leur Ligue non seulement le rejet de la Fédération, «mais du principe même, pour le présent et pour l'avenir, d'un Comité fédéral antimaçonnique».
Quelques jours après, ému d'une note parue dans la Revue Internationale, le même Flavien Brenier osait écrire à l'abbé Jouin ces lignes hypocrites : «Il y a un malentendu. Nous estimons la Fédération comme absolument nécessaire et nous en avons voté le principe à l'unanimité». Sur quoi l'abbé Jouin fit cette réflexion. «Le double jeu de M. Flavien Bre-nier est indéniable. D'une part ma Fédération est nécessaire ; d'autre part, elle est un projet «funeste et maçonnique». Est-ce que M. Flavien Brenier serait l'homme à double face, comme le prétend l'article de M. Hoog dans la Démocratie... Je veux encore en douter».
Devant tant de mauvaise foi, M. Jouin ne pouvait plus songer à son projet d'union. Il y renonça, mais non sans avoir arraché le masque dont se couvraient en vain M. Flavien Brenier et l'abbé Duperron. Dans une brochure : La Lutte Anti-maçonnique - Une Exécution nécessaire, il laisse éclater son indignation.
«Le diable est menteur et homicide dès le commencement. Or, avouez-le, Messieurs, vos calomnies ont pour but de tuer les œuvres et les hommes.
«Vous avez voulu tuer la Fédération antimaçonnique en calomniant ceux qui lui étaient favorables. Vous avez voulu tuer le promoteur de cette idée, aussi féconde que chrétienne, en osant contester sa parole : vous en avez fait le jouet ridicule et sénile de prétendus ennemis de la religion. Vous avez voulu tuer M. Bidegain dans son honneur ; je n'ai pas à le défendre, mais j'ai à vous rappeler que seul, tout franc-maçon que vous le prétendez, il a frappé d'autres coups que vous deux, qui vous dites anti-maçons, et que ces coups-là ont forcé la Maçonnerie à reculer. Vous avez voulu tuer M. Nicoullaud en l'appelant théosophe : vous jetez d'un mot, avec une aisance troublante, la dif-famation sur ce catholique pratiquant et militant. Vous avez voulu tuer le Commandant de Fraville, vous n'avez pas craint de l'appeler menteur et traître pour le mettre hors de votre Ligue et l'acculer à sa démission.
«Et après ces exploits, vous venez écrire que mon projet de Fédération était une «manœuvre louche». Mais les manœuvres louches, elles se retrouvent à chaque page de votre rapport. Dire de M. de Fraville qu'il n'est pas un menteur, mais qu'il dissimule la vérité, et le couvrir de votre estime pour mieux lui tirer dans le dos, le juger sans ap-pel pendant son absence, cela se nomme partout des «manœuvres louches»... Je comprends le général de Kerdrel (membre pourtant de votre Ligue), m'écrivant : ce ne sont pas les procédés francs auxquels je suis habitué».
«J'espère que MM. Brenier et Duperron, ajoutait-il, ne m'accuseront plus de «manœuvres louches». Je ne me sens pas le courage de les imiter. Je tiens pour meilleure la devise du Sermon sur la Montagne : Est, est ; non, non, cela est ou cela n'est pas, c'est oui ou non. Si MM. Brenier ou Duperron avaient dit simplement : Nous ne voulons pas de la Fédération ; leur attitude eût été franche ; ils auraient usé de leur droit en toute liberté, sans calomnier ni ri-diculiser personne. Ils ont louvoyé, «louché» selon l'expression qui leur est chère, et, naturellement, ils ont abouti à une «manœuvre louche».
C'est leur affaire, comme c'est leur devoir de réparer le tort fait à la réputation du prochain. Pour ma part, je leur par-donne, en ce qui me regarde. Mais, puisque nos négociations sont terminées, je les prie de ne plus écrire qu'ils sont «ac-quis à la Fédération», et de vouloir bien conclure une «entente cordiale» avec ma Ligue Franc-Catholique, en ne s'occu-pant que de la leur. Ce sera encore le moyen d'appliquer mon second article : on n'attaquera pas les Anti-maçons, on les ignorera. Ce n'est pas parfait, mais le silence remplacera, momentanément, la charité et l'union».
* * *
De Clément XII, en 1738, jusqu'à Pie XI, tous les Papes ont condamné les sociétés secrètes. Dans un discours au Congrès de la Ligue, en 1930, l'abbé Jouin rappelait leurs anathèmes et citait ces paroles de l'Encyclique «Humanus ge-nus» : «...Il s'agit, dit Léon XIII, d'une secte qui a tout envahi,... qui, dans l'espace d'un siècle et demi, a fait d'incroyables progrès et commence à prendre, au sein des États modernes, une puissance qui équivaut presque à la souveraineté... Il ne suffit donc pas de se tenir sur la défensive, mais il faut descendre courageusement dans l'arène et la combattre de front».
Et, précisant sa pensée, le Pape ajoutait : «C'est ce que vous ferez en opposant publications à publications, écoles à écoles, associations à associations, congrès à congrès, actions à actions».
Docile à ce mot d'ordre, le Curé de Saint-Augustin descendit dans l'arène, opposant la Revue Internationale des So-ciétés Secrètes aux Bulletins des Loges, sa Ligue Franc-Catholique à leurs Sociétés, ses Congrès à leurs Convents. «Démasquez, disait encore Léon XIII, ces hommes qui se cachent pour organiser leurs complots, et faites la lumière sur leurs agissements».
Pour démasquer, il faut connaître ; pour connaître, il faut chercher, fouiller. Et M. Jouin, aidé de ses collaborateurs, se mit à dépouiller revues et journaux, bulletins, ouvrages anciens et récents sur les origines et l'histoire de la secte maçon-nique. Pendant que les uns traduisaient les articles russes ou anglais, d'autres photographiaient des documents secrets importants qu'on lui avait confiés, parfois pour quelques heures.
Et voici qu'en poursuivant, dans le passé et dans le présent, la Franc-Maçonnerie, il découvrit à côté et au-dessus d'elle deux autres puissances complices : le Protestantisme et la Juiverie, le Franc-Maçon et le Protestant s'élançant, la main dans la main, sous la conduite du Juif, à l'assaut de la Religion, de la Morale et de la Société. Même but : la des-truction de l'Église Catholique et de toute religion ; même tactique : la laïcité par le monopole de l'enseignement ; mêmes formules hypocrites et mensongères : défense de la République, triomphe de la Démocratie, laïcité de la paix par la So-ciété des Nations.
Dès 1916, Protestants et Francs-Maçons s'apprêtaient à célébrer «en bons frères», les uns le quatrième centenaire de Luther (1517), les autres le bicentenaire de la Maçonnerie.
«Car, disaient les Feuilles Romaines, Protestants et Francs-Maçons sont assez bien ensemble depuis long-temps». Naturellement on ne se contenterait pas de glorifier le passé, on préparerait un programme d'action, de «re-prise» en grand pour l'après-guerre». Et l'abbé Jouin surprenait des aveux de feuilles maçonniques, confirmant cette fraternité d'armes :
«Sans doute, disait la Fremdenblatt de Hambourg, c'est le hasard qui a réuni les deux fêtes dans la même année. Mais ce hasard fait qu'on se demande si ces deux forces spirituelles n'auraient pas aussi des relations intimes. Et ces relations les voici : «L'une des deux repose sur l'autre, comme sur sa base. Il n'y aurait pas de véritable Franc-Maçonnerie, s il n'y avait eu ni Luther, ni la Réforme... La Franc-Maçonnerie ne pouvait croître que sur le sol du libre Protestantisme. Et ce n'est sans doute point par un effet du hasard que l'on trouve au berceau de la Franc-Maçonnerie deux hommes fortement influencés par le Protestantisme, le fils d'un ministre réformé français, Désagu-liers, et le prédicateur écossais, James Anderson. Ce c'est pas non plus par un effet du hasard que, pendant ces deux cents ans de son existence, la Franc-Maçonnerie a trouvé son ennemi le plus acharné dans Rome, et ses amis les plus chauds et ses défenseurs les plus zélés parmi les hommes dont la formation intellectuelle se rattache à Lu-ther et à la Réforme, Lessing, Frédéric le Grand, Goethe».
A ces aveux, d'autres voix venues d'outre-mer, faisaient écho :
«Les Francs-Maçons, lisait-il dans The Light de Louisville, doivent s'intéresser tout particulièrement au 400e anni-versaire de la Réforme protestante... Les curieux des origines historiques de la Maçonnerie seront frappés des rap-ports de Luther avec les mystiques de son temps».
Et l'abbé Jouin de conclure :
«Il est évident que pour les Francs-Maçons américains, comme pour les nôtres, le déclenchement des forces libres-penseuses et athées remonte à Luther, et que la lutte anticléricale, sous sa forme actuelle, en est à son 400e anniversaire ».
Les mêmes feuilles protestantes et maçonniques lui apprenaient encore qu'aux États-Unis, les fêtes de Luther durè-rent un an, qu'elles avaient pour organisateurs des Francs-Maçons, en majeure partie membres du clergé protestant, et qu'une souscription de 40,000 dollars était lancée pour élever une statue à Luther,
On sait d'ailleurs qu'en Europe, le Kayser s'était vanté d'aller célébrer le centenaire du moine apostat à Rome même, sous les murs du Vatican, en témoignage de sa haine pour le catholicisme, haine qu'il exprimait dans ces paroles à sa cousine, la landgravine de Hesse : «Je hais cette religion que tu as embrassée... tu accèdes donc à cette superstition romaine, dont je considère la destruction comme le but suprême de ma vie !» Mais on sait aussi comment la Providence déjoua tous ces beaux projets, et comment la guerre qui devait humainement amener l'écrasement de la France aboutit à la victoire des alliés.
Ce fut une amère déception dans le camp des puissances maçonniques. L’Alpina, de Neuchatel, et la Frankishe, de Nuremberg, en étaient inconsolables :
«Tous les Maçons se seraient tendu la main. Qui sait ? Nous aurions peut-être vu se fonder des œuvres maçon-niques qui auraient fait notre joie et soulevé nos âmes d'une espérance sans limite dans la réalisation de la fraternité humaine».
Le centenaire maçonnique n'en fut pas moins célébré dans toutes les Loges et dans tous les pays. L'abbé Jouin en apporte des témoignages cueillis en plus de cinquante revues, articles ou livres publiés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Le Temps, dont on connaît les attaches protestantes à cette époque, donnait avec complaisance le compte-rendu de l'Assemblée générale du Grand-Orient de France du 23 septembre 1917, qui dé-nonçait la «propagande confessionnelle exercée aux armées, depuis le commencement de la guerre, de l'intérieur aux tranchées, sous le couvert de l'union sacrée et réclamait contre les coupables l'action de la justice». «La Franc-Maçonnerie, disait le rapporteur, signerait sa déchéance si elle se désintéressait de la République si sournoisement combattue».
Et aussitôt, dans tout le monde maçonnique, s'élabore un programme d'action énergique visant surtout la laïcisation complète et universelle de l'Enseignement. La Croix du 23 octobre 1917 publiait un article de M. Jean Guiraud : «Nou-velle Offensive Laïque», démontrant l'emprise maçonnique de la jeunesse française par l’école unique que continuerait l’enseignement postscolaire obligatoire.
«Ainsi, concluait l'abbé Jouin, aujourd'hui, en pleine guerre, aux heures les plus critiques et les plus angoissantes, sûrs que les catholiques seront trop français pour rompre «l'union sacrée», les Maçons ajoutent aux écoles sans Dieu l'enseignement postscolaire obligatoire pour donner, suivant le F∴ Viviani, auteur du projet, aux jeunes gens de 13 à 20 ans une éducation générale, «leur enseigner leurs devoirs politiques et former leur conscience».
L’American Freemason, le grand organe maçonnique des États-Unis, donnait en exemple aux Loges américaines la France qui «au milieu d'une guerre absorbante gardait assez de calme pour étudier les besoins de l'éducation actuelle et future du pays» et leur suggérait de consacrer leurs ressources à l'établissement du monopole de l'enseignement ma-çonnique :
«Songez maintenant, disait-il, aux résultats qu'on obtiendrait, si dans dix ans, vingt ans, cinquante ans une cen-taine ou quelques centaines des individus les meilleurs, les mieux pourvus au point de vue cérébral, sortaient chaque année des collèges avec une formation qui les rendrait capables de diriger leur génération, et si cela était réalisé grâce à la libéralité et à la prévoyance maçonniques... Faites des placements sur les cerveaux et les âmes de jeunes gens et de jeunes filles, donnez à ceux qui sont entravés par les circonstances les moyens de prendre la place qui leur revient dans l'œuvre mondiale, vous ferez taire ainsi l'ennemi le plus implacable de l'Ordre».
Et continuant à mettre au jour les articles de vingt revues étrangères, il montrait la lutte scolaire engagée partout aux États-Unis, en Floride, au Massachusetts, à Chicago, au Canada, au Manitoba, à l'Equateur ; dans la Colombie et le Ve-nezuela, au Mexique et dans l'Amérique latine. En résumé, pour lui,
«Le quatrocentenaire de Luther et le bicentenaire de la Maçonnerie semblent la date fatidique du triomphe du Laïcisme sur le surnaturel. La Maçonnerie, fille du Protestantisme, rallie à sa cause toutes les hérésies, et poursuit partout le même but, l'irréligion d'État. «Cette victoire contre Rome, contre l'Église, est escomptée par tous les pays protestants... Ce serait l'apothéose de la Réforme».
Toutes ces trouvailles, l'abbé Jouin les consigna dans une brochure parue en 1917 : Le Quatrocentenaire de Luther et le Bicentenaire de la Maçonnerie. Mais voici que ses recherches l'avaient amené à une autre découverte : Derrière, ou plutôt au-dessus du Franc-Maçon et du Protestant, il avait trouvé le Juif, complice et véritable inspirateur des Sociétés Secrètes.
LA JUDEO-MACONNERIE.
Parlant, en novembre 1928, au premier Congrès de la Ligue anti-judéo-maçonnique, Mgr Jouin faisait un retour sur le passé :
«Le 1er Janvier 1912, disait-il, parut la Revue Internationale des Sociétés Secrètes. Dès le premier article, j'appa-rentai les Juifs aux Maçons, en citant La Question juive et la Révolution sociale de M. le Marquis de La Tour du Pin Chambly et un ouvrage anonyme intitulé : Les Juifs en Russie. Mais je dois avouer que je n'ai soudé les uns et les autres dans le mot unique de Judéo-Maçonnerie qu'en 1920, lorsque je repris ma Revue interrompue par la guerre».
La Judéo-Maçonnerie «cette expression, dit M. Colmet-Daage, comme le drapeau tricolore, a fait le tour du monde et rien n'est venu amoindrir la découverte d'une soudure véritablement autogène».
«Que la Franc-Maçonnerie soit elle-même subordonnée à des groupes supérieurs, c'est un aveu d'autant plus rare que la plupart sont à ce sujet dupes et ignorants. Cette dépendance, voisine de la domesticité, est cependant accusée d'un manière indiscutable presque à chaque pas de l'histoire Maçonnique». A l'appui de cette affirmation, il apportait le témoignage de Weishaupt «ordonnant que dans chaque ville tant soit peu considérable, les chapitres se-crets établissent des Loges maçonniques des trois grades ordinaires et regardant comme très important d'étudier la constitution des autres Sociétés Secrètes et de les gouverner». (R.I.S.S., N°1, 1er janvier 1912).
Cette prédominance de la puissance secrète juive sur les autres groupes ne faisait aucun doute pour Mgr Jouin.
«Pour tout chercheur averti, dit-il, la question maçonnique se complique de la question juive. La Judéo-Maçonnerie est maîtresse du monde, mais à condition de rester une société secrète. Sans doute, la Maçonnerie, s'est trouvée singulièrement démasquée par la guerre mondiale ; il n'en fut pas de même de l'élément juif. Aussi, lorsque le Docteur Wichtl fit paraître son livre : Maçonnerie universelle. Révolution universelle, République univer-selle, il ne souleva la colère de toutes les Loges d'Allemagne, que parce qu'il mettait à nu la direction et les agisse-ments des Juifs sous le couvert des ateliers maçonniques, et qu'il apportait des listes de noms à l'appui». (Avant-propos de l'Édition des Protocols de Nilus 1930, p. 1)
* * *
Qu'il y ait une volonté juive de domination universelle, c'est aussi une affirmation que nous retrouvons à chaque page sous la plume de Mgr Jouin :
«En relisant les prétentions du peuple élu, disait-il dans un discours à la salle des Centraux, nous constatons l'im-périalisme d'une race qui se croit appelé par Dieu à gouverner le monde».
Et il écrivait encore :
«Israël est roi, le Maçon est son chambellan, le Bolcheviste est son bourreau. Le Juif croit à la domination mon-diale de sa race. «Depuis votre faux Messie, disait à Mgr Caron de Versailles un des rabbins les plus en vue, nous avons vainement attendu le nôtre. A la lumière des événements du jour, nous comprenons que notre peuple est le vrai Messie, car l'heure a sonné, le monde est à nous».
Cette conviction était chez Mgr Jouin le fruit d'une étude approfondie, conviction que les faits se chargeaient de con-firmer tous les jours.
Sa parfaite connaissance de l'Évangile lui montrait ce rêve de domination temporelle persistant jusqu'à l'Ascension chez les Apôtres eux-mêmes. De plus, il avait eu la patience de lire les livres talmudiques, compilation des sentences rabbiniques, qui se transmettaient déjà oralement du temps de Notre-Seigneur, la Mischna, qui est du deuxième siècle et la Gamara terminée au cinquième, le Talmud de Babylone beaucoup plus dépravé que celui de Jérusalem. Il connaissait la lettre du Cardinal de Crémone au Cardinal de Vienne affirmant que ces livres «contiennent non seulement des blas-phèmes exécrables contre Jésus-Christ, mais encore des préceptes contraires à la loi de Moïse, au droit des gens et à toutes les lois naturelles».
Il avait aussi étudié les documents modernes, lisait assidûment la presse juive : La Tribune Juive, L’Univers Israélite, Le Peuple Juif, Les Archives Israélites, etc., et publiait dans sa Revue le discours d'un rabbin au Congrès de Lemberg, la Conférence faite par le Dr A. Rappoport à Kief, les innombrables confirmations provenant des ouvrages juifs les plus in-discutés, de V. Sombart, de Bernard Lazare, de Max Nordau, de Simon Lévy et surtout les «Protocols des Sages de Sion» autour desquels s'éleva d'ailleurs une polémique qui dure encore. D'après les traducteurs et éditeurs qui les publiè-rent en 1919, «ils reproduisent le texte des procès-verbaux de réunions secrètes du Congrès Sioniste tenu à Bâle en 1897, sous la présidence de Théodore Herzl, appelé par ses coreligionnaires : le Prince de l'Exil».
«Le thème de ces procès-verbaux est le suivant : Les Juifs sont et demeurent le peuple élu de Dieu. Ils détiennent les richesses et en particulier l'or du monde. Ils s'en servent en suscitant des guerres, des révolutions, des crises économiques mondiales qui mettent les sots et naïfs «goym» à leur merci. La victoire sera d'autant plus facile que les Juifs auront, au préalable, endormi leurs adversaires en leur injectant le poison du libéralisme. »
Les «Protocols» sont-ils authentiques ? Mgr Jouin a longuement étudié la question dans la Préface de la première édi-tion, et il conclut : Le problème des «Protocols» reste donc irrésolu, l'énigme demeure entière, mais cependant une date brille comme un phare dans la nuit : le 10 août 1906, un exemplaire des «Protocols» est entré au British Muséum de Londres où il a été répertorié sous le n° 3926-D17».
Peu importe d'ailleurs que les «Protocols» soient authentiques. M. Jouin n'a jamais demandé à ses amis de croire à leur authenticité. Il suffit qu'ils soient vrais. «Les choses vues ne se prouvent pas. La véracité des «Protocols» nous dis-pense de tout autre argument touchant leur authenticité, elle en est l'irréfragable témoin».
Le résultat de ces études sur la question juive fut la publication du Péril Judéo-Maçonnique, six volumes dans lesquels il s'attache à dévoiler le plan des Juifs alliés à la Maçonnerie. «Ce plan comprend un but : l'hégémonie mondiale ; un moyen : l'or ; un résultat : le supergouvernement juif».
Plan insensé et paradoxal, dira-t-on, conte des Mille et Une Nuits. Comment un peuple de treize millions d'hommes, dispersé et universellement méprisé, peut-il se leurrer d'un tel rêve ?
«Ne concluons pas si précipitamment, répond M. Jouin. D'abord ce rêve talmudique berce les espoirs d'Israël de-puis 2000 ans», et ce paradoxe est presque une réalité.
«On est oblige de constater qu'au triple point de vue de la race, de la nationalité et de la religion, le Juif est deve-nu en général l'ennemi de l'humanité ».
Car la race juive existe toujours, le Juif se gardant bien de mélanger son sang et les rabbins fulminant sévèrement contre les mariages mixtes ; elle ressemble à un fleuve circulant au milieu de l'Océan des peuples sans y mélanger ses eaux. S'autorisant des promesses messianiques qu'elle interprète dans un sens matériel, elle revendique pour elle les ri-chesses de l'univers et la prédominance sur les autres races. Elle est le peuple élu, appelé à la domination universelle et sa littérature apocryphe postérieure au christianisme l'entretient dans cette idée.
«Après les siècles d'esclavage, Jéhovah reprendra ses guerres victorieuses, et le monde sera juif ou n'existera plus». Aussi le Qahal, cette organisation juive, n'a-t-il été organisé que «pour maintenir intacte et isolée la nation juive privée de sa patrie, jusqu'au jour où l'Éternel, par l'intermédiaire du vrai Messie, décidera de donner à Israël l'univer-selle souveraineté».
«Le Messie, dit-il encore, est l'unique raison d'Israël.
«Toute l'histoire du peuple juif : ses gloires et ses revers, ses récompenses et ses châtiments, ses grandeurs et ses décadences, ses espoirs constants dans son inconsistante dispersion, tout cela est d'ordre messianique. Abs-traction faite du Messie, la question juive devient une énigme dont les Juifs eux-mêmes ne peuvent apporter la solu-tion».
L'étude de la Nationalité juive l'amenait à la même conclusion. Car, malgré sa dispersion, la race juive a gardé sa na-tionalité. Cinq siècles avant Jésus-Christ, les colonies juives florissaient déjà sur tous les points de l'univers. Vaincus ou émigrants, par leur génie du commerce, leur soif de richesses, leur activité, elles étaient arrivées à une rapide prospérité. Mais ces «Juifs de la Dispersion» restaient toujours des Juifs, et le lien qui les unissait, c'était la commune attente du Messie auquel semblait attachée la domination du monde. Aussi envoyaient-ils à Jérusalem des délégations et leurs of-frandes pour le Temple.
Mais comment expliquer que, dispersé depuis bientôt deux mille ans, le Temple détruit, «le peuple Juif, l'éternel élu de Dieu, se regarde encore, suivant l'expression de Bernard Lazare, comme le peuple le plus un, le plus stable, le plus im-pénétrable, le plus irréductible ?» L'écrivain juif invoque l'unité religieuse d'Israël. «Mais alors, demande Mgr Jouin, pour-quoi la religion n'a-t-elle pas produit les mêmes effets chez les autres peuples disparus ?»... Les conditions sociales faites aux Juifs dans tous les pays, les contraignant à se grouper dans les ghettos, expliquent-elles ce phénomène ? Pas davantage. «Car les Juiveries ont disparu depuis plus de temps qu'il n'en a fallu pour engloutir les peuples anciens». Les rapports financiers ou commerciaux des Juifs n'expliquent pas davantage la survivance d'Israël, et l'on ne trouve pas là les caractères spécifiques d'une nationalité et, d'autre part, faire appel à la langue reçoit un démenti de l'histoire, quand on sait que les promoteurs eux-mêmes du premier Congrès Sioniste de Bâle, Théodore Herzl et Max Nordau, ignoraient la langue de leurs pères. La solution de l'énigme, d'après M. Bernard Lazare est dans la conscience qu'eurent toujours les Juifs d'être une nation.
«Quand ils quittèrent la Palestine, aux premiers siècles avant l'ère chrétienne, un lien continua de les relier à Jé-rusalem ; lorsque Jérusalem se fut abîmée dans les flammes, ils eurent leurs exilarques, leurs écoles de docteurs, écoles de Babylone, écoles de Palestine, puis écoles d'Egypte, enfin écoles d'Espagne et de France. La chaîne tradi-tionnelle ne fut jamais brisée. Toujours ils se considérèrent comme des exilés et se bercèrent du songe du rétablis-sement du royaume terrestre d'Israël. Tous les ans, à la veille de Pâques, ils psalmodièrent du plus profond de leur être, par trois fois, la phrase consacrée : «l'année prochaine à Jérusalem !» Et, malgré tous leurs malheurs, malgré les esclavages, ils se regardèrent comme le peuple élu, celui qui était supérieur à tous les peuples» (Bernard Lazare, L'Antisémitisme, son Histoire et ses Causes, p. 237).
L'établissement des Juifs en Palestine que préconise et favorise l'Angleterre prisonnière des banquiers juifs, calmera-t-elle, en les fixant, ces appétits de domination ? Mgr Jouin ne le croyait pas. Tout au plus Jérusalem redeviendrait la ca-pitale d'un royaume qui continuera à revendiquer l'univers pour territoire ; tandis que la masse des Juifs, les plus nom-breux et les plus riches, disséminés au milieu des peuples y poursuivront leur œuvre séculaire.
«Sionistes, cosmopolites, tous, enivrés du fol orgueil de leur patriotisme, s'estiment les citoyens d'une race supé-rieure en fonction d'une mission divine qui réalisera leur plan de domination universelle».
L'étude de la religion juive amenait Mgr Jouin à une conclusion identique, si toutefois l'on peut parler de religion chez un peuple qui n'a plus qu'un culte, celui de l'argent et de la puissance. C'est un Juif, M. Bernard Lazare, qui en fait la constatation :
«La plupart ne savent plus l'hébreu ; ils ont oublié le sens des antiques cérémonies ; ils ont transformé le Ju-daïsme rabbinique en un rationalisme religieux ; ils ont délaissé les observances familières, et l'exercice de la religion se réduit pour eux à passer quelques heures par an dans une synagogue en écoutant des hymnes qu'ils n'entendent plus. Ils ne peuvent pas se rattacher à un dogme, à un symbole : ils n'en ont pas... Le Juif n'a plus de foi religieuse, il ne pratique plus, il est irréligieux, il est quelquefois athée».
Chose étrange, remarquait Mgr Jouin, ce peuple qui n'a plus de religion «veut avant tout détruire les peuples catho-liques : la suprématie sociale qu'il ambitionne le condamne à un anticléricalisme militant et formidable». Le conflit qui op-pose les Juifs aux peuples chrétiens est un conflit religieux. Il a pris naissance au Calvaire ; il est, par conséquent, d'ori-gine messianique, et c'est cette dépendance messianique qui fait du peuple juif l'irréconciliable ennemi des peuples chré-tiens». M. Bernard Lazare le reconnaît :
«Le jour où le Juif a occupé une fonction civile, l'Etat chrétien a été en péril... l'entrée des Juifs dans la société a symbolisé la destruction de l'État, de l'État chrétien, bien entendu». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 361)
«Retenons, continue Mgr Jouin, l'action du Juif qui «travaille à son œuvre séculaire : l'anéantissement de la reli-gion du Christ».
Israël enveloppait d'ailleurs dans la même haine ceux de ses fils qui se convertissaient et qui désertaient le combat contre Rome et contre l'étranger.
«Ils devenaient, dit M. Bernard Lazare, des traîtres à la patrie, à la religion juive... C'est contre eux, contre ces an-ti-patriotes, que furent rédigées des formules de malédiction ; les Juifs les mirent au ban de leur société, il fut licite de les tuer, comme il était licite de tuer le meilleur des goïms». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 290)
«Voilà bien le Juif, concluait Mgr Jouin, haineusement antichrétien, d'une haine froide, calculée, absolue... C'est la tare du Juif. Cette sentence de mort du meilleur des goïms vient du Calvaire, où le Juste, le Saint, fut cloué sur une croix. Avec le Juif, il faut revenir, malgré tout, à son déicide».
Mgr Jouin n'avait donc pas tort d'appeler la Judéo-Maçonnerie la Contre-Église. Mais elle est aussi le Contre-État, car sa haine du Christianisme a pour corollaire naturel la haine des institutions des peuples catholiques. Les écrivains juifs ne s'en cachent pas.
«Le moderne judaïsme, dit encore M. Bernard Lazare, prétend n'être plus qu'une confession religieuse ; mais il est encore et en réalité un ethnos, puisqu'il croit l'être, puisqu'il a gardé ses préjugés, son égoïsme et sa vanité de peuple : croyance, préjugés, égoïsme et vanité qui le font apparaître comme étranger aux peuples dans le sein des-quels il subsiste». (Lib. cit. p. 291-293)
Et c'est cette conscience nationale, conclut Mgr Jouin, qui fait de tout Juif, en même temps, et parfois à son insu, un étranger et un révolutionnaire. Les pages suivantes du même écrivain, ajoutait-il, sont trop concluantes pour être abré-gées :
«Quant à leur action et à leur influence dans le socialisme contemporain, elle fut et elle est, on le sait, fort grande. On peut dire que les Juifs sont aux deux pôles de la société contemporaine. Ils ont été parmi les fondateurs du capi-talisme industriel et financier et ils ont protesté avec la plus extrême véhémence contre ce capital. A Rothschild cor-respondent Marx et Lassalle ; au combat pour l'argent, le combat contre l'argent, et le cosmopolitisme de l'agioteur devient l'internationalisme prolétarien et révolutionnaire. C'est Marx qui donna l'impulsion à l'Internationalisme par le Manifeste de 1847, rédigé par lui et il fut l'inspirateur du meeting ouvrier tenu à Londres en 1864, et d'où sortit l'asso-ciation... Beaucoup de Juifs affiliés à l'Internationale jouèrent plus tard un rôle pendant la Commune.
«Quant à l'organisation du parti socialiste, les Juifs y contribuèrent puissamment. Marx et Lassalle en Allemagne, Aaron Libermann et Adler en Autriche, Gompers, Kahn et Lion aux États-Unis, en sont encore les directeurs. Les Juifs russes doivent occuper une place à part dans ce résumé. Les jeunes étudiants participèrent à l'action nihiliste ; quelques-uns - parmi lesquels des femmes - sacrifièrent leur vie à la cause émancipatrice, et à côté de ces médecins et de ces avocats israélites, il faut placer la masse des réfugiés artisans qui ont fondé à Londres et à New York des centres de propagande socialiste et même communiste-anarchiste». (Bernard Lazare, lib. cit. p. 343 et suiv.).
Dans ce tableau de l'histoire révolutionnaire des Juifs, l'écrivain dévoile comment «ils procédèrent idéologiquement et activement, comment ils furent de ceux qui préparent la révolution par la pensée et de ceux qui la traduisent en acte». Car, dit-il, les Juifs, même révolutionnaires, ont gardé l'esprit juif, et s'ils ont abandonné toute religion, ils n'en ont pas moins subi, ataviquement et éducativement, l'influence nationale juive».
Et il en donne «deux bons modèles de la première moitié du dernier siècle : Henri Heine et Karl Marx - Marx, ce des-cendant d'une lignée de rabbins, talmudiste lucide et clair, que n'embarrassaient pas les minuties niaises de la pratique, un talmudiste qui fit de la sociologie et appliqua ses qualités natives d'exégète à la critique de l'économie politique. Il fut animé de ce vieux matérialisme hébraïque qui rêva perpétuellement d'un paradis réalisé sur la terre ; mais il ne fut pas qu'un logicien, il fut aussi un révolté, un agitateur, un âpre polémiste, et il prit son don du sarcasme et de l'invective là où Heine l'avait pris : aux sources juives». Et, après avoir montré le même esprit chez d'autres philosophes ou sociologues israélites, Hess, Robert Blum et d'Israeli, il se demande s'il en est de même de «cette masse qui, actuellement, vient au socialisme ou à l'anarchie».
«Ici, répond-il, il faut distinguer. Les Juifs de Londres, des États-Unis, de Hollande, d'Allemagne acceptent les doctrines révolutionnaires, parce qu'ils sont des prolétaires en lutte avec le capital. Ils ne provoquent pas la révolu-tion, ils y adhèrent, ils la suivent, et cependant ces groupements ouvriers, ayant abandonné toute religion, n'étant plus Juifs au sens religieux du mot, sont Juifs au sens national... Ceux de Londres et des États-Unis, qui ont aban-donné leur pays d'origine, se sont fédérés entre eux, ils ont formé des groupes qui se font représenter aux Congrès ouvriers, sous le nom de «groupes de langue juive». Il en est de même en d'autres contrées, en Hollande, en Galicie, où les Juifs ouvriers nationaux forment des associations nationales. Donc, le Juif prend part à la révolution et il y prend part en tant que Juif, c'est-à-dire en restant Juif» (Bernard Lazare, p. 343).
Et les documents viennent s'accumuler sous la plume du polémiste, notamment une impressionnante nomenclature des noms de tous les personnages composant le personnel soviétique au début du Bolchevisme : «nomenclature qui im-pose cette conclusion que la révolution russe n'est pas autre chose que la prise du pouvoir russe par les Juifs».
La Judéo-Maçonnerie qui est la Contre-Église est donc aussi le Contre-État et, comme conséquence, la destructrice de l'idée de Patrie : le vaillant adversaire des Sociétés Secrètes devait aussi la combattre sur ce terrain.
* * *
Que le Juif, resté Juif, n'ait pas l'idée de la Patrie, cela n'a rien qui doive nous étonner, puisqu'il est lui-même sans pa-trie depuis vingt siècles.
«Pour nous, dit M. P. Leroy, dans un remarquable article de la R.I.S.S. sur Mgr Jouin, (P. Leroy, Mgr Jouin et la Patrie, R.I.S.S., n° du 15 août 1932) la Patrie n'est pas seulement un sol, des usines et des maisons de commerce. Elle groupe sous le symbole d'un nom maternel et vénéré, les traditions spirituelles, les affinements de la culture, les précieux souvenirs et mérites des morts, la fierté des gloires et la mémoire douloureuse des défaites et des sacri-fices». Elle est, comme le disait naguère le cardinal Pacelli, légat du Pape, à M. Charles Pichon, «cet ensemble un peu mystérieux sans doute, mais d'un mystère lumineux, car la Patrie est une des choses pour lesquelles le génie de saint Augustin a trouvé ces belles paroles : «Si vous ne me le demandez pas, je sais ce que c'est ; si vous me le de-mandez, je ne le sais plus». La Patrie, c'est plus qu'une idée, c'est un sentiment.
Le Juif, qui est cosmopolite et s'en fait gloire, ne peut comprendre ce sentiment. De là ces définitions et ces maximes glanées par le Fondateur de la R.I.S.S. dans les plus récents ouvrages de la littérature israélite et commentées par lui dans le Péril Judéo-Maçonnique : Celle-ci, d'abord, du Grand-Rabbin Simon-Lévy :
«Le beau nom de patrie n'appartient donc pas à la terre qui nous a vus naître, mais encore à celle qui nous a pris sous sa protection, qui nous nourrit aujourd'hui de ses produits et nous couvre de l'égide de sa sage législation... L'homme doit savoir se naturaliser dans tous les endroits du globe où on lui octroie ce qui lui est nécessaire pour le déploiement des facultés de son âme. Le cosmopolitisme est une vraie vertu».
Dans ces conditions, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de considérer le Juif comme un étranger. Sa Patrie est là où il se trouve bien».
C'est par centaines qu'on pourrait compter les définitions de la Patrie et du patriotisme qui ont été produites en ces cinquante dernières années. Elles portent toutes l'empreinte juive. Et l'on aboutit à l'articulation des thèses inter-nationalistes d'aujourd'hui, thèses qu'il faudrait nommer plus exactement antinationalistes. L'internationalisme n'est pas, par définition, l'ennemi des nations. Le Catholicisme, par exemple, qui est l'internationale des âmes, est à ce point respectueux des nations qu'il est le plus sûr foyer du patriotisme, même du plus jaloux et du plus fier. C'est la poussée juive qui a donné à l'internationalisme une définition et une portée antipatriotiques» (Paul Courcoural, Les Juifs et la Patrie, Péril Judéo-maçonnique, p. 137 et seq.).
Puis, cette définition d'un certain Jean Marnold : «La patrie comporte avant tout, un acquiescement individuel». Con-clusion : il peut donc cesser, et la patrie disparaître avec lui !
Pour un troisième, «la nation est une association politique engendrée par les circonstances».
Que les circonstances viennent à changer, on pourra donc changer de patrie. On trouve toujours, quand on veut s'évader d'une association, un prétexte suffisant.
Et enfin, pour abréger, cette conclusion piquante, mais combien vraie, de M. André Spire, un Juif cependant, dans son ouvrage : Les Juifs et la Guerre : «Pour donner aux Juifs le droit de citoyen, (c'est-à-dire de vrai fils d'une cité, de véri-table enfant de cette cité de cités qu'est une patrie), - je ne vois qu'un moyen, qui est de leur couper la tête en une nuit, à tous, et de leur en mettre une autre dans laquelle il n'y ait pas une seule idée juive !» (Paul Courcoural, lib. cit p. 146).
Et encore, après leur avoir ainsi changé la tête, faudrait-il leur changer aussi le cœur !
* * *
(à suivre...)
Dernière édition par Hercule le Lun 17 Oct - 8:36, édité 2 fois
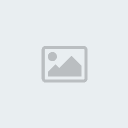
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 9)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932) (Suite)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
* * *
M. Jouin avait une âme de patriote. Mais il aimait d'un même amour l'Église et la France. La France qu'il exaltait dans ses discours, dans sa Clotilde et sa Jeanne d'Arc, c'était la France baptisée avec Clovis, son premier roi, taillant de son épée un royaume pour le Pape avec Charlemagne, volant à la délivrance des lieux saints avec les Croisés et saint Louis, boutant avec Jeanne d'Arc l'étranger hors du pays pour le préserver de l'hérésie protestante, combattant avec la Ligue contre Luther et Calvin, livrant enfin en Vendée des combats de géants pour sauver sa foi, ses prêtres et son roi très chrétien.
En 1914, s'il l'avait pu, il serait parti avec nos soldats pour la défendre, comme en 1870 l'avait fait son frère, le R.P. Jouin. Mais, (comme son père relevant les blessés sur les barricades de 1830), il ne pouvait que se pencher sur les vic-times françaises de la guerre et il leur ouvrit son ambulance. Il mettait en acte les paroles qu'il adressait à ses juges huit ans auparavant :
...«Après les efforts coalisés de l'internationalisme, de l'hervéisme et de l’antimilitarisme, lorsque, demain peut-être, ces doctrines auront fait leur œuvre révolutionnaire de destruction et d'anarchie, c'est encore dans le cœur des prêtres français que vous retrouverez immaculés l'image et l'amour de la patrie !»
Mais la Patrie n'a pas que les ennemis du dehors à combattre ; à côté de ceux qui veulent s'emparer de son sol, il y a ceux qui, à l'intérieur, comme en 1793, la livrent aux forces révolutionnaires pour la livrer aux ennemis de l'Église ; ceux qui, aujourd'hui, par l'avènement du socialisme, ne rêvent d'unir toutes les patries que pour les détruire toutes. Juifs, Ma-çons, socialistes se rencontrent en effet dans une commune profession d'internationalisme, pour aboutir au même terme : la destruction de la Patrie et du patriotisme.
Hérésie nationale et, en même temps, doctrine anticatholique dont Mgr Jouin démasquait l'origine : les faux principes de la Révolution et de la Terreur.
«Le décret de guerre de l'Assemblée législative du 20 avril 1792, annonçant «la fin des guerres de conquêtes», - {car la guerre présente n'est point une guerre de nation à nation, mais la juste défense d'un peuple libre contre l'injuste agression d'un roi) - aussi bien que les principes révolutionnaires de la Constitution de 1791 ou de la Consti-tuante de 1790 proclamant la paix universelle et faisant appel au monde par ce cri révolutionnaire : «que toutes les nations soient libres comme nous, et il n'y aura plus de guerres ; sauf pour réduire ceux-là seuls qui se ligueront contre la liberté (de la Révolution), - était au fond un appel à la guerre civile et à la désertion, puisque par ce même décret, la Révolution française «adoptait d'avance tous les étrangers qui, abjurant la cause de ses ennemis, viendront se ranger sous ses drapeaux, et favorisait même par tous les moyens leur établissement en France, «car tous les hommes sont frères». (E. JOUIN, La Grande Révolution - Juifs et Maçons)
De nos jours, socialistes et communistes abolissent aussi la guerre. Ils n'ont plus de balles, eux aussi, que pour les généraux et les bourgeois.
Comme tous les esprits avertis, Mgr Jouin voyait le piège caché sous ces théories humanitaires et ces déclarations de paix au monde. II montrait le Congrès de la Paix de 1869 aboutissant à l'invasion allemande de 1870. Pour lui, pacifisme, désarmement, défaitisme étaient synonymes de trahison.
Que des Juifs et des Maçons travaillent à la destruction de la Patrie, c'est leur rôle. Mais que des Français, des Catho-liques, fassent chorus avec eux, empruntent leur langage et jusqu'à leurs idées, prêchent en France le désarmement, le pacifisme et même le défaitisme, c'est ce qu'il ne pouvait comprendre. Aussi, après avoir rapporté les paroles du lieute-nant Mornet, patriote assurément, mais imbu des idées Franc-maçonnes de la Grande Loge, qui déclarait au procès du Bonnet Rouge : «La pensée, si abominable, si défaitiste fût-elle, si on se contente de l’exprimer, reste en dehors des at-teintes de la loi pénale», il ajoutait douloureusement :
«Ainsi, la raison du défaitiste lui enjoint de ne pas défendre la Patrie, et sa pensée, sous l'estampille du Gouver-nement, peut à loisir prêcher à ceux qui se font tuer la désertion, la révolte et la guerre civile : ce fut la semence jetée à tout vent, de 1914 à la fin de 1916, et qui fit germer 1917 avec les mutineries en France et le Bolchevisme en Rus-sie».
«Dites maintenant, si vous l'osez, qu'il n'y a rien à craindre, et qu'il est digne du libéralisme français de laisser im-punément les pacifistes nous intoxiquer d'un internationalisme humanitaire en paternité d'un défaitisme de trahison !» (RISS, 1927, p. 903).
Et encore :
«En résumé, le pacifisme est l'utopie du désarmement. La fraternité des peuples en fait infailliblement des frères ennemis... le désarmement est l'hypocrite trahison de la Patrie».
Mais quelles n'étaient pas son indignation et sa douleur quand, sous des plumes françaises, il lisait des blasphèmes comme ces lignes de L'Ame Populaire, journal du Sillon catholique : «Idole, la Patrie qui déchaîne les haines stupides... Monstre aux cent bras qui prend les vies et les dévore. Vocable de réunion publique qui retentit comme une cymbale creuse. Patrie, honneur, gloire, victoire ! ... «Quelle honte, s'écriait-il, pour des Français, sous le pavillon du démocra-tisme chrétien, d'écrire de telles infamies, inspirées par la Judéo-Maçonnerie, afin de nous livrer à la Révolution sociale et à l'Allemagne luthérienne !»
Et quelle humiliation quand il était contraint d'enregistrer les cris de joie du citoyen Lhéveder, chef du socialisme révo-lutionnaire dans la Bretagne méridionale !
«Les abbés Mancel et Trochu travaillent pour nous. Au jour de l'avènement du socialisme, qui ne saurait être très éloigné, nous aurons à remercier les abbés sillonistes qui, en éveillant les paysans aux idées nouvelles, auront rap-proché l'heure où l'armée des paysans, des ouvriers et des travailleurs intellectuels réalisera la révolution sociale».
Langage qui, disait-il, faisait écho à l'apostrophe du communiste Florimond Bonté, rédacteur en chef de L'Enchaîné, ancien démocrate, dans une réunion tenue à Lille par le parti démo-populaire chrétien :
«Nous ne vous combattrons pas ; vous nous êtes trop utiles. Si vous voulez savoir quelle besogne vous accom-plissez, regardez-moi. Je sors de chez vous. Avant la guerre, j'étais un des vôtres. Depuis, je suis allé jusqu'à la con-clusion logique des principes que vous m'avez enseignés. Grâce à vous, le communisme pénètre là où vous ne lais-seriez pas entrer ses hommes : dans vos écoles, vos patronages, vos cercles d'études et vos syndicats. Tout ce que vous croirez faire pour votre démocratie cléricale, c'est pour la révolution communiste que vous le ferez... Vous faites le lit du communisme». (Le Petit Démocrate, 27 avril 1927).
Devant une telle aberration, les journaux maçonniques ne pouvaient retenir leur étonnement :
«Le plus stupéfiant, lisait-on dans la Nation du 14 juillet 1928, est qu'un groupe de Rose-Croix fait des démarches auprès de personnalités catholiques et à tendances démocrates pour constituer, grâce à leur concours, un groupe de «conservation sociale» dont la principale raison d'être sera la soumission à la haute direction occulte du Grand Orient de France».
«Les gens qui auront donné dans le panneau ne s'en douteront pas, et les Loges pourront, en toute sécurité, exercer leur malfaisance et leur sectarisme».
Ainsi, concluait Mgr Jouin,
«La révolution sociale et communiste préparée par des catholiques dans l'Ouest, dans le Nord et dans l'Est, par la collusion des syndicats chrétiens et des syndicats révolutionnaires, au point que Mgr Ruch a dû en prononcer la con-damnation dans une lettre immédiatement approuvée par le Saint Père, quel signe des temps et des ravages de la Judéo-Maçonnerie blanche !»
Depuis ce jour, d'autres voix d'évêques se sont fait entendre pour rappeler à ceux qui paraissaient l'avoir oublié, que le patriotisme est une vertu dont le Christ Lui-même nous a donné l'exemple, que le désarmement en face de voisins qui s'arment est une folie ou un crime, et que le défaitisme est une trahison : «Nous savons ce qu'il en coûte de n'être pas prêts», disait naguère Mgr Baudrillart ; et à ceux qui se réclamaient faussement du Pape pour légitimer un criminel paci-fisme, le cardinal Pacelli, Secrétaire d'État, légat du Souverain Pontife aux fêtes de Lourdes, déclarait que s'il y a «un pa-triotisme faux qui fait de la Patrie une sorte d'idole barbare assoiffée de tyrannie et de sang», il y aussi le vrai patriotisme, celui que le Saint Père rappelait en termes magnifiques à plusieurs centaines de vos jeunes gens patriotes».
Mgr Jouin avait-il tort de dénoncer dans cet obscurcissement de l'idée de patrie une pénétration de la Maçonnerie et d'en signaler le danger à ses lecteurs ? Le plus ardent propagandiste de ces rêveries humanitaires n'était-il pas «l'auteur de la loi du 9 décembre 1905, - «loi non de séparation, a dit Pie X, mais d'oppression, contre laquelle il faut lutter avec persévérance ?» C'était celui qui abolit les fondations pieuses en 1908 ; celui qui, la même année, convertissait, au bout de trois ans, la séparation de corps en divorce ; celui qui, en 1929, déclarait que les lois de laïcité sont une assise fon-damentale de la République ; M. Briand, dont Mgr Jouin avait prouvé l'affiliation à la Franc-Maçonnerie, M. Briand, l'apôtre maçonnique de la laïcité», devenu maintenant le pèlerin de la paix. Les révélations des Mémoires de Streseman, se vantant d'avoir roulé le ministre français, et les déclarations belliqueuses de l'Allemagne réarmée sont venues souffler sur ces chimères pacifistes. Aujourd'hui, des écrivains, des historiens de valeur répètent le cri d'alarme poussé par le prêtre patriote : c'est M. Jean Guiraud qui nous montre la Maçonnerie tour à tour bonapartiste sous l'Empire, internationa-liste et laïque avec Ferry et Gambetta, puis aujourd'hui socialiste. Le socialisme allié au communisme se prépare à don-ner l'assaut à la société, comme il fut donné à l'édifice vermoulu de l'Ancien Régime quand la Révolution le renversa.
«L'histoire recommence !», dit l’éminent historien, et il montre une des causes de faiblesse de l'Ancien Régime dans sa facilité à se laisser pénétrer par les idées qui devaient le faire sauter. Les privilégiés et les grands seigneurs se fai-saient affilier à la Maçonnerie. La Princesse de Lamballe, celle dont les révolutionnaires de la rue devaient un jour dépe-cer le corps et manger le cœur, était à la tête de la Franc-Maçonnerie féminine. «Et quand la Révolution s'ouvrit, avec quel empressement le bas-clergé s'unit aux révolutionnaires qui, croyait-il, allaient faire renaître les mœurs idylliques et fraternelles de l'Église primitive ! Et comme on saluait la rénovation de la société par la «liberté chérie» en ces messes solennelles où les officiants ajoutaient aux ornements liturgiques une ceinture tricolore ! Et, trois ans après, le curé Pinot, d'Angers, montait à la guillotine revêtu de l'aube et de la chasuble pour expier le crime d'avoir dit la Messe ! Que de braves gens, se comptant par milliers, furent exclus du temps par la guillotine, pour avoir voulu être de leur temps, en partageant et en favorisant ses utopies et ses erreurs».
L'histoire recommence ! Et, comme Mgr Jouin, M. Jean Guiraud a raison d'être effrayé «de voir avec quelle facilité quantité de braves gens et même de catholiques se laissent aller aux mêmes illusions. Non contents de dénoncer, comme il convient, les abus de notre société, ils se félicitent eux-mêmes de sa prochaine disparition, acceptent le prin-cipe de son mal au lieu de le poursuivre de toutes leurs forces : et ce mal est le laïcisme.
«Ils essayent d'une conciliation avec lui en oubliant qu'entre la doctrine chrétienne et la laïcité existe une radicale et inconciliable opposition».
L'adversaire des Sociétés secrètes ne disait pas autre chose. Mais le péril judéo-maçonnique qu'il ne cessait de dé-noncer et qui effraie aujourd'hui tous les esprits clairvoyants, n'est pas inéluctable. Le plan maçonnique est en marche. Il n'est pas fatal. Il faut lui barrer la route et jusqu'à son dernier souffle, dans ses écrits comme dans les discours qu'il pro-nonçait aux congrès de la Ligue, Mgr Jouin exhortait ses troupes à s'unir et à lutter. Sans doute les puissances maçon-niques, disait-il, ont l'or qui achète les consciences, la presse qui corrompt les idées, le pouvoir qui tyrannise, qu'importe ? Que les catholiques s'unissent. «Soyez donc avec nous, répétait-il, contre la Franc-Maçonnerie dorée, plus particuliè-rement celle des Juifs et de la finance. Unissez-vous pour l'étudier et la combattre». Faire l'union, constituer une armée, être un groupe, une association, une idée, une force, une race toujours sur pied de guerre, soulevant la France, l'Europe, le monde, tel était son idéal.
«Soyez avec nous contre la Maçonnerie rouge, celle qui a fait la Terreur et la Commune, qui triomphe aujourd'hui en Russie et au Mexique et qui en attendant la guillotine sanglante nous a préparé la guillotine sèche, la persécution savante et légale par le filet inextricable des lois, des décrets, des arrêtés, depuis l'article 7 de Ferry jusqu'à l'école unique d'Herriot».
«Soyez avec nous enfin contre la Maçonnerie blanche, l'invasion des Judéo-Maçons dans nos rangs, loups vêtus de peaux de brebis, qui s'introduisent dans le bercail, parmi les meilleurs catholiques et les meilleurs Français...
«De quelque nom que vous l'appeliez, la Maçonnerie est l'ennemie qui mobilise toutes les forces du mal, toutes les hérésies, toutes les révolutions, toutes les trahisons. Son chef suprême est Satan, et son but, la destruction de la France».
«Eh bien, s'écriait-il, jurons ce soir 28 novembre 1928, que cela ne sera pas !»
L'Apôtre de cette nouvelle croisade n'avait rien d'ailleurs d'un antisémite. «Le cœur de ce prêtre était imperméable à la haine». Il ne prêchait pas l'extermination des Juifs et des Maçons, pas plus qu'il n'espérait leur conversion, ni l'assa-gissement des communistes.
«Les groupements nationalistes, fascistes ou autres sont impuissants par eux-mêmes à guérir le mal. La guerre est religieuse. Notre conversion est l'unique remède... Et cette conversion, il faut l'opérer en enlevant le libéralisme qui amène la décomposition du sang, raviver les convictions anémiées, réapprendre les formules de la foi catholique et leur rendre leur place dans le langage et la conscience.
«Il faut étouffer ce libéralisme à teinte d'Américanisme, condamné par Léon XIII, qui réduit la religion à des œuvres sociales tout extérieures - ce libéralisme à teinte de modernisme, condamné par Pie X, erreur qui enclot la religion dans la prison de la conscience - ce libéralisme à teinte de laïcisme condamné par Pie XI...» et il sonnait la charge contre ces pernicieuses erreurs, conjurant ses adhérents de soutenir la Revue - menacée de disparaître faute de ressources et dont il supportait presque seul le poids - de recruter de nouveaux Ligueurs et d'assurer l'existence de l'Institut pour la pérennité de l'entreprise.
Que les adversaires auxquels depuis vingt ans il portait de si rudes coups lui aient gardé une haine irréductible et qu'après sa mort ils aient tenté d'anéantir l'œuvre en jetant la calomnie sur son auteur, cela n'a rien qui doive nous sur-prendre et ne pouvait l'effrayer. «Vous avez combattu non sans péril pour votre vie», lui écrivait Benoît XV, dans le Bref où il l'élevait à la prélature.
Mais dans le camp des catholiques, de la part de ceux qu'il rangeait dans la Franc-Maçonnerie blanche, dans le clan de la démocratie chrétienne, que la plume peut-être trop mordante de l'un de ses collaborateurs ne ménageait guère, il rencontrait aussi d'ardentes oppositions.
Ennemi acharné du libéralisme, convaincu que le socialisme est un danger mortel pour la société, il signalait impi-toyablement tout ce qui, dans la presse ou dans l'organisation des groupements nouveaux des jeunes catholiques, lui pa-raissait d'origine protestante, un oubli de la vérité et de la morale traditionnelles, ou une concession aux erreurs condam-nées.
Plusieurs évêques partageaient ses appréhensions, et il n'est pas téméraire de penser que c'est aux critiques de sa Revue que ces groupements doivent d'avoir évité l'écueil vers lequel ils semblaient entraînés .
Du reste, intransigeant pour les idées, il était bienveillant pour les personnes. Au lendemain de sa mort, le plus tou-chant hommage de reconnaissance lui fut apporté par un groupe de jeunes scouts dont il avait autorisé la création dans son Patronage, confiant dans l'orthodoxie du prêtre qui le dirigeait.
On le représentait comme un esprit affaibli, hanté par le spectre de la Franc-Maçonnerie, comme un vieillard attardé à des idées surannées :
«Il me souvient, raconte un de ses collaborateurs aujourd'hui disparu, d'avoir été abordé, au cours d'une de ses conférences aux Centraux, par un jeune vicaire parisien, tout étonné d'entendre cette parole unie mais si claire et si ferme, tenir en haleine une heure durant un brillant auditoire. On l'avait adressé là plutôt pour se moquer, et il s'indi-gnait à présent des calomnies qu'on lui avait soufflées à l'oreille dans certains milieux :
- Comment I c'est bien lui ?... Mais on m'avait dit qu'il n'était plus qu'une ruine.
- Écoutez jusqu'au bout, Monsieur l'Abbé, et vous jugerez». Cet auditeur d'un soir devint l'un des meilleurs amis de l'œuvre ; et combien d'autres ont été conquis comme lui en l'espace de quelques mois par le spectacle de cette âme si énergiquement maîtresse, jusqu'au bout, du corps qu'elle animait».
D'autres, et parmi eux des amis, lui battaient froid et se détournaient de lui. Mais lui, résolu, continuait sa marche et poursuivait la lutte commencée et dans laquelle le retenaient ses convictions et les encouragements de Rome.
«Nous savons, lui écrivait Benoît XV, que vous vous acquittez de votre ministère sacré d'une manière exemplaire, que vous avez la plus vive sollicitude du salut éternel des fidèles et que vous avez affirmé avec constance et avec courage les droits de l'Église catholique - non sans péril pour votre vie - contre les sectes ennemies de la religion, en-fin que vous n'épargnez rien, ni labeurs, ni dépenses, pour répandre dans le public vos ouvrages sur ces matières». (Bref du 23 Mars 1918)
Un an plus tard, le cardinal Gasparri, Secrétaire d'État, en lui transmettant l'agrément du Souverain Pontife pour son étude sur la Guerre Maçonnique, lui écrivait :
«C'est avec raison que dans ce travail vous avez pris soin de mettre en lumière, par des documents et des rai-sonnements irréfutables, la doctrine inepte et essentiellement anticatholique de la Franc-Maçonnerie, doctrine issue du déisme, né lui-même de la Réforme, doctrine aboutissant fatalement, comme on le voit aujourd'hui, à la négation même de Dieu, à l'athéisme social, au «laïcisme», forme actuelle de cette impiété qui, au grand détriment des peuples, prétend bannir des sociétés toute trace de religion et toute intervention de l'Église.
«Vous avez eu soin tout particulièrement de faire ressortir, en dépit des mensonges qui trompent parfois les ca-tholiques eux-mêmes, l'identité de la Franc-Maçonnerie avec elle-même, partout et toujours, comme la continuité du plan des sectes, dont le dessein est bien la ruine de l'Église catholique.
«Sa Sainteté se plaît donc à vous féliciter et à vous encourager dans vos travaux, dont l'influence peut être si fé-conde pour mettre en garde les fidèles et les aider à lutter efficacement contre ce qui tend à détruire l'ordre social aussi bien que la religion».
Et lui-même aimait à se rappeler les encouragements de Pie XI dans une audience privée du 16 novembre 1923 : «Continuez votre Revue, malgré vos difficultés d'argent, vous combattez notre mortelle ennemie».
Enfin, quelques mois à peine avant sa mort, il recevait d'un éminent personnage de Rome ces lignes qui furent sa su-prême justification : «Vous ne savez pas combien on parle souvent ici de vous, et l'on se demande si ce n'est pas vous qui aviez raison... Ce qui arrive, ce qu'on voit, depuis longtemps vous l'aviez prévu...»
Fort de ces encouragements, il lutta jusqu'au bout, sans défaillance, réservant sa haine pour le mal et pour celui qui l'inspire ici-bas : le démon.
* * *
Au lendemain de la mort de Mgr Jouin, un journal parisien, reprochait à la Revue Internationale des Sociétés Secrètes et à son Fondateur d'avoir accueilli les fables stupides de Taxil-Jogand et du Docteur Hacks-Bataille dans Le Diable au XIXe Siècle.
«Comment l'aurait-elle fait, n'étant pas encore née ?» répondit alors un ancien collaborateur de Mgr Jouin. Bien mieux, la Revue a longtemps répudié de la manière la plus explicite, tout anti-maçonnisme du même acabit».
«Et c'est justement parce que, jusqu'à ce jour, écrivait Charles Nicoullaud en 1914, les anti-maçons ont négligé cette étude (de l'occultisme et de la mystique) qu'à un moment donné ce farceur de Léo Taxil a pu surprendre la bonne foi de nombreux catholiques adversaires de la secte. Mais si, à défaut de théologien dans les groupements anti-maçonniques de l'époque, ils s'étaient donné la peine de consulter des hommes comme le chanoine Ribet, l'ab-bé Saudreau, le P. Ludovic de Besse, le P. Poulain, etc., pour ne nommer que des maîtres, ceux-ci n'auraient pas été dupes cinq minutes de la prétendue palladiste Diana Vaughan ou du diable Bitru apparaissant sous la forme d'un crocodile pour jouer du piano dans les arrière-loges. Il faut une dose de naïveté incommensurable pour croire à de pareilles billevesées».
Mgr Jouin se rappelait sa tentative de Fédération des ligues antimaçonniques et son échec devant leur étrange refus de découvrir et de nommer l'influence satanique dans l'inspiration et la direction occulte du mouvement maçonnique. Il n'en affirmait pas moins son point de vue. Dès le premier article de la R.I.S.S. de janvier 1913, il avait mis au point la question de l'action satanique dans les sociétés secrètes grâce à une heureuse formule à laquelle on ne peut que sous-crire :
«Je n'admets pas pour ma part l'action directe du démon dans le gouvernement maçonnique ; mais je comprends que l'étude des initiations incline l'esprit vers cette solution mystique à laquelle les hauts faits de la Maçonnerie mo-derne apportent une apparente confirmation... Il semble bien qu'on a quelque droit de conclure (après ces faits) qu'elle (la Maçonnerie) a pour chef Satan lui-même, et que Léon XIII qui assimile la Maçonnerie au règne du démon, Saint-Martin, Boehme, Swedenborg, et même Stanislas de Guaita et Doinel, qui parlent de communication directe avec Satan, ne font qu'appuyer cette conclusion de leur autorité ou de leur expérience. J'oppose simplement à cette solution l'ordre providentiel d'après lequel, tout, en ce monde, relève d'un pouvoir humain ; et de même que le Christ, chef invisible de l'Église catholique, est représenté visiblement ici-bas par le Pape, de même, j'estime que Satan, chef invisible de l'armée du mal, ne commande à ses soldats que par des hommes, ses suppôts, ses âmes damnées si vous voulez, toujours libres cependant de se soustraire à ses ordres et à ses inspirations».
De là deux principes directeurs :
1° II n'est guère possible que, par une sorte de monstrueuse supériorité sur l'Église du Christ, il soit permis à Satan de se faire le chef visible de la Contre-Église, pour une régie directe, permanente et sensible.
2° Mais il est seulement probable que, perpétuel singe de Dieu, Satan s'efforce de tout son pouvoir, d'assister en quelque sorte ses antipapes, d'animer le gros de ses adeptes d'une espèce de grâce satanique attachée à ce simulacre des sacrements que sont les initiations.
Mgr Jouin se défendait d'ailleurs contre l'accusation plus ou moins sincère de M. Copin-Albancelli, de détourner ainsi l'attention des catholiques vers une certaine mystique qui tend à chercher uniquement dans le monde astral ou infernal, les chefs des sociétés secrètes et en particulier de la Franc- Maçonnerie, et de tourner les esprits vers des sujets qui sont sans utilité pratique dans la formidable lutte actuellement engagée :
«Je serais curieux de savoir ce que M. Copin-Albancelli trouve à reprendre dans cette doctrine qui, encore une fois, est celle de la Revue. Il me semble que je fais la part assez large aux «éléments humains»... Mais je réserve aussi la part du démon parce qu'elle existe, qu'elle nous est enseignée par les Papes et que la Franc-Maçonnerie se-rait, sans elle, une énigme inexplicable. N'en déplaise aux tenants de l'opinion contraire, le diable, au moment de l'ini-tiation maçonnique, a une emprise particulière sur celui-là même qui ne croit pas en lui ; emprise qui le constitue son soldat et peut se comparer, toute mesure gardée, au caractère sacramentel de la confirmation. De plus, ce caractère satanique n'est pas effacé par la simple sortie de la secte, mais uniquement par l'absolution qui relève le Maçon de son excommunication. Ces vérités sont absolument nécessaires à connaître, surtout aux anti-maçons ; on les oublie trop facilement aujourd'hui, où deux siècles de Maçonnerie ont détruit les croyances surnaturelles les plus fondamen-tales, principalement en ce qui touche au démon, à son action sur les âmes et jusqu'à son enfer éternel qu'on vou-drait rayer du Credo catholique. Il est salutaire à la cause antimaçonnique de pénétrer un peu dans «ce monde infer-nal».
Accusé de «distraire les combattants en leur suggérant que la seule chose vraiment intéressante dans la question maçonnique, c'est d'y découvrir les griffes, les cornes ou la queue du diable», il justifiait sa tactique par les encourage-ments venus de Rome, et il terminait ainsi la controverse :
«Nous formons des vœux pour le succès des autres ligues : nous espérons, et nos applaudissements seront la preuve de notre sincérité, que «la Bastille» découvrira le «Pouvoir Occulte», mais, eût-elle amené au grand jour l’Anti-Pape lui-même, que tout ne serait pas dit, il y a, il y aura toujours derrière lui le diable «avec ses cornes, ses griffes et sa queue» si M. Copin-Albancelli y tient, avec son monde non pas «astral», mais «infernal», et surtout avec sa terrible puissance dont les catholiques ne seront délivrés qu'en combattant avec le Christ et Son Église».
N'en déplaise donc à M. Brenier, à M. Copin-Albancelli et à certains catholiques qui semblaient avoir oublié l'Évangile, il était parfaitement permis à un prêtre chargé d'ans et mûri par l'expérience des âmes, et qui, dans les cas difficiles, sa-vait prendre conseil de théologiens compétents, de rester préoccupé de la partie la plus délicate du problème, à savoir : jusqu'où - dans quelles conditions - sous quelle forme s'exerce, ou non, au jour le jour, au moins sur certains initiés, l'ac-tion de Satan en vue du gouvernement de la Contre-Église. Et il semble bien que sur ce point la pensée de Mgr Jouin a un peu évolué.
Tout à la joie d'avoir trouvé le Juif derrière le voile des Loges, il en avait dévoilé la malfaisance envers la chrétienté. Mais dans les dernières années, il penchait de plus en plus à admettre par surcroît, derrière le Juif et le Maçon, l'interven-tion plus ou moins saisissable de Lucifer.
Sans doute, disait-il, il y a un ordre habituel de la Providence qui ne souffre qu'à titre d'exception les phénomènes dé-moniaques aussi bien que les autres manifestations surnaturelles ; mais il s'agit précisément ici de communications très particulières, réservées à un milieu excessivement restreint de personnages voués à la haine de l'Église. Pourquoi con-testerait-on plus volontiers ces prises de contact entre le Prince des ténèbres et ses adorateurs, que tant d'autres cas de possession non moins mystérieux et moins provoqués que l'Église semble parfaitement admettre ?
Si l’on croit aux possédés de l'Évangile, à la Tentation au désert, aux avis de Saint Paul sur les esprits de l'air, aux exorcismes rituels, à l'existence dogmatique en un mot de l'enfer et du démon, disait un collaborateur de Mgr Jouin, pourquoi s'étonner et se scandaliser dès que l'on parle d'une action quelconque, réelle, immédiate sur la vie de chaque jour ?
Qu'un libre penseur impénitent, comme M. Copin-Albancelli, veuille à tout prix trouver ailleurs qu'en enfer la souve-raine autorité maçonnique, c'est tout naturel, mais du côté catholique un ignorant peut seul trouver mauvais qu'un Curé de Saint-Augustin incline à admettre en dernière analyse, du côté du démon, - avec toutes sortes de nuances - la solution discutable, mais fort sérieuse, d'une grosse énigme.
Avant lui d'ailleurs, Mgr Fava avait jeté le cri d'alarme et soutenu cette thèse de l'influence satanique dans les Loges ; on la trouve exposée dans la plupart des classiques de l'anti-maçonnisme, et le savant Jésuite, Mgr Meurin, était allé dans cette voie aussi loin et plus loin que n'est jamais allé Mgr Jouin.
N'est-ce pas d'ailleurs Léon XIII qui déclarait que, dans un plan si criminel (celui de vouloir détruire la religion) pour ramener parmi nous, après dix-huit siècles, les mœurs païennes «il est bien permis de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ... Nous refusons d'obéir à des maîtres qui s'appellent Satan et les mau-vaises passions ?»
Enfin, ne lisait-il pas, dans la littérature maçonnique, les pages consacrées à la religion nouvelle, «la plus belle de toutes», d'après Le Travailleur communiste de Gien ?
Cette religion, elle avait ses pontifes : Pike et Lemmi, son successeur - sa révélation, son dogme et ses miracles, (ceux de la Science) que célébrait Eugène Pelletan dans la Profession de foi d'un enfant du XIXe siècle - sa morale, ré-sumée dans la haine de Dieu et le déchaînement des passions - sa liturgie et son droit canonique, rédigés par Pike, Reuss et Crowley - ses hymnes à la gloire de Satan et ses blasphèmes contre Dieu - ses adeptes enfin, «qui deviennent ainsi, à leur insu peut-être, les sujets du démon» et ses adorateurs.
Mais, dira-t-on, ces adorateurs sataniques sont rares.
«Moins que l'on ne pense», répondait Mgr Jouin. Et il citait le témoignage d'une foule de prêtres qui ont eu des rap-ports avec des voleuses d'hosties destinées aux profanations sacrilèges, et celui de son expérience personnelle : «Pour-quoi, disait-il à l'une d'elles qu'il avait vue plusieurs fois, les Maçons t'envoient-ils voler des hosties, puisqu'ils ont, hélas ! des prêtres apostats ?» Et l'enfant lui avait fait instantanément cette réponse : «Ils ont peur qu'ils ne consacrent pas !»
* * *
Ainsi, dès le premier jour, parallèlement à la lutte antimaçonnique, Mgr Jouin fut-il amené à cette conviction, qu'il était nécessaire de mettre à l'étude toutes les questions relatives aux doctrines et pratiques occultistes.
Dévoiler l'occultisme, avec ses initiations, ses mystères et ses conséquences morales pour l'homme qui, librement, se soumet à l'Esprit du Mal... le suivre à travers ses manifestations cabalistes, magiques ou autres, et le symbolisme des théories cosmogoniques... parcourir l'histoire de l'ésotérisme, remplaçant Dieu par le «Progrès», et présentant à ses adeptes «l'Idole Science» ; puis, après l'écroulement de cette divinité et le débordement du matérialisme, leur tendant le piège de la théosophie, du spiritisme, et des religions orientales, destinées à supplanter l'Église ; mettre enfin l'esprit du chrétien en garde contre certains mots destinés à le familiariser avec l'erreur, tel fut le motif qui détermina Mgr Jouin à créer une revue spécialisée : Revue distincte de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, et qu'on ne pourrait ré-pandre sans discernement, parce que, si la Judéo-Maçonnerie est sans patrie, elle est aussi sans Dieu et sans mœurs, - revue qui réclamait des collaborateurs compétents, libres de leur temps pour des recherches laborieuses, orientant cha-cun leurs travaux, d'après leurs aptitudes intellectuelles et leur formation scientifique : «Quand même, disait-il, sur cer-tains points, leurs conclusions ne seraient pas identiques, la vérité jaillira de ce chaos, de ce choc de documents et d'idées».
Sans renoncer à se placer, suivant l'opportunité, au point de vue expressément théologique, son dessein n'était point de faire surtout œuvre dogmatique... son ambition n'était que de fournir au public compétent une série de documents et d'expériences qui pût asseoir dans les esprits un jugement éclairé, large et sûr. «Les vérités catholiques étant inconnues des adeptes des sciences maudites, il serait vain de chercher à les convaincre en s'appuyant à priori sur ces postulats».
Telles sont les directives que le Fondateur de la R.I.S.S. donnait à ses collaborateurs de la Revue occultiste, lorsqu'en 1928, il sépara de nouveau la «Revue Rose», de la R.I.S.S. - directives - que tous, «pareillement unis à Mgr Jouin, par une foi très sûre, ont toujours suivies sous sa surveillance et sa garantie».
En publiant sa Revue Occultiste, Mgr Jouin n'ignorait pas les dangers auxquels il s'exposait. Il l'avait dit :
«Malheur à qui ose toucher à cette corde sensible de la Secte. C'est alors que se déchaîne contre les audacieux qui osent dénoncer l'intervention de Satan une de ces rafales qui emportent tout. Toute dénonciation sérieuse du sa-tanisme des Hautes Loges a été presque immédiatement suivie d'une catastrophe pour ses auteurs».
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 9)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932) (Suite)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
* * *
M. Jouin avait une âme de patriote. Mais il aimait d'un même amour l'Église et la France. La France qu'il exaltait dans ses discours, dans sa Clotilde et sa Jeanne d'Arc, c'était la France baptisée avec Clovis, son premier roi, taillant de son épée un royaume pour le Pape avec Charlemagne, volant à la délivrance des lieux saints avec les Croisés et saint Louis, boutant avec Jeanne d'Arc l'étranger hors du pays pour le préserver de l'hérésie protestante, combattant avec la Ligue contre Luther et Calvin, livrant enfin en Vendée des combats de géants pour sauver sa foi, ses prêtres et son roi très chrétien.
En 1914, s'il l'avait pu, il serait parti avec nos soldats pour la défendre, comme en 1870 l'avait fait son frère, le R.P. Jouin. Mais, (comme son père relevant les blessés sur les barricades de 1830), il ne pouvait que se pencher sur les vic-times françaises de la guerre et il leur ouvrit son ambulance. Il mettait en acte les paroles qu'il adressait à ses juges huit ans auparavant :
...«Après les efforts coalisés de l'internationalisme, de l'hervéisme et de l’antimilitarisme, lorsque, demain peut-être, ces doctrines auront fait leur œuvre révolutionnaire de destruction et d'anarchie, c'est encore dans le cœur des prêtres français que vous retrouverez immaculés l'image et l'amour de la patrie !»
Mais la Patrie n'a pas que les ennemis du dehors à combattre ; à côté de ceux qui veulent s'emparer de son sol, il y a ceux qui, à l'intérieur, comme en 1793, la livrent aux forces révolutionnaires pour la livrer aux ennemis de l'Église ; ceux qui, aujourd'hui, par l'avènement du socialisme, ne rêvent d'unir toutes les patries que pour les détruire toutes. Juifs, Ma-çons, socialistes se rencontrent en effet dans une commune profession d'internationalisme, pour aboutir au même terme : la destruction de la Patrie et du patriotisme.
Hérésie nationale et, en même temps, doctrine anticatholique dont Mgr Jouin démasquait l'origine : les faux principes de la Révolution et de la Terreur.
«Le décret de guerre de l'Assemblée législative du 20 avril 1792, annonçant «la fin des guerres de conquêtes», - {car la guerre présente n'est point une guerre de nation à nation, mais la juste défense d'un peuple libre contre l'injuste agression d'un roi) - aussi bien que les principes révolutionnaires de la Constitution de 1791 ou de la Consti-tuante de 1790 proclamant la paix universelle et faisant appel au monde par ce cri révolutionnaire : «que toutes les nations soient libres comme nous, et il n'y aura plus de guerres ; sauf pour réduire ceux-là seuls qui se ligueront contre la liberté (de la Révolution), - était au fond un appel à la guerre civile et à la désertion, puisque par ce même décret, la Révolution française «adoptait d'avance tous les étrangers qui, abjurant la cause de ses ennemis, viendront se ranger sous ses drapeaux, et favorisait même par tous les moyens leur établissement en France, «car tous les hommes sont frères». (E. JOUIN, La Grande Révolution - Juifs et Maçons)
De nos jours, socialistes et communistes abolissent aussi la guerre. Ils n'ont plus de balles, eux aussi, que pour les généraux et les bourgeois.
Comme tous les esprits avertis, Mgr Jouin voyait le piège caché sous ces théories humanitaires et ces déclarations de paix au monde. II montrait le Congrès de la Paix de 1869 aboutissant à l'invasion allemande de 1870. Pour lui, pacifisme, désarmement, défaitisme étaient synonymes de trahison.
Que des Juifs et des Maçons travaillent à la destruction de la Patrie, c'est leur rôle. Mais que des Français, des Catho-liques, fassent chorus avec eux, empruntent leur langage et jusqu'à leurs idées, prêchent en France le désarmement, le pacifisme et même le défaitisme, c'est ce qu'il ne pouvait comprendre. Aussi, après avoir rapporté les paroles du lieute-nant Mornet, patriote assurément, mais imbu des idées Franc-maçonnes de la Grande Loge, qui déclarait au procès du Bonnet Rouge : «La pensée, si abominable, si défaitiste fût-elle, si on se contente de l’exprimer, reste en dehors des at-teintes de la loi pénale», il ajoutait douloureusement :
«Ainsi, la raison du défaitiste lui enjoint de ne pas défendre la Patrie, et sa pensée, sous l'estampille du Gouver-nement, peut à loisir prêcher à ceux qui se font tuer la désertion, la révolte et la guerre civile : ce fut la semence jetée à tout vent, de 1914 à la fin de 1916, et qui fit germer 1917 avec les mutineries en France et le Bolchevisme en Rus-sie».
«Dites maintenant, si vous l'osez, qu'il n'y a rien à craindre, et qu'il est digne du libéralisme français de laisser im-punément les pacifistes nous intoxiquer d'un internationalisme humanitaire en paternité d'un défaitisme de trahison !» (RISS, 1927, p. 903).
Et encore :
«En résumé, le pacifisme est l'utopie du désarmement. La fraternité des peuples en fait infailliblement des frères ennemis... le désarmement est l'hypocrite trahison de la Patrie».
Mais quelles n'étaient pas son indignation et sa douleur quand, sous des plumes françaises, il lisait des blasphèmes comme ces lignes de L'Ame Populaire, journal du Sillon catholique : «Idole, la Patrie qui déchaîne les haines stupides... Monstre aux cent bras qui prend les vies et les dévore. Vocable de réunion publique qui retentit comme une cymbale creuse. Patrie, honneur, gloire, victoire ! ... «Quelle honte, s'écriait-il, pour des Français, sous le pavillon du démocra-tisme chrétien, d'écrire de telles infamies, inspirées par la Judéo-Maçonnerie, afin de nous livrer à la Révolution sociale et à l'Allemagne luthérienne !»
Et quelle humiliation quand il était contraint d'enregistrer les cris de joie du citoyen Lhéveder, chef du socialisme révo-lutionnaire dans la Bretagne méridionale !
«Les abbés Mancel et Trochu travaillent pour nous. Au jour de l'avènement du socialisme, qui ne saurait être très éloigné, nous aurons à remercier les abbés sillonistes qui, en éveillant les paysans aux idées nouvelles, auront rap-proché l'heure où l'armée des paysans, des ouvriers et des travailleurs intellectuels réalisera la révolution sociale».
Langage qui, disait-il, faisait écho à l'apostrophe du communiste Florimond Bonté, rédacteur en chef de L'Enchaîné, ancien démocrate, dans une réunion tenue à Lille par le parti démo-populaire chrétien :
«Nous ne vous combattrons pas ; vous nous êtes trop utiles. Si vous voulez savoir quelle besogne vous accom-plissez, regardez-moi. Je sors de chez vous. Avant la guerre, j'étais un des vôtres. Depuis, je suis allé jusqu'à la con-clusion logique des principes que vous m'avez enseignés. Grâce à vous, le communisme pénètre là où vous ne lais-seriez pas entrer ses hommes : dans vos écoles, vos patronages, vos cercles d'études et vos syndicats. Tout ce que vous croirez faire pour votre démocratie cléricale, c'est pour la révolution communiste que vous le ferez... Vous faites le lit du communisme». (Le Petit Démocrate, 27 avril 1927).
Devant une telle aberration, les journaux maçonniques ne pouvaient retenir leur étonnement :
«Le plus stupéfiant, lisait-on dans la Nation du 14 juillet 1928, est qu'un groupe de Rose-Croix fait des démarches auprès de personnalités catholiques et à tendances démocrates pour constituer, grâce à leur concours, un groupe de «conservation sociale» dont la principale raison d'être sera la soumission à la haute direction occulte du Grand Orient de France».
«Les gens qui auront donné dans le panneau ne s'en douteront pas, et les Loges pourront, en toute sécurité, exercer leur malfaisance et leur sectarisme».
Ainsi, concluait Mgr Jouin,
«La révolution sociale et communiste préparée par des catholiques dans l'Ouest, dans le Nord et dans l'Est, par la collusion des syndicats chrétiens et des syndicats révolutionnaires, au point que Mgr Ruch a dû en prononcer la con-damnation dans une lettre immédiatement approuvée par le Saint Père, quel signe des temps et des ravages de la Judéo-Maçonnerie blanche !»
Depuis ce jour, d'autres voix d'évêques se sont fait entendre pour rappeler à ceux qui paraissaient l'avoir oublié, que le patriotisme est une vertu dont le Christ Lui-même nous a donné l'exemple, que le désarmement en face de voisins qui s'arment est une folie ou un crime, et que le défaitisme est une trahison : «Nous savons ce qu'il en coûte de n'être pas prêts», disait naguère Mgr Baudrillart ; et à ceux qui se réclamaient faussement du Pape pour légitimer un criminel paci-fisme, le cardinal Pacelli, Secrétaire d'État, légat du Souverain Pontife aux fêtes de Lourdes, déclarait que s'il y a «un pa-triotisme faux qui fait de la Patrie une sorte d'idole barbare assoiffée de tyrannie et de sang», il y aussi le vrai patriotisme, celui que le Saint Père rappelait en termes magnifiques à plusieurs centaines de vos jeunes gens patriotes».
Mgr Jouin avait-il tort de dénoncer dans cet obscurcissement de l'idée de patrie une pénétration de la Maçonnerie et d'en signaler le danger à ses lecteurs ? Le plus ardent propagandiste de ces rêveries humanitaires n'était-il pas «l'auteur de la loi du 9 décembre 1905, - «loi non de séparation, a dit Pie X, mais d'oppression, contre laquelle il faut lutter avec persévérance ?» C'était celui qui abolit les fondations pieuses en 1908 ; celui qui, la même année, convertissait, au bout de trois ans, la séparation de corps en divorce ; celui qui, en 1929, déclarait que les lois de laïcité sont une assise fon-damentale de la République ; M. Briand, dont Mgr Jouin avait prouvé l'affiliation à la Franc-Maçonnerie, M. Briand, l'apôtre maçonnique de la laïcité», devenu maintenant le pèlerin de la paix. Les révélations des Mémoires de Streseman, se vantant d'avoir roulé le ministre français, et les déclarations belliqueuses de l'Allemagne réarmée sont venues souffler sur ces chimères pacifistes. Aujourd'hui, des écrivains, des historiens de valeur répètent le cri d'alarme poussé par le prêtre patriote : c'est M. Jean Guiraud qui nous montre la Maçonnerie tour à tour bonapartiste sous l'Empire, internationa-liste et laïque avec Ferry et Gambetta, puis aujourd'hui socialiste. Le socialisme allié au communisme se prépare à don-ner l'assaut à la société, comme il fut donné à l'édifice vermoulu de l'Ancien Régime quand la Révolution le renversa.
«L'histoire recommence !», dit l’éminent historien, et il montre une des causes de faiblesse de l'Ancien Régime dans sa facilité à se laisser pénétrer par les idées qui devaient le faire sauter. Les privilégiés et les grands seigneurs se fai-saient affilier à la Maçonnerie. La Princesse de Lamballe, celle dont les révolutionnaires de la rue devaient un jour dépe-cer le corps et manger le cœur, était à la tête de la Franc-Maçonnerie féminine. «Et quand la Révolution s'ouvrit, avec quel empressement le bas-clergé s'unit aux révolutionnaires qui, croyait-il, allaient faire renaître les mœurs idylliques et fraternelles de l'Église primitive ! Et comme on saluait la rénovation de la société par la «liberté chérie» en ces messes solennelles où les officiants ajoutaient aux ornements liturgiques une ceinture tricolore ! Et, trois ans après, le curé Pinot, d'Angers, montait à la guillotine revêtu de l'aube et de la chasuble pour expier le crime d'avoir dit la Messe ! Que de braves gens, se comptant par milliers, furent exclus du temps par la guillotine, pour avoir voulu être de leur temps, en partageant et en favorisant ses utopies et ses erreurs».
L'histoire recommence ! Et, comme Mgr Jouin, M. Jean Guiraud a raison d'être effrayé «de voir avec quelle facilité quantité de braves gens et même de catholiques se laissent aller aux mêmes illusions. Non contents de dénoncer, comme il convient, les abus de notre société, ils se félicitent eux-mêmes de sa prochaine disparition, acceptent le prin-cipe de son mal au lieu de le poursuivre de toutes leurs forces : et ce mal est le laïcisme.
«Ils essayent d'une conciliation avec lui en oubliant qu'entre la doctrine chrétienne et la laïcité existe une radicale et inconciliable opposition».
L'adversaire des Sociétés secrètes ne disait pas autre chose. Mais le péril judéo-maçonnique qu'il ne cessait de dé-noncer et qui effraie aujourd'hui tous les esprits clairvoyants, n'est pas inéluctable. Le plan maçonnique est en marche. Il n'est pas fatal. Il faut lui barrer la route et jusqu'à son dernier souffle, dans ses écrits comme dans les discours qu'il pro-nonçait aux congrès de la Ligue, Mgr Jouin exhortait ses troupes à s'unir et à lutter. Sans doute les puissances maçon-niques, disait-il, ont l'or qui achète les consciences, la presse qui corrompt les idées, le pouvoir qui tyrannise, qu'importe ? Que les catholiques s'unissent. «Soyez donc avec nous, répétait-il, contre la Franc-Maçonnerie dorée, plus particuliè-rement celle des Juifs et de la finance. Unissez-vous pour l'étudier et la combattre». Faire l'union, constituer une armée, être un groupe, une association, une idée, une force, une race toujours sur pied de guerre, soulevant la France, l'Europe, le monde, tel était son idéal.
«Soyez avec nous contre la Maçonnerie rouge, celle qui a fait la Terreur et la Commune, qui triomphe aujourd'hui en Russie et au Mexique et qui en attendant la guillotine sanglante nous a préparé la guillotine sèche, la persécution savante et légale par le filet inextricable des lois, des décrets, des arrêtés, depuis l'article 7 de Ferry jusqu'à l'école unique d'Herriot».
«Soyez avec nous enfin contre la Maçonnerie blanche, l'invasion des Judéo-Maçons dans nos rangs, loups vêtus de peaux de brebis, qui s'introduisent dans le bercail, parmi les meilleurs catholiques et les meilleurs Français...
«De quelque nom que vous l'appeliez, la Maçonnerie est l'ennemie qui mobilise toutes les forces du mal, toutes les hérésies, toutes les révolutions, toutes les trahisons. Son chef suprême est Satan, et son but, la destruction de la France».
«Eh bien, s'écriait-il, jurons ce soir 28 novembre 1928, que cela ne sera pas !»
L'Apôtre de cette nouvelle croisade n'avait rien d'ailleurs d'un antisémite. «Le cœur de ce prêtre était imperméable à la haine». Il ne prêchait pas l'extermination des Juifs et des Maçons, pas plus qu'il n'espérait leur conversion, ni l'assa-gissement des communistes.
«Les groupements nationalistes, fascistes ou autres sont impuissants par eux-mêmes à guérir le mal. La guerre est religieuse. Notre conversion est l'unique remède... Et cette conversion, il faut l'opérer en enlevant le libéralisme qui amène la décomposition du sang, raviver les convictions anémiées, réapprendre les formules de la foi catholique et leur rendre leur place dans le langage et la conscience.
«Il faut étouffer ce libéralisme à teinte d'Américanisme, condamné par Léon XIII, qui réduit la religion à des œuvres sociales tout extérieures - ce libéralisme à teinte de modernisme, condamné par Pie X, erreur qui enclot la religion dans la prison de la conscience - ce libéralisme à teinte de laïcisme condamné par Pie XI...» et il sonnait la charge contre ces pernicieuses erreurs, conjurant ses adhérents de soutenir la Revue - menacée de disparaître faute de ressources et dont il supportait presque seul le poids - de recruter de nouveaux Ligueurs et d'assurer l'existence de l'Institut pour la pérennité de l'entreprise.
Que les adversaires auxquels depuis vingt ans il portait de si rudes coups lui aient gardé une haine irréductible et qu'après sa mort ils aient tenté d'anéantir l'œuvre en jetant la calomnie sur son auteur, cela n'a rien qui doive nous sur-prendre et ne pouvait l'effrayer. «Vous avez combattu non sans péril pour votre vie», lui écrivait Benoît XV, dans le Bref où il l'élevait à la prélature.
Mais dans le camp des catholiques, de la part de ceux qu'il rangeait dans la Franc-Maçonnerie blanche, dans le clan de la démocratie chrétienne, que la plume peut-être trop mordante de l'un de ses collaborateurs ne ménageait guère, il rencontrait aussi d'ardentes oppositions.
Ennemi acharné du libéralisme, convaincu que le socialisme est un danger mortel pour la société, il signalait impi-toyablement tout ce qui, dans la presse ou dans l'organisation des groupements nouveaux des jeunes catholiques, lui pa-raissait d'origine protestante, un oubli de la vérité et de la morale traditionnelles, ou une concession aux erreurs condam-nées.
Plusieurs évêques partageaient ses appréhensions, et il n'est pas téméraire de penser que c'est aux critiques de sa Revue que ces groupements doivent d'avoir évité l'écueil vers lequel ils semblaient entraînés .
Du reste, intransigeant pour les idées, il était bienveillant pour les personnes. Au lendemain de sa mort, le plus tou-chant hommage de reconnaissance lui fut apporté par un groupe de jeunes scouts dont il avait autorisé la création dans son Patronage, confiant dans l'orthodoxie du prêtre qui le dirigeait.
On le représentait comme un esprit affaibli, hanté par le spectre de la Franc-Maçonnerie, comme un vieillard attardé à des idées surannées :
«Il me souvient, raconte un de ses collaborateurs aujourd'hui disparu, d'avoir été abordé, au cours d'une de ses conférences aux Centraux, par un jeune vicaire parisien, tout étonné d'entendre cette parole unie mais si claire et si ferme, tenir en haleine une heure durant un brillant auditoire. On l'avait adressé là plutôt pour se moquer, et il s'indi-gnait à présent des calomnies qu'on lui avait soufflées à l'oreille dans certains milieux :
- Comment I c'est bien lui ?... Mais on m'avait dit qu'il n'était plus qu'une ruine.
- Écoutez jusqu'au bout, Monsieur l'Abbé, et vous jugerez». Cet auditeur d'un soir devint l'un des meilleurs amis de l'œuvre ; et combien d'autres ont été conquis comme lui en l'espace de quelques mois par le spectacle de cette âme si énergiquement maîtresse, jusqu'au bout, du corps qu'elle animait».
D'autres, et parmi eux des amis, lui battaient froid et se détournaient de lui. Mais lui, résolu, continuait sa marche et poursuivait la lutte commencée et dans laquelle le retenaient ses convictions et les encouragements de Rome.
«Nous savons, lui écrivait Benoît XV, que vous vous acquittez de votre ministère sacré d'une manière exemplaire, que vous avez la plus vive sollicitude du salut éternel des fidèles et que vous avez affirmé avec constance et avec courage les droits de l'Église catholique - non sans péril pour votre vie - contre les sectes ennemies de la religion, en-fin que vous n'épargnez rien, ni labeurs, ni dépenses, pour répandre dans le public vos ouvrages sur ces matières». (Bref du 23 Mars 1918)
Un an plus tard, le cardinal Gasparri, Secrétaire d'État, en lui transmettant l'agrément du Souverain Pontife pour son étude sur la Guerre Maçonnique, lui écrivait :
«C'est avec raison que dans ce travail vous avez pris soin de mettre en lumière, par des documents et des rai-sonnements irréfutables, la doctrine inepte et essentiellement anticatholique de la Franc-Maçonnerie, doctrine issue du déisme, né lui-même de la Réforme, doctrine aboutissant fatalement, comme on le voit aujourd'hui, à la négation même de Dieu, à l'athéisme social, au «laïcisme», forme actuelle de cette impiété qui, au grand détriment des peuples, prétend bannir des sociétés toute trace de religion et toute intervention de l'Église.
«Vous avez eu soin tout particulièrement de faire ressortir, en dépit des mensonges qui trompent parfois les ca-tholiques eux-mêmes, l'identité de la Franc-Maçonnerie avec elle-même, partout et toujours, comme la continuité du plan des sectes, dont le dessein est bien la ruine de l'Église catholique.
«Sa Sainteté se plaît donc à vous féliciter et à vous encourager dans vos travaux, dont l'influence peut être si fé-conde pour mettre en garde les fidèles et les aider à lutter efficacement contre ce qui tend à détruire l'ordre social aussi bien que la religion».
Et lui-même aimait à se rappeler les encouragements de Pie XI dans une audience privée du 16 novembre 1923 : «Continuez votre Revue, malgré vos difficultés d'argent, vous combattez notre mortelle ennemie».
Enfin, quelques mois à peine avant sa mort, il recevait d'un éminent personnage de Rome ces lignes qui furent sa su-prême justification : «Vous ne savez pas combien on parle souvent ici de vous, et l'on se demande si ce n'est pas vous qui aviez raison... Ce qui arrive, ce qu'on voit, depuis longtemps vous l'aviez prévu...»
Fort de ces encouragements, il lutta jusqu'au bout, sans défaillance, réservant sa haine pour le mal et pour celui qui l'inspire ici-bas : le démon.
* * *
Au lendemain de la mort de Mgr Jouin, un journal parisien, reprochait à la Revue Internationale des Sociétés Secrètes et à son Fondateur d'avoir accueilli les fables stupides de Taxil-Jogand et du Docteur Hacks-Bataille dans Le Diable au XIXe Siècle.
«Comment l'aurait-elle fait, n'étant pas encore née ?» répondit alors un ancien collaborateur de Mgr Jouin. Bien mieux, la Revue a longtemps répudié de la manière la plus explicite, tout anti-maçonnisme du même acabit».
«Et c'est justement parce que, jusqu'à ce jour, écrivait Charles Nicoullaud en 1914, les anti-maçons ont négligé cette étude (de l'occultisme et de la mystique) qu'à un moment donné ce farceur de Léo Taxil a pu surprendre la bonne foi de nombreux catholiques adversaires de la secte. Mais si, à défaut de théologien dans les groupements anti-maçonniques de l'époque, ils s'étaient donné la peine de consulter des hommes comme le chanoine Ribet, l'ab-bé Saudreau, le P. Ludovic de Besse, le P. Poulain, etc., pour ne nommer que des maîtres, ceux-ci n'auraient pas été dupes cinq minutes de la prétendue palladiste Diana Vaughan ou du diable Bitru apparaissant sous la forme d'un crocodile pour jouer du piano dans les arrière-loges. Il faut une dose de naïveté incommensurable pour croire à de pareilles billevesées».
Mgr Jouin se rappelait sa tentative de Fédération des ligues antimaçonniques et son échec devant leur étrange refus de découvrir et de nommer l'influence satanique dans l'inspiration et la direction occulte du mouvement maçonnique. Il n'en affirmait pas moins son point de vue. Dès le premier article de la R.I.S.S. de janvier 1913, il avait mis au point la question de l'action satanique dans les sociétés secrètes grâce à une heureuse formule à laquelle on ne peut que sous-crire :
«Je n'admets pas pour ma part l'action directe du démon dans le gouvernement maçonnique ; mais je comprends que l'étude des initiations incline l'esprit vers cette solution mystique à laquelle les hauts faits de la Maçonnerie mo-derne apportent une apparente confirmation... Il semble bien qu'on a quelque droit de conclure (après ces faits) qu'elle (la Maçonnerie) a pour chef Satan lui-même, et que Léon XIII qui assimile la Maçonnerie au règne du démon, Saint-Martin, Boehme, Swedenborg, et même Stanislas de Guaita et Doinel, qui parlent de communication directe avec Satan, ne font qu'appuyer cette conclusion de leur autorité ou de leur expérience. J'oppose simplement à cette solution l'ordre providentiel d'après lequel, tout, en ce monde, relève d'un pouvoir humain ; et de même que le Christ, chef invisible de l'Église catholique, est représenté visiblement ici-bas par le Pape, de même, j'estime que Satan, chef invisible de l'armée du mal, ne commande à ses soldats que par des hommes, ses suppôts, ses âmes damnées si vous voulez, toujours libres cependant de se soustraire à ses ordres et à ses inspirations».
De là deux principes directeurs :
1° II n'est guère possible que, par une sorte de monstrueuse supériorité sur l'Église du Christ, il soit permis à Satan de se faire le chef visible de la Contre-Église, pour une régie directe, permanente et sensible.
2° Mais il est seulement probable que, perpétuel singe de Dieu, Satan s'efforce de tout son pouvoir, d'assister en quelque sorte ses antipapes, d'animer le gros de ses adeptes d'une espèce de grâce satanique attachée à ce simulacre des sacrements que sont les initiations.
Mgr Jouin se défendait d'ailleurs contre l'accusation plus ou moins sincère de M. Copin-Albancelli, de détourner ainsi l'attention des catholiques vers une certaine mystique qui tend à chercher uniquement dans le monde astral ou infernal, les chefs des sociétés secrètes et en particulier de la Franc- Maçonnerie, et de tourner les esprits vers des sujets qui sont sans utilité pratique dans la formidable lutte actuellement engagée :
«Je serais curieux de savoir ce que M. Copin-Albancelli trouve à reprendre dans cette doctrine qui, encore une fois, est celle de la Revue. Il me semble que je fais la part assez large aux «éléments humains»... Mais je réserve aussi la part du démon parce qu'elle existe, qu'elle nous est enseignée par les Papes et que la Franc-Maçonnerie se-rait, sans elle, une énigme inexplicable. N'en déplaise aux tenants de l'opinion contraire, le diable, au moment de l'ini-tiation maçonnique, a une emprise particulière sur celui-là même qui ne croit pas en lui ; emprise qui le constitue son soldat et peut se comparer, toute mesure gardée, au caractère sacramentel de la confirmation. De plus, ce caractère satanique n'est pas effacé par la simple sortie de la secte, mais uniquement par l'absolution qui relève le Maçon de son excommunication. Ces vérités sont absolument nécessaires à connaître, surtout aux anti-maçons ; on les oublie trop facilement aujourd'hui, où deux siècles de Maçonnerie ont détruit les croyances surnaturelles les plus fondamen-tales, principalement en ce qui touche au démon, à son action sur les âmes et jusqu'à son enfer éternel qu'on vou-drait rayer du Credo catholique. Il est salutaire à la cause antimaçonnique de pénétrer un peu dans «ce monde infer-nal».
Accusé de «distraire les combattants en leur suggérant que la seule chose vraiment intéressante dans la question maçonnique, c'est d'y découvrir les griffes, les cornes ou la queue du diable», il justifiait sa tactique par les encourage-ments venus de Rome, et il terminait ainsi la controverse :
«Nous formons des vœux pour le succès des autres ligues : nous espérons, et nos applaudissements seront la preuve de notre sincérité, que «la Bastille» découvrira le «Pouvoir Occulte», mais, eût-elle amené au grand jour l’Anti-Pape lui-même, que tout ne serait pas dit, il y a, il y aura toujours derrière lui le diable «avec ses cornes, ses griffes et sa queue» si M. Copin-Albancelli y tient, avec son monde non pas «astral», mais «infernal», et surtout avec sa terrible puissance dont les catholiques ne seront délivrés qu'en combattant avec le Christ et Son Église».
N'en déplaise donc à M. Brenier, à M. Copin-Albancelli et à certains catholiques qui semblaient avoir oublié l'Évangile, il était parfaitement permis à un prêtre chargé d'ans et mûri par l'expérience des âmes, et qui, dans les cas difficiles, sa-vait prendre conseil de théologiens compétents, de rester préoccupé de la partie la plus délicate du problème, à savoir : jusqu'où - dans quelles conditions - sous quelle forme s'exerce, ou non, au jour le jour, au moins sur certains initiés, l'ac-tion de Satan en vue du gouvernement de la Contre-Église. Et il semble bien que sur ce point la pensée de Mgr Jouin a un peu évolué.
Tout à la joie d'avoir trouvé le Juif derrière le voile des Loges, il en avait dévoilé la malfaisance envers la chrétienté. Mais dans les dernières années, il penchait de plus en plus à admettre par surcroît, derrière le Juif et le Maçon, l'interven-tion plus ou moins saisissable de Lucifer.
Sans doute, disait-il, il y a un ordre habituel de la Providence qui ne souffre qu'à titre d'exception les phénomènes dé-moniaques aussi bien que les autres manifestations surnaturelles ; mais il s'agit précisément ici de communications très particulières, réservées à un milieu excessivement restreint de personnages voués à la haine de l'Église. Pourquoi con-testerait-on plus volontiers ces prises de contact entre le Prince des ténèbres et ses adorateurs, que tant d'autres cas de possession non moins mystérieux et moins provoqués que l'Église semble parfaitement admettre ?
Si l’on croit aux possédés de l'Évangile, à la Tentation au désert, aux avis de Saint Paul sur les esprits de l'air, aux exorcismes rituels, à l'existence dogmatique en un mot de l'enfer et du démon, disait un collaborateur de Mgr Jouin, pourquoi s'étonner et se scandaliser dès que l'on parle d'une action quelconque, réelle, immédiate sur la vie de chaque jour ?
Qu'un libre penseur impénitent, comme M. Copin-Albancelli, veuille à tout prix trouver ailleurs qu'en enfer la souve-raine autorité maçonnique, c'est tout naturel, mais du côté catholique un ignorant peut seul trouver mauvais qu'un Curé de Saint-Augustin incline à admettre en dernière analyse, du côté du démon, - avec toutes sortes de nuances - la solution discutable, mais fort sérieuse, d'une grosse énigme.
Avant lui d'ailleurs, Mgr Fava avait jeté le cri d'alarme et soutenu cette thèse de l'influence satanique dans les Loges ; on la trouve exposée dans la plupart des classiques de l'anti-maçonnisme, et le savant Jésuite, Mgr Meurin, était allé dans cette voie aussi loin et plus loin que n'est jamais allé Mgr Jouin.
N'est-ce pas d'ailleurs Léon XIII qui déclarait que, dans un plan si criminel (celui de vouloir détruire la religion) pour ramener parmi nous, après dix-huit siècles, les mœurs païennes «il est bien permis de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ... Nous refusons d'obéir à des maîtres qui s'appellent Satan et les mau-vaises passions ?»
Enfin, ne lisait-il pas, dans la littérature maçonnique, les pages consacrées à la religion nouvelle, «la plus belle de toutes», d'après Le Travailleur communiste de Gien ?
Cette religion, elle avait ses pontifes : Pike et Lemmi, son successeur - sa révélation, son dogme et ses miracles, (ceux de la Science) que célébrait Eugène Pelletan dans la Profession de foi d'un enfant du XIXe siècle - sa morale, ré-sumée dans la haine de Dieu et le déchaînement des passions - sa liturgie et son droit canonique, rédigés par Pike, Reuss et Crowley - ses hymnes à la gloire de Satan et ses blasphèmes contre Dieu - ses adeptes enfin, «qui deviennent ainsi, à leur insu peut-être, les sujets du démon» et ses adorateurs.
Mais, dira-t-on, ces adorateurs sataniques sont rares.
«Moins que l'on ne pense», répondait Mgr Jouin. Et il citait le témoignage d'une foule de prêtres qui ont eu des rap-ports avec des voleuses d'hosties destinées aux profanations sacrilèges, et celui de son expérience personnelle : «Pour-quoi, disait-il à l'une d'elles qu'il avait vue plusieurs fois, les Maçons t'envoient-ils voler des hosties, puisqu'ils ont, hélas ! des prêtres apostats ?» Et l'enfant lui avait fait instantanément cette réponse : «Ils ont peur qu'ils ne consacrent pas !»
* * *
Ainsi, dès le premier jour, parallèlement à la lutte antimaçonnique, Mgr Jouin fut-il amené à cette conviction, qu'il était nécessaire de mettre à l'étude toutes les questions relatives aux doctrines et pratiques occultistes.
Dévoiler l'occultisme, avec ses initiations, ses mystères et ses conséquences morales pour l'homme qui, librement, se soumet à l'Esprit du Mal... le suivre à travers ses manifestations cabalistes, magiques ou autres, et le symbolisme des théories cosmogoniques... parcourir l'histoire de l'ésotérisme, remplaçant Dieu par le «Progrès», et présentant à ses adeptes «l'Idole Science» ; puis, après l'écroulement de cette divinité et le débordement du matérialisme, leur tendant le piège de la théosophie, du spiritisme, et des religions orientales, destinées à supplanter l'Église ; mettre enfin l'esprit du chrétien en garde contre certains mots destinés à le familiariser avec l'erreur, tel fut le motif qui détermina Mgr Jouin à créer une revue spécialisée : Revue distincte de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, et qu'on ne pourrait ré-pandre sans discernement, parce que, si la Judéo-Maçonnerie est sans patrie, elle est aussi sans Dieu et sans mœurs, - revue qui réclamait des collaborateurs compétents, libres de leur temps pour des recherches laborieuses, orientant cha-cun leurs travaux, d'après leurs aptitudes intellectuelles et leur formation scientifique : «Quand même, disait-il, sur cer-tains points, leurs conclusions ne seraient pas identiques, la vérité jaillira de ce chaos, de ce choc de documents et d'idées».
Sans renoncer à se placer, suivant l'opportunité, au point de vue expressément théologique, son dessein n'était point de faire surtout œuvre dogmatique... son ambition n'était que de fournir au public compétent une série de documents et d'expériences qui pût asseoir dans les esprits un jugement éclairé, large et sûr. «Les vérités catholiques étant inconnues des adeptes des sciences maudites, il serait vain de chercher à les convaincre en s'appuyant à priori sur ces postulats».
Telles sont les directives que le Fondateur de la R.I.S.S. donnait à ses collaborateurs de la Revue occultiste, lorsqu'en 1928, il sépara de nouveau la «Revue Rose», de la R.I.S.S. - directives - que tous, «pareillement unis à Mgr Jouin, par une foi très sûre, ont toujours suivies sous sa surveillance et sa garantie».
En publiant sa Revue Occultiste, Mgr Jouin n'ignorait pas les dangers auxquels il s'exposait. Il l'avait dit :
«Malheur à qui ose toucher à cette corde sensible de la Secte. C'est alors que se déchaîne contre les audacieux qui osent dénoncer l'intervention de Satan une de ces rafales qui emportent tout. Toute dénonciation sérieuse du sa-tanisme des Hautes Loges a été presque immédiatement suivie d'une catastrophe pour ses auteurs».
(à suivre...)
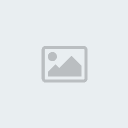
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 10)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932) (Suite)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
* * *
L'ODIEUSE CAMPAGNE.
Il venait à peine de mourir que se déchaîna contre lui une campagne acharnée de diffamations et de basses injures. Commencée obliquement dans le Figaro, (à l'occasion d'une polémique engagée entre ce journal et l'«Action Fran-çaise»), par une allusion inattendue à «l'énigmatique Curé de Saint-Augustin», elle se prolongea six semaines durant, dans une série d'articles tissus d'odieux mensonges, et ne prit fin que par la disparition du calomniateur.
Ces calomnies, la R.I.S.S. les a longuement et victorieusement réfutées dans la Réponse à une odieuse Campagne (R.I.S.S. n°17, 1932). Nous engageons les lecteurs, que l'attaque brusquée a surpris ou troublés, à se reporter à ces 70 pages, où la défense est présentée avec tous les documents et pièces à l'appui. «Le coup, dit le rédacteur de ces articles vengeurs, nous vint par derrière, d'un endroit où nous pouvions penser n'avoir que des alliés, sinon des amis... Il était, de plus, tiré très bas par un homme qui se cache, et qui ne tire que ventre à terre».
Pour lancer ces traits perfides, l'agresseur avait attendu l'époque où, dispersés par les vacances, les amis de Mgr Jouin ne pouvaient faire entendre la voix de la vérité pour venger une mémoire vénérée. Prudent autant que lâche, il dis-simulait sa personnalité sous un nom d'emprunt. On ne tarda pas à lui arracher le masque dont il se couvrait, et l'on ap-prit alors, que l’auteur de ces impostures qui signait «Eugène Gatebois» n'était autre que M. Flavien Brenier, le même, dont le Curé de Saint-Augustin et M. Bidegain avaient jadis révélé les louches manœuvres pour faire échouer le projet de fédération des Ligues. Pour la sixième fois, le personnage reprenait un attentat qu'il avait essayé autrefois contre cinq il-lustres anti-maçons. Plus habitué à tirer sur ses compagnons d'armes que sur l'ennemi commun, il tentait aujourd'hui, après vingt ans, de tuer une œuvre gênante en dégradant la mémoire de son fondateur.
Quant au Directeur du Figaro, M. Coty, complice ou inspirateur de l'agression, quel intérêt avait-il à prêter les co-lonnes de ses trois journaux (les trois «Cotydiens») aux insultes de M. Gatebois-Brenier ? Naguère, Mgr Jouin lui avait proposé, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs, d'étudier un plan de mise en société de l'Institut anti-judéo-maçonnique, et la ques-tion était restée en suspens. Plus récemment, la Revue avait fait des réserves sur des articles de M. Coty contre les «Fi-nanciers juifs». Le mégalomane gardait-il quelque ressentiment d'une approbation incomplète ? Ou bien faut-il s'arrêter à un motif encore moins noble : Le désir d'acheter les complaisances du gouvernement pour éluder les conséquences d'un jugement qui l'avait condamné à verser trois cents millions à la femme dont il se séparait ?
Quoi qu'il en soit, Mgr Jouin était accusé d'abord, d'avoir été, en France, le chef d'une société secrète et pernicieuse, «La Sapinière». - L'année 1909 aurait été celle de son initiation - et la Revue serait devenue l'organe de la «Sapinière» française. Société, disait-on, dont l'origine semble bien maçonnique (Ce «semble bien» d'ailleurs dispensait de preuves).
Trois affirmations : trois mensonges. En admettant que la «Sapinière» - sobriquet dont fut affublé le Sodalitium pia-num, ou Association Saint-Pie V - ait compté Mgr Jouin parmi ses membres - et cela n'est pas - quel crime y aurait-il eu pour lui, puisque cette Association, fondée par un prélat de la Cour romaine, Mgr Benigni, n'était nullement une «société secrète» chargée d'espionner et de dénoncer à Rome certains personnages ecclésiastiques» ; mais de mener «la bonne lutte de la foi contre les erreurs et les malices du modernisme» (autographe de Pie X, 5 Juillet 1911) et qu'à diverses re-prises, de 1909 à 1921, date de sa dissolution, elle reçut les encouragements et les bénédictions pontificales. Pour ap-puyer son accusation, M. Brenier citait des papiers trouvés à Gand, pendant l'occupation allemande, chez un avocat, Jonckx, sans d'ailleurs donner plus de précision. Or M. Mourret de Saint-Sulpice, qu'on ne saurait accuser de partialité, nous a déclaré avoir vu ces papiers et n'y avoir pas trouvé le nom du Curé de Saint- Augustin.
D'autre part, il n'est pas cité à ce titre dans l'ouvrage de Nicolas Fontaine (M. Canet) où Brenier a puisé ses docu-ments, au point d'en reproduire jusqu'aux fautes d'orthographe. Et la R.I.S.S., que l'on affirme avoir été l'organe de la «Sapinière», n'y figure pas dans l'énumération des Revues recommandées par le Sodalitium pianum.
Enfin, un dernier témoignage, d'autant moins récusable qu'il vient d'un homme séparé depuis quatre ans de Mgr Jouin par des dissentiments graves, d'un homme renseigné, puisqu'il avait été un membre actif de la «Sapinière» avant sa dis-solution. «Jamais, déclare M. l'abbé Boulin, le Curé de Saint-Augustin n'a fait, à aucun titre, partie du Sodalitium pia-num... Il est faux qu'il ait figuré dans aucun papier de Gand authentique ; et je mets M. Gatebois au défi de faire la preuve du contraire. II sait du reste fort bien qu'il n'a mêlé à cette dispute le nom de Mgr Jouin que pour faire tas d'injures et jeter, vaille que vaille, sur cette vie, une ombre ou une suspicion». (La Sapinière, par Roger Duguet. Nouvelles éditions latines, 1933. Paris VI).
Il ne fit pas davantage partie d'une seconde association, d'une sorte de «Sapinière» rénovée, fondée en 1924, par le même Mgr Benigni, après la dissolution de la première, et pour laquelle deux «congrès» se seraient tenus à Paris et à Salzbourg.
Voici les faits, certifiés par deux témoins :
«En 1924, lisons-nous dans la Réponse à une odieuse campagne, quelques personnalités du monde littéraire et politique, connues par leurs écrits et leur activité anti-judéo-maçonnique, désireuses de dégager quelques idées, qui pussent servir de base d'action commune pour la défense de la civilisation chrétienne, s'étaient réunies à Paris. Mgr Benigni ne fut nullement l'initiateur de cette réunion...
«Après quelques séances, les invités se séparèrent sans avoir accepté aucune autorité, approuvé aucun statut, payé aucune cotisation, signé aucun compte-rendu ?»
La diversité de nationalité et de religion des membres de ce «Congrès» rendait Mgr Jouin méfiant : il n'assista à aucune des séances de travail ; «mais, préoccupé de tout temps de grouper les forces catholiques contre les sectes, il ne pouvait manquer de regarder, au moins avec curiosité, une tentative d'action tendant au même but, même par des moyens différents. Aussi, voulant manifester l'intérêt qu'il prenait à de semblables échanges de vues, il accepta de recevoir quelques-uns des «Congressistes» dans son salon, pour y entendre exposer leurs opinions». On lui offrit la présidence, «Messieurs, répondit-il, il n'y a pas ici d'assemblée, je ne puis donc accepter de diriger votre assem-blée. Mais mon âge me permet de présider à vos conversations». Mgr Jouin se contenta «d'écouter silencieusement, dans une attitude pleine de réserve». Une fois seulement, il prit la parole pour contester une opinion émise par un des assistants.
«Aucun vote ne fut émis, aucune résolution prise, aucun procès-verbal rédigé».
En quittant la salle avec Roger Lambelin et une autre personne, Mgr Jouin leur dit : «Somme toute, cela ne pour-rait aboutir qu'à une sorte d'internationale blanche, c'est plus dangereux qu'utile».
Et, peu après, paraissait dans la R.I.S.S. un avis judicieux mettant en garde contre toute Ligue internationale qui n'a pas le «contrôle renforcé de l'Église et de l'État» (R.I.S.S. année 1924, p. 650).
Quant au «Congrès de Salzbourg», dit la Réponse, nous affirmons sans crainte d'aucun démenti, que Mgr Jouin, ni M. l'abbé Boulin, ni aucun membre mandaté par notre Revue n'y assistèrent.
Nous n'insisterons pas sur le second grief fait à Mgr Jouin. La Réponse à une odieuse campagne (p. 25-35) établit nettement, avec preuves à l'appui, que M. Charles Nicoullaud, simple rédacteur à la R.I.S.S. ne fut jamais, comme on le prétend, secrétaire de Mgr Jouin qu'il n'était point l'ennemi des ordres religieux, que ses romans, (antérieurs, d'ailleurs, à son entrée à la Revue) sont irréprochables qu'il ne fut ni franc-maçon, ni théosophe, et qu'il combattit les uns et les autres toute sa vie.
Il faut lire toute cette argumentation, appuyée sur des citations et des textes irrécusables, pour se faire une idée exacte de la mauvaise foi du diffamateur.
Troisième accusation, plus grave celle-là, mais non moins mensongère : «Mgr Jouin aurait été le chef et le Pape - rien que cela ? de l'Action Française et l'aurait entraînée dans le schisme».
Et la preuve, assure sérieusement M. Brenier, c'est le titre de «vénéré Mgr Jouin» que lui décerne, au cours de cette polémique, M. Pujo. Le Curé de Saint-Augustin venait, en effet de mourir à 88 ans, entouré justement de la vénération générale.
Et si cet argument ne suffit pas à vous convaincre, voici une seconde preuve d'égale force.
«Pour eux, (les dirigeants de l’Action Française) une parole de Mgr Jouin paraissait être un argument sans réplique ; son veto ou son approbation déterminaient leur attitude». - «De ce veto, dit la Réponse, M. Brenier cite un exemple, un seul, celui qui aurait été lancé contre les campagnes de M. Coty contre la Finance Internationale : «veto» qui n'était qu'un simple regret, qu'une campagne utile, ne le devienne pas encore davantage par une information plus approfondie».
La R.I.S.S. et l’Action Française pouvaient d'ailleurs se rejoindre sur certains points, - dans le culte de Jeanne d'Arc, par exemple, ou dans la lutte contre un régime qui leur paraissait livrer la France à la Révolution et à la Franc-maçonnerie, sans qu'on puisse parler de collaboration. L'une et l'autre, sans s'être concertées, avaient le droit d'appeler un chat un chat, et Briand un Maçon.
De cette collaboration, M. Brenier, une fois encore, n'apporte aucune preuve. Nous pourrions donc dédaigner l'accu-sation. Par contre, cent témoins attesteraient l'indépendance absolue de Mgr Jouin à l'égard du journal en question. Lorsque l'accord existait, c'était un accord purement de fait, accord qui s'explique par la communauté du but poursuivi, ou des sources qu'ils utilisaient : la tradition antilibérale des Barruel, de Bonald, de Maistre, Claudio Jannet, Augustin Co-chin.
D'ailleurs, tandis que le journal attaquait les principes révolutionnaires et libéraux, d'un point de vue positif et histo-rique, le prêtre les combattait sans un angle surtout théologique : «Son action antimaçonnique, il la situait sur un plan surnaturel, mystique, en tous cas, en dehors et au-dessus des partis». (Réponse à une odieuse campagne, p. 37).
Mgr Jouin comptait parmi les abonnés de sa Revue et parmi ses Ligueurs, des gens de tous les partis, des républi-cains et des royalistes. Parmi ces derniers, plusieurs étaient et demeurèrent ses amis. C'était son droit, la sentence de Rome n'ayant pas frappé les idées politiques du journal, mais seulement ses idées religieuses. Intransigeant sur la doc-trine, il demeurait bienveillant pour les personnes, dans l'espoir de les ramener à Dieu. Il avait trop le sens de ses devoirs envers le Pape, qu'il exaltait dans un magnifique discours, en 1930, pour enfreindre ses décisions ; mais il avait aussi le sens aigu de ses droits, et il en usait jusqu'au bout.
Nous ne nous attarderons pas longuement à répondre au reproche qu'on lui a fait, «d'avoir été l'ennemi des ordres re-ligieux et rebelle à l'autorité ecclésiastique qu'il faisait diffamer».
Déjà la brochure que nous suivons (p. 26) a fait justice de l'hostilité prétendue de M. Nicoullaud contre la Compagnie de Jésus, hostilité qu'aurait partagée Mgr Jouin, et qui serait devenue comme «une marque de la maison». Même dans «Zoé la théosophe» et dans l'«Expiatrice», Charles Nicoullaud se défend lui-même avec force d'en vouloir le moins du monde à la Compagnie. Il s'en prend seulement à un de ses enfants perdus. On ne trouve nulle part de lui une critique de la spiritualité particulière de saint Ignace. On y trouve, au contraire, des passages comme ceux-ci :
«...La forte et sévère formation inculquée aux membres de la Compagnie de Jésus ne s'efface jamais. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent par la suite, les enseignements si profonds qu'ils ont re-çus, lors des deux noviciats, restent toujours imprimés au fond de leur cœur». (L'Expiatrice p. 79)
Plus loin, le P. Guissin, dirigeant une retraite, apparaît tout à coup transformé :
«C'est que ce merveilleux livre des Exercices, écrit par un si grand Saint, pour le besoin des âmes, agissait à la fois, sur le fils de saint Ignace et sur la pénitente». (p. 205)
Pas plus que son collaborateur, «Mgr Jouin ne s'était jamais attaqué à la Compagnie, comme telle ; il y comptait, au contraire, d'excellents amis. Moins que personne, il ignorait qu'elle a fourni à l'anti-maçonnisme quelques-uns de ses pré-curseurs et de ses maîtres les plus illustres. Son désir était de donner de quelques unes de leurs œuvres de nouvelles éditions critiques, notamment de Barruel, dont il existait alors de précieux manuscrits encore inédits entre les mains d'un religieux de la Compagnie. «La marque de la maison» n'était point un anti-Jésuitisme de mauvais aloi.
On ne doit donc pas, même pour défendre le Directeur de la R.I.S.S., séparer son image de celle de «ce premier, fi-dèle et très digne compagnon de sa lutte contre les sectes».
Ensemble, Mgr Jouin et M. Ch. Nicoullaud, avaient tracé le programme complet de l'anti-judéo-maçonnisme, ils y tra-vaillaient de concert : c'est ce que l'ennemi ne leur a pas pardonné.
Mgr Jouin n'était pas plus «rebelle à l'autorité ecclésiastique» qu'il n'était l'ennemi des religieux.
Si, au cours de sa longue et féconde carrière, dans des matières laissées à la libre discussion et en l'absence de dé-cisions définitives, il a parfois émis un avis différent de celui de hautes autorités, «il ne l'a fait qu'avec une extrême mo-destie, avec le poids que lui conféraient sa science théologique et sa longue expérience, et toujours en soumettant son jugement à l'avis de ses supérieurs». Il n'a donc pas eu a bénéficier de «l'indulgence» de son Archevêque, et le Cardinal Dubois ne lui manifesta aucune «sévérité». Il le visitait même à l'occasion amicalement dans sa paroisse et dans sa de-meure.
- «Ne craignez-vous pas, lui disait-il un jour, à la vue des couloirs obscurs où il avait dû abriter l'abondance de ses livres, qu'un homme se cache ici et vous assassine ?»
- «Oh ! Eminence, répondit gaîment le Curé, je m'en apercevrai toujours bien».
Mieux encore, apprenant que le Curé de Saint-Augustin, volontairement appauvri, se privait, faute de ressources, d'un séjour dans le Midi que sa santé réclamait, il lui offrit, sans succès d'ailleurs, de prendre cette dépense à sa charge.
Enfin, on ne saurait oublier que le Cardinal Verdier n'hésita pas à déplacer la date du conseil archiépiscopal pour pré-sider en personne la cérémonie de ses obsèques.
Nous avons, d'autre part, cité les paroles de Benoît XV dans le Bref Præstantes animi laudes, élevant l'abbé Jouin à la prélature romaine. Six ans plus tard, Pie XI lui octroyait, à titre de récompense, les privilèges de protonotaire apostolique, soulignant avec force par cette distinction les services rendus à la cause catholique par ce grand lutteur qui était prêt à sacrifier pour l'Église son repos, sa liberté, sa vie, s'il le fallait.
Après de tels témoignages, ce n'est plus de l'indignation, c'est de l'écœurement qu'on éprouve en lisant la dernière et la plus odieuse insinuation du calomniateur :
«N'ayant jamais eu d'intimité avec Monsignor Jouin, nous ignorons dans quels sentiments il est mort, et nous es-pérons pour son salut, que ce fut avec le repentir du mal politique et religieux qu'il avait causé pendant sa vie».
Nous savons, nous, comment il a vécu et comment il est mort, consolé par la présence de son clergé, entouré de prêtres et de religieux, visité au nom du Cardinal absent, par Mgr Crépin, et serrant dans ses doigts la bénédiction apos-tolique du Souverain Pontife. Et nous ne voulons retenir que la parole de Mgr Odelin, devant la couche funèbre :
- «Vraiment, c'était une figure qui faisait honneur au clergé de Paris».
Sa vie fut celle d'un grand serviteur de l'Église et de la France, sa mort celle d'un saint prêtre. Et nous souhaitons à son accusateur, à défaut d'une vie aussi honorable, une mort aussi rassurante. Ce sera notre seule vengeance.
Mgr Jouin n'en eût pas voulu d'autre.
LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN.
C'est ainsi que, sans négliger aucun devoir de sa charge pastorale, toute sa vie et jusque dans la mort, Mgr Jouin soutint le bon combat contre les Sectes. Il s'y livra même presque exclusivement à partir du jour où une pénible infirmité le retint plusieurs mois éloigné de sa paroisse et l'obligea à demander un coadjuteur de son choix : M. l'abbé Raymond, ancien second vicaire de la paroisse dont il avait conquis l'estime par son talent et ses vertus.
Jusqu'à cette année (1927), il n'avait voulu se décharger sur aucun de ses auxiliaires du soin des catéchismes de première communion, de la prédication ni de la direction de la paroisse. Et c'est avec raison qu'aux fêtes de ses Noces d'or sacerdotales et de ses Noces d'argent pastorales, deux grands orateurs dominicains : le P. Hébert et le R.P. Janvier, avaient loué en lui le prêtre, le pasteur, l'ami des enfants, le bienfaiteur des pauvres, le recruteur du clergé.
Mais dans tous ces portraits qu'on avait faits de lui, Mgr Jouin ne se reconnaissait pas. Il ne trouvait pas là le fonds de son âme, ni les mobiles essentiels de son action et le caractère par excellence de toute sa vie. «Il me souvient, écrit un de ses collaborateurs, de son mouvement d'humeur au milieu des félicitations qui l'assaillaient à la sacristie, à propos du beau discours du R.P. Janvier.
« - Sans doute, disait-il avec embarras, voilà qui est bien gentil de la part du Père, c'est même trop de compli-ments. Mais, ce qui m'ennuie, c'est qu'il manque dans ce portrait qu'on fait de moi et c'est que le Père ait dû taire jus-tement ce que j'ai fini par vouloir être surtout et qu'on sait bien que je suis.
Il s'était regardé sans complaisance dans le brillant miroir qu'on lui avait solennellement tendu et ne s'y recon-naissait pas, ni dans ces toasts où tour à tour avaient été exaltés, de sa naissance à ses derniers jours, tous ses titres et tous ses mérites comme prêtre, curé de Paris, prélat romain et l'un des doyens d'âge du clergé français.
Il ne se souvenait pour ainsi dire plus d'avoir été ce catéchiste incomparable, ce rénovateur du théâtre chrétien et tant d'autres hommes encore que la vie l'avait faits au cours de trois quarts de siècle. C'est seulement dans son œuvre anti-judéo-maçonnique, fruit de sa féconde vieillesse, qu'il se reconnaissait tout entier, qu'il saluait le couron-nement providentiel d'une carrière si pleine de bonheurs et si longue. C’est par elle qu'à ses propres yeux, sa physio-nomie se distinguait nettement de tant d'autres, chargées d'honneurs pareils mais d'autres mérites. Pour lui, sa vraie figure n'était pas tant celle du jubilaire qu'on avait tant exalté que celle presque passée sous silence (et déjà sourde-ment critiquée) de défenseur véritablement hors de pair de l'Église et de la France en face des Sectes et de leurs in-filtrations sournoises. Mgr Jouin est et reste par là le militant incomparable d'une suprême croisade contre Israël et les Loges pour le salut de son pays».
Ce jugement, pour exact qu'il soit, demande à être complété. Il ne suffirait pas d'admirer l'importance des œuvres ac-complies par Mgr Jouin ni la vaillance des coups par lui portés à l'ennemi : il faut pénétrer jusqu'à la pensée qui les a ins-pirés et, derrière ce qu'on voit, révéler ce qu'on ne voit pas.
Or la source où s'alimentait cette activité prodigieuse et cette ardeur inlassable, c'était sa foi, sa foi mystique. Sa vie en apparence tout active, remplie de fondations et d'œuvres, eut ce constant support.
Son recueillement, que ne venait point distraire la lecture des journaux ou des romans, était habituel. On sentait, en l'abordant, qu'on interrompait une conversation intérieure. «Je sors de chez l'abbé Jouin, disait le comte de Savignac après sa première visite à Saint-Augustin, il me semblait converser avec un moine». Souvent on le consultait sur des points délicats et difficiles : on le voyait alors se recueillir un court instant, et aussitôt tombait de ses lèvres un conseil si judicieux qu'on aurait pu le croire longuement réfléchi.
Cet esprit mystique qui perçait déjà au jour de sa conversion à Combrée et lui valut, jeune prêtre, des consolations spirituelles, qu'il prenait pour des extases, l'abbé Jouin le développa dans la suite par un commerce habituel avec les au-teurs mystiques : les Conférences de Cassien, les œuvres de Jean Tauler, les Dialogues de sainte Catherine de Sienne, les ouvrages de saint Thomas d'Aquin étaient ses livres de chevet. Il aimait à les citer dans ses retraites aux religieuses ou dans ses lettres de direction. «Recueillez-vous dans la cellule de votre cœur», aimait-il à répéter après la grande sainte dominicaine. «Courage, mon fils, écrivait-il à un jeune prêtre hésitant et timide, tu commences la route, ne regarde plus en arrière, pas trop en dedans, mais beaucoup en avant».
Quand survint, en 1924, la crise financière qui faillit emporter sa Revue, il écrivait à l'un de ses fils spirituels, l'abbé Ri-chard :
«Merci de t'être associé à la neuvaine pour la Revue. Est-elle agonisante ? est-elle morte ? Humainement parlant, il n'y a qu'à l'enterrer. Surnaturellement la solution est entre les mains de la petite Bienheureuse de Lisieux. Je vais m’endetter de ce mois de janvier, puis je suspendrai jusqu'à Pâques, et si rien ne vient, je renverrai l'argent versé pour l’année courante : l'impossible est un signe providentiel de rentrer dans le silence ; j'avoue que ce ne sera pas sans une blessure au cœur».
C'est aussi à la lumière de la foi qu'il jugeait les événements. Au-dessus de la mêlée des hommes et des partis qui semblent mener le monde, il voyait la lutte de deux armées invisibles. D'un côté le Christ avec saint Michel et les anges fidèles ; de l'autre, le démon et les anges déchus. Commencée dans le ciel, continuée au Calvaire, elle s'achèvera dans l'éternité par le triomphe du Christ et de Son Église.
Mystique, il l'était dans son activité : Dieu premier servi, était une de ses devises. La pensée qu'il ne travaillait que pour Dieu le rendait audacieux jusqu'à la témérité. Il s'était montré particulièrement actif dans une affaire sur laquelle, sans qu'il le sût, Rome s'était prononcée, et, pour plaider cette cause, il envoyait rapports sur rapports, essayant de faire parvenir jusqu'au Pape ce qu'il croyait la vérité : «Je crois, écrivait-il, que le second rapport est seul capable d'avancer mes affaires, quitte à me faire anathématiser. Je m'en remets au Bon Dieu pour qui seul j'ai travaillé». Il reçut en effet l'avis officiel de ne plus s'occuper de cette affaire, et il rentra humblement dans le silence.
Mystique il l'était surtout dans sa dévotion et dans ses dévotions. Sa piété le portait d'emblée vers Celui qui est la source vive de la vie mystique : l'Esprit-Saint, et vers Celui qui s'en est fait le parfait exemplaire : le Sacré-Cœur. Un de ses derniers écrits fut en effet la Préface d'un Chemin de la Croix avec le Saint-Esprit, et l’une de ses dernières œuvres, l'établissement dans sa paroisse d'une Confrérie en l'honneur de la troisième personne de la Trinité, «le Grand Mécon-nu».
Quant au Sacré-Cœur, combien d'articles n'a-t-il pas écrits sur cette dévotion, soit dans la Revue La Foi Catholique, soit dans le Bulletin Paroissial ? Pendant la guerre, il s'en était fait l'ardent apôtre. Il y voyait le salut de la France. Dans son discours du Mont Saint-Michel, il rappelait les trois demandes du «Message de 1689» qu'il rattachait mystiquement au culte du grand archange : un temple, une fête spéciale et l'emblème du Sacré-Cœur sur l'étendard du Roi.
«La Basilique, disait-il, est construite et consacrée et la statue de saint Michel en domine le chevet. La fête spé-ciale a été établie, et l'épiscopat français en a imposé la célébration au jour demande par le Sacré-Cœur : fête dans laquelle la Bienheureuse Marguerite-Marie voyait «un des moyens de ruiner dans les âmes l'empire de Satan». Reste le drapeau national sur lequel le Sacré-Cœur veut être peint. Saint Michel était jadis représenté sur le drapeau de Charlemagne et de Charles VII. Aujourd'hui, il lutte pour que le Cœur de Jésus vienne remplacer son effigie. Et qui peut dire, ajoutait-il, que l'heure n'en soit pas venue ?»
En attendant que ce vœu se réalisât, il en répandait l'idée et beaucoup d'églises, à son exemple, arborèrent le dra-peau national orné de l'emblème du Sacré-Cœur.
Ce vieillard chargé d'années et d'expérience ne croyait pas s'abaisser en adoptant les dévotions populaires. Pieux comme une femme vendéenne, humble comme un enfant, refaisant jusqu'à la fin leurs gestes naïfs, dévot aux images, aux médailles, à l'eau bénite, il avait un culte pour les saints dont il portait sur lui les reliques et dont il multipliait les sta-tues dans son église : pour les saints militants, saint Michel, qu'il prenait pour patron de sa Ligue, et Jeanne d'Arc, dont il célébrait la fête religieuse par une éclatante solennité et la fête nationale par l'illumination de son presbytère - pour les saints de France : sainte Geneviève, dont il fut le dernier chapelain et à qui chaque année, pour sa neuvaine, il faisait l'of-frande de sa maîtrise ; le Curé d'Ars dont il était un fervent imitateur, n'estimant, à son exemple, rien de trop riche pour le culte divin ; Bernadette, la Voyante de Lourdes, qu'il chanta en un si gracieux poème , saint Antoine de Padoue enfin, dont il requérait du pain pour ses pauvres et pour lui-même la grâce de «faire oraison tous les jours, de reprendre les mortifications, d'établir patronages, catéchismes, œuvres».
Glorifier les saints ne lui suffisait pas. Sa foi mystique entraînait à leur suite à des austérités et à des actes héroïques, comme on en lit dans la vie de ces grandes âmes. Dans l’éloge funèbre de Mère Agnès, l'admirable Servante des Pauvres, il citait d'elle ce geste surhumain : «Tourmentée de scrupule, elle me dit un jour : ma malade après avoir com-munié ne put retenir les saintes espèces. Croyant voir quelques parcelles d'hostie, je les avalai». Je crus, ajoutait-il, en-tendre sainte Catherine avouant à son confesseur que, pour vaincre ses répugnances, elle avait bu l'eau dont elle avait lavé la plaie d'Andréa, la cancéreuse». Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'un jour, lui aussi, avait imité l'acte de Mère Agnès, en prenant dans les ablutions de sa messe les restes maculés d'une hostie qu'une personne, subitement malade après la communion, n'avait pu retenir.
On ne sera pas surpris d'apprendre que ce prêtre, demeuré moine, pratiquait de dures austérités. Comme autrefois au Noviciat, il se flagellait, parfois cruellement, et les instruments de pénitence - disciplines de cordes et de fer - qu'à sa grande confusion, on découvrit un jour encore ensanglantées, et les gouttes de sang trouvées sur le parquet et jusque sur les murs de sa chambre disent assez à quelles macérations il livrait sa chair lorsqu'il voulait obtenir une conversion ou réparer quelque faute de son entourage.
A l'exemple des hommes d'œuvres de son temps, d'un Don Bosco à Turin, d'un abbé Fouque à Marseille, sa con-fiance en la Providence était extrême, tentatrice, mystique. Sans souci du lendemain, il ajoutait charges sur charges, et ses libéralités s'élevaient parfois d'un seul coup à 50 et 100.000 francs. Quand il mourut, il n'avait plus rien.
Il se dépensait lui-même, sans compter, au service de l'Église pour laquelle il eût volontiers donné sa vie et dont il se regardait comme le chevalier.
Mystique, il le fut jusqu'à la fin, et c'est là, croyons-nous, dans cette foi intense qu'il faut chercher la physionomie inté-rieure, la vraie figure de ce prêtre dont on peut dire, comme de l'abbé Planchât, ce martyr de la Commune, que «ses pieds ne tenaient pas à la terre, ni ses mains à l'argent, ni sa tête aux épaules».
(à suivre...)
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 10)
* * *
CHAPITRE VII LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE (1912-1932) (Suite)
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
* * *
L'ODIEUSE CAMPAGNE.
Il venait à peine de mourir que se déchaîna contre lui une campagne acharnée de diffamations et de basses injures. Commencée obliquement dans le Figaro, (à l'occasion d'une polémique engagée entre ce journal et l'«Action Fran-çaise»), par une allusion inattendue à «l'énigmatique Curé de Saint-Augustin», elle se prolongea six semaines durant, dans une série d'articles tissus d'odieux mensonges, et ne prit fin que par la disparition du calomniateur.
Ces calomnies, la R.I.S.S. les a longuement et victorieusement réfutées dans la Réponse à une odieuse Campagne (R.I.S.S. n°17, 1932). Nous engageons les lecteurs, que l'attaque brusquée a surpris ou troublés, à se reporter à ces 70 pages, où la défense est présentée avec tous les documents et pièces à l'appui. «Le coup, dit le rédacteur de ces articles vengeurs, nous vint par derrière, d'un endroit où nous pouvions penser n'avoir que des alliés, sinon des amis... Il était, de plus, tiré très bas par un homme qui se cache, et qui ne tire que ventre à terre».
Pour lancer ces traits perfides, l'agresseur avait attendu l'époque où, dispersés par les vacances, les amis de Mgr Jouin ne pouvaient faire entendre la voix de la vérité pour venger une mémoire vénérée. Prudent autant que lâche, il dis-simulait sa personnalité sous un nom d'emprunt. On ne tarda pas à lui arracher le masque dont il se couvrait, et l'on ap-prit alors, que l’auteur de ces impostures qui signait «Eugène Gatebois» n'était autre que M. Flavien Brenier, le même, dont le Curé de Saint-Augustin et M. Bidegain avaient jadis révélé les louches manœuvres pour faire échouer le projet de fédération des Ligues. Pour la sixième fois, le personnage reprenait un attentat qu'il avait essayé autrefois contre cinq il-lustres anti-maçons. Plus habitué à tirer sur ses compagnons d'armes que sur l'ennemi commun, il tentait aujourd'hui, après vingt ans, de tuer une œuvre gênante en dégradant la mémoire de son fondateur.
Quant au Directeur du Figaro, M. Coty, complice ou inspirateur de l'agression, quel intérêt avait-il à prêter les co-lonnes de ses trois journaux (les trois «Cotydiens») aux insultes de M. Gatebois-Brenier ? Naguère, Mgr Jouin lui avait proposé, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs, d'étudier un plan de mise en société de l'Institut anti-judéo-maçonnique, et la ques-tion était restée en suspens. Plus récemment, la Revue avait fait des réserves sur des articles de M. Coty contre les «Fi-nanciers juifs». Le mégalomane gardait-il quelque ressentiment d'une approbation incomplète ? Ou bien faut-il s'arrêter à un motif encore moins noble : Le désir d'acheter les complaisances du gouvernement pour éluder les conséquences d'un jugement qui l'avait condamné à verser trois cents millions à la femme dont il se séparait ?
Quoi qu'il en soit, Mgr Jouin était accusé d'abord, d'avoir été, en France, le chef d'une société secrète et pernicieuse, «La Sapinière». - L'année 1909 aurait été celle de son initiation - et la Revue serait devenue l'organe de la «Sapinière» française. Société, disait-on, dont l'origine semble bien maçonnique (Ce «semble bien» d'ailleurs dispensait de preuves).
Trois affirmations : trois mensonges. En admettant que la «Sapinière» - sobriquet dont fut affublé le Sodalitium pia-num, ou Association Saint-Pie V - ait compté Mgr Jouin parmi ses membres - et cela n'est pas - quel crime y aurait-il eu pour lui, puisque cette Association, fondée par un prélat de la Cour romaine, Mgr Benigni, n'était nullement une «société secrète» chargée d'espionner et de dénoncer à Rome certains personnages ecclésiastiques» ; mais de mener «la bonne lutte de la foi contre les erreurs et les malices du modernisme» (autographe de Pie X, 5 Juillet 1911) et qu'à diverses re-prises, de 1909 à 1921, date de sa dissolution, elle reçut les encouragements et les bénédictions pontificales. Pour ap-puyer son accusation, M. Brenier citait des papiers trouvés à Gand, pendant l'occupation allemande, chez un avocat, Jonckx, sans d'ailleurs donner plus de précision. Or M. Mourret de Saint-Sulpice, qu'on ne saurait accuser de partialité, nous a déclaré avoir vu ces papiers et n'y avoir pas trouvé le nom du Curé de Saint- Augustin.
D'autre part, il n'est pas cité à ce titre dans l'ouvrage de Nicolas Fontaine (M. Canet) où Brenier a puisé ses docu-ments, au point d'en reproduire jusqu'aux fautes d'orthographe. Et la R.I.S.S., que l'on affirme avoir été l'organe de la «Sapinière», n'y figure pas dans l'énumération des Revues recommandées par le Sodalitium pianum.
Enfin, un dernier témoignage, d'autant moins récusable qu'il vient d'un homme séparé depuis quatre ans de Mgr Jouin par des dissentiments graves, d'un homme renseigné, puisqu'il avait été un membre actif de la «Sapinière» avant sa dis-solution. «Jamais, déclare M. l'abbé Boulin, le Curé de Saint-Augustin n'a fait, à aucun titre, partie du Sodalitium pia-num... Il est faux qu'il ait figuré dans aucun papier de Gand authentique ; et je mets M. Gatebois au défi de faire la preuve du contraire. II sait du reste fort bien qu'il n'a mêlé à cette dispute le nom de Mgr Jouin que pour faire tas d'injures et jeter, vaille que vaille, sur cette vie, une ombre ou une suspicion». (La Sapinière, par Roger Duguet. Nouvelles éditions latines, 1933. Paris VI).
Il ne fit pas davantage partie d'une seconde association, d'une sorte de «Sapinière» rénovée, fondée en 1924, par le même Mgr Benigni, après la dissolution de la première, et pour laquelle deux «congrès» se seraient tenus à Paris et à Salzbourg.
Voici les faits, certifiés par deux témoins :
«En 1924, lisons-nous dans la Réponse à une odieuse campagne, quelques personnalités du monde littéraire et politique, connues par leurs écrits et leur activité anti-judéo-maçonnique, désireuses de dégager quelques idées, qui pussent servir de base d'action commune pour la défense de la civilisation chrétienne, s'étaient réunies à Paris. Mgr Benigni ne fut nullement l'initiateur de cette réunion...
«Après quelques séances, les invités se séparèrent sans avoir accepté aucune autorité, approuvé aucun statut, payé aucune cotisation, signé aucun compte-rendu ?»
La diversité de nationalité et de religion des membres de ce «Congrès» rendait Mgr Jouin méfiant : il n'assista à aucune des séances de travail ; «mais, préoccupé de tout temps de grouper les forces catholiques contre les sectes, il ne pouvait manquer de regarder, au moins avec curiosité, une tentative d'action tendant au même but, même par des moyens différents. Aussi, voulant manifester l'intérêt qu'il prenait à de semblables échanges de vues, il accepta de recevoir quelques-uns des «Congressistes» dans son salon, pour y entendre exposer leurs opinions». On lui offrit la présidence, «Messieurs, répondit-il, il n'y a pas ici d'assemblée, je ne puis donc accepter de diriger votre assem-blée. Mais mon âge me permet de présider à vos conversations». Mgr Jouin se contenta «d'écouter silencieusement, dans une attitude pleine de réserve». Une fois seulement, il prit la parole pour contester une opinion émise par un des assistants.
«Aucun vote ne fut émis, aucune résolution prise, aucun procès-verbal rédigé».
En quittant la salle avec Roger Lambelin et une autre personne, Mgr Jouin leur dit : «Somme toute, cela ne pour-rait aboutir qu'à une sorte d'internationale blanche, c'est plus dangereux qu'utile».
Et, peu après, paraissait dans la R.I.S.S. un avis judicieux mettant en garde contre toute Ligue internationale qui n'a pas le «contrôle renforcé de l'Église et de l'État» (R.I.S.S. année 1924, p. 650).
Quant au «Congrès de Salzbourg», dit la Réponse, nous affirmons sans crainte d'aucun démenti, que Mgr Jouin, ni M. l'abbé Boulin, ni aucun membre mandaté par notre Revue n'y assistèrent.
Nous n'insisterons pas sur le second grief fait à Mgr Jouin. La Réponse à une odieuse campagne (p. 25-35) établit nettement, avec preuves à l'appui, que M. Charles Nicoullaud, simple rédacteur à la R.I.S.S. ne fut jamais, comme on le prétend, secrétaire de Mgr Jouin qu'il n'était point l'ennemi des ordres religieux, que ses romans, (antérieurs, d'ailleurs, à son entrée à la Revue) sont irréprochables qu'il ne fut ni franc-maçon, ni théosophe, et qu'il combattit les uns et les autres toute sa vie.
Il faut lire toute cette argumentation, appuyée sur des citations et des textes irrécusables, pour se faire une idée exacte de la mauvaise foi du diffamateur.
Troisième accusation, plus grave celle-là, mais non moins mensongère : «Mgr Jouin aurait été le chef et le Pape - rien que cela ? de l'Action Française et l'aurait entraînée dans le schisme».
Et la preuve, assure sérieusement M. Brenier, c'est le titre de «vénéré Mgr Jouin» que lui décerne, au cours de cette polémique, M. Pujo. Le Curé de Saint-Augustin venait, en effet de mourir à 88 ans, entouré justement de la vénération générale.
Et si cet argument ne suffit pas à vous convaincre, voici une seconde preuve d'égale force.
«Pour eux, (les dirigeants de l’Action Française) une parole de Mgr Jouin paraissait être un argument sans réplique ; son veto ou son approbation déterminaient leur attitude». - «De ce veto, dit la Réponse, M. Brenier cite un exemple, un seul, celui qui aurait été lancé contre les campagnes de M. Coty contre la Finance Internationale : «veto» qui n'était qu'un simple regret, qu'une campagne utile, ne le devienne pas encore davantage par une information plus approfondie».
La R.I.S.S. et l’Action Française pouvaient d'ailleurs se rejoindre sur certains points, - dans le culte de Jeanne d'Arc, par exemple, ou dans la lutte contre un régime qui leur paraissait livrer la France à la Révolution et à la Franc-maçonnerie, sans qu'on puisse parler de collaboration. L'une et l'autre, sans s'être concertées, avaient le droit d'appeler un chat un chat, et Briand un Maçon.
De cette collaboration, M. Brenier, une fois encore, n'apporte aucune preuve. Nous pourrions donc dédaigner l'accu-sation. Par contre, cent témoins attesteraient l'indépendance absolue de Mgr Jouin à l'égard du journal en question. Lorsque l'accord existait, c'était un accord purement de fait, accord qui s'explique par la communauté du but poursuivi, ou des sources qu'ils utilisaient : la tradition antilibérale des Barruel, de Bonald, de Maistre, Claudio Jannet, Augustin Co-chin.
D'ailleurs, tandis que le journal attaquait les principes révolutionnaires et libéraux, d'un point de vue positif et histo-rique, le prêtre les combattait sans un angle surtout théologique : «Son action antimaçonnique, il la situait sur un plan surnaturel, mystique, en tous cas, en dehors et au-dessus des partis». (Réponse à une odieuse campagne, p. 37).
Mgr Jouin comptait parmi les abonnés de sa Revue et parmi ses Ligueurs, des gens de tous les partis, des républi-cains et des royalistes. Parmi ces derniers, plusieurs étaient et demeurèrent ses amis. C'était son droit, la sentence de Rome n'ayant pas frappé les idées politiques du journal, mais seulement ses idées religieuses. Intransigeant sur la doc-trine, il demeurait bienveillant pour les personnes, dans l'espoir de les ramener à Dieu. Il avait trop le sens de ses devoirs envers le Pape, qu'il exaltait dans un magnifique discours, en 1930, pour enfreindre ses décisions ; mais il avait aussi le sens aigu de ses droits, et il en usait jusqu'au bout.
Nous ne nous attarderons pas longuement à répondre au reproche qu'on lui a fait, «d'avoir été l'ennemi des ordres re-ligieux et rebelle à l'autorité ecclésiastique qu'il faisait diffamer».
Déjà la brochure que nous suivons (p. 26) a fait justice de l'hostilité prétendue de M. Nicoullaud contre la Compagnie de Jésus, hostilité qu'aurait partagée Mgr Jouin, et qui serait devenue comme «une marque de la maison». Même dans «Zoé la théosophe» et dans l'«Expiatrice», Charles Nicoullaud se défend lui-même avec force d'en vouloir le moins du monde à la Compagnie. Il s'en prend seulement à un de ses enfants perdus. On ne trouve nulle part de lui une critique de la spiritualité particulière de saint Ignace. On y trouve, au contraire, des passages comme ceux-ci :
«...La forte et sévère formation inculquée aux membres de la Compagnie de Jésus ne s'efface jamais. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent par la suite, les enseignements si profonds qu'ils ont re-çus, lors des deux noviciats, restent toujours imprimés au fond de leur cœur». (L'Expiatrice p. 79)
Plus loin, le P. Guissin, dirigeant une retraite, apparaît tout à coup transformé :
«C'est que ce merveilleux livre des Exercices, écrit par un si grand Saint, pour le besoin des âmes, agissait à la fois, sur le fils de saint Ignace et sur la pénitente». (p. 205)
Pas plus que son collaborateur, «Mgr Jouin ne s'était jamais attaqué à la Compagnie, comme telle ; il y comptait, au contraire, d'excellents amis. Moins que personne, il ignorait qu'elle a fourni à l'anti-maçonnisme quelques-uns de ses pré-curseurs et de ses maîtres les plus illustres. Son désir était de donner de quelques unes de leurs œuvres de nouvelles éditions critiques, notamment de Barruel, dont il existait alors de précieux manuscrits encore inédits entre les mains d'un religieux de la Compagnie. «La marque de la maison» n'était point un anti-Jésuitisme de mauvais aloi.
On ne doit donc pas, même pour défendre le Directeur de la R.I.S.S., séparer son image de celle de «ce premier, fi-dèle et très digne compagnon de sa lutte contre les sectes».
Ensemble, Mgr Jouin et M. Ch. Nicoullaud, avaient tracé le programme complet de l'anti-judéo-maçonnisme, ils y tra-vaillaient de concert : c'est ce que l'ennemi ne leur a pas pardonné.
Mgr Jouin n'était pas plus «rebelle à l'autorité ecclésiastique» qu'il n'était l'ennemi des religieux.
Si, au cours de sa longue et féconde carrière, dans des matières laissées à la libre discussion et en l'absence de dé-cisions définitives, il a parfois émis un avis différent de celui de hautes autorités, «il ne l'a fait qu'avec une extrême mo-destie, avec le poids que lui conféraient sa science théologique et sa longue expérience, et toujours en soumettant son jugement à l'avis de ses supérieurs». Il n'a donc pas eu a bénéficier de «l'indulgence» de son Archevêque, et le Cardinal Dubois ne lui manifesta aucune «sévérité». Il le visitait même à l'occasion amicalement dans sa paroisse et dans sa de-meure.
- «Ne craignez-vous pas, lui disait-il un jour, à la vue des couloirs obscurs où il avait dû abriter l'abondance de ses livres, qu'un homme se cache ici et vous assassine ?»
- «Oh ! Eminence, répondit gaîment le Curé, je m'en apercevrai toujours bien».
Mieux encore, apprenant que le Curé de Saint-Augustin, volontairement appauvri, se privait, faute de ressources, d'un séjour dans le Midi que sa santé réclamait, il lui offrit, sans succès d'ailleurs, de prendre cette dépense à sa charge.
Enfin, on ne saurait oublier que le Cardinal Verdier n'hésita pas à déplacer la date du conseil archiépiscopal pour pré-sider en personne la cérémonie de ses obsèques.
Nous avons, d'autre part, cité les paroles de Benoît XV dans le Bref Præstantes animi laudes, élevant l'abbé Jouin à la prélature romaine. Six ans plus tard, Pie XI lui octroyait, à titre de récompense, les privilèges de protonotaire apostolique, soulignant avec force par cette distinction les services rendus à la cause catholique par ce grand lutteur qui était prêt à sacrifier pour l'Église son repos, sa liberté, sa vie, s'il le fallait.
Après de tels témoignages, ce n'est plus de l'indignation, c'est de l'écœurement qu'on éprouve en lisant la dernière et la plus odieuse insinuation du calomniateur :
«N'ayant jamais eu d'intimité avec Monsignor Jouin, nous ignorons dans quels sentiments il est mort, et nous es-pérons pour son salut, que ce fut avec le repentir du mal politique et religieux qu'il avait causé pendant sa vie».
Nous savons, nous, comment il a vécu et comment il est mort, consolé par la présence de son clergé, entouré de prêtres et de religieux, visité au nom du Cardinal absent, par Mgr Crépin, et serrant dans ses doigts la bénédiction apos-tolique du Souverain Pontife. Et nous ne voulons retenir que la parole de Mgr Odelin, devant la couche funèbre :
- «Vraiment, c'était une figure qui faisait honneur au clergé de Paris».
Sa vie fut celle d'un grand serviteur de l'Église et de la France, sa mort celle d'un saint prêtre. Et nous souhaitons à son accusateur, à défaut d'une vie aussi honorable, une mort aussi rassurante. Ce sera notre seule vengeance.
Mgr Jouin n'en eût pas voulu d'autre.
LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN.
C'est ainsi que, sans négliger aucun devoir de sa charge pastorale, toute sa vie et jusque dans la mort, Mgr Jouin soutint le bon combat contre les Sectes. Il s'y livra même presque exclusivement à partir du jour où une pénible infirmité le retint plusieurs mois éloigné de sa paroisse et l'obligea à demander un coadjuteur de son choix : M. l'abbé Raymond, ancien second vicaire de la paroisse dont il avait conquis l'estime par son talent et ses vertus.
Jusqu'à cette année (1927), il n'avait voulu se décharger sur aucun de ses auxiliaires du soin des catéchismes de première communion, de la prédication ni de la direction de la paroisse. Et c'est avec raison qu'aux fêtes de ses Noces d'or sacerdotales et de ses Noces d'argent pastorales, deux grands orateurs dominicains : le P. Hébert et le R.P. Janvier, avaient loué en lui le prêtre, le pasteur, l'ami des enfants, le bienfaiteur des pauvres, le recruteur du clergé.
Mais dans tous ces portraits qu'on avait faits de lui, Mgr Jouin ne se reconnaissait pas. Il ne trouvait pas là le fonds de son âme, ni les mobiles essentiels de son action et le caractère par excellence de toute sa vie. «Il me souvient, écrit un de ses collaborateurs, de son mouvement d'humeur au milieu des félicitations qui l'assaillaient à la sacristie, à propos du beau discours du R.P. Janvier.
« - Sans doute, disait-il avec embarras, voilà qui est bien gentil de la part du Père, c'est même trop de compli-ments. Mais, ce qui m'ennuie, c'est qu'il manque dans ce portrait qu'on fait de moi et c'est que le Père ait dû taire jus-tement ce que j'ai fini par vouloir être surtout et qu'on sait bien que je suis.
Il s'était regardé sans complaisance dans le brillant miroir qu'on lui avait solennellement tendu et ne s'y recon-naissait pas, ni dans ces toasts où tour à tour avaient été exaltés, de sa naissance à ses derniers jours, tous ses titres et tous ses mérites comme prêtre, curé de Paris, prélat romain et l'un des doyens d'âge du clergé français.
Il ne se souvenait pour ainsi dire plus d'avoir été ce catéchiste incomparable, ce rénovateur du théâtre chrétien et tant d'autres hommes encore que la vie l'avait faits au cours de trois quarts de siècle. C'est seulement dans son œuvre anti-judéo-maçonnique, fruit de sa féconde vieillesse, qu'il se reconnaissait tout entier, qu'il saluait le couron-nement providentiel d'une carrière si pleine de bonheurs et si longue. C’est par elle qu'à ses propres yeux, sa physio-nomie se distinguait nettement de tant d'autres, chargées d'honneurs pareils mais d'autres mérites. Pour lui, sa vraie figure n'était pas tant celle du jubilaire qu'on avait tant exalté que celle presque passée sous silence (et déjà sourde-ment critiquée) de défenseur véritablement hors de pair de l'Église et de la France en face des Sectes et de leurs in-filtrations sournoises. Mgr Jouin est et reste par là le militant incomparable d'une suprême croisade contre Israël et les Loges pour le salut de son pays».
Ce jugement, pour exact qu'il soit, demande à être complété. Il ne suffirait pas d'admirer l'importance des œuvres ac-complies par Mgr Jouin ni la vaillance des coups par lui portés à l'ennemi : il faut pénétrer jusqu'à la pensée qui les a ins-pirés et, derrière ce qu'on voit, révéler ce qu'on ne voit pas.
Or la source où s'alimentait cette activité prodigieuse et cette ardeur inlassable, c'était sa foi, sa foi mystique. Sa vie en apparence tout active, remplie de fondations et d'œuvres, eut ce constant support.
Son recueillement, que ne venait point distraire la lecture des journaux ou des romans, était habituel. On sentait, en l'abordant, qu'on interrompait une conversation intérieure. «Je sors de chez l'abbé Jouin, disait le comte de Savignac après sa première visite à Saint-Augustin, il me semblait converser avec un moine». Souvent on le consultait sur des points délicats et difficiles : on le voyait alors se recueillir un court instant, et aussitôt tombait de ses lèvres un conseil si judicieux qu'on aurait pu le croire longuement réfléchi.
Cet esprit mystique qui perçait déjà au jour de sa conversion à Combrée et lui valut, jeune prêtre, des consolations spirituelles, qu'il prenait pour des extases, l'abbé Jouin le développa dans la suite par un commerce habituel avec les au-teurs mystiques : les Conférences de Cassien, les œuvres de Jean Tauler, les Dialogues de sainte Catherine de Sienne, les ouvrages de saint Thomas d'Aquin étaient ses livres de chevet. Il aimait à les citer dans ses retraites aux religieuses ou dans ses lettres de direction. «Recueillez-vous dans la cellule de votre cœur», aimait-il à répéter après la grande sainte dominicaine. «Courage, mon fils, écrivait-il à un jeune prêtre hésitant et timide, tu commences la route, ne regarde plus en arrière, pas trop en dedans, mais beaucoup en avant».
Quand survint, en 1924, la crise financière qui faillit emporter sa Revue, il écrivait à l'un de ses fils spirituels, l'abbé Ri-chard :
«Merci de t'être associé à la neuvaine pour la Revue. Est-elle agonisante ? est-elle morte ? Humainement parlant, il n'y a qu'à l'enterrer. Surnaturellement la solution est entre les mains de la petite Bienheureuse de Lisieux. Je vais m’endetter de ce mois de janvier, puis je suspendrai jusqu'à Pâques, et si rien ne vient, je renverrai l'argent versé pour l’année courante : l'impossible est un signe providentiel de rentrer dans le silence ; j'avoue que ce ne sera pas sans une blessure au cœur».
C'est aussi à la lumière de la foi qu'il jugeait les événements. Au-dessus de la mêlée des hommes et des partis qui semblent mener le monde, il voyait la lutte de deux armées invisibles. D'un côté le Christ avec saint Michel et les anges fidèles ; de l'autre, le démon et les anges déchus. Commencée dans le ciel, continuée au Calvaire, elle s'achèvera dans l'éternité par le triomphe du Christ et de Son Église.
Mystique, il l'était dans son activité : Dieu premier servi, était une de ses devises. La pensée qu'il ne travaillait que pour Dieu le rendait audacieux jusqu'à la témérité. Il s'était montré particulièrement actif dans une affaire sur laquelle, sans qu'il le sût, Rome s'était prononcée, et, pour plaider cette cause, il envoyait rapports sur rapports, essayant de faire parvenir jusqu'au Pape ce qu'il croyait la vérité : «Je crois, écrivait-il, que le second rapport est seul capable d'avancer mes affaires, quitte à me faire anathématiser. Je m'en remets au Bon Dieu pour qui seul j'ai travaillé». Il reçut en effet l'avis officiel de ne plus s'occuper de cette affaire, et il rentra humblement dans le silence.
Mystique il l'était surtout dans sa dévotion et dans ses dévotions. Sa piété le portait d'emblée vers Celui qui est la source vive de la vie mystique : l'Esprit-Saint, et vers Celui qui s'en est fait le parfait exemplaire : le Sacré-Cœur. Un de ses derniers écrits fut en effet la Préface d'un Chemin de la Croix avec le Saint-Esprit, et l’une de ses dernières œuvres, l'établissement dans sa paroisse d'une Confrérie en l'honneur de la troisième personne de la Trinité, «le Grand Mécon-nu».
Quant au Sacré-Cœur, combien d'articles n'a-t-il pas écrits sur cette dévotion, soit dans la Revue La Foi Catholique, soit dans le Bulletin Paroissial ? Pendant la guerre, il s'en était fait l'ardent apôtre. Il y voyait le salut de la France. Dans son discours du Mont Saint-Michel, il rappelait les trois demandes du «Message de 1689» qu'il rattachait mystiquement au culte du grand archange : un temple, une fête spéciale et l'emblème du Sacré-Cœur sur l'étendard du Roi.
«La Basilique, disait-il, est construite et consacrée et la statue de saint Michel en domine le chevet. La fête spé-ciale a été établie, et l'épiscopat français en a imposé la célébration au jour demande par le Sacré-Cœur : fête dans laquelle la Bienheureuse Marguerite-Marie voyait «un des moyens de ruiner dans les âmes l'empire de Satan». Reste le drapeau national sur lequel le Sacré-Cœur veut être peint. Saint Michel était jadis représenté sur le drapeau de Charlemagne et de Charles VII. Aujourd'hui, il lutte pour que le Cœur de Jésus vienne remplacer son effigie. Et qui peut dire, ajoutait-il, que l'heure n'en soit pas venue ?»
En attendant que ce vœu se réalisât, il en répandait l'idée et beaucoup d'églises, à son exemple, arborèrent le dra-peau national orné de l'emblème du Sacré-Cœur.
Ce vieillard chargé d'années et d'expérience ne croyait pas s'abaisser en adoptant les dévotions populaires. Pieux comme une femme vendéenne, humble comme un enfant, refaisant jusqu'à la fin leurs gestes naïfs, dévot aux images, aux médailles, à l'eau bénite, il avait un culte pour les saints dont il portait sur lui les reliques et dont il multipliait les sta-tues dans son église : pour les saints militants, saint Michel, qu'il prenait pour patron de sa Ligue, et Jeanne d'Arc, dont il célébrait la fête religieuse par une éclatante solennité et la fête nationale par l'illumination de son presbytère - pour les saints de France : sainte Geneviève, dont il fut le dernier chapelain et à qui chaque année, pour sa neuvaine, il faisait l'of-frande de sa maîtrise ; le Curé d'Ars dont il était un fervent imitateur, n'estimant, à son exemple, rien de trop riche pour le culte divin ; Bernadette, la Voyante de Lourdes, qu'il chanta en un si gracieux poème , saint Antoine de Padoue enfin, dont il requérait du pain pour ses pauvres et pour lui-même la grâce de «faire oraison tous les jours, de reprendre les mortifications, d'établir patronages, catéchismes, œuvres».
Glorifier les saints ne lui suffisait pas. Sa foi mystique entraînait à leur suite à des austérités et à des actes héroïques, comme on en lit dans la vie de ces grandes âmes. Dans l’éloge funèbre de Mère Agnès, l'admirable Servante des Pauvres, il citait d'elle ce geste surhumain : «Tourmentée de scrupule, elle me dit un jour : ma malade après avoir com-munié ne put retenir les saintes espèces. Croyant voir quelques parcelles d'hostie, je les avalai». Je crus, ajoutait-il, en-tendre sainte Catherine avouant à son confesseur que, pour vaincre ses répugnances, elle avait bu l'eau dont elle avait lavé la plaie d'Andréa, la cancéreuse». Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'un jour, lui aussi, avait imité l'acte de Mère Agnès, en prenant dans les ablutions de sa messe les restes maculés d'une hostie qu'une personne, subitement malade après la communion, n'avait pu retenir.
On ne sera pas surpris d'apprendre que ce prêtre, demeuré moine, pratiquait de dures austérités. Comme autrefois au Noviciat, il se flagellait, parfois cruellement, et les instruments de pénitence - disciplines de cordes et de fer - qu'à sa grande confusion, on découvrit un jour encore ensanglantées, et les gouttes de sang trouvées sur le parquet et jusque sur les murs de sa chambre disent assez à quelles macérations il livrait sa chair lorsqu'il voulait obtenir une conversion ou réparer quelque faute de son entourage.
A l'exemple des hommes d'œuvres de son temps, d'un Don Bosco à Turin, d'un abbé Fouque à Marseille, sa con-fiance en la Providence était extrême, tentatrice, mystique. Sans souci du lendemain, il ajoutait charges sur charges, et ses libéralités s'élevaient parfois d'un seul coup à 50 et 100.000 francs. Quand il mourut, il n'avait plus rien.
Il se dépensait lui-même, sans compter, au service de l'Église pour laquelle il eût volontiers donné sa vie et dont il se regardait comme le chevalier.
Mystique, il le fut jusqu'à la fin, et c'est là, croyons-nous, dans cette foi intense qu'il faut chercher la physionomie inté-rieure, la vraie figure de ce prêtre dont on peut dire, comme de l'abbé Planchât, ce martyr de la Commune, que «ses pieds ne tenaient pas à la terre, ni ses mains à l'argent, ni sa tête aux épaules».
(à suivre...)
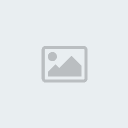
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 11)
* * *
CHAPITRE VIII LES DERNIÈRES ANNÉES.
CE QUE MGR JOUIN AVAIT ECRIT SUR SON AGENDA, LE 1ER JANVIER 1914. - SON ACTIVITE INTELLECTUELLE DANS LES DERNIERES ANNEES. IL PRONONCE D'IMPORTANTS DISCOURS. - IL CELEBRE SES NOCES D'OR, SES NOCES D'ARGENT PASTORALES ET SES NOCES DE DIAMANT. - IL REPOND AUX TOASTS DE SES AMIS. - BENOIT XV L’ELEVE A LA PRELATURE ET PIE XI LE FAIT PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE. - MGR RUMEAU LE NOMME CHA-NOINE D'HONNEUR D'ANGERS. - QUALITES ET VERTUS DE MGR JOUIN SUR LA FIN DE SA VIE : L'HOMME, LE PRETRE, LE MOINE. - IL POUSSE LA CHARITE ET L'AMOUR DES ENNEMIS JUSQU'A L'HEROÏSME.
Les années, en s'enfuyant, n'altéraient chez Mgr Jouin ni la lucidité de l'esprit ni la fraîcheur de l'imagination. Qu'on en juge par ces jolis vers tracés au crayon sur son agenda, le 1er janvier 1914, et que le temps avait presque effacés. Il y pleure ses années évanouies comme un songe :
Le fuseau de mes jours est tantôt effilé.
Il fut long, direz-vous : - long comme une chimère,
Comme un rêve de nuit brusquement déroulé,
Qui ne laisse au matin qu'une trace éphémère.
Hier n'est déjà plus, quand paraît aujourd'hui,
Que demain pousse en croupe et fait tomber de selle.
En cette chevauchée, hélas ! les ans ont fui
Plus vite qu'un vautour fondant à tire d'aile.
C'est une année, une autre, et puis dix et puis vingt,
Enfin soixante-dix qui se sont égrenées !...
Sous vos voiles de deuil, on chercherait en vain
A vous rendre la vie, ô mes belles années...
Les vingt dernières années de la vie de Mgr Jouin devaient être les plus remplies, les plus fécondes, les plus glo-rieuses.
Tout en vaquant aux occupations de son ministère, il avait trouvé le temps de préparer et de prononcer à Paris et en province d'importants discours - En 19118, l'éloge funèbre de la Révérende Mére Agnès - six ans plus tard, un discours pour le cinquantenaire de la Congrégation des Servantes des Pauvres, à Angers, discours que Mgr Rumeau appelait un «monument oratoire» - un an auparavant, invité encore par l'Évêque d'Angers, il avait parlé longuement à l'occasion de l'érection de l'église de Sainte-Madeleine du Sacré-Cœur en basilique mineure. - Enfin, en 1923, sur le désir de son il-lustre, ami, Dom Cabrol, il avait célébré le retour des Bénédictins dans l'Abbaye du Mont Saint-Michel, par un discours d'une rare élévation sur la mission du grand Archange dans la vie de l’Église !
Nous avons raconté comment, à trois reprises différentes, dans la chaire de Saint-Augustin - plus particulièrement à l'occasion des Noces de diamant de M. Eugène Gigout, organiste de la paroisse depuis soixante ans, il avait dit quel était l'homme, sa valeur et son œuvre. «Que dire de Me Gigout, s'écriait-il, lorsque seul, en face de son instrument, au terme d'une religieuse improvisation, réunissant sous la pression d'une machine pneumatique ses trois claviers manuels, aux-quels s'ajoute son pédalier, il fait résonner instantanément 600 tuyaux de son orgue à chacun de ses accords, taillant dans l'air, étonné de marches si triomphales, les sublimes degrés de ces ascensions que Dieu a mises au cœur de l'homme pour le conduire jusqu'à Lui ?
«L'émotion d'un tel artiste, unique créateur et unique exécutant de ce chef-d'œuvre, n'est plus du lyrisme, c'est, dans son sens le plus profond, de l'enthousiasme ébauché sur terre et achevé au ciel».
L'éloquence, la poésie, le cœur peuvent difficilement, croyons-nous, atteindre plus haut que ces pathétiques accents.
Ces dernières années ramenèrent aussi, pour le curé de Saint-Augustin, de glorieux anniversaires, et il dut entendre à son tour d'éloquentes harangues et se résigner à des éloges qui mirent à l'épreuve son humilité :
«Vous êtes un grand collectionneur de jubilés, lui disait, le jour de ses Noces de diamant, M. Péronne, l'aîné de son Conseil curial. Et, par un effet de la Providence, tous vos jubilés, sans exception, ont été célébrés à Saint-Augustin : Noces d'argent sacerdotales quand vous y étiez premier vicaire, et, depuis que vous y êtes revenu comme Curé, Noces d'or, Noces de diamant, et, entre les deux, vos Noces d'argent avec la cure de Saint-Augustin ; voilà des liens peu ordinaires entre une paroisse et son curé».
* * *
Noces d'or (23 Février 1918) - C'était en pleine guerre, le 23 février, notre situation était critique ; à la semaine sainte, elle semblait désespérée. L'ambulance n° 139 battait son plein. Malgré ces alarmantes conjonctures, le cardinal Amette s'était refusé à supprimer et même à ajourner la cérémonie. Deux jours plus tard, il faisait parvenir au jubilaire la nouvelle de son élévation à la prélature. Le bref de Benoît XV était des plus flatteurs :
«Les éminentes qualités que vous avez manifestées avec éclat au cours de votre longue carrière sacerdotale Nous décident sans peine à vous honorer d'une illustre dignité. Nous savons, en effet, que vous vous acquittez de votre ministère sacré d'une manière exemplaire, que vous avez la plus vive sollicitude du salut éternel des fidèles et que vous affirmez avec constance et avec courage les droits de l'Église catholique - non sans péril pour votre vie - contre les sectes ennemies de la religion, enfin que vous n'épargnez rien, ni labeurs, ni dépenses, pour répandre dans le public vos ouvrages en ces matières. Puisqu'il en est ainsi, Nous vous conférons d'autant plus volontiers un témoignage de bienveillance que, comme vous venez de célébrer le cinquantième anniversaire de votre sacerdoce, Nos félicitations pontificales sont le couronnement des vœux de tous les gens de bien».
De son côté, l'Evêque d'Angers, Mgr Rumeau, chargé par le cardinal Amette de demander pour le jubilaire la bénédic-tion, du Saint Père, élargissant le geste de son prédécesseur, Mgr Mathieu, lui conférait le titre de Chanoine d'Honneur de sa cathédrale.
Au cours de la messe solennelle, le R.P. Hébert lui avait adressé une allocution, gênante sans doute pour son humili-té, mais qui fit tant de plaisirs aux paroissiens. Après avoir signalé dans le Curé de Saint-Augustin le prêtre qui, depuis vingt ans, assurait dans son église, d'une manière irréprochable, la régularité des cérémonies, la décence et la splendeur du culte et donnait au dehors d'admirables exemples de dévouement aux malades par l'institution des Servantes des Pauvres, aux enfants, pour lesquels il s'était fait compositeur et librettiste, aux artistes enfin, qu'il rapprochait de Dieu - l'orateur montrait en M. l'abbé Jouin l'homme complet qu'il était : l'homme d'étude qui, dans sa jeunesse, ayant rêvé de devenir comme son frère fils de saint Dominique, prit sa revanche en se faisant Bénédictin ; car, depuis ce temps, c'est au milieu des livres qu'il a vécu – l’homme de caractère, «dont la volonté est capable de s'incliner quand elle le doit, mais qui ne se courbe jamais» - l’homme de cœur surtout, fidèle à son collège qu'il comble de ses générosités et peuple de ses disciples - fidèle aux religieux de son Ordre auxquels il ouvre largement les portes de son église - fidèle à ses frères dans le sacerdoce pour leur rendre les derniers devoirs et les accompagner de ses prières - ne l'avait-on pas vu un jour de ce dur hiver partir pour Saint-Médard et, à son âge, célébrer une messe tardive pour une défunte dont il n'avait plus la charge depuis vingt ans ? - fidèle enfin à l'Église pour laquelle il recrute sans cesse de nouveaux ouvriers.
«Je souhaite, disait l'éloquent Dominicain, à tous les Ordres religieux d'avoir dans le monde des novices qui les aiment avec cette persévérance - à tous ceux qui aiment d'avoir de pareils amis - au clergé français de compter beaucoup de cœurs qui l'aiment avec ce désintéressement et cette charité».
Du banc d'œuvre, le cardinal Amette s'était associé aux paroles du prédicateur «qui s'était exprimé avec une merveil-leuse délicatesse, une justesse parfaite, et avait décrit avec autant de cœur que d'esprit le caractère du pasteur et sa car-rière sacerdotale».
Aux agapes qui suivirent la fête religieuse et auxquelles assistaient avec l'évêque de Tarbes et de Lourdes, Mgr Schoepfer, le comte Jean Chandon de Briailles, le sénateur Delahaye, le sculpteur Louis-Noël, membre de l'Institut et le Ministre plénipotentiaire de l'Equateur, d'autres voix se firent entendre. A tous, avec un à-propos exquis et une modestie charmante, le jubilaire répondit.
Au cardinal Amette, il adressait un hommage et une prière : «l'hommage de tout ce que son cœur pouvait avoir de fi-lial et de reconnaissant et la demande d'une de ses prières pour que les jours de grâce de la vie présente lui fussent dé-sormais une sainte préparation à la vie future».
Du R.P. Hébert il disait :
«Les orateurs de sa trempe tirent tout de leur propre fonds, c'est là qu'il a cru me voir. Dans le portrait qu'il a tracé, il s'est peint lui-même, si bien qu'au lieu d'avoir dit ce que je suis, il a dit ce que je devrais être».
«Je sais bien, ajoutait-il, que l'on essaye de me persuader, que, si Dieu a changé l'orientation de ma vie, en m'ar-rachant à la vie monastique, mes cinquante ans de sacerdoce fournissent des jours remplis. Je suis bien loin d'en être convaincu.
«M. Macchiavelli disait : «La réputation d'un curé est celle que lui font ses vicaires». A entendre ce qui se dit sur mon compte depuis ce matin, mon clergé a bien travaillé et m'a fait une réputation enviable pour tout curé de Paris... Si l’on tient peu de cas de celui qui n'est loué que de son curé, ne faut-il pas craindre qu'il en soit ainsi du curé qui n'est loué que de ses vicaires ?»
Au Curé de Saint-Étienne du Mont qui avait évoqué le souvenir de ses élèves ecclésiastiques, de ses deux Patro-nages, de la Nativité et de la Passion :
«Je suis, répondait-il, devenu, il est vrai, le pourvoyeur des économes des petits et des grands Séminaires ; mais la charité des fidèles est venue à mon aide, et, de ce chef, mon mérite est infiniment petit». Quant à ses pièces de théâtre, il les avait composées, mais c'est M. Sauvêtre qui les avait fait exécuter.
Quant à M. la Caille - qui avait évoqué les combats lointains de Joinville-le-Pont et ceux plus proches des Inventaires et le procès devant la XIIe Chambre, toutes «ces épreuves dont l'abbé Jouin était sorti grandi et non moins humble» - c'était un homme «plein de charité pour son prochain et pour son curé en particulier. Autrefois magistrat intègre, il est de-venu, sans doute, sous l'action de la grâce et du Sacré-Cœur, un avocat qui dissimule les faiblesses de son client, et non plus le juge qui porte en toute justice une rigoureuse sentence».
Pour M. le Vicomte d'Hendecourt «qui a réveillé le souvenir vieux de douze ans, du siège de Saint-Augustin, auquel il m'a attribué une influence à la hauteur des tourelles de l’église où j'ai couché, en effet, pendant quatre mois, le malheur est que mes nuits ne furent jamais troublées. Tout au contraire, le jour se passait sur pied de guerre, avec M. d'Hende-court au titre de général, ayant pour colonels mon regretté M. de Boismorel et M. Jean de Lannoy, de nature militante, qui m'a souvent soutenu dans mes travaux contre la Franc-Maçonnerie...»
Par rapport à l'ambulance dont on avait beaucoup parlé, sur ce point encore, comme sur les autres, il fallait «rabattre des éloges qu'on lui avait adressés, ou plutôt les aiguiller vers leurs destinataires : son chirurgien, le docteur Mauclaire, et son médecin chef, le docteur Moizard, dont la science et les soins ont, à la lettre, ressuscité des condamnés à mort» - les Servantes des Pauvres aidées par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, et les infirmières si dévouées, si parfaitement bonnes. «Voilà les ouvriers et les ouvrières qui ont produit le grand bien physique, moral et religieux de l'Hôpital auxiliaire n° 139». Il n'avait fait que «transmettre» les fonds de la charité. «Encore est-il que la prolongation de la guerre, épuisant les ressources de tous, il n'aurait pu continuer son œuvre, si le Ministre de l'Equateur, M. Dorn y de Alsua, n'était venu à son secours et n'avait fait de son ambulance l'hôpital franco-équatorien».
Enfin, jetant un regard sur les convives amis assis à sa table, il eut un mot gracieux et délicat pour chacun d'eux : pour M. Louis-Noël, l'auteur des deux statues monumentales de saint Augustin et de sainte Monique - don de la paroisse - le sculpteur qui, selon le vers du poète, «Fait au marbre étonné de superbes entailles»
- pour le comte Jean Chandon de Briailles qui, malgré le passage des Prussiens à Epernay a pour ses amis des ré-serves de son «crémant impérial», chaud et bon comme son cœur. Ce nectar des dieux, il en est sûr, inspirera à ses compatriotes, le sénateur et le député Delahaye «quelques discours incisifs et vengeurs qui nous vaudront les victoires de l'arrière, premier gage des victoires du front».
Relevant enfin sur la chasuble offerte par son clergé - un magnifique ornement de couleur verte «couleur d'espé-rance» - l'inscription : Ad multos annos, qu'il traduisait ainsi : Aux Noces de Diamant ! il demandait à tous un serment et prenait un engagement :
«En temps de guerre, il faut être brave et rester debout au poste de combat. Aussi, confiant dans vos vœux et vos prières, je prends l'engagement de célébrer mes Noces de diamant le 23 Février 1928, à la condition expresse que tous ici, sans exception, jurent en conscience de venir à cette date partager, une dernière fois, du coup, les mêmes agapes fraternelles».
Il devait tenir parole ; mais auparavant, il eut à célébrer un autre jubilé : celui de ses noces d'argent avec la cure de Saint-Augustin.
* * *
Noces d'argent pastorales (25 Janvier 1924) - Le Souverain Pontife Pie XI voulut s'associer à cette fête en élevant Mgr Jouin, déjà prélat, à la dignité de protonotaire apostolique qui lui donnait le privilège de porter, en certaines circons-tances, l'anneau et la mitre, honneur dans lequel le jubilaire ne voulut voir qu'un lien de plus avec le Pape, une approba-tion de ses travaux et de ses luttes et un nouveau motif de dévouement à l'Église.
A la fin de la cérémonie religieuse, lui-même fit distribuer à la foule des fidèles présents une image du Patron de la pa-roisse, petit signet de livre d'heures, portant au verso cette parole du grand Docteur : De bonis ovibus fiunt boni pastores, les bons paroissiens font les bons pasteurs. Tel fut le thème du rapport qu'il lut du haut de la chaire au cardinal Dubois et dans lequel il s'attacha à démontrer que s'il s'était fait quelque bien, soit au point de vue matériel, soit sous le rapport spi-rituel, au cours des trente-trois années qu'il avait passées à Saint-Augustin - huit ans comme vicaire et vingt-cinq à titre de curé - c'était à ses paroissiens et à tous ses collaborateurs qu'il fallait en faire remonter le mérite.
Qui donc, en effet, avait permis de réparer les brèches ouvertes dans le budget paroissial par la loi de séparation, si-non les fidèles qui supportent seuls l'impôt du Denier du Culte ? Le Curé n'est que le dépositaire de ces fonds religieux, aidé dans leur administration par le Conseil de Fabrique, aujourd'hui Conseil curial.
Et le Curé se plaisait à évoquer les noms de ces administrateurs émérites qu'avaient été, en ces 25 années, les Chesnelong, «chez qui la parole et la foi marchaient de pair, le front haut, dans cette attitude indomptable d'un lutteur qui ne doute pas de la victoire définitive» - les baron de Nervo, «âme chaude sous une écorce trop impassible» - les baron de Livois, «homme d'œuvres et de grande vertu» - les Boutillier «dont la science rayonnait au travers d'une excessive modestie et qui, avec son successeur, M. la Caille, devint l'un des artisans les plus précieux de la Basilique du Sacré-Cœur».
Passant en revue les améliorations matérielles apportées dans l'église, il s'arrêtait à la restauration du grand orgue à son arrivée, qui lui avait donné l'idée de transférer le petit orgue et la maîtrise dans la tribune de droite, pour dégager le chœur, lui rendre sa forme primitive et faciliter le passage qui le sépare de la chapelle de la Vierge. De ce fait, disait-il, grand et petit orgue commençaient avec lui un nouveau bail qu'il pouvait croire définitif.
«Hélas ! ajoutait-il, il n'en est rien ; j'ai traversé sans trop de fatigue mes 25 ans, et mes deux orgues sont à bout de souffle. Je ne sais si la fourmi dirait à ces gigantesques cigales :
«Vous chantiez ?...
Eh bien ! dansez maintenant».
Ce que je sais trop, c'est qu'il s'agit de coûteuses réparations».
Et ce que les paroissiens savaient - eux, les laborieuses et généreuses fourmis - c'est que si leur pasteur employait, comme la fourmi du Fabuliste, le mot de «danse», ce mot ne pouvait s'adresser qu'à leur bourse.
Il passait, avec raison, pour faire exécuter dans son église de bonne musique religieuse. «La peine, explique-t-il, en revient à mon maître de chapelle, M. Vivet, les frais aux fidèles et l'honneur au Curé».
On lui fait gloire de sa résistance au moment des Inventaires, de ses veilles dans les tourelles de l'église. Mais, le jour, des escouades de veilleurs se succédaient sans interruption, du 13 février au 9 juin. De cette persévérante fidélité, il gar-dait une légitime fierté ; «et les chefs de file : MM. de Boismorel, d'Hendecourt, de Lannoy et, à la tête de la classe labo-rieuse, M. David, avec les noms de tous ceux qui leur ont prêté un inlassable concours, sont au livre d'honneur de la pa-roisse et au livre de vie au Ciel». C'étaient eux, plus encore que lui-même, qui avaient défendu les droits de Dieu.
«C'est grâce à leur résistance et à celle des catholiques de France que peu à peu la loi de Séparation, au lende-main d'une guerre de quatre ans, a subi un fléchissement, symptôme d'une future révision et d'un loyal Concordat, base d'une irrévocable alliance entre la France et l'Église».
Passant à la vie spirituelle que le Curé doit communiquer à ses paroissiens par l'exemple - par la parole - et par le don de lui-même, il observait que :
«la vie du pasteur est de cristal, que les yeux des fidèles percent les murs du presbytère, qu'il est en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. On nous observe pour constater la supériorité de l'âme sur le corps, au prix des macérations, s'il le faut ; pour contrôler l'idéal dont il est défendu de déchoir ; pour suivre pas à pas notre apostolat, fait de désintéressement ; pour nous voir à l'église, au chevet des malades, uniquement occupés à écrire le nom de Jésus dans les âmes ; pour se rendre compte enfin si nous avons laborieusement gagné le pain du Christ et bu Son calice de bénédiction, à la sueur de notre front et si, parfois, cette sueur-là n'était pas vermeille de notre sang».
Sous ces traits les fidèles n'avaient pas de peine à reconnaître leur propre pasteur. «Mais combien, ajoutait-il, ce la-beur sacerdotal est excité et soutenu par l'exemple de paroissiennes, comme celles dont il avait admiré l'héroïsme dans son ambulance !»
A l'exemple, le pasteur doit joindre la parole. Cet enseignement, il l'a donné, suivant le conseil de l'Apôtre, en temps et hors de temps. A la messe de onze heures notamment, il a dit des vérités opportunes et inopportunes pour quelques-uns.
«Prêcher, disait-il avec saint Augustin, la miséricorde divine basée sur la foi sans les œuvres, tolérer les spec-tacles, les modes et les fêtes voluptueuses ; encourager les excès de table sous prétexte que ces biens sont le par-tage des chrétiens comme celui des païens, c'est être parmi les mauvais pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître leurs brebis».
Et encore :
«Dire aux amants du monde : «On ne peut servir deux maîtres, à la fois ; dire aux amants d'eux-mêmes : Ne vous y trompez pas, le dédoublement factice de l'homme privé et de l'homme public ne vaut pas devant Dieu ; au jour du jugement, vos œuvres vous suivront ; prêcher de la sorte la vérité, c'est mettre en pratique la règle de saint Jacques : cela est, cela n'est pas ; cela est vrai, cela est faux ; cela conduit au Ciel, cela conduit en Enfer».
C'était bien là le fond de la prédication du Curé de Saint-Augustin ; mais aussitôt il ajoutait :
«Je crois pouvoir rendre ce témoignage que telle fut toujours, au cours de ces 25 années, la prédication à Saint-Augustin, et que cette salutaire intransigeance, inaccessible aux innovations modernes, est tout à l'honneur de mon clergé dont l'intégrité de la doctrine et la sûreté de l'enseignement rejaillissent jusque sur leur curé».
Quant à la prière pour le peuple, c'est surtout à la messe que le pasteur l'adresse à Dieu en faveur des âmes qui lui sont confiées et en union avec elles, puisqu'elles partagent, dans une certaine mesure, son sacerdoce :
«Depuis 25 ans, mes frères, j'ai célébré plus de 10.000 messes en communion avec vous ; nous avons uni en-semble mon sacrifice et le vôtre pour cimenter l'union de nos cœurs, et à l'élévation de l'hostie, nous nous sommes écriés : Mon Seigneur et mon Dieu ! Aimons-Le donc ensemble, puisqu'Il nous a tant aimés».
Au terme de ces 25 ans, le pasteur serait tenté de dire à Dieu avec Job : «Donnez-moi, Seigneur, un peu de repos pour que je pleure douloureusement ma vie perdue avant de faire le voyage dont on ne revient pas» ; mais puisqu'il fallait encore poursuivre la route, il demandait à ses paroissiens de s'unir à lui dans une ardente prière d'action de grâces pour le passé et de confiance pour l'avenir.
Après ce rapport, où l'humilité du pasteur avait cherché à s'effacer, le doyen du Conseil curial. M. la Caille, remit les choses au point. Il rappelait le vivant souvenir que la paroisse avait gardé du second et du premier vicaire des années 1886 à 1894 :
«Oh ! vous ne faisiez pas grand bruit, lui dit-il. Moine de par la formation que vous aviez reçue des fils de saint Dominique, moine vous êtes resté, couché comme les Bénédictins de Saint-Maur sur des volumes poudreux pour leur arracher leurs secrets ; moine guerrier vous devîntes, au jour des Inventaires, où Saint-Augustin s'est si bien dé-fendu sous votre commandement, qu'il a fallu la ruse pour en avoir raison. Mais, par contre, sans vous mériter tout à fait le martyre, cela vous conduisit en police correctionnelle... Plus tard, vous fondiez l'ambulance,... vous présidiez à tout ; les pauvres étaient largement secourus, les malades visités, l'argent vous glissant des mains pour les grandes infortunes... Il faut bien, cher Monsieur le Curé, que vous entendiez ces vérités. Elles ne doivent pas être mises sous le boisseau. L'occasion est unique pour le Conseil curial de les faire connaître à qui les ignore».
* * *
Noces de diamant (23 Février 1928) - On avait pu craindre un instant que Mgr Jouin ne fêtât pas ses Noces de dia-mant. En 1926, une crise grave des reins avait mis ses jours en danger. En raison de son âge, le docteur Bazy, n'avait pas osé opérer le malade ; il dut rester huit mois hors de sa paroisse. Il se remettait à peine quand, sur un trottoir de Lourdes, une voiture automobile sans conducteur le renversa et lui passa sur le corps : c'était le 9 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame de Pellevoisin, et dans la cité de Marie. Elle l'avait manifestement préservé. Moins de dix jours après cet accident, on le retrouvait dans son bureau en face de ses dossiers. Deux ans plus tard, fidèle au rendez-vous de ses Noces d'or, il célébrait la soixantaine de son sacerdoce.
Le sénateur Dominique Delahaye et le comte Jean Chandon de Briailles, le Conseil curial, son clergé, de nombreux amis, des artistes célèbres l'entouraient. Le cardinal Dubois, pour la seconde fois, présidait ; le R.P. Janvier était en chaire. L'illustre conférencier de Notre-Dame évoqua les tristesses et les deuils, puis les joies de l'Église et du jubilaire au cours de ces soixante années de vie sacerdotale. Dans l'ordre intellectuel et moral, dans les esprits et les cœurs bien des ruines s'étaient accumulées. Dans sa vie personnelle, «sans compter les contradictions et les hostilités ouvertes ou sour-noises», il avait connu des deuils et des séparations qui lui avaient arraché les êtres qu'il aimait le plus : «sa mère et deux frères - la moitié de son âme» ; la fragilité de sa santé avait souvent trahi ses desseins :
«Je n'ai point oublié, disait le Père, en évoquant ses souvenirs, nos promenades sous les beaux cieux, sur la côte d'azur, dans les grandes forêts, au milieu des oliviers et des orangers de toute cette riante nature de la Corse. Com-bien alors on avait lieu de craindre pour vous une fin prochaine !»
A travers ces épreuves, des joies lui avaient souri : à tous les assauts, l'Église avait résisté ; elle reprenait sa place dans la société ; le clergé avait vu son zèle exalté par la persécution ; les Ordres religieux bravant la tempête avaient re-fusé de mourir.
«Vous-même, malgré votre mauvaise santé, vous avez travaillé sans répit et vous travaillez encore pour le règne de Dieu. Les Sectes complices des puissances d'argent et encouragées par une politique fatale à notre pays comme à l'Église ont trouvé en vous un adversaire résolu».
Le présent autorisait toutes les espérances de l'avenir.
«Vous êtes de ceux dont le temps renouvelle la jeunesse. Jamais vous n'avez été plus fort, jamais, me semble-t-il, vous n'avez été plus exempt d'infirmité... Vous jouissez d'une autorité progressivement grandissante, vous portez au front une auréole que la Providence accorde rarement à ses meilleurs amis, l'auréole d'une vie sans tache, pleine-ment chrétienne, pleinement dévouée, pleinement sacerdotale, pleinement apostolique, bien qu'elle ait duré près d'un siècle... Les anges de la Provence et de la Bourgogne, de Paris et de l'Anjou veillent sur vous et garderont toutes vos voies... Quelles qu'aient été vos prédictions au moment de vos Noces d'or, ce n'est pas la dernière fois que vous nous réunissez autour de vous...»
Au repas qui suivit la cérémonie religieuse, d'autres voix s'unirent à ces éloges et à ces vœux de l'éloquent domini-cain : celle de M. le premier vicaire, au nom du clergé - celle de M. le Curé de Saint-Etienne du Mont glorifiant l'ouvrier in-fatigable qui parmi tant de travaux, trouvait encore le temps de réunir les éléments d'une «Histoire de la Paroisse de Saint-Augustin» et le félicitait d'avoir eu la joie d'assister, pour son 80e anniversaire, à la 100e représentation de la Nativi-té - de M. Péronne saluant, au nom du Conseil curial, le pasteur qui, par son action personnelle, par le dévouement à tous et l'irrésistible élan du cœur, avait su réaliser avec sa paroisse l'union la plus étroite. Après une allusion aux deux orphelins adoptés par le bon pasteur, il avait ajouté :
«Malgré la simplicité et la discrétion avec lesquelles ces œuvres furent accomplies, le bruit s'en répandit, et ceux qui ne connaissaient pas encore les trésors de charité que Dieu a mis au cœur de leur Curé, durent enfin com-prendre et furent conquis».
A son tour, le jubilaire prit la parole :
«Ce n'est que trop vrai, Eminence, répondit-il : des quarante-quatre invités du 23 Février 1918, seize sont partis pour un monde meilleur».
Parmi ces disparus d'hier, il évoquait particulièrement trois noms : le cardinal Amette, le R.P. Hébert, Maître Gigout.
«C'était en pleine guerre. Deux jours après, Son Eminence le cardinal Amette me faisait parvenir par son Secré-taire, M. le chanoine Clément, la nouvelle de mon élévation à la prélature pontificale. J'appris ensuite que je devais cette distinction à l'entremise de Son Eminence le Cardinal Granito di Belmonte qui venait jadis confesser les Italiens de la rue Mouffetard, et daigna ne jamais oublier le modeste Curé de Saint-Médard.
Aujourd'hui, nous sommes en pleine paix ; et je me souviens, Eminence, que vous êtes venu, il y aura quatre ans, le Vendredi Saint, le soir, à six heures, m'apporter le bref qui me nommait Protonotaire Apostolique, ayant soin de me faire remarquer qu'à la suite de votre nom, vous aviez tenu à ajouter celui du Révérendissime Père Abbé de Farnbo-rough, dom Cabrol, l'ami fidèle d'antan.
«J'ai dit que nous sommes en pleine paix, car, en dépit de quelques mauvaises langues, mon compatriote, le sé-nateur Delahaye et moi, nous sommes des pacifistes, persuadés d'ailleurs du vieil axiome : Si vis pacem, para bel-lum, convaincus que la sécurité des frontières est le premier gage de pacification, si bien qu'en cas d'attaque brus-quée, notre armée ait le temps, non plus de reculer de dix kilomètres, mais d'avancer de dix lieues sur le territoire ennemi ; pénétrés enfin, sans humanitarisme, de l'amour de l'humanité, secondaire toutefois à l'amour de la France».
Il évoquait ensuite la figure du R.P. Hébert :
«Vous le remplacez, cher Père Janvier, de même qu'il vous remplaçait en 1918 ; vous ne faisiez qu'un. Aujour-d'hui, l'union est plus intime, car vous êtes tous les mêmes. Vous avez votre idéal de vie religieuse, vous en cherchez intérieurement la réalité, puis vous appliquez ce portrait subjectif à une figure objective qui, dans l'espèce, est en ce jour la mienne. Tableau bien brossé, mais la ressemblance est incontestablement contestable».
Il se tournait alors vers les vivants, vers les amis et les artistes qui l'entouraient et près desquels «il retrouvait la vie, sinon la verve d'il y a dix ans». N'avait-il pas près de lui, à la même place qu'en 1918, le comte Jean Chandon de Briailles, «dont l'amitié et, pour un peu aussi, le délicieux Champagne, devenu le «crémant pontifical», lui rendent le cœur joyeux et prêt aux nouveaux combats qu'on lui annonce ?» - N'avait-il pas ses médecins : le docteur Chiron, toujours pré-sent à la moindre alerte, le docteur Bazy, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, «délicatement empressé de lui faire oublier le dur contact du fer ou de l'acier par de charmantes réunions familiales avec François Coppée et Mgr Odelin ; et enfin le docteur Lacronique qui reportait son souvenir sur le regretté et aimé docteur Sauvez, prématurément enlevé dans la force de l'âge ?» - S'il ne voyait pas devant lui M. la Caille, l'aîné de son Conseil curial, qui entrait dans sa 90e année et qui l'encourageait de parole et d'exemple dans cette course d'une vie prolongée, il avait, par contre, M. Pé-ronne «qui lui fut très indulgent, dit-il, en soulignant de menus faits semés négligemment dans sa vie curiale par la Provi-dence». - Il avait son premier vicaire et son clergé qu'il remerciait du riche chapelet qu'ils lui avaient offert, ainsi que l’Ouvroir des Enfants de Marie du merveilleux ornement qu'il avait étrenné le matin.
«Avec les dalmatiques et les trois chapes, c'est un ouvrage princier pour la paroisse, commencé, disait-il, sous l'inspiration de M. Raymond, curé de Saint-Denis du Saint-Sacrement, et terminé sous le regard averti de M. Baron-net».
Vint enfin le tour des artistes, qui n'avaient pas pris la parole, mais qui avaient si bien fait parler leurs instruments et leur voix à la cérémonie du matin. Maître Gigout n'était plus là.
«Mais son successeur et ami, Maître Huré, enveloppe souvent son jeu comme de voiles de deuil d'une transpa-rence qui laisse entrevoir le cher disparu. Son orgue était un orchestre : à son tour, sous les doigts du premier vir-tuose français et premier interprète mondial de Beethoven, le piano m'a donné la même illusion. J'envoie un salut re-connaissant à Maître Risler, dont la présence et l'amitié m'honorent, me réjouissent et me reposent. Car la musique est un repos au milieu des trépidantes occupations de la vie actuelle, et une envolée au-dessus des affaires, des in-térêts, des incertitudes de l'heure présente».
Il l'avait éprouvé, disait-il, durant l'inoubliable cérémonie du matin où, pour la première fois, «on avait entendu une cantate diamantée de M. Vivet». Et il priait Son Eminence de vouloir bien remettre à son Maître de chapelle la croix de Chevalier de Saint-Grégoire et d'étendre sa bienveillance à toute la maîtrise représentée par M. Dardigna - son organiste - MM. Lacaze et Texier - ses solistes - avec M. Dossogne, a la plus forte basse des maîtrises parisiennes», pour qui le Cardinal avait obtenu la médaille Bene merenti.
Ainsi, dans cette longue énumération, sa délicatesse n'oubliait personne. Il terminait par ce dernier mot :
«Les noces de diamant sont rares et étincelantes ; mais soixante ans de sacerdoce supposent d'incalculables responsabilités. Des noces de radium, cinq ans ou dix ans plus tard, sont plus rares encore, on risque d’y arriver en état de seconde enfance».
A ces causes, il demandait à tous les amis qui l'entouraient, une prière pour que, jusqu'à son dernier soupir, «il restât debout dans la lutte pour la France et pour l'Église».
* * *
Pour faire un prêtre, plus encore un saint, il faut d'abord un homme. La loyauté, l'amour du travail, le sérieux, la bien-veillance et la charité fraternelles, requises du simple laïc, sont des qualités encore plus indispensables au ministre de Dieu. Mgr Jouin gémissait quand il ne les trouvait pas autour de lui, quand il voyait au contraire chez quelques-uns «une formation de collégien qui suit au séminaire, puis dans le ministère, dans la vie publique et jusqu'à l'ombre du cloître». Ecrivant à l'un de ses plus chers disciples, l'abbé Richard, il le mettait en garde contre certains défauts qu'on néglige trop de surveiller : «l'esprit de jalousie, de critique, d'égoïsme, de vie paresseuse, trop facilement satisfaite du bréviaire, du journal, parfois d'une revue», et lui recommandait d'avoir soin «de ne pas greffer la grâce - et particulièrement celle du sacerdoce - sur un arbuste trop chétif et sur une nature anémiée».
Chez lui, l'arbuste était vigoureux, le sol riche et généreux ; la fleur de la sainteté pouvait s'y épanouir largement. De l'homme, vir, il possédait non seulement les qualités fondamentales : un grand cœur et une volonté puissante ; mais celles même qui peuvent sembler secondaires.
Sa tenue était toujours digne et sérieuse. Même quand il était obligé de dépouiller le costume ecclésiastique, comme dans son voyage en Angleterre pour la bénédiction abbatiale de Dom Cabrol ou à travers les régions protestantes de la Scandinavie, il gardait un extérieur irréprochable ; à son air grave et recueilli on reconnaissait le prêtre. L'un de ses com-pagnons de voyage en Norvège défiait un jour une protestante, rencontrée entre Stockolm et Upsal, de deviner la profes-sion de chacun des cinq voyageurs qu'elle avait devant elle. Parcourant du regard les inconnus, elle fixa d'abord l'abbé Jouin et, sans hésiter : «Monsieur est un moine», prononça-t-elle.
Distingué, mais sans recherche dans sa personne, il ne faisait pas cependant de cette distinction le signe toujours cer-tain et exclusif de la sainteté :
«Pour le Père P., écrivait-il au même abbé, c'est un saint prêtre, mais on ne saurait, en effet, le donner comme un modèle de tenue ecclésiastique. Peut-être faut-il être ainsi en Palestine où il porte ses pas ? quoi qu'il en soit, sa vie est bien extraordinaire et déjà pleine de faits surnaturels marquants. Dieu se récrée à faire des prodiges avec quelques âmes privilégiées, pour oublier les nausées que lui infligent l'immense majorité des tièdes et des mé-diocres... Une âme encore bien surprenante, est celle de M. E... C'est la «foi vivante».
Mgr Jouin ne voulait pas être rangé parmi ces inutiles et ces médiocres. Au soir de sa vie, sentant venir l'heure où l’on ne peut plus rien, il redoublait d'ardeur au travail et prolongeait ses journées en prenant sur ses nuits.
«Mon plus grand agrément serait de faire connaissance avec le bon Père Foy. Demande-lui ses prières pour moi. J'en ai besoin pour l'âme et pour le corps. Pour l'âme ça date de 78 ans. Pour le corps, je me suis aperçu que j'avais perdu l'œil droit, comme Philippe à Pharsale, mais pour une autre raison.
J'ai eu une hémorragie qui a fait tache noire. Elle s'atténue un peu, sans qu'on puisse affirmer encore si elle dis-paraîtra. Je devais être dans cet état à mon insu, depuis deux ou trois mois, car je m'apercevais seulement que ma vue était brouillée. Je ne lis pas moins jour et nuit, ce qui n'est pas sans doute un remède coté dans le Codex (27 mai 1923).
Quelques mois après, de Fouchy, en Alsace, où il passait ses vacances dans la demeure hospitalière de l'abbé Ant-zenberger, son ancien vicaire et son commensal à Saint-Augustin, il écrivait encore : «Ici, les sapins sont à deux kilo-mètres en montagne à pic, mais il fait un tel vent que je reçois leurs effluves à domicile. J'ai fini hier mon chapitre sur 1848 - Je vais me mettre au second Empire ; puis j'aurai «la Commune» et cela me fera cinq chapitres et mon Ve volume. - Si je n'avais pas le sermon sur saint Michel, tout serait fini durant les vacances. D'autre part, je ne pouvais pas dédai-gner saint Michel, puisque c'est lui qui chasse le diable et les Maçons... Le Bon Dieu est bien avec toi ; prends des forces pour le servir et étendre Son règne».
Cette conviction, qu'un prêtre a pour mission d'étendre le règne de Dieu et qu'il n'est jamais assez armé pour défendre l'Église, explique chez Mgr Jouin cette activité inlassable qui nous déconcerte :
«Depuis mon retour de Rome, écrit-il au même jeune prêtre, le 2 janvier 1924, je n'ai pas arrêté : visite pastorale, travaux en retard, Revue, Noces d argent de M. Zemmer, réceptions de Noël et du Jour de l'An, c'est l'engrenage d'une chaîne sans fin. J'ai bien 100 lettres à écrire et je commence dans huit jours mon Adoration perpétuelle, et je reçois en même temps Dom Cabrol... Quant aux visites, elles sont emportées par les inondations !»
Pendant les dix ou quinze années qui lui restaient à vivre, constate M. l'abbé Chupin, dans un remarquable article du Bulletin des anciens élèves de Combrée, l'activité intellectuelle et physique de Mgr Jouin semblait à peine faiblir. Malgré son aspect débile, il conservait presque entières les forces qu'il avait protégées toute sa vie au prix de soins constants.
«L'année même de sa mort, il avait annoncé sa visite au Collège pour la fête des Anciens. Au travail de bonne heure, jusque tard dans la nuit, il se tenait au courant de toutes les nouveautés. Du fond de sa bibliothèque silen-cieuse, il dirigeait l'évolution de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, rédigeait de nombreux articles et composait d'importants discours qui témoignaient de la vivacité de son esprit. Ceux qui le visitaient alors étaient frap-pés par la limpidité de son regard tout rayonnant d'intelligence».
Sa belle humeur, son entrain, sa gaieté même, aux heures de détente et au cours de ses voyages n'étaient que le fruit naturel de cette prodigieuse activité. Il était docile au conseil du poète à la jeune ouvrière dans ces vers qu'il avait souli-gnés dans son Victor Hugo :
Travaille : Dieu, vois-tu,
Fit naître du travail, que l'insensé repousse,
Deux filles : la vertu qui rend la gaieté douce,
Et la gaieté qui rend charmante la vertu.
«C'est en voyage surtout, dit l'abbé Constant, professeur à l'Institut catholique, que se révélait la figure originale de l'Abbé Jouin : sa générosité, son cœur, son entrain, sa jeunesse».
Il voyageait rarement seul, mais le plus souvent accompagné d'un ou plusieurs prêtres, pour s'assurer, en cas de be-soin, le bénéfice de l'absolution. Il est bien peu de ses vicaires ou de ses amis qu'il n'ait, un jour ou l'autre, emmenés avec lui dans l'un de ces voyages légendaires, en Savoie, dans les Pyrénées, en Suisse, en Espagne et en Portugal, en Angleterre ou en Italie.
Toujours pressé, il ne demeurait au même endroit que contraint et forcé. A Tanger, ne parlait-il pas sérieusement, pour revenir en Espagne, de traverser en barque le détroit de Gibraltar, ne pouvant se résigner à attendre deux jours le départ du bateau ! Et il fit dans ce sens une démarche aux bureaux de la marine.
Intrépide d'ailleurs, ne connaissant, même en montagne, que la ligne droite ; préférant le sentier à la route et le rac-courci au sentier ; plus heureux de l'effort accompli que du panorama qui s'offre à ses yeux. Ce qu'il aime c'est l'imprévu les incidents, les marches de nuit, les couchers sur la paille dans quelque refuge alpestre, les ascensions à la corde sur les névés, les fourrés et les taillis où l'on se fraye un passage à coups de canne,... ou les trains manques qui obligent à des heures de marche. Toutes ces aventures, qui provoquent les récriminations de ses compagnons, semblent l'amuser. Maître de son estomac, il peut rester de longues heures sans manger et pense que ses compagnons, prêtres ou reli-gieux, peuvent bien, eux aussi, racheter le plaisir du voyage par quelque pénitence.
«C'est à Alpnachstadt, sur les bords du Lac des Quatre-Cantons, que j'ai commencé à le connaître, nous écrit l'abbé Constant... Toutes ses matinées, il les passait au travail ; mais souvent, l'après-midi, nous excursionnions, lui toujours en avant, grimpeur infatigable et hardi, le plus jeune de tous. Parfois, c'étaient de grandes tournées d'un ou deux jours... Sa générosité était sans bornes et magnifique. Quel que fût le nombre de ses compagnons, il voulait supporter seul les frais du voyage : voitures, hôtels, guides, tout était largement rétribué, de façon à mériter la recon-naissance de chacun. Partout où il passait, il semait de gras pourboires et de généreuses offrandes. Les curés sur-tout n'étaient jamais oubliés... L'année suivante, 1912, il me chargea de le devancer à Feldkirch avec deux grands séminaristes et un plus jeune. Il ne voulait pas que rien manquât dans la maison qu'il avait louée... Vous savez comme moi, qu'à un moment, nous étions six à sa charge, et qu'il nous envoya quatre assister au Congrès eucharis-tique de Vienne... Quant à moi, continue notre savant correspondant, je fus toujours édifié par sa charité et sa bonté, sa piété candide, son assiduité à commencer le voyage par le bréviaire et le chapelet. Il fut toujours le plus agréable des compagnons, comprenant les jeunes, la plaisanterie et la saine gaieté».
Ses absorbants travaux ne l'empêchaient pas du reste de se montrer accueillant à tous. Pauvre ou riche, chacun était assuré de la même cordialité. Les humbles avaient peut-être sa préférence ; dans ses relations avec les gens des classes supérieures, une certaine timidité naturelle paralysait quelque peu sa bonne grâce.
«Devenu curé de Saint-Augustin, lisons-nous encore dans l'article cité plus haut, il s'était entouré d'un certain luxe et menait un train de vie qui aurait pu risquer de le séparer de la foule. On savait que c'était la faute de la charge et non celle des sentiments et pour pénétrer jusqu'à lui, on traversait sans se laisser intimider les salons en enfilade à l'aspect cossu et on l'abordait sans trop d'émoi, malgré l'attitude réservée qu'il gardait devant son bureau surchargé de dossiers, sous la lumière d'une haute fenêtre, pendant les premiers instants de l'entrevue. Mais on était bien vite mis à l'aise : les confidences, un nom connu jeté dans la conversation, le rappel d'un souvenir le déridaient ; ses yeux pénétrants brillaient d'un éclat malicieux, et il vous tenait sous le charme de ses paroles. Jamais on n'avait l'impres-sion qu'on avait pu l'importuner ; l'affabilité était chez lui la forme la plus souriante de la charité».
Cette aimable cordialité était chez Mgr Jouin le fruit de la vertu et le résultat de longs efforts, plus encore qu'une dis-position de nature. Son tempérament l'eût porté plutôt à la vivacité et à l'impatience. Mais au jour de sa conversion, le jeune collégien de Combrée, «pour se conformer au Cœur de Jésus», avait promis d'être aimable avec tous, et le Curé de Saint-Médard avait écrit dans ses notes de retraite ces mots devenus pour lui un programme : Faire plaisir pour attirer les âmes à Jésus.
Cette patience fut pourtant mise à de rudes épreuves ; il rencontra sur son chemin la félonie et la trahison. Rarement on le vit perdre la maîtrise de lui-même. Pour lui arracher un mouvement d'impatience ou de colère, il fallait un motif d'une haute gravité. Ce qui lui répugnait au-delà de toute expression, c'étaient les manœuvres louches et hypocrites ; elles soulevaient chez lui un dégoût qui pouvait aller jusqu'à la révolte.
Maître de ses impressions, il ne l'était par moins de son corps, auquel il imposait des marches forcées, des jeûnes prolongés, de sanglantes macérations. En voyage, il préférait se priver de manger plutôt que de se mêler à la foule dans un buffet ou dans un restaurant. «Vous savez comme moi, nous disait son dernier confesseur, M. l'abbé Baronnet, com-bien il tenait peu compte de sa propre souffrance, quand il s'agissait de travailler ou de rendre service. Autant il était at-tentif à s'enquérir de la santé des autres, autant il se taisait sur ses propres souffrances si patiemment supportées».
Mais la note dominante de son caractère fut jusqu'à la fin la droiture et la ténacité d'une volonté sur laquelle les an-nées n'avaient pas de prise. Il réalisait magnifiquement dans sa personne le Justum ac tenacem propositi virum du poète latin.
De la justice, il avait un sentiment très aigu : jamais on ne l'y vit manquer et il ne souffrait pas qu'on y manquât en sa présence. Pour défendre des innocents, il s'exposait lui-même aux coups. Les coupables avaient toute sa pitié, et l'on di-sait de lui qu'il était presque aussi avantageux d'être de ses ennemis qu'au nombre de ses amis. Parfois trompé, il ne trompa jamais personne : il n'abandonnait pas ceux à qui il avait accordé sa confiance.
Un de ses amis parmi les meilleurs regardait comme le signe caractéristique de son âme sa fidélité, et à bon droit. Une fois que Mgr Jouin s'était donné, il savait difficilement se reprendre. «L'amitié avait chez lui des racines profondes : quand il avait jugé quelqu'un digne de sa confiance, il se reposait sur lui les yeux fermés ; il ne s'arrêtait pas à la pensée décevante que l'on n'est jamais mieux trompé que par les siens, et il ne suffisait pas d'une seule peccadille pour ébranler sa sérénité ! C'est qu'il avait une âme limpide et sans détours et son défaut, si défaut il y a, fut de mesurer toujours autrui à son aune».
Dans ses discours de mariage, on remarquait avec quelle insistance il recommandait la fidélité à la parole jurée et l'accent d'énergie qu'il mettait dans ces vers que le poète place sur les lèvres d'un de ses héros dans les Burgraves, à propos des chevaliers du Moyen-Age :
Le brave mort dormait dans sa tombe humble et pure,
Couché dans son serment comme dans son armure ;
Et le temps qui des morts ronge le vêtement,
Parfois brisait l'armure, et jamais le serment !
«Sa droiture, dit encore l'abbé Chupin, n'avait d'égale que sa franchise et il avait peine à imaginer des sentiments retors et intéressés qu'il n'éprouvait point. Jamais homme ne fut moins courtisan que lui : il traça son sillon tout droit, en bousculant peut-être quelque peu les uns et les autres, mais ce fut à force de travail persévérant, sans rien devoir à la flatterie, sans jamais sacrifier un iota de ses convictions».
La vertu naturelle qui jetait chez Mgr Jouin le plus vif éclat, c'était incontestablement l'énergie tenace de sa volonté. Elle commandait même à son corps qu'elle forçait à vivre. Au lendemain de sa mort, le docteur Chiron nous écrivait :
«Au point de vue strictement médical, je suis étonné de son extrême longévité. Perpétuellement malade depuis ses plus jeunes années, il est extraordinaire qu'il ait pu atteindre un âge aussi avancé, en faisant fi de toutes les pré-cautions qui lui étaient pourtant nécessaires. Enfant délicat, il est obligé d'interrompre ses études. Bronchites fré-quentes, pleurésie, probablement même légère atteinte de tuberculose, comme semblent l'indiquer les hémoptysies qui se manifesteront plus tard. Il se rétablit tant bien que mal. Trouvé trop faible pour rester chez les Dominicains, le voilà maintenant exerçant son ministère à Paris et dans la banlieue, débordant d'une activité qui ne cadre guère avec sa santé toujours précaire. Presque chaque année, il est malade : bronchites, congestions pulmonaires se suivent, auxquelles viennent s'ajouter par la suite coliques néphrétiques, cystite, pyélo-néphrite. Il se soigne à peine, commet toutes les imprudences, se nourrit vaille que vaille. Hygiène, régime, repos n'existent pas pour lui. Malade, alité, il tra-vaille encore. A peine rétabli, c'est de nouveau le surmenage ; il est infatigable. Sa résistance semble donc réelle-ment extraordinaire et s'explique difficilement avec la fragilité d'un organisme débilité par la maladie».
On était frappé de la flamme de son regard et de l'accent de sa voix quand, aux fêtes du Centenaire de Combrée, il rappelait devant tout le collège les vers immortels du poète qui le peignaient lui-même si bien :
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front ;
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime ;
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour ;
Ceux dont le cœur est bon et dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ; les autres, je les plains.
Il n'est pas douteux - et c'est l'avis de ses médecins - que Mgr Jouin n'a vécu si longtemps que parce qu'il l'a voulu, et il n'a voulu vivre que pour lutter - sans crainte d'ailleurs - contre les ennemis de Dieu. Turenne menait de force au combat sa «vieille carcasse» tremblante. Lui, on ne l'a jamais vu trembler, pas plus qu'on n'a jamais surpris ses larmes.
Cette énergie indomptable parut bien dans les toutes dernières années de sa vie, quand il découvrit une sorte de complot tramé autour de lui pour lui enlever avec sa bibliothèque la direction de la Ligue Anti-Maçonnique. Avec quelle énergie il bouscula toutes les intrigues pour rester maître chez lui. On s'aperçut alors qu'il n'était pas le vieillard affaibli que l'on supposait.
Sur une nature aussi ferme, le prêtre pouvait sans peine, avec l'appui d'en haut, élever l'édifice solide de la sainteté : ce ne serait pas la maison bâtie sur le sable qu'emporte l'ouragan ou qu'entraînent les eaux. Sa vie religieuse s'arc-boutait sur la prière, à laquelle il donnait la plus grande partie de son temps. «Il prie plus que nos moines», disaient ses amis bénédictins ou dominicains. C'était d'abord une prière au premier éveil, puis la prière du matin, à genoux, aux pieds de son grand Crucifix, puis les petites heures du bréviaire avant la Messe - celle-ci suivie d'une action de grâces prolon-gée - puis l'oraison, la lecture, vêpres et complies avant midi ; matines et laudes avant le travail de l'après-midi. Pendant les soins douloureux et prolongés, auxquels il dut se résigner pendant sept ans, il récitait à haute voix le rosaire en entier, les litanies de la Sainte Vierge, souvent celles du Sacré-Cœur ou de saint Joseph, le De Profundis, une prière au Saint-Esprit dont il lisait un petit office, enfin de pieuses invocations à ses saints de prédilection (en 1926, il avait été atteint d'une cystite, et, en raison de son grand âge, le docteur Bazy n'avait pas osé l'opérer). Chaque semaine l'office des morts s'ajoutait au bréviaire, et presque chaque jour le Chemin de la Croix. (Nous tenons ces détails et plusieurs autres qu'on li-ra dans la suite du témoin dévoué de ses vingt dernières années, Mme Baurrault).
C'est dans cette union habituelle avec Dieu qu'il faut chercher la source secrète de ces vertus surnaturelles dont il donna, au déclin de sa vie surtout, tant et de si beaux exemples. Là, comme dans un sol fertile, sa foi enfonçait ses ra-cines vivaces, sa confiance trouvait son abandon, sa charité son inépuisable fécondité.
Sa foi voyait Dieu en tout et en tous. Les créatures, il ne semblait pas les apercevoir. On ne surprenait son regard si limpide et si profond que rarement, dans une discussion ou lorsqu'il écoutait de la musique : «Ne me demandez pas, di-sait-il, si tel ou tel est blond ou brun, s'il est chauve, s'il porte la barbe, de quelle couleur sont ses yeux... je ne vois rien de tout cela». Il ne voyait que Dieu et les âmes faites pour Dieu. «Qu'aucune d'elles, écrivait-il à quelqu'un qui était tenté de l'oublier, ne puisse jamais nous reprocher d'avoir arrêté son élan vers les cimes et de l'avoir ramenée vers la terre».
C'est vers Dieu et vers les âmes rachetées par Dieu que tendait son labeur : Ad te ! pour vous, mon Dieu, telle était sa devise. Rien de ce qui se rapportait à Dieu et au culte divin ne lui semblait petit ou négligeable ; aussi le voyait-on passer des journées entières, debout, sur des gradins, à orner lui-même les reposoirs, et cela jusqu'à un âge très avancé, au prix de fatigues excessives.
Il n'est pas jusqu'à ses vacances et à ses voyages qu'il ne ramenât à cette unique pensée : Dieu et les âmes : c'était ou un pèlerinage pieux à accomplir, à la Salette, à la Sainte-Baume, à Lourdes ou même à Pellevoisin, ou quelque bien à faire : des âmes à toucher ou à convertir ; des amis, prêtres ou laïcs peu fortunés, à distraire, comme ce bon curé de Dampierre, l'abbé Bertrand ; des santés à rétablir, surtout celle de ses prêtres et de ses séminaristes qu'il conduisait à Divonne, à Saint-Christophe en Oisans et jusqu'en Tyrol ; du soleil enfin à mettre dans les vies et dans les cœurs.
Sa confiance en Dieu, dans l'Église et dans le Pape grandissait avec les années : «Le seul espoir de salut, disait-il avec énergie quelques jours avant sa mort, est dans l'intervention du Pape, seul capable d'arracher le monde à l'emprise des forces mauvaises».
Mais la vertu qui, au soir de sa vie, jetait chez lui les rayons les plus chauds, c'était sa bonté pitoyable à toutes les dé-tresses. Cette vertu qu'il se plaisait à recommander aux époux dont il bénissait l'union, en leur rappelant les vers du poète
La bonté, c'est le fond des natures augustes :
D'une seule vertu Dieu fait le cœur des justes,
Comme d'un seul saphir la coupole du ciel,
il la mettait le premier en pratique.
Pour consoler des familles éplorées, il traversait la France. Il était à Lourdes quand lui parvint la nouvelle de la mort de Mme Busson Billault, une paroissienne d'élite et sa pénitente. Il part le soir, change deux ou trois fois de train dans la nuit pour arriver le matin dans le petit village, près de Nantes, où les obsèques avaient lieu. Il célèbre la messe du convoi qu'il préside jusqu'au bout, puis sans prendre le temps de déjeuner, s'embarque pour Paris, où il arrive épuisé. Une bronchite se déclare qui le retient six semaines au lit.
C'est encore en arrivant à Lourdes qu'une autre année il apprend la mort d'un des plus fidèles employés de Saint-Augustin, M. Gardette, père de l'un de ses séminaristes. Il laisse aussitôt son compagnon, le Curé de Vern, pour aller rendre à ce serviteur dévoué les derniers devoirs.
Ni le temps, ni les ingratitudes n'arrivaient à épuiser cette inlassable charité. Chapelain de Sainte-Geneviève, en 1878, il avait rencontré près d'une malade, une jeune fille qu'elle avait adoptée. La pauvre femme mourut. L'abbé Jouin n'abandonna jamais l'enfant : 55 ans plus tard, au lendemain de la mort de son bienfaiteur, celle-ci nous écrivait sa peine et sa reconnaissance : «Il me recevait le dimanche, deux fois le mois et, me remettant à chaque fois une petite somme : «Prenez, ma bonne Marie, prenez sans crainte. Je ne vous demande que de prier beaucoup pour moi».
Car il n'attendait pas, pour donner, la demande qui, chez certains, n'ose s'exprimer ; il la provoquait ou plutôt la de-vançait :
«Quelques semaines avant sa fin qu'il pressentait déjà, dit l'abbé Chupin, il fit appeler le supérieur de Combrée et après l'avoir interrogé sur la prospérité du collège comme aussi sur ses besoins, il le rendit bénéficiaire d'une géné-reuse aumône dont on lui avait laissé la libre disposition. Il n'avait plus personnellement les moyens de nous conti-nuer ses libéralités et il en souffrait plus que l'on ne saurait s'imaginer. C'était en effet sa façon à lui de traduire ses sentiments : il donnait largement, parfois même un peu au delà de ses moyens. Ses visites à Combrée se mar-quaient presque toujours par quelque aménagement nouveau ou quelque embellissement de la maison : il voulait qu'elle présentât aux élèves un visage accueillant et aimable. Le plus naïvement du monde, il provoquait les do-léances et ses yeux fureteurs savaient découvrir les travaux qui s'Imposaient. Après avoir fait parqueter les dortoirs à ses frais, il paya le pavage des cloîtres. Les élèves n'avaient point de salle pour jouer la comédie : l'abbé Jouin fit bâ-tir la salle que les téméraires seuls osaient rêver et le donateur poussa même la munificence jusqu'à la décorer d'un plafond lambrissé et à la doter d'une vaste scène, pourvue de la machinerie la plus moderne pour l'époque».
Ses élèves, ses séminaristes surtout étaient véritablement ses enfants. L'un d'eux que la maladie empêcha d'arriver au sacerdoce, fut de sa part l'objet de soins prolongés. Il lui avait assuré le traitement fort coûteux d'un spécialiste en re-nom - traitement qui prenait toute la journée - et comme le pauvre abbé n'avait pas le temps de rentrer chez lui en ban-lieue, le Curé de Saint-Augustin le gardait chez lui, se privant, pour le distraire, du repos qui lui était prescrit à lui-même après ses repas. De plus, un frère de cet abbé fut envoyé au collège de Combrée, où l’on fondait sur lui des espérances qui ne devaient pas se réaliser et, deux fois la semaine, la mère et la sœur de ces jeunes gens venaient au presbytère suivre le traitement d'un grand spécialiste.
Un autre séminariste fut de sa part l'objet de soins non moins touchants. Pour sa santé menacée, il l'avait envoyé dans un séminaire du Midi, puis à Rome pour ses grades théologiques, obtenait des supérieurs tous les adoucissements et le confort nécessaires à son état et, pour ses vacances, tenait compte des recommandations des médecins.
Il avait pour certaines infortunes des attentions maternelles. C'est une paroissienne, veuve de guerre qu'il faut mainte-nir dans un appartement trop coûteux, et ses deux enfants dont il faut continuer l'instruction et qui ont besoin de va-cances au grand air... L'aide arrivera toujours au moment opportun, discrète, touchante, paternelle. - C'en est une autre dont le commerce périclite. Si elle ne trouve pas 20.000 francs, c'est la faillite... et la faillite est évitée. Ce sont des amis malheureux qu'il faut sauver de la misère : Mgr Jouin a eu pendant près de quinze ans à sa charge un de ses collabora-teurs ruiné et sa fille.
Pour les malades, sa bonté s'exprimait en des gestes d'une délicatesse exquise. Un jour on le vit arriver les bras chargés de fleurs rares dans une clinique où son premier vicaire venait de subir une grave opération : c'étaient les fleurs de son 86e anniversaire dont il se privait pour réjouir le cher malade. Ses vicaires étaient-ils souffrants ? il était le premier à leur imposer tout le repos nécessaire à une complète guérison.
Mais où sa charité s'élevait à des hauteurs peu communes, c'était à l'égard de ses ennemis. Déjà on l'avait vu secou-rir dans sa détresse un sacristain de JoinviIIe-le-Pont qui avait pris parti contre lui pour le Maire franc-maçon. Plus tard il agit de même à l'égard d'une femme à son service pendant un séjour à Feldkirch et dont on lui avait signalé les larcins. Le besoin, sans doute, était la cause de ces indélicatesses. Aussi de retour à Paris, le Curé de Saint-Augustin lui faisait-il parvenir des subsides.
Cet amour des ennemis lui inspira des actes vraiment héroïques. Un personnage ami lui avait demandé une pièce pour son théâtre : le «Mystère de Jeanne d'Arc». L'abbé Jouin, pour le satisfaire, avait fait de gros frais et travaillé jour et nuit. La pièce était achevée et les répétitions commencées, quand il apprit par hasard, que ce n'était pas sa «Jeanne d'Arc» qu'on allait jouer, mais celle d'un autre auteur. Bien plus, le même personnage lui avait pris une scène entière de sa «Passion» sans en indiquer la source. Des hommes d'affaires furent nommés de part et d'autre ; on offrait éventuelle-ment à l'auteur trompé et volé une indemnité qui ne fut d'ailleurs jamais versée. Toutes les relations avaient été rompues entre les deux amis, quand au bout de dix ans, Mgr Jouin annonce, un peu avant le déjeuner, à la personne chargée du gouvernement de sa maison, la présence d'un convive.
- Devinez le nom, lui dit-il, énigmatique... C'est M. P.
- Comment, il ose reparaître chez vous !
- Vous a-t-il au moins fait des excuses ?
- Du tout. Mais il a besoin de moi. Je viens de lui donner une recommandation pour le docteur Bazy. Dans un instant, il va revenir déjeuner avec nous.
- Excusez-moi, répondit la Secrétaire. Je ne paraîtrai pas à ce repas.
- Ce ne serait pas chrétien. Rappelez-vous le Pater.
- Mais Notre-Seigneur n'a pas dit de pardonner les offenses faites à ceux que nous aimons !
- Notre-Seigneur n'a pas mis de limite au pardon.
Bientôt le personnage arrivait radieux : le docteur allait l'opérer gratuitement. Il déjeune très à l'aise. Bien plus, il s'ins-talle au presbytère, comme autrefois ; tout le temps de la guerre il y descendit à l'improviste, y recevant toujours un bien-veillant accueil.
Envers le comte de B., en qui il avait mis toute sa confiance et qui l'avait entraîné jadis dans une affaire désastreuse, lui faisant perdre à lui et à ses amis une somme considérable, Mgr Jouin ne fut pas moins magnanime. Après vingt ans de séparation, M. de B. reparut tout à coup, vieilli et «mourant de faim». Le Curé de Saint-Augustin, qui avait alors tant de peine à soutenir son ambulance, lui fit jusqu'à sa mort une pension mensuelle de 200 francs, souvent portée à 300, lors-que les demandes se faisaient plus pressantes. La lettre suivante, dont la Secrétaire avait pris copie, montre bien sa grandeur d'âme.
«Mon cher ami.
A cause du froid, je vous envoie, ce mois-ci encore, 300 francs ; mais je ne pourrai continuer, et je ne sais même comment je pourrai trouver 200 francs pendant les mois d'été... Toujours est-il que je le fais de bon cœur. C'est bien uniquement à titre d'ami et par bonté de cœur que je vous envoie les mensualités, parce qu'on est venu me dire que vous «mouriez de faim», ce que confirme votre lettre dans les mêmes termes. J'espère de la sorte pourvoir au plus indispensable, avec le vrai regret de ne pouvoir faire davantage.
Soyez persuadé que le passé - même les lettres écrites contre moi à Mgr L... et qui m'ont été remises - est tota-lement oublié.
Bien fidèlement à vous E. J.
Ce magnifique mépris de l'argent n'était chez Mgr Jouin que la mise en pratique du vœu de pauvreté dont il avait ce-pendant été relevé en quittant la robe de saint Dominique. Il se considérait toujours comme le simple économe des sommes qu'on lui remettait comme de celles qui auraient pu lui appartenir en propre. Ce qu'il recevait d'une main, il le donnait de l'autre. Cet homme qui, au jugement de son prêtre trésorier, «distribua des millions», ne gardait rien pour lui et vivait au jour le jour. Il n'eut de calice à lui qu'à la mort de son frère, et ne prenait point d'honoraires pour ses messes.
Plus d'une fois, dans les dernières années surtout, il fut réduit à la gêne ; et lui, qui avait passé sa vie à faire l'aumône, consentit à la recevoir d'un prêtre qui avait devin
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 11)
* * *
CHAPITRE VIII LES DERNIÈRES ANNÉES.
CE QUE MGR JOUIN AVAIT ECRIT SUR SON AGENDA, LE 1ER JANVIER 1914. - SON ACTIVITE INTELLECTUELLE DANS LES DERNIERES ANNEES. IL PRONONCE D'IMPORTANTS DISCOURS. - IL CELEBRE SES NOCES D'OR, SES NOCES D'ARGENT PASTORALES ET SES NOCES DE DIAMANT. - IL REPOND AUX TOASTS DE SES AMIS. - BENOIT XV L’ELEVE A LA PRELATURE ET PIE XI LE FAIT PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE. - MGR RUMEAU LE NOMME CHA-NOINE D'HONNEUR D'ANGERS. - QUALITES ET VERTUS DE MGR JOUIN SUR LA FIN DE SA VIE : L'HOMME, LE PRETRE, LE MOINE. - IL POUSSE LA CHARITE ET L'AMOUR DES ENNEMIS JUSQU'A L'HEROÏSME.
Les années, en s'enfuyant, n'altéraient chez Mgr Jouin ni la lucidité de l'esprit ni la fraîcheur de l'imagination. Qu'on en juge par ces jolis vers tracés au crayon sur son agenda, le 1er janvier 1914, et que le temps avait presque effacés. Il y pleure ses années évanouies comme un songe :
Le fuseau de mes jours est tantôt effilé.
Il fut long, direz-vous : - long comme une chimère,
Comme un rêve de nuit brusquement déroulé,
Qui ne laisse au matin qu'une trace éphémère.
Hier n'est déjà plus, quand paraît aujourd'hui,
Que demain pousse en croupe et fait tomber de selle.
En cette chevauchée, hélas ! les ans ont fui
Plus vite qu'un vautour fondant à tire d'aile.
C'est une année, une autre, et puis dix et puis vingt,
Enfin soixante-dix qui se sont égrenées !...
Sous vos voiles de deuil, on chercherait en vain
A vous rendre la vie, ô mes belles années...
Les vingt dernières années de la vie de Mgr Jouin devaient être les plus remplies, les plus fécondes, les plus glo-rieuses.
Tout en vaquant aux occupations de son ministère, il avait trouvé le temps de préparer et de prononcer à Paris et en province d'importants discours - En 19118, l'éloge funèbre de la Révérende Mére Agnès - six ans plus tard, un discours pour le cinquantenaire de la Congrégation des Servantes des Pauvres, à Angers, discours que Mgr Rumeau appelait un «monument oratoire» - un an auparavant, invité encore par l'Évêque d'Angers, il avait parlé longuement à l'occasion de l'érection de l'église de Sainte-Madeleine du Sacré-Cœur en basilique mineure. - Enfin, en 1923, sur le désir de son il-lustre, ami, Dom Cabrol, il avait célébré le retour des Bénédictins dans l'Abbaye du Mont Saint-Michel, par un discours d'une rare élévation sur la mission du grand Archange dans la vie de l’Église !
Nous avons raconté comment, à trois reprises différentes, dans la chaire de Saint-Augustin - plus particulièrement à l'occasion des Noces de diamant de M. Eugène Gigout, organiste de la paroisse depuis soixante ans, il avait dit quel était l'homme, sa valeur et son œuvre. «Que dire de Me Gigout, s'écriait-il, lorsque seul, en face de son instrument, au terme d'une religieuse improvisation, réunissant sous la pression d'une machine pneumatique ses trois claviers manuels, aux-quels s'ajoute son pédalier, il fait résonner instantanément 600 tuyaux de son orgue à chacun de ses accords, taillant dans l'air, étonné de marches si triomphales, les sublimes degrés de ces ascensions que Dieu a mises au cœur de l'homme pour le conduire jusqu'à Lui ?
«L'émotion d'un tel artiste, unique créateur et unique exécutant de ce chef-d'œuvre, n'est plus du lyrisme, c'est, dans son sens le plus profond, de l'enthousiasme ébauché sur terre et achevé au ciel».
L'éloquence, la poésie, le cœur peuvent difficilement, croyons-nous, atteindre plus haut que ces pathétiques accents.
Ces dernières années ramenèrent aussi, pour le curé de Saint-Augustin, de glorieux anniversaires, et il dut entendre à son tour d'éloquentes harangues et se résigner à des éloges qui mirent à l'épreuve son humilité :
«Vous êtes un grand collectionneur de jubilés, lui disait, le jour de ses Noces de diamant, M. Péronne, l'aîné de son Conseil curial. Et, par un effet de la Providence, tous vos jubilés, sans exception, ont été célébrés à Saint-Augustin : Noces d'argent sacerdotales quand vous y étiez premier vicaire, et, depuis que vous y êtes revenu comme Curé, Noces d'or, Noces de diamant, et, entre les deux, vos Noces d'argent avec la cure de Saint-Augustin ; voilà des liens peu ordinaires entre une paroisse et son curé».
* * *
Noces d'or (23 Février 1918) - C'était en pleine guerre, le 23 février, notre situation était critique ; à la semaine sainte, elle semblait désespérée. L'ambulance n° 139 battait son plein. Malgré ces alarmantes conjonctures, le cardinal Amette s'était refusé à supprimer et même à ajourner la cérémonie. Deux jours plus tard, il faisait parvenir au jubilaire la nouvelle de son élévation à la prélature. Le bref de Benoît XV était des plus flatteurs :
«Les éminentes qualités que vous avez manifestées avec éclat au cours de votre longue carrière sacerdotale Nous décident sans peine à vous honorer d'une illustre dignité. Nous savons, en effet, que vous vous acquittez de votre ministère sacré d'une manière exemplaire, que vous avez la plus vive sollicitude du salut éternel des fidèles et que vous affirmez avec constance et avec courage les droits de l'Église catholique - non sans péril pour votre vie - contre les sectes ennemies de la religion, enfin que vous n'épargnez rien, ni labeurs, ni dépenses, pour répandre dans le public vos ouvrages en ces matières. Puisqu'il en est ainsi, Nous vous conférons d'autant plus volontiers un témoignage de bienveillance que, comme vous venez de célébrer le cinquantième anniversaire de votre sacerdoce, Nos félicitations pontificales sont le couronnement des vœux de tous les gens de bien».
De son côté, l'Evêque d'Angers, Mgr Rumeau, chargé par le cardinal Amette de demander pour le jubilaire la bénédic-tion, du Saint Père, élargissant le geste de son prédécesseur, Mgr Mathieu, lui conférait le titre de Chanoine d'Honneur de sa cathédrale.
Au cours de la messe solennelle, le R.P. Hébert lui avait adressé une allocution, gênante sans doute pour son humili-té, mais qui fit tant de plaisirs aux paroissiens. Après avoir signalé dans le Curé de Saint-Augustin le prêtre qui, depuis vingt ans, assurait dans son église, d'une manière irréprochable, la régularité des cérémonies, la décence et la splendeur du culte et donnait au dehors d'admirables exemples de dévouement aux malades par l'institution des Servantes des Pauvres, aux enfants, pour lesquels il s'était fait compositeur et librettiste, aux artistes enfin, qu'il rapprochait de Dieu - l'orateur montrait en M. l'abbé Jouin l'homme complet qu'il était : l'homme d'étude qui, dans sa jeunesse, ayant rêvé de devenir comme son frère fils de saint Dominique, prit sa revanche en se faisant Bénédictin ; car, depuis ce temps, c'est au milieu des livres qu'il a vécu – l’homme de caractère, «dont la volonté est capable de s'incliner quand elle le doit, mais qui ne se courbe jamais» - l’homme de cœur surtout, fidèle à son collège qu'il comble de ses générosités et peuple de ses disciples - fidèle aux religieux de son Ordre auxquels il ouvre largement les portes de son église - fidèle à ses frères dans le sacerdoce pour leur rendre les derniers devoirs et les accompagner de ses prières - ne l'avait-on pas vu un jour de ce dur hiver partir pour Saint-Médard et, à son âge, célébrer une messe tardive pour une défunte dont il n'avait plus la charge depuis vingt ans ? - fidèle enfin à l'Église pour laquelle il recrute sans cesse de nouveaux ouvriers.
«Je souhaite, disait l'éloquent Dominicain, à tous les Ordres religieux d'avoir dans le monde des novices qui les aiment avec cette persévérance - à tous ceux qui aiment d'avoir de pareils amis - au clergé français de compter beaucoup de cœurs qui l'aiment avec ce désintéressement et cette charité».
Du banc d'œuvre, le cardinal Amette s'était associé aux paroles du prédicateur «qui s'était exprimé avec une merveil-leuse délicatesse, une justesse parfaite, et avait décrit avec autant de cœur que d'esprit le caractère du pasteur et sa car-rière sacerdotale».
Aux agapes qui suivirent la fête religieuse et auxquelles assistaient avec l'évêque de Tarbes et de Lourdes, Mgr Schoepfer, le comte Jean Chandon de Briailles, le sénateur Delahaye, le sculpteur Louis-Noël, membre de l'Institut et le Ministre plénipotentiaire de l'Equateur, d'autres voix se firent entendre. A tous, avec un à-propos exquis et une modestie charmante, le jubilaire répondit.
Au cardinal Amette, il adressait un hommage et une prière : «l'hommage de tout ce que son cœur pouvait avoir de fi-lial et de reconnaissant et la demande d'une de ses prières pour que les jours de grâce de la vie présente lui fussent dé-sormais une sainte préparation à la vie future».
Du R.P. Hébert il disait :
«Les orateurs de sa trempe tirent tout de leur propre fonds, c'est là qu'il a cru me voir. Dans le portrait qu'il a tracé, il s'est peint lui-même, si bien qu'au lieu d'avoir dit ce que je suis, il a dit ce que je devrais être».
«Je sais bien, ajoutait-il, que l'on essaye de me persuader, que, si Dieu a changé l'orientation de ma vie, en m'ar-rachant à la vie monastique, mes cinquante ans de sacerdoce fournissent des jours remplis. Je suis bien loin d'en être convaincu.
«M. Macchiavelli disait : «La réputation d'un curé est celle que lui font ses vicaires». A entendre ce qui se dit sur mon compte depuis ce matin, mon clergé a bien travaillé et m'a fait une réputation enviable pour tout curé de Paris... Si l’on tient peu de cas de celui qui n'est loué que de son curé, ne faut-il pas craindre qu'il en soit ainsi du curé qui n'est loué que de ses vicaires ?»
Au Curé de Saint-Étienne du Mont qui avait évoqué le souvenir de ses élèves ecclésiastiques, de ses deux Patro-nages, de la Nativité et de la Passion :
«Je suis, répondait-il, devenu, il est vrai, le pourvoyeur des économes des petits et des grands Séminaires ; mais la charité des fidèles est venue à mon aide, et, de ce chef, mon mérite est infiniment petit». Quant à ses pièces de théâtre, il les avait composées, mais c'est M. Sauvêtre qui les avait fait exécuter.
Quant à M. la Caille - qui avait évoqué les combats lointains de Joinville-le-Pont et ceux plus proches des Inventaires et le procès devant la XIIe Chambre, toutes «ces épreuves dont l'abbé Jouin était sorti grandi et non moins humble» - c'était un homme «plein de charité pour son prochain et pour son curé en particulier. Autrefois magistrat intègre, il est de-venu, sans doute, sous l'action de la grâce et du Sacré-Cœur, un avocat qui dissimule les faiblesses de son client, et non plus le juge qui porte en toute justice une rigoureuse sentence».
Pour M. le Vicomte d'Hendecourt «qui a réveillé le souvenir vieux de douze ans, du siège de Saint-Augustin, auquel il m'a attribué une influence à la hauteur des tourelles de l’église où j'ai couché, en effet, pendant quatre mois, le malheur est que mes nuits ne furent jamais troublées. Tout au contraire, le jour se passait sur pied de guerre, avec M. d'Hende-court au titre de général, ayant pour colonels mon regretté M. de Boismorel et M. Jean de Lannoy, de nature militante, qui m'a souvent soutenu dans mes travaux contre la Franc-Maçonnerie...»
Par rapport à l'ambulance dont on avait beaucoup parlé, sur ce point encore, comme sur les autres, il fallait «rabattre des éloges qu'on lui avait adressés, ou plutôt les aiguiller vers leurs destinataires : son chirurgien, le docteur Mauclaire, et son médecin chef, le docteur Moizard, dont la science et les soins ont, à la lettre, ressuscité des condamnés à mort» - les Servantes des Pauvres aidées par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, et les infirmières si dévouées, si parfaitement bonnes. «Voilà les ouvriers et les ouvrières qui ont produit le grand bien physique, moral et religieux de l'Hôpital auxiliaire n° 139». Il n'avait fait que «transmettre» les fonds de la charité. «Encore est-il que la prolongation de la guerre, épuisant les ressources de tous, il n'aurait pu continuer son œuvre, si le Ministre de l'Equateur, M. Dorn y de Alsua, n'était venu à son secours et n'avait fait de son ambulance l'hôpital franco-équatorien».
Enfin, jetant un regard sur les convives amis assis à sa table, il eut un mot gracieux et délicat pour chacun d'eux : pour M. Louis-Noël, l'auteur des deux statues monumentales de saint Augustin et de sainte Monique - don de la paroisse - le sculpteur qui, selon le vers du poète, «Fait au marbre étonné de superbes entailles»
- pour le comte Jean Chandon de Briailles qui, malgré le passage des Prussiens à Epernay a pour ses amis des ré-serves de son «crémant impérial», chaud et bon comme son cœur. Ce nectar des dieux, il en est sûr, inspirera à ses compatriotes, le sénateur et le député Delahaye «quelques discours incisifs et vengeurs qui nous vaudront les victoires de l'arrière, premier gage des victoires du front».
Relevant enfin sur la chasuble offerte par son clergé - un magnifique ornement de couleur verte «couleur d'espé-rance» - l'inscription : Ad multos annos, qu'il traduisait ainsi : Aux Noces de Diamant ! il demandait à tous un serment et prenait un engagement :
«En temps de guerre, il faut être brave et rester debout au poste de combat. Aussi, confiant dans vos vœux et vos prières, je prends l'engagement de célébrer mes Noces de diamant le 23 Février 1928, à la condition expresse que tous ici, sans exception, jurent en conscience de venir à cette date partager, une dernière fois, du coup, les mêmes agapes fraternelles».
Il devait tenir parole ; mais auparavant, il eut à célébrer un autre jubilé : celui de ses noces d'argent avec la cure de Saint-Augustin.
* * *
Noces d'argent pastorales (25 Janvier 1924) - Le Souverain Pontife Pie XI voulut s'associer à cette fête en élevant Mgr Jouin, déjà prélat, à la dignité de protonotaire apostolique qui lui donnait le privilège de porter, en certaines circons-tances, l'anneau et la mitre, honneur dans lequel le jubilaire ne voulut voir qu'un lien de plus avec le Pape, une approba-tion de ses travaux et de ses luttes et un nouveau motif de dévouement à l'Église.
A la fin de la cérémonie religieuse, lui-même fit distribuer à la foule des fidèles présents une image du Patron de la pa-roisse, petit signet de livre d'heures, portant au verso cette parole du grand Docteur : De bonis ovibus fiunt boni pastores, les bons paroissiens font les bons pasteurs. Tel fut le thème du rapport qu'il lut du haut de la chaire au cardinal Dubois et dans lequel il s'attacha à démontrer que s'il s'était fait quelque bien, soit au point de vue matériel, soit sous le rapport spi-rituel, au cours des trente-trois années qu'il avait passées à Saint-Augustin - huit ans comme vicaire et vingt-cinq à titre de curé - c'était à ses paroissiens et à tous ses collaborateurs qu'il fallait en faire remonter le mérite.
Qui donc, en effet, avait permis de réparer les brèches ouvertes dans le budget paroissial par la loi de séparation, si-non les fidèles qui supportent seuls l'impôt du Denier du Culte ? Le Curé n'est que le dépositaire de ces fonds religieux, aidé dans leur administration par le Conseil de Fabrique, aujourd'hui Conseil curial.
Et le Curé se plaisait à évoquer les noms de ces administrateurs émérites qu'avaient été, en ces 25 années, les Chesnelong, «chez qui la parole et la foi marchaient de pair, le front haut, dans cette attitude indomptable d'un lutteur qui ne doute pas de la victoire définitive» - les baron de Nervo, «âme chaude sous une écorce trop impassible» - les baron de Livois, «homme d'œuvres et de grande vertu» - les Boutillier «dont la science rayonnait au travers d'une excessive modestie et qui, avec son successeur, M. la Caille, devint l'un des artisans les plus précieux de la Basilique du Sacré-Cœur».
Passant en revue les améliorations matérielles apportées dans l'église, il s'arrêtait à la restauration du grand orgue à son arrivée, qui lui avait donné l'idée de transférer le petit orgue et la maîtrise dans la tribune de droite, pour dégager le chœur, lui rendre sa forme primitive et faciliter le passage qui le sépare de la chapelle de la Vierge. De ce fait, disait-il, grand et petit orgue commençaient avec lui un nouveau bail qu'il pouvait croire définitif.
«Hélas ! ajoutait-il, il n'en est rien ; j'ai traversé sans trop de fatigue mes 25 ans, et mes deux orgues sont à bout de souffle. Je ne sais si la fourmi dirait à ces gigantesques cigales :
«Vous chantiez ?...
Eh bien ! dansez maintenant».
Ce que je sais trop, c'est qu'il s'agit de coûteuses réparations».
Et ce que les paroissiens savaient - eux, les laborieuses et généreuses fourmis - c'est que si leur pasteur employait, comme la fourmi du Fabuliste, le mot de «danse», ce mot ne pouvait s'adresser qu'à leur bourse.
Il passait, avec raison, pour faire exécuter dans son église de bonne musique religieuse. «La peine, explique-t-il, en revient à mon maître de chapelle, M. Vivet, les frais aux fidèles et l'honneur au Curé».
On lui fait gloire de sa résistance au moment des Inventaires, de ses veilles dans les tourelles de l'église. Mais, le jour, des escouades de veilleurs se succédaient sans interruption, du 13 février au 9 juin. De cette persévérante fidélité, il gar-dait une légitime fierté ; «et les chefs de file : MM. de Boismorel, d'Hendecourt, de Lannoy et, à la tête de la classe labo-rieuse, M. David, avec les noms de tous ceux qui leur ont prêté un inlassable concours, sont au livre d'honneur de la pa-roisse et au livre de vie au Ciel». C'étaient eux, plus encore que lui-même, qui avaient défendu les droits de Dieu.
«C'est grâce à leur résistance et à celle des catholiques de France que peu à peu la loi de Séparation, au lende-main d'une guerre de quatre ans, a subi un fléchissement, symptôme d'une future révision et d'un loyal Concordat, base d'une irrévocable alliance entre la France et l'Église».
Passant à la vie spirituelle que le Curé doit communiquer à ses paroissiens par l'exemple - par la parole - et par le don de lui-même, il observait que :
«la vie du pasteur est de cristal, que les yeux des fidèles percent les murs du presbytère, qu'il est en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. On nous observe pour constater la supériorité de l'âme sur le corps, au prix des macérations, s'il le faut ; pour contrôler l'idéal dont il est défendu de déchoir ; pour suivre pas à pas notre apostolat, fait de désintéressement ; pour nous voir à l'église, au chevet des malades, uniquement occupés à écrire le nom de Jésus dans les âmes ; pour se rendre compte enfin si nous avons laborieusement gagné le pain du Christ et bu Son calice de bénédiction, à la sueur de notre front et si, parfois, cette sueur-là n'était pas vermeille de notre sang».
Sous ces traits les fidèles n'avaient pas de peine à reconnaître leur propre pasteur. «Mais combien, ajoutait-il, ce la-beur sacerdotal est excité et soutenu par l'exemple de paroissiennes, comme celles dont il avait admiré l'héroïsme dans son ambulance !»
A l'exemple, le pasteur doit joindre la parole. Cet enseignement, il l'a donné, suivant le conseil de l'Apôtre, en temps et hors de temps. A la messe de onze heures notamment, il a dit des vérités opportunes et inopportunes pour quelques-uns.
«Prêcher, disait-il avec saint Augustin, la miséricorde divine basée sur la foi sans les œuvres, tolérer les spec-tacles, les modes et les fêtes voluptueuses ; encourager les excès de table sous prétexte que ces biens sont le par-tage des chrétiens comme celui des païens, c'est être parmi les mauvais pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître leurs brebis».
Et encore :
«Dire aux amants du monde : «On ne peut servir deux maîtres, à la fois ; dire aux amants d'eux-mêmes : Ne vous y trompez pas, le dédoublement factice de l'homme privé et de l'homme public ne vaut pas devant Dieu ; au jour du jugement, vos œuvres vous suivront ; prêcher de la sorte la vérité, c'est mettre en pratique la règle de saint Jacques : cela est, cela n'est pas ; cela est vrai, cela est faux ; cela conduit au Ciel, cela conduit en Enfer».
C'était bien là le fond de la prédication du Curé de Saint-Augustin ; mais aussitôt il ajoutait :
«Je crois pouvoir rendre ce témoignage que telle fut toujours, au cours de ces 25 années, la prédication à Saint-Augustin, et que cette salutaire intransigeance, inaccessible aux innovations modernes, est tout à l'honneur de mon clergé dont l'intégrité de la doctrine et la sûreté de l'enseignement rejaillissent jusque sur leur curé».
Quant à la prière pour le peuple, c'est surtout à la messe que le pasteur l'adresse à Dieu en faveur des âmes qui lui sont confiées et en union avec elles, puisqu'elles partagent, dans une certaine mesure, son sacerdoce :
«Depuis 25 ans, mes frères, j'ai célébré plus de 10.000 messes en communion avec vous ; nous avons uni en-semble mon sacrifice et le vôtre pour cimenter l'union de nos cœurs, et à l'élévation de l'hostie, nous nous sommes écriés : Mon Seigneur et mon Dieu ! Aimons-Le donc ensemble, puisqu'Il nous a tant aimés».
Au terme de ces 25 ans, le pasteur serait tenté de dire à Dieu avec Job : «Donnez-moi, Seigneur, un peu de repos pour que je pleure douloureusement ma vie perdue avant de faire le voyage dont on ne revient pas» ; mais puisqu'il fallait encore poursuivre la route, il demandait à ses paroissiens de s'unir à lui dans une ardente prière d'action de grâces pour le passé et de confiance pour l'avenir.
Après ce rapport, où l'humilité du pasteur avait cherché à s'effacer, le doyen du Conseil curial. M. la Caille, remit les choses au point. Il rappelait le vivant souvenir que la paroisse avait gardé du second et du premier vicaire des années 1886 à 1894 :
«Oh ! vous ne faisiez pas grand bruit, lui dit-il. Moine de par la formation que vous aviez reçue des fils de saint Dominique, moine vous êtes resté, couché comme les Bénédictins de Saint-Maur sur des volumes poudreux pour leur arracher leurs secrets ; moine guerrier vous devîntes, au jour des Inventaires, où Saint-Augustin s'est si bien dé-fendu sous votre commandement, qu'il a fallu la ruse pour en avoir raison. Mais, par contre, sans vous mériter tout à fait le martyre, cela vous conduisit en police correctionnelle... Plus tard, vous fondiez l'ambulance,... vous présidiez à tout ; les pauvres étaient largement secourus, les malades visités, l'argent vous glissant des mains pour les grandes infortunes... Il faut bien, cher Monsieur le Curé, que vous entendiez ces vérités. Elles ne doivent pas être mises sous le boisseau. L'occasion est unique pour le Conseil curial de les faire connaître à qui les ignore».
* * *
Noces de diamant (23 Février 1928) - On avait pu craindre un instant que Mgr Jouin ne fêtât pas ses Noces de dia-mant. En 1926, une crise grave des reins avait mis ses jours en danger. En raison de son âge, le docteur Bazy, n'avait pas osé opérer le malade ; il dut rester huit mois hors de sa paroisse. Il se remettait à peine quand, sur un trottoir de Lourdes, une voiture automobile sans conducteur le renversa et lui passa sur le corps : c'était le 9 septembre, le jour de la fête de Notre-Dame de Pellevoisin, et dans la cité de Marie. Elle l'avait manifestement préservé. Moins de dix jours après cet accident, on le retrouvait dans son bureau en face de ses dossiers. Deux ans plus tard, fidèle au rendez-vous de ses Noces d'or, il célébrait la soixantaine de son sacerdoce.
Le sénateur Dominique Delahaye et le comte Jean Chandon de Briailles, le Conseil curial, son clergé, de nombreux amis, des artistes célèbres l'entouraient. Le cardinal Dubois, pour la seconde fois, présidait ; le R.P. Janvier était en chaire. L'illustre conférencier de Notre-Dame évoqua les tristesses et les deuils, puis les joies de l'Église et du jubilaire au cours de ces soixante années de vie sacerdotale. Dans l'ordre intellectuel et moral, dans les esprits et les cœurs bien des ruines s'étaient accumulées. Dans sa vie personnelle, «sans compter les contradictions et les hostilités ouvertes ou sour-noises», il avait connu des deuils et des séparations qui lui avaient arraché les êtres qu'il aimait le plus : «sa mère et deux frères - la moitié de son âme» ; la fragilité de sa santé avait souvent trahi ses desseins :
«Je n'ai point oublié, disait le Père, en évoquant ses souvenirs, nos promenades sous les beaux cieux, sur la côte d'azur, dans les grandes forêts, au milieu des oliviers et des orangers de toute cette riante nature de la Corse. Com-bien alors on avait lieu de craindre pour vous une fin prochaine !»
A travers ces épreuves, des joies lui avaient souri : à tous les assauts, l'Église avait résisté ; elle reprenait sa place dans la société ; le clergé avait vu son zèle exalté par la persécution ; les Ordres religieux bravant la tempête avaient re-fusé de mourir.
«Vous-même, malgré votre mauvaise santé, vous avez travaillé sans répit et vous travaillez encore pour le règne de Dieu. Les Sectes complices des puissances d'argent et encouragées par une politique fatale à notre pays comme à l'Église ont trouvé en vous un adversaire résolu».
Le présent autorisait toutes les espérances de l'avenir.
«Vous êtes de ceux dont le temps renouvelle la jeunesse. Jamais vous n'avez été plus fort, jamais, me semble-t-il, vous n'avez été plus exempt d'infirmité... Vous jouissez d'une autorité progressivement grandissante, vous portez au front une auréole que la Providence accorde rarement à ses meilleurs amis, l'auréole d'une vie sans tache, pleine-ment chrétienne, pleinement dévouée, pleinement sacerdotale, pleinement apostolique, bien qu'elle ait duré près d'un siècle... Les anges de la Provence et de la Bourgogne, de Paris et de l'Anjou veillent sur vous et garderont toutes vos voies... Quelles qu'aient été vos prédictions au moment de vos Noces d'or, ce n'est pas la dernière fois que vous nous réunissez autour de vous...»
Au repas qui suivit la cérémonie religieuse, d'autres voix s'unirent à ces éloges et à ces vœux de l'éloquent domini-cain : celle de M. le premier vicaire, au nom du clergé - celle de M. le Curé de Saint-Etienne du Mont glorifiant l'ouvrier in-fatigable qui parmi tant de travaux, trouvait encore le temps de réunir les éléments d'une «Histoire de la Paroisse de Saint-Augustin» et le félicitait d'avoir eu la joie d'assister, pour son 80e anniversaire, à la 100e représentation de la Nativi-té - de M. Péronne saluant, au nom du Conseil curial, le pasteur qui, par son action personnelle, par le dévouement à tous et l'irrésistible élan du cœur, avait su réaliser avec sa paroisse l'union la plus étroite. Après une allusion aux deux orphelins adoptés par le bon pasteur, il avait ajouté :
«Malgré la simplicité et la discrétion avec lesquelles ces œuvres furent accomplies, le bruit s'en répandit, et ceux qui ne connaissaient pas encore les trésors de charité que Dieu a mis au cœur de leur Curé, durent enfin com-prendre et furent conquis».
A son tour, le jubilaire prit la parole :
«Ce n'est que trop vrai, Eminence, répondit-il : des quarante-quatre invités du 23 Février 1918, seize sont partis pour un monde meilleur».
Parmi ces disparus d'hier, il évoquait particulièrement trois noms : le cardinal Amette, le R.P. Hébert, Maître Gigout.
«C'était en pleine guerre. Deux jours après, Son Eminence le cardinal Amette me faisait parvenir par son Secré-taire, M. le chanoine Clément, la nouvelle de mon élévation à la prélature pontificale. J'appris ensuite que je devais cette distinction à l'entremise de Son Eminence le Cardinal Granito di Belmonte qui venait jadis confesser les Italiens de la rue Mouffetard, et daigna ne jamais oublier le modeste Curé de Saint-Médard.
Aujourd'hui, nous sommes en pleine paix ; et je me souviens, Eminence, que vous êtes venu, il y aura quatre ans, le Vendredi Saint, le soir, à six heures, m'apporter le bref qui me nommait Protonotaire Apostolique, ayant soin de me faire remarquer qu'à la suite de votre nom, vous aviez tenu à ajouter celui du Révérendissime Père Abbé de Farnbo-rough, dom Cabrol, l'ami fidèle d'antan.
«J'ai dit que nous sommes en pleine paix, car, en dépit de quelques mauvaises langues, mon compatriote, le sé-nateur Delahaye et moi, nous sommes des pacifistes, persuadés d'ailleurs du vieil axiome : Si vis pacem, para bel-lum, convaincus que la sécurité des frontières est le premier gage de pacification, si bien qu'en cas d'attaque brus-quée, notre armée ait le temps, non plus de reculer de dix kilomètres, mais d'avancer de dix lieues sur le territoire ennemi ; pénétrés enfin, sans humanitarisme, de l'amour de l'humanité, secondaire toutefois à l'amour de la France».
Il évoquait ensuite la figure du R.P. Hébert :
«Vous le remplacez, cher Père Janvier, de même qu'il vous remplaçait en 1918 ; vous ne faisiez qu'un. Aujour-d'hui, l'union est plus intime, car vous êtes tous les mêmes. Vous avez votre idéal de vie religieuse, vous en cherchez intérieurement la réalité, puis vous appliquez ce portrait subjectif à une figure objective qui, dans l'espèce, est en ce jour la mienne. Tableau bien brossé, mais la ressemblance est incontestablement contestable».
Il se tournait alors vers les vivants, vers les amis et les artistes qui l'entouraient et près desquels «il retrouvait la vie, sinon la verve d'il y a dix ans». N'avait-il pas près de lui, à la même place qu'en 1918, le comte Jean Chandon de Briailles, «dont l'amitié et, pour un peu aussi, le délicieux Champagne, devenu le «crémant pontifical», lui rendent le cœur joyeux et prêt aux nouveaux combats qu'on lui annonce ?» - N'avait-il pas ses médecins : le docteur Chiron, toujours pré-sent à la moindre alerte, le docteur Bazy, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, «délicatement empressé de lui faire oublier le dur contact du fer ou de l'acier par de charmantes réunions familiales avec François Coppée et Mgr Odelin ; et enfin le docteur Lacronique qui reportait son souvenir sur le regretté et aimé docteur Sauvez, prématurément enlevé dans la force de l'âge ?» - S'il ne voyait pas devant lui M. la Caille, l'aîné de son Conseil curial, qui entrait dans sa 90e année et qui l'encourageait de parole et d'exemple dans cette course d'une vie prolongée, il avait, par contre, M. Pé-ronne «qui lui fut très indulgent, dit-il, en soulignant de menus faits semés négligemment dans sa vie curiale par la Provi-dence». - Il avait son premier vicaire et son clergé qu'il remerciait du riche chapelet qu'ils lui avaient offert, ainsi que l’Ouvroir des Enfants de Marie du merveilleux ornement qu'il avait étrenné le matin.
«Avec les dalmatiques et les trois chapes, c'est un ouvrage princier pour la paroisse, commencé, disait-il, sous l'inspiration de M. Raymond, curé de Saint-Denis du Saint-Sacrement, et terminé sous le regard averti de M. Baron-net».
Vint enfin le tour des artistes, qui n'avaient pas pris la parole, mais qui avaient si bien fait parler leurs instruments et leur voix à la cérémonie du matin. Maître Gigout n'était plus là.
«Mais son successeur et ami, Maître Huré, enveloppe souvent son jeu comme de voiles de deuil d'une transpa-rence qui laisse entrevoir le cher disparu. Son orgue était un orchestre : à son tour, sous les doigts du premier vir-tuose français et premier interprète mondial de Beethoven, le piano m'a donné la même illusion. J'envoie un salut re-connaissant à Maître Risler, dont la présence et l'amitié m'honorent, me réjouissent et me reposent. Car la musique est un repos au milieu des trépidantes occupations de la vie actuelle, et une envolée au-dessus des affaires, des in-térêts, des incertitudes de l'heure présente».
Il l'avait éprouvé, disait-il, durant l'inoubliable cérémonie du matin où, pour la première fois, «on avait entendu une cantate diamantée de M. Vivet». Et il priait Son Eminence de vouloir bien remettre à son Maître de chapelle la croix de Chevalier de Saint-Grégoire et d'étendre sa bienveillance à toute la maîtrise représentée par M. Dardigna - son organiste - MM. Lacaze et Texier - ses solistes - avec M. Dossogne, a la plus forte basse des maîtrises parisiennes», pour qui le Cardinal avait obtenu la médaille Bene merenti.
Ainsi, dans cette longue énumération, sa délicatesse n'oubliait personne. Il terminait par ce dernier mot :
«Les noces de diamant sont rares et étincelantes ; mais soixante ans de sacerdoce supposent d'incalculables responsabilités. Des noces de radium, cinq ans ou dix ans plus tard, sont plus rares encore, on risque d’y arriver en état de seconde enfance».
A ces causes, il demandait à tous les amis qui l'entouraient, une prière pour que, jusqu'à son dernier soupir, «il restât debout dans la lutte pour la France et pour l'Église».
* * *
Pour faire un prêtre, plus encore un saint, il faut d'abord un homme. La loyauté, l'amour du travail, le sérieux, la bien-veillance et la charité fraternelles, requises du simple laïc, sont des qualités encore plus indispensables au ministre de Dieu. Mgr Jouin gémissait quand il ne les trouvait pas autour de lui, quand il voyait au contraire chez quelques-uns «une formation de collégien qui suit au séminaire, puis dans le ministère, dans la vie publique et jusqu'à l'ombre du cloître». Ecrivant à l'un de ses plus chers disciples, l'abbé Richard, il le mettait en garde contre certains défauts qu'on néglige trop de surveiller : «l'esprit de jalousie, de critique, d'égoïsme, de vie paresseuse, trop facilement satisfaite du bréviaire, du journal, parfois d'une revue», et lui recommandait d'avoir soin «de ne pas greffer la grâce - et particulièrement celle du sacerdoce - sur un arbuste trop chétif et sur une nature anémiée».
Chez lui, l'arbuste était vigoureux, le sol riche et généreux ; la fleur de la sainteté pouvait s'y épanouir largement. De l'homme, vir, il possédait non seulement les qualités fondamentales : un grand cœur et une volonté puissante ; mais celles même qui peuvent sembler secondaires.
Sa tenue était toujours digne et sérieuse. Même quand il était obligé de dépouiller le costume ecclésiastique, comme dans son voyage en Angleterre pour la bénédiction abbatiale de Dom Cabrol ou à travers les régions protestantes de la Scandinavie, il gardait un extérieur irréprochable ; à son air grave et recueilli on reconnaissait le prêtre. L'un de ses com-pagnons de voyage en Norvège défiait un jour une protestante, rencontrée entre Stockolm et Upsal, de deviner la profes-sion de chacun des cinq voyageurs qu'elle avait devant elle. Parcourant du regard les inconnus, elle fixa d'abord l'abbé Jouin et, sans hésiter : «Monsieur est un moine», prononça-t-elle.
Distingué, mais sans recherche dans sa personne, il ne faisait pas cependant de cette distinction le signe toujours cer-tain et exclusif de la sainteté :
«Pour le Père P., écrivait-il au même abbé, c'est un saint prêtre, mais on ne saurait, en effet, le donner comme un modèle de tenue ecclésiastique. Peut-être faut-il être ainsi en Palestine où il porte ses pas ? quoi qu'il en soit, sa vie est bien extraordinaire et déjà pleine de faits surnaturels marquants. Dieu se récrée à faire des prodiges avec quelques âmes privilégiées, pour oublier les nausées que lui infligent l'immense majorité des tièdes et des mé-diocres... Une âme encore bien surprenante, est celle de M. E... C'est la «foi vivante».
Mgr Jouin ne voulait pas être rangé parmi ces inutiles et ces médiocres. Au soir de sa vie, sentant venir l'heure où l’on ne peut plus rien, il redoublait d'ardeur au travail et prolongeait ses journées en prenant sur ses nuits.
«Mon plus grand agrément serait de faire connaissance avec le bon Père Foy. Demande-lui ses prières pour moi. J'en ai besoin pour l'âme et pour le corps. Pour l'âme ça date de 78 ans. Pour le corps, je me suis aperçu que j'avais perdu l'œil droit, comme Philippe à Pharsale, mais pour une autre raison.
J'ai eu une hémorragie qui a fait tache noire. Elle s'atténue un peu, sans qu'on puisse affirmer encore si elle dis-paraîtra. Je devais être dans cet état à mon insu, depuis deux ou trois mois, car je m'apercevais seulement que ma vue était brouillée. Je ne lis pas moins jour et nuit, ce qui n'est pas sans doute un remède coté dans le Codex (27 mai 1923).
Quelques mois après, de Fouchy, en Alsace, où il passait ses vacances dans la demeure hospitalière de l'abbé Ant-zenberger, son ancien vicaire et son commensal à Saint-Augustin, il écrivait encore : «Ici, les sapins sont à deux kilo-mètres en montagne à pic, mais il fait un tel vent que je reçois leurs effluves à domicile. J'ai fini hier mon chapitre sur 1848 - Je vais me mettre au second Empire ; puis j'aurai «la Commune» et cela me fera cinq chapitres et mon Ve volume. - Si je n'avais pas le sermon sur saint Michel, tout serait fini durant les vacances. D'autre part, je ne pouvais pas dédai-gner saint Michel, puisque c'est lui qui chasse le diable et les Maçons... Le Bon Dieu est bien avec toi ; prends des forces pour le servir et étendre Son règne».
Cette conviction, qu'un prêtre a pour mission d'étendre le règne de Dieu et qu'il n'est jamais assez armé pour défendre l'Église, explique chez Mgr Jouin cette activité inlassable qui nous déconcerte :
«Depuis mon retour de Rome, écrit-il au même jeune prêtre, le 2 janvier 1924, je n'ai pas arrêté : visite pastorale, travaux en retard, Revue, Noces d argent de M. Zemmer, réceptions de Noël et du Jour de l'An, c'est l'engrenage d'une chaîne sans fin. J'ai bien 100 lettres à écrire et je commence dans huit jours mon Adoration perpétuelle, et je reçois en même temps Dom Cabrol... Quant aux visites, elles sont emportées par les inondations !»
Pendant les dix ou quinze années qui lui restaient à vivre, constate M. l'abbé Chupin, dans un remarquable article du Bulletin des anciens élèves de Combrée, l'activité intellectuelle et physique de Mgr Jouin semblait à peine faiblir. Malgré son aspect débile, il conservait presque entières les forces qu'il avait protégées toute sa vie au prix de soins constants.
«L'année même de sa mort, il avait annoncé sa visite au Collège pour la fête des Anciens. Au travail de bonne heure, jusque tard dans la nuit, il se tenait au courant de toutes les nouveautés. Du fond de sa bibliothèque silen-cieuse, il dirigeait l'évolution de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, rédigeait de nombreux articles et composait d'importants discours qui témoignaient de la vivacité de son esprit. Ceux qui le visitaient alors étaient frap-pés par la limpidité de son regard tout rayonnant d'intelligence».
Sa belle humeur, son entrain, sa gaieté même, aux heures de détente et au cours de ses voyages n'étaient que le fruit naturel de cette prodigieuse activité. Il était docile au conseil du poète à la jeune ouvrière dans ces vers qu'il avait souli-gnés dans son Victor Hugo :
Travaille : Dieu, vois-tu,
Fit naître du travail, que l'insensé repousse,
Deux filles : la vertu qui rend la gaieté douce,
Et la gaieté qui rend charmante la vertu.
«C'est en voyage surtout, dit l'abbé Constant, professeur à l'Institut catholique, que se révélait la figure originale de l'Abbé Jouin : sa générosité, son cœur, son entrain, sa jeunesse».
Il voyageait rarement seul, mais le plus souvent accompagné d'un ou plusieurs prêtres, pour s'assurer, en cas de be-soin, le bénéfice de l'absolution. Il est bien peu de ses vicaires ou de ses amis qu'il n'ait, un jour ou l'autre, emmenés avec lui dans l'un de ces voyages légendaires, en Savoie, dans les Pyrénées, en Suisse, en Espagne et en Portugal, en Angleterre ou en Italie.
Toujours pressé, il ne demeurait au même endroit que contraint et forcé. A Tanger, ne parlait-il pas sérieusement, pour revenir en Espagne, de traverser en barque le détroit de Gibraltar, ne pouvant se résigner à attendre deux jours le départ du bateau ! Et il fit dans ce sens une démarche aux bureaux de la marine.
Intrépide d'ailleurs, ne connaissant, même en montagne, que la ligne droite ; préférant le sentier à la route et le rac-courci au sentier ; plus heureux de l'effort accompli que du panorama qui s'offre à ses yeux. Ce qu'il aime c'est l'imprévu les incidents, les marches de nuit, les couchers sur la paille dans quelque refuge alpestre, les ascensions à la corde sur les névés, les fourrés et les taillis où l'on se fraye un passage à coups de canne,... ou les trains manques qui obligent à des heures de marche. Toutes ces aventures, qui provoquent les récriminations de ses compagnons, semblent l'amuser. Maître de son estomac, il peut rester de longues heures sans manger et pense que ses compagnons, prêtres ou reli-gieux, peuvent bien, eux aussi, racheter le plaisir du voyage par quelque pénitence.
«C'est à Alpnachstadt, sur les bords du Lac des Quatre-Cantons, que j'ai commencé à le connaître, nous écrit l'abbé Constant... Toutes ses matinées, il les passait au travail ; mais souvent, l'après-midi, nous excursionnions, lui toujours en avant, grimpeur infatigable et hardi, le plus jeune de tous. Parfois, c'étaient de grandes tournées d'un ou deux jours... Sa générosité était sans bornes et magnifique. Quel que fût le nombre de ses compagnons, il voulait supporter seul les frais du voyage : voitures, hôtels, guides, tout était largement rétribué, de façon à mériter la recon-naissance de chacun. Partout où il passait, il semait de gras pourboires et de généreuses offrandes. Les curés sur-tout n'étaient jamais oubliés... L'année suivante, 1912, il me chargea de le devancer à Feldkirch avec deux grands séminaristes et un plus jeune. Il ne voulait pas que rien manquât dans la maison qu'il avait louée... Vous savez comme moi, qu'à un moment, nous étions six à sa charge, et qu'il nous envoya quatre assister au Congrès eucharis-tique de Vienne... Quant à moi, continue notre savant correspondant, je fus toujours édifié par sa charité et sa bonté, sa piété candide, son assiduité à commencer le voyage par le bréviaire et le chapelet. Il fut toujours le plus agréable des compagnons, comprenant les jeunes, la plaisanterie et la saine gaieté».
Ses absorbants travaux ne l'empêchaient pas du reste de se montrer accueillant à tous. Pauvre ou riche, chacun était assuré de la même cordialité. Les humbles avaient peut-être sa préférence ; dans ses relations avec les gens des classes supérieures, une certaine timidité naturelle paralysait quelque peu sa bonne grâce.
«Devenu curé de Saint-Augustin, lisons-nous encore dans l'article cité plus haut, il s'était entouré d'un certain luxe et menait un train de vie qui aurait pu risquer de le séparer de la foule. On savait que c'était la faute de la charge et non celle des sentiments et pour pénétrer jusqu'à lui, on traversait sans se laisser intimider les salons en enfilade à l'aspect cossu et on l'abordait sans trop d'émoi, malgré l'attitude réservée qu'il gardait devant son bureau surchargé de dossiers, sous la lumière d'une haute fenêtre, pendant les premiers instants de l'entrevue. Mais on était bien vite mis à l'aise : les confidences, un nom connu jeté dans la conversation, le rappel d'un souvenir le déridaient ; ses yeux pénétrants brillaient d'un éclat malicieux, et il vous tenait sous le charme de ses paroles. Jamais on n'avait l'impres-sion qu'on avait pu l'importuner ; l'affabilité était chez lui la forme la plus souriante de la charité».
Cette aimable cordialité était chez Mgr Jouin le fruit de la vertu et le résultat de longs efforts, plus encore qu'une dis-position de nature. Son tempérament l'eût porté plutôt à la vivacité et à l'impatience. Mais au jour de sa conversion, le jeune collégien de Combrée, «pour se conformer au Cœur de Jésus», avait promis d'être aimable avec tous, et le Curé de Saint-Médard avait écrit dans ses notes de retraite ces mots devenus pour lui un programme : Faire plaisir pour attirer les âmes à Jésus.
Cette patience fut pourtant mise à de rudes épreuves ; il rencontra sur son chemin la félonie et la trahison. Rarement on le vit perdre la maîtrise de lui-même. Pour lui arracher un mouvement d'impatience ou de colère, il fallait un motif d'une haute gravité. Ce qui lui répugnait au-delà de toute expression, c'étaient les manœuvres louches et hypocrites ; elles soulevaient chez lui un dégoût qui pouvait aller jusqu'à la révolte.
Maître de ses impressions, il ne l'était par moins de son corps, auquel il imposait des marches forcées, des jeûnes prolongés, de sanglantes macérations. En voyage, il préférait se priver de manger plutôt que de se mêler à la foule dans un buffet ou dans un restaurant. «Vous savez comme moi, nous disait son dernier confesseur, M. l'abbé Baronnet, com-bien il tenait peu compte de sa propre souffrance, quand il s'agissait de travailler ou de rendre service. Autant il était at-tentif à s'enquérir de la santé des autres, autant il se taisait sur ses propres souffrances si patiemment supportées».
Mais la note dominante de son caractère fut jusqu'à la fin la droiture et la ténacité d'une volonté sur laquelle les an-nées n'avaient pas de prise. Il réalisait magnifiquement dans sa personne le Justum ac tenacem propositi virum du poète latin.
De la justice, il avait un sentiment très aigu : jamais on ne l'y vit manquer et il ne souffrait pas qu'on y manquât en sa présence. Pour défendre des innocents, il s'exposait lui-même aux coups. Les coupables avaient toute sa pitié, et l'on di-sait de lui qu'il était presque aussi avantageux d'être de ses ennemis qu'au nombre de ses amis. Parfois trompé, il ne trompa jamais personne : il n'abandonnait pas ceux à qui il avait accordé sa confiance.
Un de ses amis parmi les meilleurs regardait comme le signe caractéristique de son âme sa fidélité, et à bon droit. Une fois que Mgr Jouin s'était donné, il savait difficilement se reprendre. «L'amitié avait chez lui des racines profondes : quand il avait jugé quelqu'un digne de sa confiance, il se reposait sur lui les yeux fermés ; il ne s'arrêtait pas à la pensée décevante que l'on n'est jamais mieux trompé que par les siens, et il ne suffisait pas d'une seule peccadille pour ébranler sa sérénité ! C'est qu'il avait une âme limpide et sans détours et son défaut, si défaut il y a, fut de mesurer toujours autrui à son aune».
Dans ses discours de mariage, on remarquait avec quelle insistance il recommandait la fidélité à la parole jurée et l'accent d'énergie qu'il mettait dans ces vers que le poète place sur les lèvres d'un de ses héros dans les Burgraves, à propos des chevaliers du Moyen-Age :
Le brave mort dormait dans sa tombe humble et pure,
Couché dans son serment comme dans son armure ;
Et le temps qui des morts ronge le vêtement,
Parfois brisait l'armure, et jamais le serment !
«Sa droiture, dit encore l'abbé Chupin, n'avait d'égale que sa franchise et il avait peine à imaginer des sentiments retors et intéressés qu'il n'éprouvait point. Jamais homme ne fut moins courtisan que lui : il traça son sillon tout droit, en bousculant peut-être quelque peu les uns et les autres, mais ce fut à force de travail persévérant, sans rien devoir à la flatterie, sans jamais sacrifier un iota de ses convictions».
La vertu naturelle qui jetait chez Mgr Jouin le plus vif éclat, c'était incontestablement l'énergie tenace de sa volonté. Elle commandait même à son corps qu'elle forçait à vivre. Au lendemain de sa mort, le docteur Chiron nous écrivait :
«Au point de vue strictement médical, je suis étonné de son extrême longévité. Perpétuellement malade depuis ses plus jeunes années, il est extraordinaire qu'il ait pu atteindre un âge aussi avancé, en faisant fi de toutes les pré-cautions qui lui étaient pourtant nécessaires. Enfant délicat, il est obligé d'interrompre ses études. Bronchites fré-quentes, pleurésie, probablement même légère atteinte de tuberculose, comme semblent l'indiquer les hémoptysies qui se manifesteront plus tard. Il se rétablit tant bien que mal. Trouvé trop faible pour rester chez les Dominicains, le voilà maintenant exerçant son ministère à Paris et dans la banlieue, débordant d'une activité qui ne cadre guère avec sa santé toujours précaire. Presque chaque année, il est malade : bronchites, congestions pulmonaires se suivent, auxquelles viennent s'ajouter par la suite coliques néphrétiques, cystite, pyélo-néphrite. Il se soigne à peine, commet toutes les imprudences, se nourrit vaille que vaille. Hygiène, régime, repos n'existent pas pour lui. Malade, alité, il tra-vaille encore. A peine rétabli, c'est de nouveau le surmenage ; il est infatigable. Sa résistance semble donc réelle-ment extraordinaire et s'explique difficilement avec la fragilité d'un organisme débilité par la maladie».
On était frappé de la flamme de son regard et de l'accent de sa voix quand, aux fêtes du Centenaire de Combrée, il rappelait devant tout le collège les vers immortels du poète qui le peignaient lui-même si bien :
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front ;
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime ;
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour ;
Ceux dont le cœur est bon et dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur ; les autres, je les plains.
Il n'est pas douteux - et c'est l'avis de ses médecins - que Mgr Jouin n'a vécu si longtemps que parce qu'il l'a voulu, et il n'a voulu vivre que pour lutter - sans crainte d'ailleurs - contre les ennemis de Dieu. Turenne menait de force au combat sa «vieille carcasse» tremblante. Lui, on ne l'a jamais vu trembler, pas plus qu'on n'a jamais surpris ses larmes.
Cette énergie indomptable parut bien dans les toutes dernières années de sa vie, quand il découvrit une sorte de complot tramé autour de lui pour lui enlever avec sa bibliothèque la direction de la Ligue Anti-Maçonnique. Avec quelle énergie il bouscula toutes les intrigues pour rester maître chez lui. On s'aperçut alors qu'il n'était pas le vieillard affaibli que l'on supposait.
Sur une nature aussi ferme, le prêtre pouvait sans peine, avec l'appui d'en haut, élever l'édifice solide de la sainteté : ce ne serait pas la maison bâtie sur le sable qu'emporte l'ouragan ou qu'entraînent les eaux. Sa vie religieuse s'arc-boutait sur la prière, à laquelle il donnait la plus grande partie de son temps. «Il prie plus que nos moines», disaient ses amis bénédictins ou dominicains. C'était d'abord une prière au premier éveil, puis la prière du matin, à genoux, aux pieds de son grand Crucifix, puis les petites heures du bréviaire avant la Messe - celle-ci suivie d'une action de grâces prolon-gée - puis l'oraison, la lecture, vêpres et complies avant midi ; matines et laudes avant le travail de l'après-midi. Pendant les soins douloureux et prolongés, auxquels il dut se résigner pendant sept ans, il récitait à haute voix le rosaire en entier, les litanies de la Sainte Vierge, souvent celles du Sacré-Cœur ou de saint Joseph, le De Profundis, une prière au Saint-Esprit dont il lisait un petit office, enfin de pieuses invocations à ses saints de prédilection (en 1926, il avait été atteint d'une cystite, et, en raison de son grand âge, le docteur Bazy n'avait pas osé l'opérer). Chaque semaine l'office des morts s'ajoutait au bréviaire, et presque chaque jour le Chemin de la Croix. (Nous tenons ces détails et plusieurs autres qu'on li-ra dans la suite du témoin dévoué de ses vingt dernières années, Mme Baurrault).
C'est dans cette union habituelle avec Dieu qu'il faut chercher la source secrète de ces vertus surnaturelles dont il donna, au déclin de sa vie surtout, tant et de si beaux exemples. Là, comme dans un sol fertile, sa foi enfonçait ses ra-cines vivaces, sa confiance trouvait son abandon, sa charité son inépuisable fécondité.
Sa foi voyait Dieu en tout et en tous. Les créatures, il ne semblait pas les apercevoir. On ne surprenait son regard si limpide et si profond que rarement, dans une discussion ou lorsqu'il écoutait de la musique : «Ne me demandez pas, di-sait-il, si tel ou tel est blond ou brun, s'il est chauve, s'il porte la barbe, de quelle couleur sont ses yeux... je ne vois rien de tout cela». Il ne voyait que Dieu et les âmes faites pour Dieu. «Qu'aucune d'elles, écrivait-il à quelqu'un qui était tenté de l'oublier, ne puisse jamais nous reprocher d'avoir arrêté son élan vers les cimes et de l'avoir ramenée vers la terre».
C'est vers Dieu et vers les âmes rachetées par Dieu que tendait son labeur : Ad te ! pour vous, mon Dieu, telle était sa devise. Rien de ce qui se rapportait à Dieu et au culte divin ne lui semblait petit ou négligeable ; aussi le voyait-on passer des journées entières, debout, sur des gradins, à orner lui-même les reposoirs, et cela jusqu'à un âge très avancé, au prix de fatigues excessives.
Il n'est pas jusqu'à ses vacances et à ses voyages qu'il ne ramenât à cette unique pensée : Dieu et les âmes : c'était ou un pèlerinage pieux à accomplir, à la Salette, à la Sainte-Baume, à Lourdes ou même à Pellevoisin, ou quelque bien à faire : des âmes à toucher ou à convertir ; des amis, prêtres ou laïcs peu fortunés, à distraire, comme ce bon curé de Dampierre, l'abbé Bertrand ; des santés à rétablir, surtout celle de ses prêtres et de ses séminaristes qu'il conduisait à Divonne, à Saint-Christophe en Oisans et jusqu'en Tyrol ; du soleil enfin à mettre dans les vies et dans les cœurs.
Sa confiance en Dieu, dans l'Église et dans le Pape grandissait avec les années : «Le seul espoir de salut, disait-il avec énergie quelques jours avant sa mort, est dans l'intervention du Pape, seul capable d'arracher le monde à l'emprise des forces mauvaises».
Mais la vertu qui, au soir de sa vie, jetait chez lui les rayons les plus chauds, c'était sa bonté pitoyable à toutes les dé-tresses. Cette vertu qu'il se plaisait à recommander aux époux dont il bénissait l'union, en leur rappelant les vers du poète
La bonté, c'est le fond des natures augustes :
D'une seule vertu Dieu fait le cœur des justes,
Comme d'un seul saphir la coupole du ciel,
il la mettait le premier en pratique.
Pour consoler des familles éplorées, il traversait la France. Il était à Lourdes quand lui parvint la nouvelle de la mort de Mme Busson Billault, une paroissienne d'élite et sa pénitente. Il part le soir, change deux ou trois fois de train dans la nuit pour arriver le matin dans le petit village, près de Nantes, où les obsèques avaient lieu. Il célèbre la messe du convoi qu'il préside jusqu'au bout, puis sans prendre le temps de déjeuner, s'embarque pour Paris, où il arrive épuisé. Une bronchite se déclare qui le retient six semaines au lit.
C'est encore en arrivant à Lourdes qu'une autre année il apprend la mort d'un des plus fidèles employés de Saint-Augustin, M. Gardette, père de l'un de ses séminaristes. Il laisse aussitôt son compagnon, le Curé de Vern, pour aller rendre à ce serviteur dévoué les derniers devoirs.
Ni le temps, ni les ingratitudes n'arrivaient à épuiser cette inlassable charité. Chapelain de Sainte-Geneviève, en 1878, il avait rencontré près d'une malade, une jeune fille qu'elle avait adoptée. La pauvre femme mourut. L'abbé Jouin n'abandonna jamais l'enfant : 55 ans plus tard, au lendemain de la mort de son bienfaiteur, celle-ci nous écrivait sa peine et sa reconnaissance : «Il me recevait le dimanche, deux fois le mois et, me remettant à chaque fois une petite somme : «Prenez, ma bonne Marie, prenez sans crainte. Je ne vous demande que de prier beaucoup pour moi».
Car il n'attendait pas, pour donner, la demande qui, chez certains, n'ose s'exprimer ; il la provoquait ou plutôt la de-vançait :
«Quelques semaines avant sa fin qu'il pressentait déjà, dit l'abbé Chupin, il fit appeler le supérieur de Combrée et après l'avoir interrogé sur la prospérité du collège comme aussi sur ses besoins, il le rendit bénéficiaire d'une géné-reuse aumône dont on lui avait laissé la libre disposition. Il n'avait plus personnellement les moyens de nous conti-nuer ses libéralités et il en souffrait plus que l'on ne saurait s'imaginer. C'était en effet sa façon à lui de traduire ses sentiments : il donnait largement, parfois même un peu au delà de ses moyens. Ses visites à Combrée se mar-quaient presque toujours par quelque aménagement nouveau ou quelque embellissement de la maison : il voulait qu'elle présentât aux élèves un visage accueillant et aimable. Le plus naïvement du monde, il provoquait les do-léances et ses yeux fureteurs savaient découvrir les travaux qui s'Imposaient. Après avoir fait parqueter les dortoirs à ses frais, il paya le pavage des cloîtres. Les élèves n'avaient point de salle pour jouer la comédie : l'abbé Jouin fit bâ-tir la salle que les téméraires seuls osaient rêver et le donateur poussa même la munificence jusqu'à la décorer d'un plafond lambrissé et à la doter d'une vaste scène, pourvue de la machinerie la plus moderne pour l'époque».
Ses élèves, ses séminaristes surtout étaient véritablement ses enfants. L'un d'eux que la maladie empêcha d'arriver au sacerdoce, fut de sa part l'objet de soins prolongés. Il lui avait assuré le traitement fort coûteux d'un spécialiste en re-nom - traitement qui prenait toute la journée - et comme le pauvre abbé n'avait pas le temps de rentrer chez lui en ban-lieue, le Curé de Saint-Augustin le gardait chez lui, se privant, pour le distraire, du repos qui lui était prescrit à lui-même après ses repas. De plus, un frère de cet abbé fut envoyé au collège de Combrée, où l’on fondait sur lui des espérances qui ne devaient pas se réaliser et, deux fois la semaine, la mère et la sœur de ces jeunes gens venaient au presbytère suivre le traitement d'un grand spécialiste.
Un autre séminariste fut de sa part l'objet de soins non moins touchants. Pour sa santé menacée, il l'avait envoyé dans un séminaire du Midi, puis à Rome pour ses grades théologiques, obtenait des supérieurs tous les adoucissements et le confort nécessaires à son état et, pour ses vacances, tenait compte des recommandations des médecins.
Il avait pour certaines infortunes des attentions maternelles. C'est une paroissienne, veuve de guerre qu'il faut mainte-nir dans un appartement trop coûteux, et ses deux enfants dont il faut continuer l'instruction et qui ont besoin de va-cances au grand air... L'aide arrivera toujours au moment opportun, discrète, touchante, paternelle. - C'en est une autre dont le commerce périclite. Si elle ne trouve pas 20.000 francs, c'est la faillite... et la faillite est évitée. Ce sont des amis malheureux qu'il faut sauver de la misère : Mgr Jouin a eu pendant près de quinze ans à sa charge un de ses collabora-teurs ruiné et sa fille.
Pour les malades, sa bonté s'exprimait en des gestes d'une délicatesse exquise. Un jour on le vit arriver les bras chargés de fleurs rares dans une clinique où son premier vicaire venait de subir une grave opération : c'étaient les fleurs de son 86e anniversaire dont il se privait pour réjouir le cher malade. Ses vicaires étaient-ils souffrants ? il était le premier à leur imposer tout le repos nécessaire à une complète guérison.
Mais où sa charité s'élevait à des hauteurs peu communes, c'était à l'égard de ses ennemis. Déjà on l'avait vu secou-rir dans sa détresse un sacristain de JoinviIIe-le-Pont qui avait pris parti contre lui pour le Maire franc-maçon. Plus tard il agit de même à l'égard d'une femme à son service pendant un séjour à Feldkirch et dont on lui avait signalé les larcins. Le besoin, sans doute, était la cause de ces indélicatesses. Aussi de retour à Paris, le Curé de Saint-Augustin lui faisait-il parvenir des subsides.
Cet amour des ennemis lui inspira des actes vraiment héroïques. Un personnage ami lui avait demandé une pièce pour son théâtre : le «Mystère de Jeanne d'Arc». L'abbé Jouin, pour le satisfaire, avait fait de gros frais et travaillé jour et nuit. La pièce était achevée et les répétitions commencées, quand il apprit par hasard, que ce n'était pas sa «Jeanne d'Arc» qu'on allait jouer, mais celle d'un autre auteur. Bien plus, le même personnage lui avait pris une scène entière de sa «Passion» sans en indiquer la source. Des hommes d'affaires furent nommés de part et d'autre ; on offrait éventuelle-ment à l'auteur trompé et volé une indemnité qui ne fut d'ailleurs jamais versée. Toutes les relations avaient été rompues entre les deux amis, quand au bout de dix ans, Mgr Jouin annonce, un peu avant le déjeuner, à la personne chargée du gouvernement de sa maison, la présence d'un convive.
- Devinez le nom, lui dit-il, énigmatique... C'est M. P.
- Comment, il ose reparaître chez vous !
- Vous a-t-il au moins fait des excuses ?
- Du tout. Mais il a besoin de moi. Je viens de lui donner une recommandation pour le docteur Bazy. Dans un instant, il va revenir déjeuner avec nous.
- Excusez-moi, répondit la Secrétaire. Je ne paraîtrai pas à ce repas.
- Ce ne serait pas chrétien. Rappelez-vous le Pater.
- Mais Notre-Seigneur n'a pas dit de pardonner les offenses faites à ceux que nous aimons !
- Notre-Seigneur n'a pas mis de limite au pardon.
Bientôt le personnage arrivait radieux : le docteur allait l'opérer gratuitement. Il déjeune très à l'aise. Bien plus, il s'ins-talle au presbytère, comme autrefois ; tout le temps de la guerre il y descendit à l'improviste, y recevant toujours un bien-veillant accueil.
Envers le comte de B., en qui il avait mis toute sa confiance et qui l'avait entraîné jadis dans une affaire désastreuse, lui faisant perdre à lui et à ses amis une somme considérable, Mgr Jouin ne fut pas moins magnanime. Après vingt ans de séparation, M. de B. reparut tout à coup, vieilli et «mourant de faim». Le Curé de Saint-Augustin, qui avait alors tant de peine à soutenir son ambulance, lui fit jusqu'à sa mort une pension mensuelle de 200 francs, souvent portée à 300, lors-que les demandes se faisaient plus pressantes. La lettre suivante, dont la Secrétaire avait pris copie, montre bien sa grandeur d'âme.
«Mon cher ami.
A cause du froid, je vous envoie, ce mois-ci encore, 300 francs ; mais je ne pourrai continuer, et je ne sais même comment je pourrai trouver 200 francs pendant les mois d'été... Toujours est-il que je le fais de bon cœur. C'est bien uniquement à titre d'ami et par bonté de cœur que je vous envoie les mensualités, parce qu'on est venu me dire que vous «mouriez de faim», ce que confirme votre lettre dans les mêmes termes. J'espère de la sorte pourvoir au plus indispensable, avec le vrai regret de ne pouvoir faire davantage.
Soyez persuadé que le passé - même les lettres écrites contre moi à Mgr L... et qui m'ont été remises - est tota-lement oublié.
Bien fidèlement à vous E. J.
Ce magnifique mépris de l'argent n'était chez Mgr Jouin que la mise en pratique du vœu de pauvreté dont il avait ce-pendant été relevé en quittant la robe de saint Dominique. Il se considérait toujours comme le simple économe des sommes qu'on lui remettait comme de celles qui auraient pu lui appartenir en propre. Ce qu'il recevait d'une main, il le donnait de l'autre. Cet homme qui, au jugement de son prêtre trésorier, «distribua des millions», ne gardait rien pour lui et vivait au jour le jour. Il n'eut de calice à lui qu'à la mort de son frère, et ne prenait point d'honoraires pour ses messes.
Plus d'une fois, dans les dernières années surtout, il fut réduit à la gêne ; et lui, qui avait passé sa vie à faire l'aumône, consentit à la recevoir d'un prêtre qui avait devin
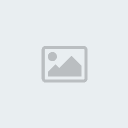
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
Re: Totalitarisme Franc-maçon - Mgr Ernest Jouin, curé de Saint-Augustin (1844 - 1932)
UN BON SERVITEUR DE L'ÉGLISE MGR JOUIN
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 13 et Fin)
* * *
CHAPITRE IX LES DERNIERS JOURS. 12-27 Juin 1932.
LA MORT FRAPPE AUTOUR DE MGR JOUIN : M. DOMINIQUE DELAHAYE ; M. BOUHIER, SON NEVEU ; MLLE AMIEL. - PROJET DE DEPART POUR LE CANNET. - IL TOMBE MALADE. - IL DEMANDE L'EXTREME-ONCTION. - SA PATIENCE. - «C'EST ETRANGE, JE NE PEUX PAS MOURIR !» - SON DERNIER MOT EST UNE PAROLE DE BONTE. - LE SALVE REGINA. - SA DERNIERE COMMUNION. - LES VISITES DE MGR CREPIN ET DE MGR ODELIN. - LA BENEDICTION DU SAINT PERE. - SA DERNIERE JOIE. - LA MORT : 27 JUIN 1932. - LES FUNERAILLES.
La mort pouvait venir. Sa gerbe était faite et le divin moissonneur allait l'engranger dans les célestes greniers.
En cette année 1932 - la dernière de sa longue existence - la mort avait frappé cruellement autour de lui ; en quelques mois, elle lui avait pris ses meilleurs amis : son compagnon de luttes, le sénateur Dominique Delahaye, puis la sainte complice de ses charités, Mlle Céleste Amiel, à laquelle moins d'un mois avant sa propre mort, il était allé rendre, à Join-ville, les derniers devoirs ; quelques semaines auparavant, c'était la mort foudroyante de son neveu, M. Bouhier, enlevé, à quarante trois ans, à l'affection de sa femme et de ses quatre petits enfants.
Tous ces êtres aimés, partis pour un monde meilleur, l'attiraient là-haut. Il était prêt. Son rêve d'une société de prêtres ou de religieux continuant, après lui, la lutte anti-maçonnique qu'il soutenait depuis vingt ans, ne s'était pas réalisé. Mais un Comité composé de ses meilleurs collaborateurs avait acquis l'inestimable bibliothèque amassée, livre par livre, de-puis de longues années. Son œuvre ne mourrait pas avec lui. Ses affaires personnelles étaient en règle. Sa nièce avait ses instructions pour l'attribution de souvenirs à la paroisse, à ses amis, à ses vicaires, à ses fils spirituels surtout.
L'été venu, tranquille du côté de la paroisse confiée aux soins de son Coadjuteur, il allait partir pour plusieurs mois, non pour se reposer - ce travailleur ne connaissait pas ce mot - mais pour continuer son œuvre plus librement et sous un ciel plus clément. Le 3 juin, il écrivait au Curé de Saint-Joseph d'Angers, qui lui avait adressé l'image de deuil de son frère, le sénateur Delahaye :
«Comme Dominique nous fait défaut en ce moment ! Où allons-nous ?... En attendant les graves événements, le docteur m'envoie dans le Midi, réchauffer mes vieux os. Je pars la semaine prochaine et je suis déjà au classement des notes et des livres pour continuer la Revue en pays lointain...»
Trois cents kilos de livres et de documents l'avaient devancé. Les places étaient retenues pour le Dimanche soir 12 juin.
On lui avait offert l'hospitalité au Cannet. Le souvenir de son frère, mort là-bas en pleine force, après une agonie de six mois, lui inspirait-il quelque pressentiment ? «Pourvu, disait-il à l'un de ses abbés qui lui parlait de son prochain dé-part, que je ne fasse pas comme mon frère qui partit pour Cannes, et qui n'en revint pas !» Lui, ne devait pas partir.
Depuis quelques jours il se fatiguait à rassembler livres et notes. La veille du départ, il se ménagea encore moins. Il devait présider, ce samedi, une séance de la Ligue. Il avait invité à déjeuner M. le Chanoine Chantrel et une autre per-sonne venus pour l'entretenir de questions concernant l'occultisme ; il les garda encore après le repas, et, sans prendre un instant de repos, partit à la Salle des Centraux.
Quand il revint, il était à bout de forces : la fièvre se déclara. Le lendemain, quelques heures avant l'heure fixée pour le départ, il essaya de se lever. Mais il dut céder aux instances de son entourage ; il se recoucha, cette fois pour ne plus se relever. Aussitôt mandés, son chirurgien et son médecin constatèrent un mal infectieux, conséquence trop ordinaire des hypertrophies prostatiques non opérées. Au bout de quelques jours, elle céda mais pour faire place à rembarras broncho-pulmonaire si dangereux pour les vieillards.
Dès le premier jour, les médecins n'avaient pas caché leur inquiétude. Mais le malade avait si souvent trompé leurs prévisions qu'ils n'osaient pas désespérer. Pour lui, conscient du danger, il demanda dès le mardi 21 à M. l'abbé Baron-net, son premier vicaire et son confesseur depuis la mort du R.P. de Maistre, de lui administrer l'Extrême-Onction. Chaque matin on lui apportait la sainte Communion.
Durant toute cette crise, sa patience ne se démentit pas un instant. Il supportait sans un mot, sans le moindre signe d'impatience les soins nécessités par sa cystite et les traitements souvent très douloureux auxquels on le soumettait.
Dans la nuit du vendredi 24, la Prieure des Servantes des Pauvres qui le veillait depuis quelques nuits, le trouvant plus mal, fit appeler M. l'abbé Sauvêtre et le clergé, et l'on commença les prières des agonisants. Ces messieurs, en arri-vant, baisaient la main que le cher malade agitait doucement en signe de salut ou en geste de bénédiction. Il respirait dif-ficilement, mais restait très attentif à tout et remarquait chacun de ceux qui entraient. Il voulait tous ses prêtres autour de lui et, croyant la fin venue, il en réclama trois qui n'étaient pas encore arrivés. Après une heure de prières, la crise parais-sant conjurée, chacun se retira, sous sa bénédiction.
Les journées du samedi et du dimanche furent meilleures et laissèrent encore un peu d'espoir. Mais dans la nuit du lundi, les vicaires furent de nouveau alertés. Quand ils arrivèrent, celui qui avait été son second fils dans le sacerdoce ré-citait le rosaire que le malade avait lui-même demandé ; les prêtres présents répondaient. On se souvint alors du regret qu'il avait jadis exprimé de ne pas entendre à son heure dernière le Salve Regina chanté à mi-voix par ses frères en saint Dominique, et l'on interrompit le chapelet pour réciter l'antienne à la T.S. Vierge. Le malade paraissait en proie à de vives souffrances et sa respiration était très pénible. «Cependant chaque fois que l'un de nous en arrivant, écrit un des té-moins, touchait sa main, il ouvrait les yeux et le bénissait : c'était infiniment touchant». Le rosaire terminé, on lui demanda s'il désirait qu'on demeurât près de lui : «Non, répondit-il, c'est trop long !»
M. l'abbé Raymond, son coadjuteur, s'approcha. Il entendit ces mots prononcés d'une voix faible : «C'est étrange, je ne puis pas mourir !» Le moribond s'étonnait lui-même de sa vitalité ; puis il bénit tous ses prêtres, comme pour leur don-ner congé.
A son tour, «son abbé» se pencha vers lui, demandant une bénédiction pour le Curé de Vern : «Oui, fit-il tout bas, oui». Et, délicatement bon jusqu'à la fin, il ajouta : «Et pour sa domestique !» Ce fut l'une de ses dernières paroles.
Au matin, «son abbé», celui qu'il avait préparé à sa première Communion à Saint-Maurice d'Angers, lui apporta le Saint Viatique : sa dernière Communion.
Le cher malade devait, toute la journée encore, résister aux assauts de la mort, mais l'issue fatale n'était plus dou-teuse. «C'est bien la fin», dit-il au docteur Chiron qui, ainsi que le docteur Bazy, le visitait matin et soir.
C'est dans cette matinée que Mgr bénit sa nièce et ses quatre petits-neveux en larmes, soulevant péniblement son bras pour poser la main sur leur tête et essayant encore de tracer le signe de la croix sur leur front. Ces efforts le lais-saient dans une sorte de torpeur, dont il ne sortait que par un acte d'énergie pour saluer des yeux et pour bénir d'autres personnes qui se présentaient. Ce même jour apercevant dans la chambre son fidèle secrétaire, Michaut, et ses deux domestiques, il leur fit signe d'approcher et voulut les bénir une dernière fois.
La veille, Mgr Crépin était venu lui apporter la bénédiction du Cardinal absent. Le mourant ouvrit les yeux et eut en-core la force de dire avec effusion : «Merci». Le même jour, il avait reçu la visite de Mgr Odelin, qui lui rappela que c'était lui qui avait présidé la cérémonie de son installation à Saint-Augustin : «Mgr Jouin, disait en se retirant le Vicaire général, est vraiment une figure qui honorait le clergé de Paris».
La journée du lundi se poursuivait péniblement et le malade déclinait d'heure en heure, mais toujours luttant et gar-dant sa pleine connaissance. Plusieurs fois on vit ses yeux se fixer dans une expression de douleur intense et d'an-goisse. On l'entendit murmurer : «je n'en puis plus !»
«Je récitais à plusieurs reprises, dit le jeune prêtre qui se tenait près de lui, des invocations auxquelles il s'unissait visiblement. Mais les prières récitées à haute voix devaient le fatiguer, car à deux reprises, comme je lui proposais de réciter les litanies des Saints : «Oui, répondit-il, mais tout bas». A un moment, il me dit péniblement : «l'eau bénite contre le diable ! Fais l'exorcisme». Je récitai la prière Sancte Michaël, et je jetai l'eau bénite ; j'en versai sur ses mains qu'il frotta l'une contre l'autre et lui-même porta l'eau à son front».
Le Cardinal Granito di Belmonte avisé, le matin de ce jour, de la gravité de l'état de Mgr Jouin, lui transmettait, avant midi, de la part du Saint Père «la bénédiction apostolique et ses souhaits de réconfort spirituel». Une Religieuse lut au malade la précieuse dépêche ; ne pouvant la lire, il la tenait serrée entre ses doigts, essayant de sourire.
On se souvint alors qu'il avait dit autrefois avoir reçu du Pape Pie X, alors vivant, une grâce spirituelle très précieuse qui ne lui avait jamais manqué un seul jour. Cette suprême bénédiction du Pape régnant fut pour lui, à sa dernière heure, une très douce consolation.
«Dès le début de l'après-midi, les yeux commencèrent à devenir vitreux. Mais ils s'animaient encore lorsque par un effort le malade exprimait une volonté. On le soutenait alors assis sur son lit, et sa tête s'inclinait sur la poitrine. La sueur inondait son front et la respiration se précipitait. C'était une rude agonie».
Vers 7 heures, on récita le Proficiscere, anima christiana. Il y avait dans la chambre un autre prêtre qui resta dans l'entourage jusqu'au dernier soupir. Quelques instants avant la mort il demanda l'avis du vénéré malade au sujet d'un voyage important à Rome et obtint sa réponse affirmative et sa bénédiction.
Enfin un peu avant 8 heures, le lutteur déposa les armes, laissant la mort accomplir son œuvre. Elle le fit si douce-ment - si timidement, semble-t-il, - et avec un tel respect que le médecin qui, à ce moment, lui tenait la main, ne s'aperçut qu'après quelques instants que le cœur avait cessé de battre.
Mgr Jouin mourait dans sa 88e année, entouré de tout son clergé, de cinq de ses fils dans le sacerdoce et d'autres prêtres ses amis, soigné par les Servantes des Pauvres, dont il était bien le «second Fondateur».
La toilette funèbre achevée, on transporta aussitôt son corps dans le grand salon, sous les bras étendus du Christ en croix qu'à l'exemple de saint Paul il avait uniquement prêché, - non loin du tableau de sainte Monique et de saint Augus-tin, le patron de cette paroisse où quarante ans de sa vie s'étaient dépensés - entre les bustes de ses deux frères, géné-reux apôtres eux aussi, et dont il partageait maintenant la couronne - près du portrait de sa mère à qui «il devait tout», la vie et sa vocation - en face de ces livres où il avait cherché la Vérité qu'il contemplait maintenant sans voiles - à côté de ce piano qui avait tressailli tant de fois sous les doigts des Gigout, des Rissler et de tant d'autres artistes de la terre, et soutenu de ses accords les chants de Notre-Dame de Lourdes, et qui maintenant se taisait pour ne pas troubler le ravis-sement de cette âme enivrée des harmonies du Ciel.
Car nous imaginons, nous aussi, que saint Michel était descendu saluer de son épée, à son dernier soupir, l'âme de ce vaillant soldat tombé en pleine lutte sur le champ de bataille, que la Vierge - qu'il avait si bien chantée - l'avait enve-loppée dans son grand manteau bleu, et que le Christ Jésus, à l'entrée du Paradis lui avait dit ces douces paroles : «Al-lons, viens, bon serviteur, entre à jamais dans la joie du Maître que tu as si fidèlement servi !»
C'est dans ce cadre que reposait, étendue, la dépouille mortelle de l'ardent lutteur, admis enfin au «repos éternel», et revêtue des insignes de la prélature, symbole de son indéfectible fidélité à l'Église. Ses doigts, qui avaient écrit tant de choses si douces et si fortes, étaient joints pour une prière qui ne finirait plus. A ses pieds, la croix du Chapitre d'Angers rappelait que s'il s'était donné à Paris, il n'avait jamais cessé d'appartenir de cœur à son diocèse d'origine...
Et, dès le soir, et pendant trois jours, ce fut le défilé ininterrompu des paroissiens et des amis.
Devant Geneviève vieillie et mourante, le poète fait passer un à un tous ceux qu'elle avait guéris, et chacun de pro-clamer le miracle dont il avait été l'objet de la part de la Sainte. Devant le lit où reposait le corps du Curé de Saint-Augustin, si l'on avait pu saisir le chant des âmes reconnaissantes, on aurait entendu : C'est à lui que je dois ma voca-tion... C'est à lui que je dois d'avoir aimé les pauvres, les malades, les enfants..., il m'a ramené à la foi..., il m'a aidé dans mes œuvres..., consolé dans mes épreuves..., soigné dans ma maladie par ses Religieuses..., secouru dans ma dé-tresse...
* * *
Les obsèques furent célébrées le vendredi 1er Juillet. Malgré les vacances, une foule immense remplissait la nef, le pourtour du chœur, les tribunes et débordait sur le parvis.
La levée du corps fut faite par M. le Vicaire général Gaston, qui chanta également la messe.
Le deuil était conduit par M. l'abbé Raymond, coadjuteur du défunt et le clergé de la paroisse - sa famille spirituelle - et par M. et Mme Amédée Jouin, Mme Alain Bouhier et ses enfants, ses neveux et petits-neveux - sa famille de la terre.
Les cordons du poêle étaient tenus par M.M. les Chanoines Labourt, Couchot, Millet et Schaefer : curés de Saint-Honoré, de N.-D. de Bercy, de Sainte-Anne de la Maison-Blanche et de Saint-Lambert de Vaugirard.
La cérémonie était présidée et l'absoute fut donnée par le Cardinal Verdier, qui, pour être présent, avait reculé la réu-nion du conseil archiépiscopal. Il était assisté au trône par M. l'abbé Bridier, chanoine titulaire de Notre-Dame et M. l'abbé de Veyrac, secrétaire de l'Archevêché.
Dans le chœur avaient pris place : Mgr Crépin, évêque de Tralles, Auxiliaire de Paris ; le Rme père dom Cabrol, abbé de Farnborough ; Mgr Odelin, Vicaire général ; M. le Chanoine Lacour, représentant avec M. le Chanoine Bridier le Cha-pitre de Notre-Dame ; Mgr Chabrier, du chapitre de Troyes ; M. le chanoine Villien, Doyen de la Faculté Canonique, M. M. les chanoines Delahaye et Pinier, supérieur du collège de Combrée et M. le curé de Vern représentant le diocèse d'Angers.
Autour du catafalque et dans la nef une vingtaine de Curés de Paris, un grand nombre de chanoines, de prêtres et de religieux - surtout des dominicains - et la foule des paroissiens et des amis accourus de toutes les paroisses où le vénéré défunt avait exercé son ministère.
Après la messe, admirablement chantée par la maîtrise, et le défilé interminable, le corps, accompagné de la même foule fidèle et courageuse sous la pluie, fut conduit au cimetière Montparnasse et, après les dernières prières de la litur-gie, descendu dans le caveau de famille, près de sa mère et de ses deux frères.
C'est là qu'il dort son dernier sommeil.
Mais la pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin n'étouffe pas sa voix et ne pa-ralyse pas son activité. Il parle encore et se survit dans les œuvres qu'il a créées. Les 20 prêtres qu'il a donnés à l'Église, les œuvres de jeunesse qu'il a fondées, les 70 Servantes des Pauvres qu'il a introduites à Paris et, surtout, la Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer l'action bienfaisante du grand serviteur de l'Église que fut Mgr Ernest Jouin.
Au lendemain de sa mort, les continuateurs de son œuvre, lui consacraient ces lignes émues :
«Nous sommes frappés en plein cœur : celui qui était le fondateur, le directeur, le guide, le juge, le maître de cette Revue, vient de mourir.
«Toutes les tristesses de l'affection filiale s'aggravent de l'immense douleur de la perte subie. Il nous quitte quand nous avions le plus besoin de lui, de sa pure lumière, de sa vive flamme, de sa foi incorruptible et, en le voyant partir vers une demeure meilleure, permanente, nous ne trouvons à dire que la parole d'Elisée : «Père, Père, le char d'Israël et son guide !»
«Aujourd'hui, groupés et priants, nous lui faisons la promesse de ne pas oublier l'enseignement de sa vie et de son œuvre. Il est mort aux premières vêpres de saint Irénée, qui porte un nom de paix et combattit toute sa vie contre les hérésies et nous répétons dans nos cœurs avec toute l'Église : «Demeure ferme dans les choses que tu as ap-prises et qui t'ont été confiées».
Aussi bien, le lutteur intrépide que fut Mgr Jouin pourrait-il oublier ses frères d'armes ? Près de Dieu, avec une puis-sance accrue, ne doit-il pas redire la prière qu'il accentuait avec une singulière énergie à la fin de sa messe : que Satan et tous les esprits mauvais acharnés à la perte des âmes soient à jamais rejetés en enfer I
«Éternellement heureux, pouvons-nous dire avec saint Augustin, il se désaltère à loisir à la source de la Sagesse. Et pourtant, nous ne croyons pas qu'il s'enivre jusqu'à nous oublier, quand Vous, ô Seigneur, Vous qu'il boit, Vous conser-vez notre souvenir».
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Lettre de Dom Cabrol
Avant-propos
CHAPITRE PREMIER. DU BAPTÊME A L'ORDINATION. 1844-1868
M. ET MME MARIN JOUIN. - NAISSANCE ET BAPTEME D'ERNEST. - SES DEUX FRERES, AMEDEE ET HENRY. - LE REVE DE MME JOUIN. - LE VIEIL AN-GERS. - MORT DE M. JOUIN. - SOUVENIRS D'ENFANCE. - EVEIL MUSICAL. - PREMIER APPEL DE DIEU. - LE COLLEGE MONGAZON. - L'EXTERNAT SAINT-JULIEN. - LE COLLEGE DE COMBREE. - «JE SERAI DANS BOUILLET !». - PREMIERS ESSAIS LITTERAIRES. - L'OUBLI DE DIEU. - DANS LA CHAMBRE DU PERE PIOU. - LA CONVERSION. - «ENTRE JESUS ET MOI». - ERNEST FAIT VŒU DE CHASTETE ET D'OBEISSANCE. - SA CONSECRATION AU SACRE-CŒUR. - SON ENTREE AU COUVENT DES DOMINICAINS A FLAVIGNY. - LE FRERE MANNES. - IL Y RETROUVE SON FRERE AMEDEE. - LE NOVICIAT SIMPLE. - LE NOVICIAT PROFES A SAINT-MAXIMIN. - MME JOUIN ACCOMPAGNE SES FILS JUSQU'A LA SALETTE. - LA SANTE DU FRERE MANNES L'OBLIGE A RENONCER A LA VIE RELIGIEUSE. - SON ORDINATION A ANGERS.
CHAPITRE II LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE. 1868-1882.
AU CHATEAU DE LATHAN. - SA CORRESPONDANCE AVEC M. LAROCHE, SON DIRECTEUR. - CONSEILS SUR LE JEU DE CROQUET ET AUTRES JEUX. - CONSEILS LITTERAIRES ! ETRE SOI-MEME. - CONSEILS DE PIETE. - CRISE DE SANTE. - DECOURAGEMENT. - IL VOUDRAIT ARRIVER A L'ORAISON D'UNION. - IL REVE D'UN CHAMP D'ACTION PLUS VASTE. - PARIS L'ATTIRE. - SON DIRECTEUR L'EN DETOURNE : OPINION FAUSSE QUE SE FAIT M. LA-ROCHE DU CLERGE DE PARIS. - «DONNEZ-VOUS A L'ANJOU». - LE VICARIAT DE BREZE. - NOUVELLE CRISE DE DECOURAGEMENT : L'ABBE JOUIN VOU-DRAIT MOURIR. - SA VIE INUTILE. - IL EST NOMME VICAIRE A LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH D'ANGERS ET TROIS MOIS APRES A LA CATHEDRALE. - AVEC LES SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE UNE ŒUVRE DE JEUNESSE. SES DEUX PREMIERS ELEVES. - IL OBTIENT DE REJOINDRE A PARIS SA MERE ET SES DEUX FRERES. - UNE PROPHETIE DE MGR FREPPEL QUI NE S'EST PAS REALISEE. - L'ABBE JOUIN EST NOMME VICAIRE A SAINT-ETIENNE DU MONT A PARIS, ET, BIENTOT, CHAPELAIN DE SAINTE-GENEVIEVE. - IL TOMBE GRAVEMENT MALADE. - DANS LES PINS D'ARCACHON.
CHAPITRE III LE CURÉ DE JOINVILLE-LE-PONT. 1882-1886.
JOINVILLE-LE-PONT EN 1882 - LE BANQUET DU VENDREDI-SAINT. - UNE INSTALLATION QUI COMMENCE PAR LE MISERERE. - PREMIERE REN-CONTRE AVEC LA FRANC-MAÇONNERIE. - LES CONQUETES MERVEILLEUSES DES SERVANTES DES PAUVRES. - L'ORAGE ECLATE. - COMMENT ON «FAIT RENDRE GORGE A UN CURE AVANT LA LETTRE». - UN MINISTRE DES CULTES QUI SE DEJUGE A DEUX SEMAINES DE DISTANCE. - QUATRE PROCES ET CENT ARTICLES DE JOURNAUX EN DEUX ANS. - UNE SEANCE TRAGI-COMIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE. - ACQUITTE SUR TOUTE LA LIGNE. - LE CURE DE JOINVILLE EST NOMME SECOND VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. - COMMENT IL SE VENGE DE SES ENNEMIS.
CHAPITRE IV. SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894.
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
CHAPITRE V. LE CURÉ DE SAINT-MÉDARD. 1894-1898.
LE QUARTIER MOUFFETARD ET LA PAROISSE SAINT-MEDARD. LA REORGANISATION DES CATECHISMES ET LA FONDATION D'UN PATRONAGE POUR LES GARÇONS. - UNE BELLE CONQUETE DE L'ABBE JOUIN : L'ABBE BOSSARD. - LA REPRISE DES REPRESENTATIONS DE LA NATIVITE A CHAILLOT ET A L'ALCAZAR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CHANOINE HONORAIRE D'ANGERS. - FONDATION D'UN CATECHISME POUR LES PETITS ET DE LA DOCTRINE CHRETIENNE. - LE CULTE DIVIN A SAINT-MEDARD. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES ; NOMBREUSES CONVERSIONS. - LE REGISSEUR DE LA SCENE DE L'OPERA FAIT SA PREMIERE COMMUNION A 72 ANS. - L'ORATORIO DE N.-D. DE LOURDES. - L'ABBE JOUIN FONDE UNE SECONDE MAISON DE SER-VANTES DES PAUVRES. - ON L'APPELLE LUI-MEME LE PERE DES PAUVRES. - SON DEVOUEMENT ET SA CHARITE POUR LES MALADES. - DEUX EVEQUES VEULENT FAIRE ELEVER L'ABBE JOUIN A L'EPISCOPAT. - IL EST NOMME CURE DE SAINT-AUGUSTIN. - IL QUITTE SAINT-MEDARD EN BEAUTE.
CHAPITRE VI. LE CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN. 1899-1932.
LA TACHE IMMENSE DU CURE DE SAINT-AUGUSTIN.
L'HOMME D'ETUDE : CHAQUE DIMANCHE LA MESSE DU JOUR EXPLIQUEE EST DISTRIBUEE AUX PAROISSIENS. FONDATION DE LA REVUE : LE CA-TECHISME. - IL ENTREPREND UN TRAVAIL COLOSSAL SUR LES EVANGILES. - LE THEATRE CHRETIEN : LE MYSTERE DE LA PASSION», «LE MYSTERE DE JEANNE D'ARC», CLOTILDE, BERNADETTE. - AUTRES ECRITS DE L'ABBE JOUIN : DISCOURS D'INSTALLATIONS ; DISCOURS SUR LA MUSIQUE ET SUR LES MUSICIENS. - POLEMIQUE AVEC M. CAMILLE BELLAÏGNE A PROPOS DE LA MUSIQUE SACREE.
L'HOMME D'ACTION : LES INVENTAIRES A SAINT-AUGUSTIN. L'ABBE JOUIN INVITE SES PAROISSIENS A UNE MESSE DE «DEUIL ARME». IL EST TRA-DUIT EN POLICE CORRECTIONNELLE ET CONDAMNE A 16 FRANCS D'AMENDE. - SA FIERE DECLARATION DEVANT SES JUGES.
L'HOMME DE CŒUR : FONDATION D'UNE TROISIEME MAISON DE SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE L'HOPITAL 139.
SES EPREUVES : IL PERD SA MERE ET SON FRERE HENRY JOUIN. - LA «PASSION» AU NOUVEAU THEATRE. - EPREUVES PATRIOTIQUES. - LA MOBILI-SATION DE LA PRIERE.
CHAPITRE VII. LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE. 1912-1932.
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
CHAPITRE VIII. LES DERNIÈRES ANNÉES.
CE QUE MGR JOUIN AVAIT ECRIT SUR SON AGENDA, LE 1ER JANVIER 1914. - SON ACTIVITE INTELLECTUELLE DANS LES DERNIERES ANNEES. IL PRONONCE D'IMPORTANTS DISCOURS. - IL CELEBRE SES NOCES D'OR, SES NOCES D'ARGENT PASTORALES ET SES NOCES DE DIAMANT. - IL REPOND AUX TOASTS DE SES AMIS. - BENOIT XV L’ELEVE A LA PRELATURE ET PIE XI LE FAIT PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE. - MGR RUMEAU LE NOMME CHA-NOINE D'HONNEUR D'ANGERS. - QUALITES ET VERTUS DE MGR JOUIN SUR LA FIN DE SA VIE : L'HOMME, LE PRETRE, LE MOINE. - IL POUSSE LA CHARITE ET L'AMOUR DES ENNEMIS JUSQU'A L'HEROÏSME.
CHAPITRE IX. LES DERNIERS JOURS.
LA MORT FRAPPE AUTOUR DE MGR JOUIN : M. DOMINIQUE DELAHAYE ; M. BOUHIER, SON NEVEU ; MLLE AMIEL. - PROJET DE DEPART POUR LE CAN-NET. - IL TOMBE MALADE. - IL DEMANDE L'EXTREME-ONCTION. - SA PATIENCE. - «C'EST ETRANGE, JE NE PEUX PAS MOURIR !» - SON DERNIER MOT EST UNE PAROLE DE BONTE. - LE SALVE REGINA. - SA DERNIERE COMMUNION. - LES VISITES DE MGR CREPIN ET DE MGR ODELIN. - LA BENEDICTION DU SAINT PERE. - SA DERNIERE JOIE. - LA MORT : 27 JUIN 1932. - LES FUNERAILLES.
PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE, CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN (1844 - 1932)
CHANOINE SAUVÊTRE, ANCIEN CURE DE SAINT-ETIENNE DU MONT.
1936
(Suite 13 et Fin)
* * *
CHAPITRE IX LES DERNIERS JOURS. 12-27 Juin 1932.
LA MORT FRAPPE AUTOUR DE MGR JOUIN : M. DOMINIQUE DELAHAYE ; M. BOUHIER, SON NEVEU ; MLLE AMIEL. - PROJET DE DEPART POUR LE CANNET. - IL TOMBE MALADE. - IL DEMANDE L'EXTREME-ONCTION. - SA PATIENCE. - «C'EST ETRANGE, JE NE PEUX PAS MOURIR !» - SON DERNIER MOT EST UNE PAROLE DE BONTE. - LE SALVE REGINA. - SA DERNIERE COMMUNION. - LES VISITES DE MGR CREPIN ET DE MGR ODELIN. - LA BENEDICTION DU SAINT PERE. - SA DERNIERE JOIE. - LA MORT : 27 JUIN 1932. - LES FUNERAILLES.
La mort pouvait venir. Sa gerbe était faite et le divin moissonneur allait l'engranger dans les célestes greniers.
En cette année 1932 - la dernière de sa longue existence - la mort avait frappé cruellement autour de lui ; en quelques mois, elle lui avait pris ses meilleurs amis : son compagnon de luttes, le sénateur Dominique Delahaye, puis la sainte complice de ses charités, Mlle Céleste Amiel, à laquelle moins d'un mois avant sa propre mort, il était allé rendre, à Join-ville, les derniers devoirs ; quelques semaines auparavant, c'était la mort foudroyante de son neveu, M. Bouhier, enlevé, à quarante trois ans, à l'affection de sa femme et de ses quatre petits enfants.
Tous ces êtres aimés, partis pour un monde meilleur, l'attiraient là-haut. Il était prêt. Son rêve d'une société de prêtres ou de religieux continuant, après lui, la lutte anti-maçonnique qu'il soutenait depuis vingt ans, ne s'était pas réalisé. Mais un Comité composé de ses meilleurs collaborateurs avait acquis l'inestimable bibliothèque amassée, livre par livre, de-puis de longues années. Son œuvre ne mourrait pas avec lui. Ses affaires personnelles étaient en règle. Sa nièce avait ses instructions pour l'attribution de souvenirs à la paroisse, à ses amis, à ses vicaires, à ses fils spirituels surtout.
L'été venu, tranquille du côté de la paroisse confiée aux soins de son Coadjuteur, il allait partir pour plusieurs mois, non pour se reposer - ce travailleur ne connaissait pas ce mot - mais pour continuer son œuvre plus librement et sous un ciel plus clément. Le 3 juin, il écrivait au Curé de Saint-Joseph d'Angers, qui lui avait adressé l'image de deuil de son frère, le sénateur Delahaye :
«Comme Dominique nous fait défaut en ce moment ! Où allons-nous ?... En attendant les graves événements, le docteur m'envoie dans le Midi, réchauffer mes vieux os. Je pars la semaine prochaine et je suis déjà au classement des notes et des livres pour continuer la Revue en pays lointain...»
Trois cents kilos de livres et de documents l'avaient devancé. Les places étaient retenues pour le Dimanche soir 12 juin.
On lui avait offert l'hospitalité au Cannet. Le souvenir de son frère, mort là-bas en pleine force, après une agonie de six mois, lui inspirait-il quelque pressentiment ? «Pourvu, disait-il à l'un de ses abbés qui lui parlait de son prochain dé-part, que je ne fasse pas comme mon frère qui partit pour Cannes, et qui n'en revint pas !» Lui, ne devait pas partir.
Depuis quelques jours il se fatiguait à rassembler livres et notes. La veille du départ, il se ménagea encore moins. Il devait présider, ce samedi, une séance de la Ligue. Il avait invité à déjeuner M. le Chanoine Chantrel et une autre per-sonne venus pour l'entretenir de questions concernant l'occultisme ; il les garda encore après le repas, et, sans prendre un instant de repos, partit à la Salle des Centraux.
Quand il revint, il était à bout de forces : la fièvre se déclara. Le lendemain, quelques heures avant l'heure fixée pour le départ, il essaya de se lever. Mais il dut céder aux instances de son entourage ; il se recoucha, cette fois pour ne plus se relever. Aussitôt mandés, son chirurgien et son médecin constatèrent un mal infectieux, conséquence trop ordinaire des hypertrophies prostatiques non opérées. Au bout de quelques jours, elle céda mais pour faire place à rembarras broncho-pulmonaire si dangereux pour les vieillards.
Dès le premier jour, les médecins n'avaient pas caché leur inquiétude. Mais le malade avait si souvent trompé leurs prévisions qu'ils n'osaient pas désespérer. Pour lui, conscient du danger, il demanda dès le mardi 21 à M. l'abbé Baron-net, son premier vicaire et son confesseur depuis la mort du R.P. de Maistre, de lui administrer l'Extrême-Onction. Chaque matin on lui apportait la sainte Communion.
Durant toute cette crise, sa patience ne se démentit pas un instant. Il supportait sans un mot, sans le moindre signe d'impatience les soins nécessités par sa cystite et les traitements souvent très douloureux auxquels on le soumettait.
Dans la nuit du vendredi 24, la Prieure des Servantes des Pauvres qui le veillait depuis quelques nuits, le trouvant plus mal, fit appeler M. l'abbé Sauvêtre et le clergé, et l'on commença les prières des agonisants. Ces messieurs, en arri-vant, baisaient la main que le cher malade agitait doucement en signe de salut ou en geste de bénédiction. Il respirait dif-ficilement, mais restait très attentif à tout et remarquait chacun de ceux qui entraient. Il voulait tous ses prêtres autour de lui et, croyant la fin venue, il en réclama trois qui n'étaient pas encore arrivés. Après une heure de prières, la crise parais-sant conjurée, chacun se retira, sous sa bénédiction.
Les journées du samedi et du dimanche furent meilleures et laissèrent encore un peu d'espoir. Mais dans la nuit du lundi, les vicaires furent de nouveau alertés. Quand ils arrivèrent, celui qui avait été son second fils dans le sacerdoce ré-citait le rosaire que le malade avait lui-même demandé ; les prêtres présents répondaient. On se souvint alors du regret qu'il avait jadis exprimé de ne pas entendre à son heure dernière le Salve Regina chanté à mi-voix par ses frères en saint Dominique, et l'on interrompit le chapelet pour réciter l'antienne à la T.S. Vierge. Le malade paraissait en proie à de vives souffrances et sa respiration était très pénible. «Cependant chaque fois que l'un de nous en arrivant, écrit un des té-moins, touchait sa main, il ouvrait les yeux et le bénissait : c'était infiniment touchant». Le rosaire terminé, on lui demanda s'il désirait qu'on demeurât près de lui : «Non, répondit-il, c'est trop long !»
M. l'abbé Raymond, son coadjuteur, s'approcha. Il entendit ces mots prononcés d'une voix faible : «C'est étrange, je ne puis pas mourir !» Le moribond s'étonnait lui-même de sa vitalité ; puis il bénit tous ses prêtres, comme pour leur don-ner congé.
A son tour, «son abbé» se pencha vers lui, demandant une bénédiction pour le Curé de Vern : «Oui, fit-il tout bas, oui». Et, délicatement bon jusqu'à la fin, il ajouta : «Et pour sa domestique !» Ce fut l'une de ses dernières paroles.
Au matin, «son abbé», celui qu'il avait préparé à sa première Communion à Saint-Maurice d'Angers, lui apporta le Saint Viatique : sa dernière Communion.
Le cher malade devait, toute la journée encore, résister aux assauts de la mort, mais l'issue fatale n'était plus dou-teuse. «C'est bien la fin», dit-il au docteur Chiron qui, ainsi que le docteur Bazy, le visitait matin et soir.
C'est dans cette matinée que Mgr bénit sa nièce et ses quatre petits-neveux en larmes, soulevant péniblement son bras pour poser la main sur leur tête et essayant encore de tracer le signe de la croix sur leur front. Ces efforts le lais-saient dans une sorte de torpeur, dont il ne sortait que par un acte d'énergie pour saluer des yeux et pour bénir d'autres personnes qui se présentaient. Ce même jour apercevant dans la chambre son fidèle secrétaire, Michaut, et ses deux domestiques, il leur fit signe d'approcher et voulut les bénir une dernière fois.
La veille, Mgr Crépin était venu lui apporter la bénédiction du Cardinal absent. Le mourant ouvrit les yeux et eut en-core la force de dire avec effusion : «Merci». Le même jour, il avait reçu la visite de Mgr Odelin, qui lui rappela que c'était lui qui avait présidé la cérémonie de son installation à Saint-Augustin : «Mgr Jouin, disait en se retirant le Vicaire général, est vraiment une figure qui honorait le clergé de Paris».
La journée du lundi se poursuivait péniblement et le malade déclinait d'heure en heure, mais toujours luttant et gar-dant sa pleine connaissance. Plusieurs fois on vit ses yeux se fixer dans une expression de douleur intense et d'an-goisse. On l'entendit murmurer : «je n'en puis plus !»
«Je récitais à plusieurs reprises, dit le jeune prêtre qui se tenait près de lui, des invocations auxquelles il s'unissait visiblement. Mais les prières récitées à haute voix devaient le fatiguer, car à deux reprises, comme je lui proposais de réciter les litanies des Saints : «Oui, répondit-il, mais tout bas». A un moment, il me dit péniblement : «l'eau bénite contre le diable ! Fais l'exorcisme». Je récitai la prière Sancte Michaël, et je jetai l'eau bénite ; j'en versai sur ses mains qu'il frotta l'une contre l'autre et lui-même porta l'eau à son front».
Le Cardinal Granito di Belmonte avisé, le matin de ce jour, de la gravité de l'état de Mgr Jouin, lui transmettait, avant midi, de la part du Saint Père «la bénédiction apostolique et ses souhaits de réconfort spirituel». Une Religieuse lut au malade la précieuse dépêche ; ne pouvant la lire, il la tenait serrée entre ses doigts, essayant de sourire.
On se souvint alors qu'il avait dit autrefois avoir reçu du Pape Pie X, alors vivant, une grâce spirituelle très précieuse qui ne lui avait jamais manqué un seul jour. Cette suprême bénédiction du Pape régnant fut pour lui, à sa dernière heure, une très douce consolation.
«Dès le début de l'après-midi, les yeux commencèrent à devenir vitreux. Mais ils s'animaient encore lorsque par un effort le malade exprimait une volonté. On le soutenait alors assis sur son lit, et sa tête s'inclinait sur la poitrine. La sueur inondait son front et la respiration se précipitait. C'était une rude agonie».
Vers 7 heures, on récita le Proficiscere, anima christiana. Il y avait dans la chambre un autre prêtre qui resta dans l'entourage jusqu'au dernier soupir. Quelques instants avant la mort il demanda l'avis du vénéré malade au sujet d'un voyage important à Rome et obtint sa réponse affirmative et sa bénédiction.
Enfin un peu avant 8 heures, le lutteur déposa les armes, laissant la mort accomplir son œuvre. Elle le fit si douce-ment - si timidement, semble-t-il, - et avec un tel respect que le médecin qui, à ce moment, lui tenait la main, ne s'aperçut qu'après quelques instants que le cœur avait cessé de battre.
Mgr Jouin mourait dans sa 88e année, entouré de tout son clergé, de cinq de ses fils dans le sacerdoce et d'autres prêtres ses amis, soigné par les Servantes des Pauvres, dont il était bien le «second Fondateur».
La toilette funèbre achevée, on transporta aussitôt son corps dans le grand salon, sous les bras étendus du Christ en croix qu'à l'exemple de saint Paul il avait uniquement prêché, - non loin du tableau de sainte Monique et de saint Augus-tin, le patron de cette paroisse où quarante ans de sa vie s'étaient dépensés - entre les bustes de ses deux frères, géné-reux apôtres eux aussi, et dont il partageait maintenant la couronne - près du portrait de sa mère à qui «il devait tout», la vie et sa vocation - en face de ces livres où il avait cherché la Vérité qu'il contemplait maintenant sans voiles - à côté de ce piano qui avait tressailli tant de fois sous les doigts des Gigout, des Rissler et de tant d'autres artistes de la terre, et soutenu de ses accords les chants de Notre-Dame de Lourdes, et qui maintenant se taisait pour ne pas troubler le ravis-sement de cette âme enivrée des harmonies du Ciel.
Car nous imaginons, nous aussi, que saint Michel était descendu saluer de son épée, à son dernier soupir, l'âme de ce vaillant soldat tombé en pleine lutte sur le champ de bataille, que la Vierge - qu'il avait si bien chantée - l'avait enve-loppée dans son grand manteau bleu, et que le Christ Jésus, à l'entrée du Paradis lui avait dit ces douces paroles : «Al-lons, viens, bon serviteur, entre à jamais dans la joie du Maître que tu as si fidèlement servi !»
C'est dans ce cadre que reposait, étendue, la dépouille mortelle de l'ardent lutteur, admis enfin au «repos éternel», et revêtue des insignes de la prélature, symbole de son indéfectible fidélité à l'Église. Ses doigts, qui avaient écrit tant de choses si douces et si fortes, étaient joints pour une prière qui ne finirait plus. A ses pieds, la croix du Chapitre d'Angers rappelait que s'il s'était donné à Paris, il n'avait jamais cessé d'appartenir de cœur à son diocèse d'origine...
Et, dès le soir, et pendant trois jours, ce fut le défilé ininterrompu des paroissiens et des amis.
Devant Geneviève vieillie et mourante, le poète fait passer un à un tous ceux qu'elle avait guéris, et chacun de pro-clamer le miracle dont il avait été l'objet de la part de la Sainte. Devant le lit où reposait le corps du Curé de Saint-Augustin, si l'on avait pu saisir le chant des âmes reconnaissantes, on aurait entendu : C'est à lui que je dois ma voca-tion... C'est à lui que je dois d'avoir aimé les pauvres, les malades, les enfants..., il m'a ramené à la foi..., il m'a aidé dans mes œuvres..., consolé dans mes épreuves..., soigné dans ma maladie par ses Religieuses..., secouru dans ma dé-tresse...
* * *
Les obsèques furent célébrées le vendredi 1er Juillet. Malgré les vacances, une foule immense remplissait la nef, le pourtour du chœur, les tribunes et débordait sur le parvis.
La levée du corps fut faite par M. le Vicaire général Gaston, qui chanta également la messe.
Le deuil était conduit par M. l'abbé Raymond, coadjuteur du défunt et le clergé de la paroisse - sa famille spirituelle - et par M. et Mme Amédée Jouin, Mme Alain Bouhier et ses enfants, ses neveux et petits-neveux - sa famille de la terre.
Les cordons du poêle étaient tenus par M.M. les Chanoines Labourt, Couchot, Millet et Schaefer : curés de Saint-Honoré, de N.-D. de Bercy, de Sainte-Anne de la Maison-Blanche et de Saint-Lambert de Vaugirard.
La cérémonie était présidée et l'absoute fut donnée par le Cardinal Verdier, qui, pour être présent, avait reculé la réu-nion du conseil archiépiscopal. Il était assisté au trône par M. l'abbé Bridier, chanoine titulaire de Notre-Dame et M. l'abbé de Veyrac, secrétaire de l'Archevêché.
Dans le chœur avaient pris place : Mgr Crépin, évêque de Tralles, Auxiliaire de Paris ; le Rme père dom Cabrol, abbé de Farnborough ; Mgr Odelin, Vicaire général ; M. le Chanoine Lacour, représentant avec M. le Chanoine Bridier le Cha-pitre de Notre-Dame ; Mgr Chabrier, du chapitre de Troyes ; M. le chanoine Villien, Doyen de la Faculté Canonique, M. M. les chanoines Delahaye et Pinier, supérieur du collège de Combrée et M. le curé de Vern représentant le diocèse d'Angers.
Autour du catafalque et dans la nef une vingtaine de Curés de Paris, un grand nombre de chanoines, de prêtres et de religieux - surtout des dominicains - et la foule des paroissiens et des amis accourus de toutes les paroisses où le vénéré défunt avait exercé son ministère.
Après la messe, admirablement chantée par la maîtrise, et le défilé interminable, le corps, accompagné de la même foule fidèle et courageuse sous la pluie, fut conduit au cimetière Montparnasse et, après les dernières prières de la litur-gie, descendu dans le caveau de famille, près de sa mère et de ses deux frères.
C'est là qu'il dort son dernier sommeil.
Mais la pierre du tombeau qui recouvre la dépouille mortelle du Curé de Saint-Augustin n'étouffe pas sa voix et ne pa-ralyse pas son activité. Il parle encore et se survit dans les œuvres qu'il a créées. Les 20 prêtres qu'il a donnés à l'Église, les œuvres de jeunesse qu'il a fondées, les 70 Servantes des Pauvres qu'il a introduites à Paris et, surtout, la Revue dont il fut le fondateur et l'âme, prolongeront la mémoire et continueront d'assurer l'action bienfaisante du grand serviteur de l'Église que fut Mgr Ernest Jouin.
Au lendemain de sa mort, les continuateurs de son œuvre, lui consacraient ces lignes émues :
«Nous sommes frappés en plein cœur : celui qui était le fondateur, le directeur, le guide, le juge, le maître de cette Revue, vient de mourir.
«Toutes les tristesses de l'affection filiale s'aggravent de l'immense douleur de la perte subie. Il nous quitte quand nous avions le plus besoin de lui, de sa pure lumière, de sa vive flamme, de sa foi incorruptible et, en le voyant partir vers une demeure meilleure, permanente, nous ne trouvons à dire que la parole d'Elisée : «Père, Père, le char d'Israël et son guide !»
«Aujourd'hui, groupés et priants, nous lui faisons la promesse de ne pas oublier l'enseignement de sa vie et de son œuvre. Il est mort aux premières vêpres de saint Irénée, qui porte un nom de paix et combattit toute sa vie contre les hérésies et nous répétons dans nos cœurs avec toute l'Église : «Demeure ferme dans les choses que tu as ap-prises et qui t'ont été confiées».
Aussi bien, le lutteur intrépide que fut Mgr Jouin pourrait-il oublier ses frères d'armes ? Près de Dieu, avec une puis-sance accrue, ne doit-il pas redire la prière qu'il accentuait avec une singulière énergie à la fin de sa messe : que Satan et tous les esprits mauvais acharnés à la perte des âmes soient à jamais rejetés en enfer I
«Éternellement heureux, pouvons-nous dire avec saint Augustin, il se désaltère à loisir à la source de la Sagesse. Et pourtant, nous ne croyons pas qu'il s'enivre jusqu'à nous oublier, quand Vous, ô Seigneur, Vous qu'il boit, Vous conser-vez notre souvenir».
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Lettre de Dom Cabrol
Avant-propos
CHAPITRE PREMIER. DU BAPTÊME A L'ORDINATION. 1844-1868
M. ET MME MARIN JOUIN. - NAISSANCE ET BAPTEME D'ERNEST. - SES DEUX FRERES, AMEDEE ET HENRY. - LE REVE DE MME JOUIN. - LE VIEIL AN-GERS. - MORT DE M. JOUIN. - SOUVENIRS D'ENFANCE. - EVEIL MUSICAL. - PREMIER APPEL DE DIEU. - LE COLLEGE MONGAZON. - L'EXTERNAT SAINT-JULIEN. - LE COLLEGE DE COMBREE. - «JE SERAI DANS BOUILLET !». - PREMIERS ESSAIS LITTERAIRES. - L'OUBLI DE DIEU. - DANS LA CHAMBRE DU PERE PIOU. - LA CONVERSION. - «ENTRE JESUS ET MOI». - ERNEST FAIT VŒU DE CHASTETE ET D'OBEISSANCE. - SA CONSECRATION AU SACRE-CŒUR. - SON ENTREE AU COUVENT DES DOMINICAINS A FLAVIGNY. - LE FRERE MANNES. - IL Y RETROUVE SON FRERE AMEDEE. - LE NOVICIAT SIMPLE. - LE NOVICIAT PROFES A SAINT-MAXIMIN. - MME JOUIN ACCOMPAGNE SES FILS JUSQU'A LA SALETTE. - LA SANTE DU FRERE MANNES L'OBLIGE A RENONCER A LA VIE RELIGIEUSE. - SON ORDINATION A ANGERS.
CHAPITRE II LE PRÉCEPTEUR ET LE VICAIRE. 1868-1882.
AU CHATEAU DE LATHAN. - SA CORRESPONDANCE AVEC M. LAROCHE, SON DIRECTEUR. - CONSEILS SUR LE JEU DE CROQUET ET AUTRES JEUX. - CONSEILS LITTERAIRES ! ETRE SOI-MEME. - CONSEILS DE PIETE. - CRISE DE SANTE. - DECOURAGEMENT. - IL VOUDRAIT ARRIVER A L'ORAISON D'UNION. - IL REVE D'UN CHAMP D'ACTION PLUS VASTE. - PARIS L'ATTIRE. - SON DIRECTEUR L'EN DETOURNE : OPINION FAUSSE QUE SE FAIT M. LA-ROCHE DU CLERGE DE PARIS. - «DONNEZ-VOUS A L'ANJOU». - LE VICARIAT DE BREZE. - NOUVELLE CRISE DE DECOURAGEMENT : L'ABBE JOUIN VOU-DRAIT MOURIR. - SA VIE INUTILE. - IL EST NOMME VICAIRE A LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH D'ANGERS ET TROIS MOIS APRES A LA CATHEDRALE. - AVEC LES SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE UNE ŒUVRE DE JEUNESSE. SES DEUX PREMIERS ELEVES. - IL OBTIENT DE REJOINDRE A PARIS SA MERE ET SES DEUX FRERES. - UNE PROPHETIE DE MGR FREPPEL QUI NE S'EST PAS REALISEE. - L'ABBE JOUIN EST NOMME VICAIRE A SAINT-ETIENNE DU MONT A PARIS, ET, BIENTOT, CHAPELAIN DE SAINTE-GENEVIEVE. - IL TOMBE GRAVEMENT MALADE. - DANS LES PINS D'ARCACHON.
CHAPITRE III LE CURÉ DE JOINVILLE-LE-PONT. 1882-1886.
JOINVILLE-LE-PONT EN 1882 - LE BANQUET DU VENDREDI-SAINT. - UNE INSTALLATION QUI COMMENCE PAR LE MISERERE. - PREMIERE REN-CONTRE AVEC LA FRANC-MAÇONNERIE. - LES CONQUETES MERVEILLEUSES DES SERVANTES DES PAUVRES. - L'ORAGE ECLATE. - COMMENT ON «FAIT RENDRE GORGE A UN CURE AVANT LA LETTRE». - UN MINISTRE DES CULTES QUI SE DEJUGE A DEUX SEMAINES DE DISTANCE. - QUATRE PROCES ET CENT ARTICLES DE JOURNAUX EN DEUX ANS. - UNE SEANCE TRAGI-COMIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE. - ACQUITTE SUR TOUTE LA LIGNE. - LE CURE DE JOINVILLE EST NOMME SECOND VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. - COMMENT IL SE VENGE DE SES ENNEMIS.
CHAPITRE IV. SECOND ET PREMIER VICAIRE A SAINT-AUGUSTIN. 1886-1894.
«LE SAINT-SULPICE DE LA RIVE DROITE». - L'ABBE JOUIN N'A AUCUNE ŒUVRE A DIRIGER. - IL PRECHE AVEC SUCCES LE TRIDUUM DES MORTS. - LES REUNIONS DE FAMILLE CHEZ ME JOUIN. - LE R.P. JOUIN, PRIEUR DE CORBARA, L'INVITE A VISITER LA CORSE. - MORT DE M. L'ABBE TAILLANDIER. - SON SUCCESSEUR, CONFIE A L'ABBE JOUIN LE CATECHISME DES GARÇONS DE L'ECOLE LAÏQUE. - LES SUCCES QU'IL Y OBTIENT. - SA METHODE. - FONDATION DU PATRONAGE N.-D. DE LA BIENFAISANCE. - COMMENT L'ABBE JOUIN SAIT «AERER» LA JEUNESSE. - LA MORT DU R.P. JOUIN. - L'ABBE JOUIN CONSOLE SA MERE. - IL EST NOMME PREMIER VICAIRE. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES. - VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX PAYS SCANDINAVES. - LE «MYSTERE DE LA NATIVITE» - BEL ARTICLE DU MARQUIS DE SEGUR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CURE DE SAINT-MEDARD.
CHAPITRE V. LE CURÉ DE SAINT-MÉDARD. 1894-1898.
LE QUARTIER MOUFFETARD ET LA PAROISSE SAINT-MEDARD. LA REORGANISATION DES CATECHISMES ET LA FONDATION D'UN PATRONAGE POUR LES GARÇONS. - UNE BELLE CONQUETE DE L'ABBE JOUIN : L'ABBE BOSSARD. - LA REPRISE DES REPRESENTATIONS DE LA NATIVITE A CHAILLOT ET A L'ALCAZAR. - L'ABBE JOUIN EST NOMME CHANOINE HONORAIRE D'ANGERS. - FONDATION D'UN CATECHISME POUR LES PETITS ET DE LA DOCTRINE CHRETIENNE. - LE CULTE DIVIN A SAINT-MEDARD. - RAPPORTS AVEC LES ARTISTES ; NOMBREUSES CONVERSIONS. - LE REGISSEUR DE LA SCENE DE L'OPERA FAIT SA PREMIERE COMMUNION A 72 ANS. - L'ORATORIO DE N.-D. DE LOURDES. - L'ABBE JOUIN FONDE UNE SECONDE MAISON DE SER-VANTES DES PAUVRES. - ON L'APPELLE LUI-MEME LE PERE DES PAUVRES. - SON DEVOUEMENT ET SA CHARITE POUR LES MALADES. - DEUX EVEQUES VEULENT FAIRE ELEVER L'ABBE JOUIN A L'EPISCOPAT. - IL EST NOMME CURE DE SAINT-AUGUSTIN. - IL QUITTE SAINT-MEDARD EN BEAUTE.
CHAPITRE VI. LE CURÉ DE SAINT-AUGUSTIN. 1899-1932.
LA TACHE IMMENSE DU CURE DE SAINT-AUGUSTIN.
L'HOMME D'ETUDE : CHAQUE DIMANCHE LA MESSE DU JOUR EXPLIQUEE EST DISTRIBUEE AUX PAROISSIENS. FONDATION DE LA REVUE : LE CA-TECHISME. - IL ENTREPREND UN TRAVAIL COLOSSAL SUR LES EVANGILES. - LE THEATRE CHRETIEN : LE MYSTERE DE LA PASSION», «LE MYSTERE DE JEANNE D'ARC», CLOTILDE, BERNADETTE. - AUTRES ECRITS DE L'ABBE JOUIN : DISCOURS D'INSTALLATIONS ; DISCOURS SUR LA MUSIQUE ET SUR LES MUSICIENS. - POLEMIQUE AVEC M. CAMILLE BELLAÏGNE A PROPOS DE LA MUSIQUE SACREE.
L'HOMME D'ACTION : LES INVENTAIRES A SAINT-AUGUSTIN. L'ABBE JOUIN INVITE SES PAROISSIENS A UNE MESSE DE «DEUIL ARME». IL EST TRA-DUIT EN POLICE CORRECTIONNELLE ET CONDAMNE A 16 FRANCS D'AMENDE. - SA FIERE DECLARATION DEVANT SES JUGES.
L'HOMME DE CŒUR : FONDATION D'UNE TROISIEME MAISON DE SERVANTES DES PAUVRES. - IL FONDE L'HOPITAL 139.
SES EPREUVES : IL PERD SA MERE ET SON FRERE HENRY JOUIN. - LA «PASSION» AU NOUVEAU THEATRE. - EPREUVES PATRIOTIQUES. - LA MOBILI-SATION DE LA PRIERE.
CHAPITRE VII. LA LUTTE ANTI-MAÇONNIQUE. 1912-1932.
UNE VISITE DE M. JEAN BIDEGAIN. FONDATION DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - PROJET DE FEDERATION DES LIGUES ANTI-MAÇONNIQUES. - DERRIERE LA FRANC-MAÇONNERIE M. JOUIN DECOUVRE L'ACTION PROTESTANTE ET JUIVE. - LE QUATRO CENTENAIRE DU PRO-TESTANTISME ET LE BICENTENAIRE DE LA FRANC-MAÇONNERIE. - LA JUDEO-MAÇONNERIE «CONTRE-EGLISE, CONTRE-ETAT, ET CONTRE-MORALE». - MGR. JOUIN ET LA PATRIE. - L'ACTION SATANIQUE DANS LES LOGES. - L'OCCULTISME. - UNE ODIEUSE CAMPAGNE DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE MGR JOUIN APRES SA MORT. - REPONSE VICTORIEUSE DE LA REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES SECRETES. - LA VRAIE FIGURE DE MGR JOUIN : IL ETAIT UN MYSTIQUE.
CHAPITRE VIII. LES DERNIÈRES ANNÉES.
CE QUE MGR JOUIN AVAIT ECRIT SUR SON AGENDA, LE 1ER JANVIER 1914. - SON ACTIVITE INTELLECTUELLE DANS LES DERNIERES ANNEES. IL PRONONCE D'IMPORTANTS DISCOURS. - IL CELEBRE SES NOCES D'OR, SES NOCES D'ARGENT PASTORALES ET SES NOCES DE DIAMANT. - IL REPOND AUX TOASTS DE SES AMIS. - BENOIT XV L’ELEVE A LA PRELATURE ET PIE XI LE FAIT PROTONOTAIRE APOSTOLIQUE. - MGR RUMEAU LE NOMME CHA-NOINE D'HONNEUR D'ANGERS. - QUALITES ET VERTUS DE MGR JOUIN SUR LA FIN DE SA VIE : L'HOMME, LE PRETRE, LE MOINE. - IL POUSSE LA CHARITE ET L'AMOUR DES ENNEMIS JUSQU'A L'HEROÏSME.
CHAPITRE IX. LES DERNIERS JOURS.
LA MORT FRAPPE AUTOUR DE MGR JOUIN : M. DOMINIQUE DELAHAYE ; M. BOUHIER, SON NEVEU ; MLLE AMIEL. - PROJET DE DEPART POUR LE CAN-NET. - IL TOMBE MALADE. - IL DEMANDE L'EXTREME-ONCTION. - SA PATIENCE. - «C'EST ETRANGE, JE NE PEUX PAS MOURIR !» - SON DERNIER MOT EST UNE PAROLE DE BONTE. - LE SALVE REGINA. - SA DERNIERE COMMUNION. - LES VISITES DE MGR CREPIN ET DE MGR ODELIN. - LA BENEDICTION DU SAINT PERE. - SA DERNIERE JOIE. - LA MORT : 27 JUIN 1932. - LES FUNERAILLES.
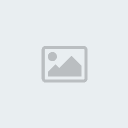
Her- Messages : 9481
Date d'inscription : 01/05/2009
Localisation : France
 Sujets similaires
Sujets similaires» Totalitarisme Franc-maçon - Le Scandale de "l'Affaire des Fiches"
» Totalitarisme Franc-maçon - Révolution Française : Le Génocide de la Vendée
» Totalitarisme Franc-maçon - Révolution Française : Le Génocide du Clergé
» Totalitarisme Franc-maçon - Actualités des Loges, des Ateliers et des Fraternelles
» Totalitarisme Franc-maçon - La Révolution Française : Un Coup d'Etat Maçonnique !
» Totalitarisme Franc-maçon - Révolution Française : Le Génocide de la Vendée
» Totalitarisme Franc-maçon - Révolution Française : Le Génocide du Clergé
» Totalitarisme Franc-maçon - Actualités des Loges, des Ateliers et des Fraternelles
» Totalitarisme Franc-maçon - La Révolution Française : Un Coup d'Etat Maçonnique !
Le GRAND PAPE, le GRAND MONARQUE et HENRI V de la CROIX, le NOUVEAU ROI de FRANCE :: DICTATURE DU RELATIVISME
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum